"Wastburg", de Cédric Ferrand
FERRAND (Cédric), Wastburg, Paris, Gallimard, Folio Science-fiction, [2011] 2013, 403 p.
J’en suis le premier surpris, mais je n’avais toujours pas lu Wastburg, le premier roman de Cédric Ferrand (auteur de jeux de rôle par ailleurs ; Wastburg a d’ailleurs été adapté depuis chez les XII Singes, et ce jeu a plutôt bonne réputation pour ce que j’en sais). Pourtant, à sa sortie aux Moutons électriques, le livre avait pas mal fait parler de lui, et on l’avait inévitablement, Moutons et jeux de rôle obligent, comparé aux excellentes productions de l’excellent Jean-Philippe Jaworski. J’en avais entendu dire vraiment beaucoup de bien (j’avais originellement envie de dire « que du bien », car c’était tout ce dont je me souvenais, mais, en fouinant un peu dans les réactions forumesques d’alors, je me suis rendu compte qu’il y avait en fait eu pas mal d’avis plus critiques, voire franchement négatifs, pour contrebalancer l’éloge dominant – même si tout le monde semblait s’accorder sur le fait que c’était en tout cas un auteur à suivre), mais, pour une raison ou une autre, que je serais bien en peine d’expliquer, je n’avais pas fait l’acquisition du livre en grand format. Et même si je me l’étais procuré à sa sortie en poche, je n’avais toujours pas trouvé l’occasion de le glisser dans mon programme de lecture scientifiquement établi (avec ses obligations bizarres que je m’impose tout seul) ; en fait, je n’ai enfin entamé ce livre l’autre jour que par hasard, dans un sens : cela n’arrive normalement jamais, mais je m’étais retrouvé dans la situation où je n’avais peu ou prou rien d’autre à lire… Et comme il était bien temps (le deuxième roman de l’auteur, Sovok, basé sur un jeu de rôle, vient de paraître aux Moutons électriques… mais là j’ai eu essentiellement des retours négatifs, ou du moins déçus), ben, hop, hein.
Wastburg est un roman de fantasy. Mais pas de la fantasy comme on l’entend le plus souvent (et sans doute trop souvent) ; la couleur est annoncée par une diatribe anti-Tolkien en exergue, signée China Miéville, auteur que j’aime beaucoup par ailleurs, mais qui a quand même un peu forcé le trait pour le coup. Un peu. Aheum. Bon, c’est de la provoc à l’état pur, hein… Mais je dois dire que ce « programme d’intentions » pas forcément très pertinent en tête de Wastburg m’a fait un peu peur pour la suite ; ça me paraissait bien arrogant, tout de même… même si je ne suis pas le dernier à déboulonner les vieilles idoles, je serais donc gonflé de m'en offusquer plus que de raison. Cela dit, effectivement, la fantasy du premier roman de Cédric Ferrand n’a à peu près rien à voir avec Tolkien. Plutôt réaliste, tout sauf épique, très sombre, à cadre urbain… Non, on peut sans doute chercher des références – cela reste assez connoté –, mais ailleurs ; la quatrième de couverture évoque les francophones Jean-Philippe Jaworski (donc) et Laurent Kloetzer, mais on peut penser à bien d’autres choses : le cadre urbain, ainsi, a probablement quelque chose de la Lankhmar de Fritz Leiber (je le suppose, du moins, n’ayant toujours pas lu le classique « Cycle des épées », mais je compte me rattraper prochainement), et, s’il n’a pas l’épaisseur baroque de la Nouvelle-Crobuzon de China Miéville, donc, il y a peut-être un peu de ça aussi ; mais inévitablement, et d’autant plus que le roman de Cédric Ferrand se focalise sur les gardes de la ville de Wastburg, cosmopolite, dominée par la tour des majeers, toujours bien droite malgré la Déglingue, et dans l’ombre par un machiavélique burgmaester qui n’a pas grand-chose à envier au Patricien Vétérini, ben j’ai forcément pensé à l’Ankh-Morpork des « Annales du Disque-Monde » de Terry Pratchett, et bien sûr en premier lieu au « cycle intérieur » consacré au Guet…
Cela dit, l’ambiance n’est pas franchement à la rigolade ici (même si l’humour noir est bien au rendez-vous, ainsi que la farce), et les gardoches de Cédric Ferrand, s’ils ont le côté populo crasseux d’un Colon ou d’un Chicard, n’ont certes pas à leur tête un incorruptible Vimaire – et c’est tant mieux. Non : les gardes de Wastburg, des clampins qui arpentent les rues de la cité aux échevins qui sont censés les commander au nom du burgmaester invisible et des maesters autrement plus concrets, avec des prévôts en guise d’intermédiaires, sont généralement pourris jusqu’à la moelle. Tout, ici, est corruption, abus de pouvoir, ce genre de choses réjouissantes. Même les plus sympathiques de ces gardes – et ils sont pour la plupart assez sympathiques dans leur bassesse, à vrai dire – ont un gros problème qui ne les rend pas forcément toujours très aptes à exercer leur fonction et à incarner la loi (en témoigne ce prévôt alcoolique aux absences inquiétantes, que j’ai beaucoup aimé).
Mais, pour être centraux à leur manière, les gardoches sont aussi éphémères. Cédric Ferrand use en effet d’un procédé – c’est le mot, avec ce qu’il comporte d’artifice – pour narrer son histoire, consistant à changer de personnages points de vue à chaque chapitre ; lesdits personnages sont le plus souvent des gardes, à tous les niveaux de l’échelle, et aux occupations parfois très spécialisées, mais ce n’est pas systématique ; par ailleurs, même si certains reviennent de temps à autre donner du liant au roman, nombreux parmi eux sont ceux dont le sort s’avère rapidement fâcheux (pas nécessairement fatal, mais cela arrive quand même à plusieurs reprises)… On s’y attache (malgré tout) le temps d’un chapitre, et on passe à autre chose (en apparence tout du moins). J’étais au départ assez sceptique devant ce procédé, mais, en définitive, j’ai été plutôt convaincu de sa pertinence ; car Cédric Ferrand gère assez bien cette dimension artificielle, et c’est là en fin de compte un très bel outil d’immersion, permettant de se plonger avec une humanité toujours de mise dans l’atmosphère poisseuse de la ville de Wastburg – et, étonnamment, de raconter malgré tout une histoire, les divers fils narratifs se rejoignant dans une complexe toile d’araignée (fabriquée, donc, mais belle à sa manière…).
Mais c’est bien la ville le personnage principal du roman, celle qui est toujours là, pas avare de promesses, mais dans un sens jamais décevante dans ses crapuleries et mesquineries. Wastburg est un entre-deux, coincée qu’elle est à l’embouchure du fleuve marquant la frontière entre le Waelmstat et la Loritanie. Elle a acquis sa souveraineté sur son île, mais les Waelmiens et Loritaniens qui s’y installent, quand bien même ils ont contribué à faire de l’apatride Wastburg une ville unique au croisement des mondes, restent, au fond, culturellement sinon politiquement, des Waelmiens et des Loritaniens. Ce qui ne va pas sans poser problème… surtout dans la mesure où, concrètement, ce sont les Waelmiens qui dominent la cité, les Loritaniens ghettoïsés étant relégués à un désolant statut de citoyens de seconde zone. La xénophobie crasse des Waelmiens est un thème récurrent du roman ; ceux-ci ne peuvent envisager leurs voisins, leurs concitoyens pourtant, que comme des gens fondamentalement bizarres, avec leur langue incompréhensible, leurs coutumes absurdes, leur hygiène nécessairement douteuse, leur moralité forcément questionnable, ce genre de choses ; heureusement qu’on est dans un monde imaginaire, hein…
Wastburg, en dépit de quelques envolées dans les sphères supérieures, on l’appréhende surtout par la rue, encombrée d’ordures et suintant la misère, qu’arpentent les gardoches aussi fiers que pourris, côtoyant dans leurs rondes, entre deux verres gracieusement offerts par les patrons de tavernes, les petits mendiants et les putes, les commerçants bas-de-gamme et leurs clients fauchés, les criminels aussi forcément, entre deux séjours à la Purge. D’où ce style gouailleur, argotique, qui en temps normal me sort par les yeux ; ici, pourtant, ça passe plutôt bien, car j’y ai trouvé une certaine saveur authentique qui fait souvent défaut aux bouquins jouant cette carte (mais c’est un avis très personnel, par nature contestable ; j’ai lu plusieurs avis assez critiques sur cet aspect du roman…). Le style de Cédric Ferrand est à vrai dire assez plaisant à mes yeux : on sent qu’il y a du travail formel, ne négligeant pas pour autant une fluidité de tous les instants ; ça coule tout seul, probablement bien mieux que le fleuve entourant Wastburg (qui n’est donc pas l’Ankh, mais quand même). Ce n’est certainement pas irréprochable, cela dit : il y a de temps à autre des ruptures de registre assez fâcheuses, ou l’utilisation d’un lexique probablement trop « moderne » parfois, qui fait un peu tache… Des erreurs de débutant ? C’est quand même nettement au-dessus du lot, et bien plus intéressant que la fantasy « utilitaire » dont on nous abreuve trop souvent ; mais, contrairement à ce que laisse entendre la couverture, non, ce n’est pas du Laurent Kloetzer ou du Jean-Philippe Jaworski, quand même pas ; pas encore, peut-être ? On verra bien…
Wastburg n’est donc pas sans défauts ; le premier roman de Cédric Ferrand, en usant de tant d’artifices, dans la construction ou le style, et en dépit d’une grande habileté à mes yeux dans leur maniement, a parfois quelque chose d’un peu trop « fabriqué », peut-être… surtout dans la mesure où tout cela est passablement voyant. Mais, au final, ces artifices, je les ai plutôt goûtés et trouvé pertinents ; et ces interrogations d’après lecture ne sauraient dissimuler l’essentiel : j’ai passé un excellent moment en compagnie des gardoches de Wastburg. Je n’en ferais pas un chef-d’œuvre, mais un très bon roman sans aucun doute, bien au-dessus du lot ; car un divertissement, et sans doute un peu plus que ça, efficace et ambitieux à la fois. La marque, à certains égards, de la meilleure fantasy, non ?

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





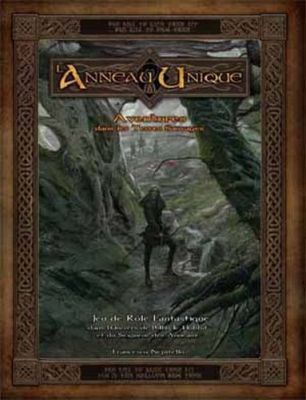
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)