Certaines n'avaient jamais vu la mer, de Julie Otsuka
OTSUKA (Julie), Certaines n’avaient jamais vu la mer, [The Buddha in the Attic], traduit de l’anglais (États-Unis) par Carine Chichereau, Paris, Libella – Phébus – 10/18, [2011-2013] 2017, 143 p.
JAPONAISE(S)-AMÉRICAINE(S)
Je vais causer aujourd’hui d’un court roman qui a rencontré, assez récemment, un beau succès critique et commercial, aux États-Unis puis en France (où il a notamment remporté le prix Fémina étranger en 2012) – un roman par ailleurs assez singulier sur le plan formel, et qui, disons-le d’emblée, vaut bien, bien mieux que ce que cette couverture et ce titre français (qui sonne beaucoup trop à mes yeux comme une parodie…) pourraient laisser croire.
Julie Otsuka est une autrice américaine d’origine japonaise, née d’une mère nisei et d’un père issei. Diplômée en art, elle s’est intéressée au sort des immigrants japonais aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle, inspirée tout d’abord par les récits de ses propres grand-parents maternels, et a ainsi traité, dans son premier roman, Quand l’empereur était un dieu, d’une page sombre et longtemps tabou de l’histoire américaine contemporaine (mais que certaines trumperies récentes rappellent à notre mauvais souvenir…) : la déportation et l’internement des immigrants japonais et des citoyens américains d’origine japonaise après l’assaut sur Pearl Harbor ; des dizaines de milliers de personnes avaient ainsi été privées de leurs droits les plus élémentaires du jour au lendemain, au motif à peu près systématiquement incongru qu’ils pourraient être des « espions », des « saboteurs », membres de la « cinquième colonne », voire commandos avancés disposant de caches d’armes, etc. Les grands-parents maternels de l’autrice étaient du lot.
Quand l’empereur était un dieu a remporté un beau succès à tous points de vue, et je l’ai noté précieusement sur mes tablettes, mais le deuxième roman de Julie Otsuka, Certaines n’avaient jamais vu la mer (on préférera largement, ou en tout cas je préférerai largement, le titre original, bien différent : The Buddha in the Attic), bien davantage encore. Les deux romans sont thématiquement liés, d’une certaine manière, puisque celui-ci s’arrête peu ou prou là où Quand l’empereur était un dieu commençait, avec la déportation dans les camps d’internement. Certaines n’avaient jamais vu la mer débute, de manière approximative, entre 1900 et 1920, à vue de nez, et narre ainsi ce qui s’est produit avant les événements décrits par l’autrice dans son premier roman – une préquelle, hein !
PICTURE BRIDES
En l’occurrence, il s’agit du destin de celles que l’on appelle les picture brides – des femmes d’origine japonaise (origine entendue largement – car cela concerne aussi des Coréennes, en cette époque de colonisation) qui traversaient l’océan Pacifique pour épouser un Japonais qui avait émigré aux États-Unis, et dont elles ne connaissaient qu’une photographie – et encore…
Car ces femmes étaient les victimes d’une terrible escroquerie. Bien souvent, la photographie ne correspondait pas à l’homme qu’elles allaient ainsi épouser – ou bien, ce qui revient au même, elle datait de vingt ans plus tôt. Et les lettres de ces hommes étaient tout aussi mensongères : tel qui se présentait comme un cadre dans une puissante banque américaine s’avérait en fait un travailleur de la terre comme tous les autres – en Californie, les immigrants japonais peinaient souvent dans les champs et les vergers, la récolte des fruits étant pour eux une activité essentielle.
Sacrée déception pour nos candides voyageuses, pleines d’espoirs vites déçus – au plus tard dès la nuit de noces, en descendant du bateau : un vrai cauchemar, bien trop souvent. Et la suite ne s’annonçait pas sous un meilleur jour : il fallait faire des enfants, les élever, et aussi travailler – dans les cultures comme leurs maris, auxquels elles avaient bien dû se résigner (il ne s’agissait pas de les aimer), ou ailleurs, par exemple en tant que domestiques pour telle riche Américaine, blanche, admirée, haïe, redoutée, jalousée.
L’histoire des picture brides est parfaitement connue de la communauté des Américains d’origine japonaise – pour ainsi dire, un très grand nombre d’entre eux en comptent dans leurs ancêtres. Mais les autres Américains n’en savaient pas forcément grand-chose : Julie Otsuka, avec Certaines n’avaient jamais vu la mer, poursuivait donc l’entreprise « éducative », je suppose que l’on peut employer ce terme, qui était déjà celle de Quand l’empereur était un dieu.
NOUS
Ce point de départ, à la condition de savoir gérer le pathos, pas le moindre risque dans un récit aussi désolant et même révoltant, peut assurément donner lieu à un bon roman. Ce qui fait de Certaines n’avaient jamais vu la mer un très bon roman, c’est la manière bien particulière qu’a Julie Otsuka de narrer son histoire.
En effet, Certaines n’avaient jamais vu la mer est un roman sans héroïne – à moins qu’il ne soit plus juste de dire qu’il en compte des centaines. Contre la troisième personne du singulier, distante, contre aussi la première personne du singulier, limitant l’expérience dans une casuistique trop restreinte, l’autrice a fait le pari pas banal de la première personne du pluriel. Tout au long du roman (mais avec une nuance sur laquelle je reviendrai en temps utile), c’est ce « nous » qui s’exprime – comme un bloc rassemblant toutes les expériences, et affichant l’idée d’une destinée collective, globale, jusque dans les plus personnelles, les plus intimes des anecdotes, dont le sens varie justement en raison de ce choix du pluriel et donc du collectif. Nous, nous, nous… Ce « nous » est longtemps anonyme, mais il ne le demeure pas éternellement – il garde pourtant sa nature englobante à mesure que les noms de ces femmes surgissent çà et là, beaucoup pour ne plus jamais revenir, certains pour se manifester épisodiquement, à des dizaines de pages de distance. Le lecteur est ainsi prisonnier d’une masse envahissante de témoignages – et c’est probablement le meilleur moyen de lui faire vivre cette destinée en l’intégrant au plus profond de lui-même ; ce que le magistral premier chapitre démontre très vite. « Il » ou « je » n’auraient pas eu cet impact : seul « nous » parvient à véritablement coller le lecteur au fond d’une cale, saturée d’espoirs et d’angoisses, d’odeurs aussi, tandis que le bateau, bien trop lentement, traverse l’océan pour convoyer ses têtes de bétail dans le prétendu pays de la liberté, en vue de lendemains qui ne cesseront de déchanter.
La dimension historique du roman renforce encore l’effet, en jouant de la carte documentaire. Ce « nous » incarne des centaines, des milliers de photographies aux teintes sépia – portraits de femmes dont l’identité se perd dans les méandres d’un drame commun, le regard figé face à l’objectif (si l’on ose dire). Le lecteur croule sous les archives, procédé par essence étouffant, mais moins froid qu’il n’y paraît – car chacune de ces photographies prend vie, au détour d’une ligne ; et il ne s’agit pas d’un simulacre de vie, mais bien de l’expression poignante de ce que, dans ce destin collectif, chaque trajectoire individuelle relevait d’une authentique femme, singulière, esprit et chair ; quelqu’un qui avait vraiment vécu. Autant dire que, en dépit de la sensation de noyade, rien ne saurait être moins froid que ce « nous » faussement anonyme : la destinée collective ne relève pas que des seules statistiques, ainsi que nous le rappelle utilement Julie Otsuka de la sorte.
Il y a peut-être autre chose, pourtant – qui relève presque du fantastique. Car ces voix qui scandent le récit de leurs misères, même sans faire montre d’une agressivité particulière (laquelle est en fait des plus rare), ont parfois quelques choses d’une accusation. Et ces murmures comme ces cris, qui hantent nos têtes à chaque ligne, endossent parfois des atours de fantômes, d’esprits qui ne reposent pas en paix – à moins qu’il ne s’agisse, de manière très japonaise, de ces ancêtres qui devraient être divinisés ?
LIVING IN AMERICA
Mais nous n’en sommes pas (encore) à la mort, dans le roman. Ce qui précède est bien plus terrible : la vie.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, ici – ça ne serait guère approprié, absurde même à vrai dire. Mais l’approche de Julie Otsuka joue justement de l’abondance des détails. La confrontation très particulière des expériences qu’autorise l’emploi de la première personne du pluriel produit – dès le premier chapitre – un effet d’accumulation parfaitement redoutable, et même effrayant.
Il s’agit bel et bien d’assommer, de noyer le lecteur sous la multiplicité des destinées tragiques. Pourtant, ce n’est pas vraiment de pathos qu’il s’agit – et, au détour d’un paragraphe, on peut même saisir, parfois, un fugace trait de lumière… Dans l’ensemble cependant, la litanie des noms et des drames produit un effet des plus déprimant, presque au point de l’insupportable.
Et c’est bien d’une litanie qu’il s’agit, avec sa scansion particulière, évocatrice de quelque poème épique comme il s’en trouve au départ de toutes les mythologies. Un chœur de fantômes, du coup, en rien hostile, et qui pourtant nous affecte de par sa seule présence, quasi muette – car c’est comme si la retranscription de ces vies passait… eh bien, par un médium.
Le plus prosaïque se retrouve ainsi sublimé, d’une certaine manière – même essentiellement sur un mode dépressif, où la lutte pour la vie est perdue d’avance, où l’on ne s’accroche que par (mauvaise) habitude.
La famille et ses atrocités, au mieux ses trahisons – les maris qui ne se contentent pas de ne pas être ceux qu’ils prétendaient, mais qui s’avèrent en outre insupportablement absents, ou volages (la jalousie n’a pas besoin de l’amour) ; les enfants non désirés, et pourtant ; la ronde des morts précoces, et plus ou moins regrettées.
Le travail et ses cruautés inhumaines – les conditions terribles, la paye misérable, l’oppression des employeurs, celle des petits chefs ; le mari qui se tue à la tâche pour rien ; la femme de même, et au lendemain de son accouchement, pas le choix ; le mépris des autres.
Les Américains, leur richesse, leur dédain – les dames et leur condescendance ; leurs cruels rituels, sous couvert d’innocentes manies ; les compliments vécus comme des insultes, car c’est ce qu’ils sont tout au fond.
La guerre, la suspicion – la haine, ou peut-être pire encore : l’indifférence ?
LA DISPARITION
Car nous en arrivons au point où Certaines n’avaient jamais vu la mer fait la jonction avec Quand l’empereur était un dieu. Ici, le fait de ne pas avoir (encore) lu ce précédent roman est peut-être un handicap, au plan de l'analyse du moins…
Reste que c’est un passage particulièrement saisissant du présent roman. Il l’est peut-être d’autant plus qu’il semble presque, parfois, prendre ironiquement le contrepied des chapitres précédents ? Ou non, pas exactement, c’est plus subtil que ça… Plus cruel, aussi.
L’idée, c’est que ces immigrants japonais, et plus particulièrement ces immigrantes japonaises, en dépit de toutes les avanies subies depuis leur arrivée à San Francisco, en étaient pourtant venus, très légitimement, à considérer ce pays comme le leur – peut-être même à l’aimer, si c’était dans la douleur. Le « nous », ici, est d’une force toute particulière. Quand les Japonais lancent leurs Zéros sur Pearl Harbor, ils sont « eux », ils sont « l’ennemi ». « Nous », « notre pays », désigne les Américains, les États-Unis. Pour ces immigrants, cela relève de l’évidence – ça ne prête même pas à débat.
Mais les Américains autour d’eux – les vrais Américains, les Blancs donc – sont d’un tout autre avis. Le « péril jaune », très prégnant dans les mentalités, offre une grille de lecture sans nuance, ce qui est toujours bien pratique. Et les immigrants en font une fois de plus l’expérience, mais de la plus cruelle des manières : on ne leur reconnaît pas le statut d’Américains. Ils ont tout fait pour ce statut – ils ont travaillé dur, ils ont subi sans geindre… Ils ont tout fait. Mais vingt, trente, quarante années passées sur le territoire des États-Unis n’y changent rien : essentiellement autres, et à jamais, et quoi qu’ils fassent, ils sont naturellement suspects.
Eux-mêmes ne savent que penser des récits sur la « cinquième colonne ». Peut-être celui-ci était-il vraiment un espion ? On dit après tout qu’il avait une cache d’armes, et le Hinomaru au-dessus de son lit… Il doit être un « ennemi ». Mais pas nous ! Qu'importe la législation, nous, nous vivons en Amérique, nous sommes américains !
Le gouvernement ne s’embarrassera pas du fardeau d’un tri préalable. « Japonais » signifie « suspect ». Les immigrants japonais doivent bien l’admettre – et, bientôt, ils s’y résignent ; sans protestations, sans colère – cela ne servirait de toute façon à rien. Ils préparent leurs affaires pour le jour de la déportation, qui viendra forcément – les chaussures, bien cirées, attendent au pied du lit ; la valise est faite ; les dettes sont réglées ; on confie le chien aux voisins… Et on attend.
Le jour arrive – on part.
En silence.
Les Japonais de la côte Ouest des États-Unis ont disparu, sans un bruit.
NOUS AUTRES
Et c’est alors qu’opère un ultime retournement, terrible et génial. Dans le dernier chapitre, le « nous » demeure… mais il ne désigne plus du tout les mêmes personnes : cette fois, dans une très révélatrice dialectique entre « nous » et « eux », qui se plie commodément aux desiderata de ceux qui y tiennent le plus, « nous » désigne les autres, soit les Américains – ceux qui ne sont pas d’origine japonaise, mais constatent, au petit matin, que leurs voisins immigrants ne sont plus là, qu’ils ont disparu.
Un chapitre finalement pas moins douloureux que les précédents, et pourtant tout autre – et plus ambigu ? Les fermiers qui attendent en vain leurs ouvriers agricoles, ces dames qui n’ont plus leur petite domestique, s’étonnent de cette disparition. Ils vont jusqu’à prétendre, d’une certaine manière, qu’ils n’étaient pas au courant. Certes, ils avaient bien vu leurs concitoyens (…) d’origine japonaise se rassembler autour de telle ou telle affiche, mais ils ne l’ont pas lue, et, de toute façon, elle était en tout petits caractères, alors…
Finalement, ce « nous » est plus lâche qu’haineux. Même en pareilles circonstances, il a du mal à accepter que figurent en son sein de ces hommes en colère et ignorants, qui soupçonnent, non, qui sont parfaitement sûrs et certains, que tel bonhomme, Kato, Sato, allez savoir comment il s’appelle au juste, était une menace pour les États-Unis. La plupart sont sceptiques à ce propos – ils ont vécu si longtemps à côté de ces immigrants ! Les prendre pour des espions, dès lors… Cette femme toute frêle et prématurément vieillie, ce garçonnet de cinq ans à peine…
Mais, par choix ou par indolence, ils ont fait l’autruche. Une fois la disparition constatée, certains éprouvent sans doute le besoin de chercher des responsables – mais avec la conviction que c’est ailleurs qu’on les trouvera. Les locaux appréciaient ces immigrants, après tout – si on les a fait partir, c’est la faute du gouvernement ! Qui ne les a même pas consultés… C’est fâcheux – surtout parce que cela pénalise l’économie locale : qui va ramasser les fruits, maintenant ?
Mais s’il y a, dans le roman de Julie Otsuka, en définitive, quelque chose d’un acte d’accusation, c’est sur le ton las, monotone, de la douloureuse litanie entonnée par les femmes japonaises depuis le jour fatidique où elles sont montées à bord d’un bateau supposé les conduire dans une utopie de liberté, de fortune et de respect. Elle ressort avant toute chose de ce constat de la mesquinerie généralisée – comportement si commun qu’il mérite effectivement l’emploi de la première personne du pluriel, étendue au genre humain : nous sommes des lâches, nous ignorons ce que nous ne voulons pas voir, nous ne faisons rien quand il faudrait faire quelque chose – et en définitive nous sommes seuls face à notre insuffisance.
Un bien triste tableau ? Sans doute – mais peut-être pas autant qu’on le croirait ? Car ce « nous » des Américains, en dernière mesure, croit, non sans perplexité, percevoir quelque chose qui, peut-être, un jour, changera enfin la donne ? Et c’est que les enfants sont bien plus affectés par la disparition de leurs petits camarades d’origine japonaise, que les parents par la disparition de ceux qui n’étaient jamais que leurs employés corvéables à merci…
Un fugace trait de lumière, à nouveau, en dernier recours ? Pas dit – a fortiori dans l’Amérique de Donald Trump… Quand est paru le roman, en 2011, peut-être a-t-il fait preuve d’un peu trop d’optimisme, finalement ! Et c’est un roman pourtant guère riant…
ROMAN, ESSAI, POÈME
Un roman ? En fait, on peut se poser la question – un peu naïvement, j’imagine. Ce parti-pris d’un récit sans le moindre personnage sur lequel se fixer, que l’on puisse accompagner au fil d’une narration suivie, distingue Certaines n’avaient jamais vu la mer des canons du roman. Alors quoi ? Le besoin de catégoriser est sans doute toujours un peu vain… mais pas moins tentant.
L’abondance des sources consultées (dont une partie seulement est citée en fin d’ouvrage, au-delà des témoignages de vive voix), cette sensation permanente de baigner dans les archives, photographies, lettres, journaux intimes… On pourrait avancer que Certaines n’avaient jamais vu la mer, sans être forcément un essai à proprement parler, fait tout de même un peu plus que loucher sur ce registre. Mais l’émotion est en permanence de la partie, ce qui s’accorde mal avec l’analyse académique… Cependant, quiconque, pour une raison ou pour une autre, a fouiné, ne serait-ce qu’un tout petit peu, dans des collections d’archives, sait que le sentiment peut pointer là où on l’attend le moins, et que ces papiers jaunis, fripés, poussiéreux, conservent parfois dans leur encre à demi effacée toute l’âme de celui qui a écrit – comme s’il avait ainsi transmis de sa substance à un dérisoire bout de papier « privé », sans même en avoir conscience, sans jamais s'imaginer que, des dizaines d'années plus tard, quelqu'un pourrait le lire…
Mais une autre approche est tentante : celle du poème – j’avais avancé « épique » tout à l’heure, en parlant de mythologie… Je raconte peut-être n’importe quoi, mais j’ai quand même ce sentiment. Cela dit, sans nécessairement avoir à aller jusque-là, la forme même de Certaines n’avaient jamais vu la mer incite à envisager cette dimension poétique. La litanie des noms et des douleurs, la scansion du « nous », y contribuent pour une part énorme, mais d’autres procédés en participent. Ainsi, dans le superbe et terrible premier chapitre, la quasi-totalité des paragraphes, à quatre exceptions près, commencent par les mêmes mots : « Sur le bateau… » L’ensemble constitue comme une incantation, et la répétition, procédé si essentiel, tourne même au mantra. Parfois, il s’en dégage, jusque dans le tableau des pires souffrances, comme une harmonie lasse – pas moins fascinante ; mais d’autres chapitres, notamment ceux qui consistent en un seul paragraphe de bout en bout, jouent davantage la carte du chaos, incontrôlable, incontrôlé, pour un effet... étrangement similaire. Oui, il ne serait pas abusif de présenter Certaines n’avaient jamais vu la mer comme un long poème, plutôt que comme un court roman…
IMPRESSIONNANT
L’ensemble constitue un texte très fort, très impressionnant – juste et d’autant plus terrible, plus inventif aussi qu’on ne le croirait à s’en tenir, eh bien… à cette couverture kitschouille au possible, qui abuse comme qui dirait du rose, et à ce titre français qui m’évoque le pire de la rentrée littéraire jetable.
(Note : oui, il s’agit bien d’un fragment tiré de la toute première page du roman – mais son impact est alors tout autre.)
The Buddha in the Attic, donc, vaut bien, bien mieux que tout ça. C’est un texte très fort, qui ne prend pas exactement le lecteur par la main, mais ne l’éveille que mieux, au travers du récit d'un fait historique un peu oublié, occasion toujours utile de se rappeler que l’indifférence, parfois, est criminelle.
Une belle réussite, et il faudra que je prolonge l’expérience avec Quand l’empereur était un dieu.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)

















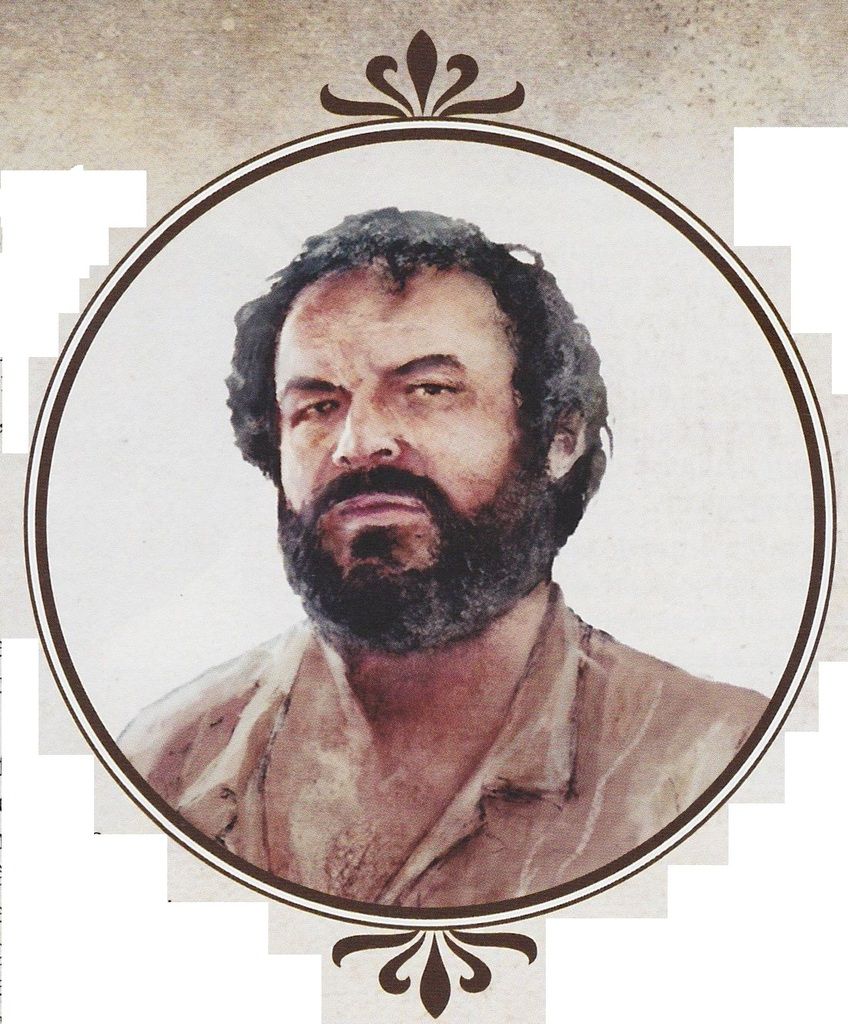











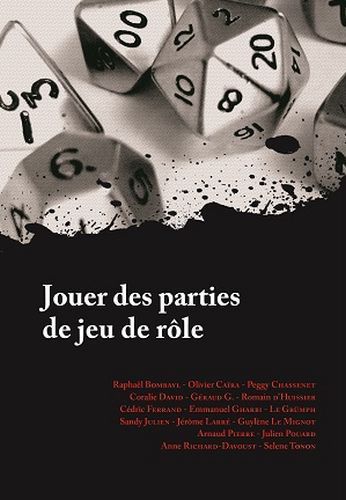


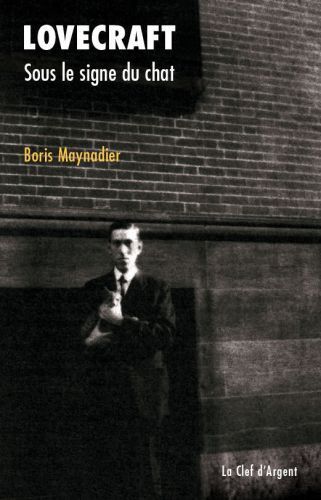



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)