Hana-bi, de Takeshi Kitano
Réalisateur : Takeshi Kitano
Titres alternatifs : Hana-bi – Feux d’artifice ; Fireworks
Année : 1997
Pays : Japon
Durée : 103 min.
Acteurs principaux : Beat Takeshi, Kayoko Kishimoto, Ren Osugi, Susumu Terajima…
Je serais bien incapable de dire aujourd’hui quel est le film qui m’a fait découvrir Takeshi Kitano – à vrai dire, je ne sais même plus si je l’ai découvert d’abord en tant que réalisateur, ou en tant qu’acteur… Mais, quoi qu’il en soit, c’est un artiste multiforme qui m’a régulièrement comblé et mieux encore ; pourtant, j’ai de grosses lacunes dans sa filmographie – et, notamment, je n’ai vu aucun de ses films postérieurs à Zatoichi (j’ai l’impression qu’il a ensuite nettement moins été diffusé en Occident…), retard qu’il va falloir que je rattrape, et de toute urgence encore… Me reste néanmoins des images fortes, empruntées aux films qui avaient correspondu, sans doute, à son pic de popularité de par chez nous : outre Hana-bi qui va faire l’objet de cet article, et qui demeure mon préféré, il y a bien sûr Sonatine, L’Été de Kikujiro, Aniki, mon frère… Violent Cop, son premier film en tant que réalisateur (il avait remplacé au pied levé Kinji Fukusaku, le célèbre réalisateur de films noirs, mettant souvent en scène les yakuzas), est sans doute plus anecdotique, même s’il ne manque pas d’intérêt (le scénario préexistait, faut dire…). Je garde un peu à part Zatoichi, que j’ai beaucoup aimé, mais qui me paraît néanmoins un cran en dessous ; quant à Dolls, je me souviens qu’il est d’une très grande beauté plastique, mais il me faut le revoir avant d’en dire quoi que ce soit d’autre – ça ne devrait pas trop tarder… Bien sûr, il faut aussi mentionner Takeshi Kitano en tant qu’acteur (généralement sous son nom d’humoriste et d’animateur de télévision, Beat Takeshi, quand ce n’est pas Takeshi tout court) : au premier chef, son incroyable performance dans Furyo, dont j’avais parlé assez récemment, et, pour le même et immense Nagisa Ōshima, il y a bien sûr Tabou ; autre rôle fameux, même si c’est pour un film (de Kinji Fukusaku, là encore – son dernier à bien des égards) qui m’avait un peu déçu sur le moment (mais il faut que je le revoie, celui-là aussi) : le prof psychopathe de Battle Royale – ça lui allait comme un gant…
Takeshi Kitano, c’est bien d’autres choses encore : avant tout connu au Japon en tant qu’humoriste et animateur star de la télévision, quand ses films, à l’époque où les Occidentaux se l’arrachaient, lui donnaient une image autrement sombre, presque systématiquement associée en outre à un goût marqué pour l’ultra-violence, il est une personnalité complexe – il est tout ceci, oui, mais aussi davantage ; d’autant que son activité artistique s’étend à une multitude de domaines en dehors du cinéma et de la comédie, comme la littérature et, de manière plus marquée, tout spécialement dans ce film, la peinture…
Quoi qu’il en soit, pour ce que j’en ai vu, Hana-bi est clairement à mes yeux le sommet de sa filmographie ; et ce n’est pas seulement mon Kitano préféré : c’est aussi, et de manière générale, un de mes films préférés tout court. Une œuvre complexe, d’une grande beauté, incroyablement poignante, triste sans doute mais tout en ménageant de délicieuses séquences humoristiques voire burlesques, violent par éclats soudains tranchant sur une tendresse autrement fondamentale à bien des égards… Une somme, qui est tout Kitano ou presque – si quoi que ce soit puisse être « tout Kitano » –, et donc beaucoup de choses à la foi, mais avec pourtant une cohérence de tous les instants, une précision dans la narration, le jeu d’acteurs et la réalisation qui m’ont fait l’effet d’être sans égales dans sa carrière (j’imagine que, sous cet angle, il soit assez légitime pour beaucoup de valoriser davantage l’inattendu, la très légère imperfection foncièrement rafraichissante d’un Sonatine, ou peut-être même de L’Été de Kikujiro, mais le caractère presque millimétré de Hana-bi me fascine, car il n’a rien d’une limitation).
Beat Takeshi incarne ici un certain Nishi – à la croisée exacte de certains fantasmes de Kitano sur les flics et les yakuzas. Flic à l’origine, il a été durement marqué par la vie : le décès de sa fille, comme de juste, l’a beaucoup affecté ainsi que sa femme – et celle-ci, gravement malade, est même en phase terminale… Au point, en fait, où le docteur qui s’occupe d’elle, avouant son impuissance, suggère à Nishi de la ramener chez elle, où elle sera bien mieux qu'à l'hôpital ; peut-être pourraient-ils même entreprendre un voyage ?
Mais nous n’en sommes pas encore là – il faut revenir un peu en arrière. Une bonne partie du film, la première moitié si ça se trouve, use en effet d’un jeu temporel assez complexe, alternant présent et passé au travers de flashbacks parfois très brefs mais toujours intenses, et même traumatiques, d’autres fois un peu plus longs ; cela rend peut-être le tout début un brin hermétique, mais la construction adroite et quelques gimmicks visuels (notamment, bien sûr, le costume et les lunettes noires du Nishi du présent, à l’opposé du flic bonhomme et un brin pataud, yeux tristes dégagés, du passé traumatique) permettent d’intégrer le propos avec un grand naturel.
Un jour, donc, son collègue Horibe – associé de tous les instants, chacun gérant l’autre, et notamment la colère de l’autre – lui suggère de le laisser quelques instants tout seul en planque pour aller rendre visite à sa femme à l’hôpital tout proche ; mal lui en prend : en l’absence de Nishi, le criminel frappe, et, si Horibe y survit, c’est néanmoins en tant que paraplégique, condamné à la chaise roulante… après quoi sa femme et sa fille l’abandonnent. Ses perspectives d’avenir, on s’en doute, sont plutôt déprimantes…
Mais la tragédie ne s’arrête pas là : la traque de l’agresseur se finit mal à son tour. Un jeune policier est abattu par le malfrat que Nishi n’a pu maîtriser – et s’il l’abat par réflexe, c’est un peu tard ; il n’en vide pas moins son chargeur sur le cadavre du tueur…
Durement affecté par tous ces drames, et souffrant pour chacun d’entre eux d’un remord inextinguible, Nishi quitte la police – et il en vient même à fricoter avec des yakuzas… C’est qu’il entend racheter ses torts (à supposer qu’il en ait vraiment ? Lui n’a probablement aucun doute à ce sujet…). Il compte ainsi tout faire pour venir en aide à son ami Horibe, qui n’accepte pas sa condition d’infirme et est tenté par le suicide… Il compte faire de même pour la veuve du jeune policier abattu sous ses yeux… Enfin, il entend offrir à sa femme cet ultime voyage qu’on lui avait suggéré, pour susciter et se réjouir d’ultimes moments de tendresse et de complicité…
Pour ce faire, il a besoin d’argent – il ne s’embarrasse plus de la légalité, les cadeaux qu’il destine à chacun dépendant à certains égards d’un ordre normatif différent et supérieur. Nishi est passé de l’autre côté de la barrière.
Taciturne voire bougon (il ne parle quasiment jamais dans le film – Kitano tirant d’ailleurs au mieux partie de la paralysie qui l’affecte depuis son célèbre accident de moto : il fixe la caméra, impassible en apparence derrière ses lunettes noires, quelques tics pourtant parcourant son rude faciès – l’effet est impressionnant d’aura inquiétante…), Nishi exprime pourtant une étonnante empathie, ainsi lorsqu’il achète à Horibe du matériel de peinture (le paraplégique lui avait dit qu’il se cherchait un hobby, et avait envisagé cette orientation – jusqu’au béret de peintre qu’il voulait s’acheter…), ce qui débouche sur des scènes d’une incroyable beauté et d’une incroyable poésie, mettant en valeur des tableaux joliment naïfs dus à Kitano lui-même (des œuvres qu’il avait justement créé alors qu’il se remettait de son accident de moto…). Il lui est plus délicat, sans doute, de venir en aide à la jeune veuve – mais au moins lui fera-t-il quelques cadeaux, lui donnera-t-il un peu d’argent… Quant à sa femme, en dépit de sa tendance instinctive, jusqu’en ces derniers moments partagés, de refuser timidement tout contact corporel, il lui offrira pourtant le plus beau des cadeaux, au terme d’un périple de la dernière minute (ses anciens collègues flics comme ses plus récents contacts dans la pègre, dangereux au possible, sont sur sa trace, ce qui ne lui facilite pas la tâche…), périple qui en dévoilera pourtant une autre facette : celle d’un homme profondément doux et tendre à l’égard de celle qu’il aime, profondément drôle aussi, enchaînant les petits gags absurdes et complices sous les yeux de son épouse à l’agonie, suscitant son sourire quand elle n’a plus que bien peu de raisons de sourire…
Je ne sais pas s’il s’agit à proprement parler d’un SPOILER, j’en doute un peu, même, mais au cas où, prudence…
Le voyage de Nishi et de son épouse, au-delà des séquences violentes qui l’émaillent et ce de plus en plus (au début du film, on revient sans cesse sur la seule tuerie du centre commercial – dans un ralenti éprouvant, et avec un travail du son et plus encore du silence incroyablement efficace – mais d’autres scènes de violence suivront), s’inscrit sans doute (du moins j’en ai l’impression, contredisez-moi si jamais) dans une tradition japonaise marquée, qui a abondamment imprégné l’art du Pays du Soleil Levant (littérature et cinéma tout particulièrement) : il s’agit du shinjū, terme que l’on rend en français par « double suicide », et qui est notamment un thème classique du bunraku, ou théâtre de marionnettes (sur lequel Kitano reviendra bien sûr dans Dolls) ; le shinjū implique souvent l’amour contrarié de jeunes gens, qui ne peuvent s’unir sur cette terre, notamment en raison des conventions sociales et obligations familiales, ou giri, et qui décident donc de s’unir à jamais dans un autre monde ; si le couple formé par Nishi et sa femme ne correspond pas pleinement à cette définition, on peut néanmoins supposer que les magouilles criminelles de Nishi, et les soucis qu’elles entraînent en lançant sur sa piste tant les policiers que les yakuzas, ont notamment pour rôle de recréer, quand bien même de manière transfigurée, cette situation de base (et c’est bien pour cela que je mentionnais tout à l’heure la possibilité que Nishi se débarrasse de la légalité pour s’en tenir à un ordre normatif différent et supérieur) ; d'autant bien sûr que la maladie de l'épouse permet d'envisager l'amour impossible sous un autre angle... En outre, le shinjū a presque systématiquement un préalable, le michiyuki, qui est à proprement parler un « voyage », thème qui intervient souvent, de manière plus générale, dans le théâtre japonais – en tant que prologue dans le nô, et en tant que dernier acte dans le kabuki, ce qui correspond davantage à Hana-bi. Ici, la parenté avec le film de Kitano est immanquable, justifiant par ailleurs l’humour complice de ces scènes d’errance heureuse, à la montagne enneigée, dans tel monastère grandiose (la cloche s’en remettra peut-être, le jardin zen un peu moins), à la mer enfin (un classique chez Kitano…). Le michiyuki est traditionnellement émaillé de danses (d’où, je suppose, les séquences burlesques de Hana-bi), ainsi que de conversations plutôt apaisées – certes, l’épouse de Nishi ne dit pas un mot de tout le film, jusqu’au tout dernier moment, et c’est alors on ne peut plus poignant ; certes, Nishi lui-même est taciturne, mais sans doute bien moins dans ces scènes-là que dans toutes les autres ; et c’est bien pour cela qu’il entend user de toutes les méthodes possibles pour rasséréner son épouse à l’agonie, l’émerveiller devant les « fleurs de feu » (littéralement « hana-bi ») du feu d’artifices, la faire rire enfin… La conclusion, dès lors, est inévitable – et d’une beauté extraordinaire : la dernière scène du film fait partie des plus beaux moments de l’histoire du cinéma en ce qui me concerne (bénéficiant en outre de la musique éventuellement légère de Joe Hisaishi, pourtant d'un à-propos remarquable, le célèbre compositeur souvent associé à Takeshi Kitano mais aussi à Hayao Miyazaki signant peut-être là sa plus belle partition). Cette obsession du suicide chez Kitano est pour le moins troublante (on pense ici sans doute au premier chef à Sonatine, bien sûr, mais on en trouve bien d’autres exemples dans sa filmographie), et va sans doute au-delà des clichés associés au Japon, via kamikazes et seppuku (que la culture japonaise l’ait marqué dans ce sens, c’est plus que probable, mais, dans les motivations et questionnements, c’est tout autre chose, du moins j’en ai l’impression) ; peut-être est-ce vrai qu’il en est venu à percevoir son accident de moto comme une tentative inconsciente de suicide (la question apparaît dans le documentaire qui accompagne Hana-bi dans cette édition, Takeshi Kitano, l’imprévisible, hélas un brin médiocre)... Quoi qu'il en soit, il joue ici au mieux du thème, en évacuant peut-être son rapport personnel à la mort pour le sublimer dans une inscription dans la tradition littéraire du Japon, transfigurée cependant à son tour par le déplacement du procédé dans un cadre contemporain, où la violence, sans cesse, vient contrebalancer la tendresse, suscitant (encore un mot du réalisateur dans le documentaire précité) l’oscillation du pendule – et si le pendule n’oscillait pas, à quoi bon ?
L’intelligence, l’astuce et l’empathie du film sont indéniables – il passe sans cesse du rire aux larmes, de la violence à la tendresse, sans que jamais cela ne sonne faux, mais bien au contraire en déployant d’autant mieux son incroyable précision, son incroyable justesse, qui n’ont pour autant rien de froid ou de sec. La réalisation impeccable de Kitano (son sens du cadrage, notamment – tout particulièrement saisissant dans la mise en valeur des peintures de Horibe – mais aussi l’élégance et la lenteur de ses mouvements de caméra, parfois inattendus, jamais gratuits cependant) s’associe à une brillante direction d’acteurs et interprétation (comment Kitano parvient à exprimer autant de choses en restant de marbre, et comment son épouse – superbement incarnée par Kayoko Kishimoto – parvient à être aussi vivante dans sa douleur, et émouvante sans prononcer le moindre mot jusqu’à la fatale conclusion, sont des choses qui me dépassent ; il faut aussi saluer la performance de Ren Osugi dans le rôle de Horibe – qui est bien plus qu’un simple air de chien battu) pour donner un incroyable chef-d’œuvre, une somme qui joue de bien des thèmes et des traditions pour livrer en définitive un résultat unique et formidable, où la beauté et la justesse formelles n’ont d’égales que la beauté et la justesse du fond.
Hana-bi est un film parfait, un monument du cinéma contemporain. Quant à moi, j’en tire cette conclusion relevant de l’évidence : il me faut revoir les films de Kitano que j’avais adorés à l’époque, et voir aussi tout ce que j’en ai manqué. De toute urgence. Au boulot !

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)
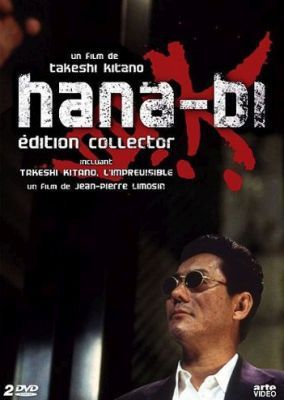


/image%2F1385856%2F20190409%2Fob_727fc2_maisons.png)
/image%2F1385856%2F20190307%2Fob_68da64_nobi-00.png)
/image%2F1385856%2F20190302%2Fob_1b1711_lords-of-chaos.jpg)
/image%2F1385856%2F20181113%2Fob_fac141_daredevil-03.jpg)
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)
Commenter cet article