"Lovecraft : le dernier puritain", de Cédric Monget
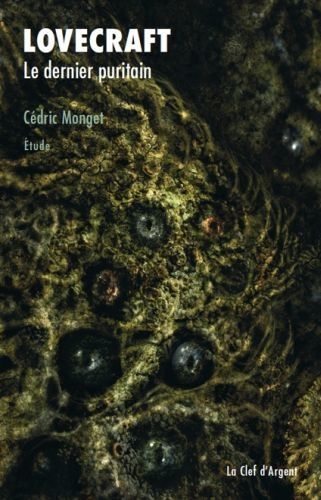
MONGET (Cédric), Lovecraft : le dernier puritain, Aiglepierre, La Clef d’Argent, coll. KhThOn, 2011, 81 p.
Ainsi que vous l’avez peut-être remarqué (…), je traverse un ce moment une période de lovecraftite aiguë. En effet, je n’arrive pas ces derniers temps à lire grand-chose en dehors de Lovecraft, de lovecrafteries, et d’essais sur tout ça, en dépit de mes efforts acharnés. Comme vous avez pu le constater, dans le tas, il y avait pas mal de mauvais trucs… Mais il y en a aussi des bons, notamment du côté des essais (même si, à vue de nez, je vais peut-être être contraint d’en descendre en flammes un de « mythique » – aha – prochainement, mais ça, on verra…). Et – ça tombe bien – le tout petit bouquin (encore) de La Clef d’Argent (encore) dont je vais brièvement vous entretenir aujourd’hui fait partie des bons crus.
Notons cependant pour commencer que cette étude de Cédric Monget – je ne sais absolument rien de l’auteur – est fort mal titrée. Si cette histoire de « dernier puritain » fait écho au nom d’un best-seller d’antan, elle a en effet de quoi laisser un brin perplexe… « Dernier » ? Allons bon ! « Puritain » ? Vraiment ? En fait, il s’agit là d’un paradoxe effectivement étudié dans cet essai, mais qui – à mon sens tout du moins – n’en constitue pas le cœur. Ce qui intéresse ici avant tout Cédric Monget, c’est – et là on respire – le matérialisme et surtout l’athéisme de Lovecraft. Ce qui nous amène à nous pencher également sur deux autres aspects de sa philosophie, indissociables : le conservatisme (pour ne pas dire la réaction, ce qui serait à mon avis plus approprié, mais bon) et, fatalement, le racisme.
Que Lovecraft fut matérialiste et athée n’a (aujourd’hui en tout cas) rien d’un scoop. Il a maintes fois eu l’occasion d’afficher son matérialisme (éventuellement qualifié de « mécaniste »), et, malgré la tentation de voir dans les Grands Anciens des dieux (a fortiori après les manipulations saugrenues du catholique Derleth), le lecteur un tant soit peu observateur comprend vite qu’il s’agit en fait d’entités extraterrestres parfaitement concrètes, même si elles échappent plus ou moins à la raison (avec – peut-être – une exception, Azathoth, sur laquelle on aura l’occasion de revenir). De même, si l’exégèse lovecraftienne a mis du temps à l’admettre, on ne saurait nier aujourd’hui le conservatisme comme le racisme du maître de Providence, qui imprègnent non seulement sa correspondance, mais aussi son œuvre de fiction…
Cela n’est pas, cependant, sans soulever un certain nombre de paradoxes, du moins en apparence. C’est que la pensée de Lovecraft, tour à tour séduisante et puante, se révèle comme de juste riche et complexe. Et c’est ce qu’entend nous montrer Cédric Monget dans cette étude qu’il présente lui-même avec humilité comme étant sans prétention, mais qui se révèle très vite passablement érudite (sans jamais virer dans le pédantisme et l’étalage de science), fondée sur des sources précises (pour beaucoup hélas indisponibles en français), et tout à fait pertinente.
On commence par se pencher sur deux « découvertes » capitales pour Lovecraft : l’astronomie et le darwinisme (par le biais du vulgarisateur Haeckel). La première – très tôt dans la vie de l’auteur – débouche sur un rationalisme forcené qui l’amène à batailler contre l’astrologie et à s’interroger sur la pluralité des mondes et la place de l’homme dans l’univers ; or, si les conceptions de Lovecraft en ce qui regarde la prépondérance ou pas de la vie dans l’univers ont changé, l’idée – que l’on peut qualifier de « pessimisme cosmique » – selon laquelle l’homme y est insignifiant l’a très vite séduit. Et c’est un corollaire de son athéisme et de son absence de téléologie. Tout au plus, dans sa fiction, pourrait-on voir une forme de panthéisme à la Spinoza dans sa présentation d’Azathoth, identifié au cosmos lui-même, mais cela ne prête pas forcément à conséquence ; il ne s’agit en effet pas d’y voir un dieu créateur qui aurait attribué un but à sa création (on aura l’occasion de revenir sur la question de l’origine de la vie, et notamment de l’homme), mais bien d’affirmer que « la nature est aveugle ». Le darwinisme, de son côté, infuse dans bien des textes de Lovecraft, et Cédric Monget se penche notamment sur le cas de « Faits concernant feu Arthur Jermyn et sa famille », mais on pourrait citer bien d’autres textes (je vous ai causé récemment de La Peur qui rôde, et il y a, bien sûr, « Le Cauchemar d’Innsmouth »). « Les Montagnes hallucinées » est également un texte très révélateur dans cette optique globale, avec ses Anciens finalement « humains » (et peut-être créateurs de l’humain, par dérision) et leur écrasement par les esclaves shoggoths ; ce qui amène l’auteur à affirmer à juste titre que « le darwinisme athée de Lovecraft est fondamentalement raciste ».
On s’intéresse ensuite à la conception des religions selon Lovecraft ; si celui-ci affirmait avoir été dans son enfance un « romain païen » (la découverte de la mythologie gréco-latine étant également pour lui un événement fondateur), et s’il a toujours eu un faible pour Rome – parfois difficile à concilier avec sa fascination pour les barbares germaniques, lui qui se rêvait « grande brute blonde » –, l’idée essentielle est que les religions sont « vaines », ce qui découle de ce que l’on vient de voir, et « étrangères », ce qui, à la fois, explique et fonde le racisme et l’antisémitisme de Lovecraft. Mais celui-ci est également conservateur : aussi s’attache-t-il paradoxalement à la religion qui l’entoure et qui l’a baigné – le protestantisme, donc – comme « tradition » en tant que telle à respecter, et éventuellement « utile » (les guillemets s’imposent) pour les peuples dans leur enfance, mais aussi, dans une vision un peu voltairienne, étrangement, pour les classes inférieures ; en tout cas, Lovecraft se montre très sévère à l’encontre des minorités religieuses (« importées », donc), et justifie à leur égard l’état d’exception… De même, son athéisme ne l’empêche pas d’être fasciné, on le sait, par la morale puritaine (d’où ce titre, on le voit pas très bien choisi) : Lovecraft, et ce n’est pas le seul paradoxe de sa pensée, est donc bien un « athée puritain » (j’avais vaguement évoqué cette question en traitant du Cas Lovecraft).
Et tout cela imprègne son œuvre, qui passe « de l’horreur gothique à la science-fiction d’horreur », « L’Appel de Cthulhu » constituant ici un tournant, ainsi que cela a souvent été noté (par exemple, histoire de vous renvoyer à une autre note antérieure, en l’occurrence le premier volume de la collection « KhThOn », dans Qu’est-ce que le Mythe de Cthulhu ?). L’horreur selon Lovecraft est fondamentalement athée, quoi qu’on ait pu en dire ; et, de même, elle se fonde essentiellement sur le matérialisme, le conservatisme et le racisme, en plaçant l’homme insignifiant dans un « struggle for life » cosmique dénué de finalité, où la menace extraterrestre – étrangère, donc – plane, ce qui « justifie » un « état d’exception » face à « l’anormal » (épistémologique ou ontologique).
Mais il y a eu – et c’est sur ce point que se conclue ce bref essai – « captation d’héritage »… D’une part, Lovecraft a été parfois (longtemps ?) perçu à tort comme un « occultiste » et un « initié » (pensons à Jacques Bergier…) (EDIT : ou pas ; voir les commentaires), et a ainsi été récupéré par les cultes ufologiques, ce qui est bien évidemment une aberration (ceux-ci, par un étrange biais, redonnant une place et un sens à l’homme dans le cosmos). Mais, d’autre part, Lovecraft a également été utilisé – et sa pensée déformée, selon Cédric Monget – par les « New Atheists », y compris parmi les exégètes lovecraftiens (S.T. Joshi, athée et progressiste, est nommément cité), qui ont forcé le trait et négligé le conservatisme essentiel chez Lovecraft, dont l’athéisme n’était certainement pas aussi « militant » et n’avait en tout cas rien de « progressiste »…
On le voit, l’étude de Cédric Monget, très dense mais d’une lecture assez agréable (même si un décoquillage aurait pu être utile), soulève de nombreux points intéressants, et se révèle au final tout à fait pertinente. Cette lecture de l’homme et de son œuvre n’est pas forcément d’une originalité à couper le squeele, mais est toujours fondée sur des sources précises et est en définitive subtile sans virer à l’enculage de mouches pour autant. J’ai été plus que convaincu par ce Dernier puritain, et invite donc tous les amateurs de Lovecraft à en faire l’acquisition, ils ne seront probablement pas déçus.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



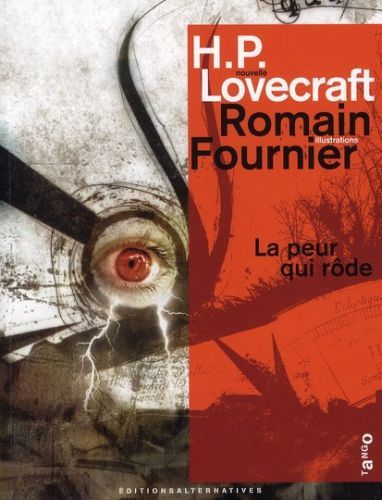

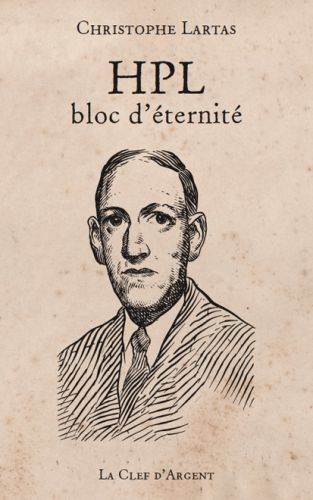
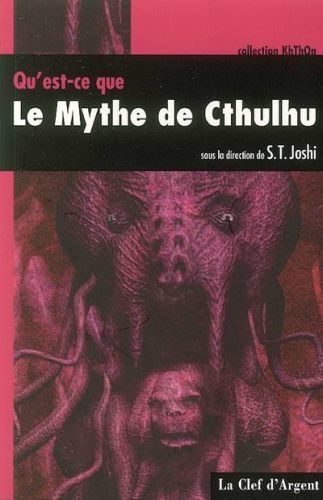

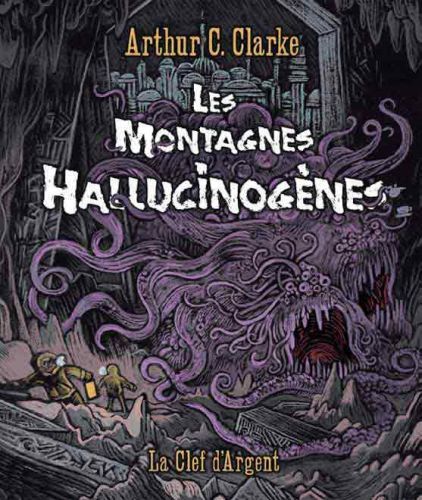





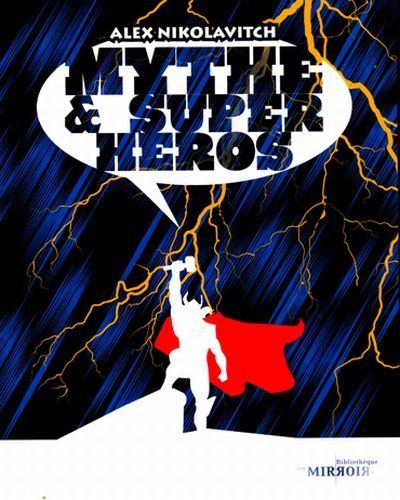


/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)