
TOLKIEN (J.R.R.), Le Livre des contes perdus, [The Book of Lost Tales], édition établie et avant-propos de Christopher Tolkien, traduit de l’anglais par Adam Tolkien, [s.l.], Christian Bourgois, [1993, 1995, 1998, 2001] 2002, 698 p.
Ouf.
Je suis enfin venu à bout de ce monstre.
Mazette.
C’est qu’il ne s’agit pas exactement d’une « lecture récréative », là.
J’avais commencé Le Livre des contes perdus (alors en deux volumes) au moment de sa première publication française ; et j’avais craqué… C’était beaucoup trop compliqué dans le fond comme dans la forme pour parler à l’ado que j’étais, qui se croyait authentique petit fan de Tolkien, et découvrait, avec la virulence d’une grosse baffe dans la gueule, qu’il avait encore beaucoup de progrès à faire, jeune padawan. À vrai dire, cette tentative fut même traumatisante, et m’a longtemps dissuadé de poursuivre les tolkienneries, à savoir cette monumentale « Histoire de la Terre du Milieu » qui était ainsi inaugurée. Tentant bêtement de justifier mon échec par la mauvaise foi, je me suis mis à considérer cette vaste entreprise comme étant une escroquerie à base de fonds de tiroir.
Erreur de jugement dont je suis bien revenu aujourd’hui. Non, il ne s’agit pas là de fonds de tiroir, mais bel et bien de l’analyse en profondeur d’un processus de création et d’écriture. Ce qui est tout à fait passionnant, mais implique de se trouver dans un certain état d’esprit. En clair, pour lire Le Livre des contes perdus, il faut satisfaire à plusieurs conditions : être fan de Tolkien, certes ; mais aussi avoir du temps devant soi et ne pas redouter l’effort ; vouloir en savoir plus, pas tant sur la Terre du Milieu et compagnie que sur les processus mis en œuvre par l’auteur qui ont en définitive abouti aux chefs-d’œuvre que l’on sait ; enfin, et cela me paraît capital, bien avoir en tête Le Silmarillion et les Contes et légendes inachevés (ceux du Premier Âge, en tout cas). Non qu’il s’agisse ici de la même entreprise : Le Silmarillion, en effet, peut (et doit sans doute) être lu pour lui-même, et ne nécessite pas d’effort particulier ; les Contes et légendes inachevés, déjà, demandent un peu plus une tournure d’esprit d’exégète ; mais il y a un vrai fossé entre la lecture de ces ouvrages accessibles à tous et celle de « L’Histoire de la Terre du Milieu », à réserver aux plus acharnés des lecteurs, « amateurs » au sens le plus positif, prêts à se livrer à une complexe quête archéologique dans les plus archaïques des manuscrits de l’auteur. Cependant, pour que cette quête porte ses fruits, il faut être en mesure de comparer les différents états de la création tolkienienne. Condition nécessaire à mes yeux, donc, mais ça tombe bien : dans le cadre du dossier d’un futur Bifrost (où je ferai une synthèse des volumes traduits en français de « L’Histoire de la Terre du Milieu »), je venais de relire, avec quelle délectation, Le Silmarillion et les Contes et légendes inachevés (je vous en parlerai à cette occasion). Je satisfaisais donc désormais à tous les pré-requis pour m’attaquer au Livre des contes perdus. Taïaut !
…
N’empêche que c’est rude. Le traducteur (un certain Adam Tolkien…) a en effet pris le parti, sans aucun doute justifié, de rendre le texte anglais au plus près, préférant la précision à l’élégance. Or ces textes, datant pour les plus vieux de la guerre de 1914-1918, sont écrits dans une langue délibérément archaïque, une langue « autre », pas avare en bizarreries grammaticales et syntaxiques. Je vous balance le début dans la gueule :
« Maintenant il se trouva qu’en un temps un voyageur venu de pays lointains, un homme d’une grande curiosité, fut par le désir de pays étranges et d’us et de demeures de peuples inhabituels mené par bateau tant loin à l’ouest que l’Île Solitaire elle-même, Tol Eressëa dans le langage des fées, mais que les Gnomes nomment Dor Faidwen, le Pays de la Libération, et un grand conte s’y rapporte.
« Maintenant un jour au bout de longs voyages il vint à l’heure où l’on allumait les lumières du soir à de nombreuses fenêtres au pied d’une colline dans une large plaine boisée. Il se trouvait maintenant près du centre de cette vaste île et avait erré sur ses routes durant bien des jours, s’arrêtant chaque nuit dans telle demeure de gens où il arrivait par hasard, qu’il s’agisse d’un hameau ou d’une ville de bonne taille, vers l’heure du soir où l’on allumait les chandelles. Maintenant à cette heure le désir de nouvelles visions se fait moindre, même chez celui dont le cœur est celui d’un explorateur, et même un fils d’Eärendel tel ce voyageur-ci tourne plutôt ses pensées vers le souper et le repos et la narration de contes avant que n’advienne l’heure du lit et du sommeil.
« Maintenant, comme il se tenait au pied de la petite colline, il vint une faible brise suivie d’un vol de corneilles au-dessus de sa tête dans la claire lumière du soir. Le soleil avait depuis quelque temps sombré derrière les branches des ormes qui se dressaient de par la plaine aussi loin que l’œil put percevoir, et depuis quelques temps ses dernières dorures s’étaient évanouies à travers les feuilles et avaient glissé le long des clairières pour dormir sous les racines et rêver jusqu’à l’aube.
« Maintenant ces corneilles donnèrent de la voix pour le retour au-dessus de lui, et virant rapidement vinrent à leur demeure dans les cimes des grands ormes au sommet de la colline. Alors Eriol pensa (car ce fut ainsi que le nomma ensuite le peuple de l’île, et sa teneur est « Celui qui rêve seul », mais de ses noms antérieurs le conte ne parle nulle part) : « L’heure du repos est proche, et bien que je ne connaisse même pas le nom de cette ville à belle apparence sur une petite colline, ici vais-je chercher du repos et un logis et je n’irai pas plus loin jusqu’au lendemain, ni peut-être même alors, car l’endroit semble doux et ses brises de bon aloi. Il a pour moi un air à conserver maints secrets de choses anciennes et belles et merveilleuses dans ses trésors et endroits nobles et dans les cœurs de ceux qui demeurent entre ses murs. » »
Etc. Encore que non : la suite est pire, car les contes commenceront alors, récités auprès du feu dans la Chaumière du Jeu Perdu, et leur style sera encore plus ampoulé, et le lexique se fera autrement plus complexe, riche en noms propres déroutants et variantes de termes elfiques. Bref : il faut être prêt à se farcir 700 pages du genre (un peu moins, si l’on enlève l’appendice sur les noms), bien tassées, et dont les phrases commencent une fois sur deux par « maintenant » ou « voici ». Et c’est tout de même passablement hardcore.
Mais voilà : la magie opère. Et le lecteur de se retrouver dans la position de cet Eriol (ou bien Ælfwine ? La question, extrêmement complexe, est traitée dans le dernier « conte »), voyageur curieux qui a accompli un beau voyage, mais long et périlleux, et découvre émerveillé, de la bouche même des Elfes, les récits des temps anciens. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : le développement (plutôt que l’esquisse ; comprenez par là que Le Silmarillion est en fait un abrégé extrêmement condensé…) de ce qui sera ultérieurement connu sous le nom de Premier Âge.
Ben oui : dès 1915-1916, Tolkien avait semble-t-il en tête bien des éléments de son « Légendaire », et certains n’ont connu qu’une évolution somme toute limitée. On y assiste donc à la création du monde, à l’établissement des dieux en Valinor, à la rébellion de Melko, à la venue des Elfes, etc. Mais, dans le détail, les changements peuvent être considérables.
Prenons ainsi un exemple frappant, le « Conte de Tinúviel » (qui sera connu plus tard comme étant celui de Beren et Lúthien). Beren n’y est pas un Homme, mais un Gnome (c’est-à-dire un Elfe, un Noldor plus précisément), ce qui change radicalement la donne (et, disons-le, enlève une bonne partie de son intérêt au conte, que l’on préfèrera largement dans sa version plus « achevée », mais ce n’est pas toujours le cas, loin de là) ; l’histoire se passe en une époque bien plus rapprochée de la fuite des Noldor que ce que l’on connaîtra ultérieurement (voir plus bas, à propos de Nirnaeth Arnoediad) ; si les Silmarils y apparaissent bel et bien, ce conte fait cependant exception (l’importance des joyaux était alors bien moindre) ; Beren y est nettement moins héroïque que dans les récits futurs, tandis que Tinúviel occupe sans aucun doute le devant de la scène ; le précurseur de Sauron, ici… est un chat, Tevildo ! et le récit prend ainsi des tournures étranges de conte animalier, avec des chiens et des loups en prime ; l’imbrication du récit dans une trame plus vaste, notamment du fait du serment des fils de Fëanor, est quasi inexistante (même s’il y a un lien qui se fait par la suite avec l’histoire de Túrin – on peut noter, dans le même ordre d’idées, qu’il n’est pas ici le cousin de Tuor – et celle du « collier des Nains », le « Nauglafring » – les Nains étant d’ailleurs présentés comme des créatures maléfiques d’origine inconnue, exit le joli mythe de leur création par Aulë) : pour employer les désignations « modernes », Doriath est à peine décrit (même si Thingol et Melian jouent bel et bien un rôle central), et « l’élément Nargothrond » est absent ; last but no least, la résurrection de Beren (un Elfe, rappelons-le…) au terme de la quête de Tinúviel dans les cavernes de Mandos est traitée brièvement dans un épilogue, bien loin de constituer un élément central du récit… Et tout ça fait une sacrée différence.
Cela dit, cet exemple ne prêche pas exactement en faveur du Livre des contes perdus : le conte, ici, est à tous les égards – et par nature – moins « achevé » que ce que l’on connaîtra ultérieurement. Mais ce n’est pas forcément toujours le cas, loin de là : bien d’autres récits sont au contraire plus développés (prenez le « Conte du Soleil et de la Lune »), et on a même droit à un très grand morceau du « Légendaire » avec un de ses textes fondateurs, celui de « La Chute de Gondolin », qui n’a à ma connaissance jamais été aussi complet qu’ici. Même si, là encore, on peut noter bien des différences cruciales : Tuor, donc, n’est pas le cousin de Túrin, ainsi que je l’avais déjà noté ; son père (et donc a fortiori « son oncle ») n’a jamais mis les pieds à Gondolin, qui est nettement moins « ancienne » que dans Le Silmarillion (il faut dire que Nirnaeth Arnoediad, à vue de nez, suit presque immédiatement l’arrivée des Noldor dans les « Grands Terres », même si c’est sans doute plus compliqué que ça) ; mais Tuor accède à la cité cachée bien plus facilement que dans le récit des Contes et légendes inachevés, et Turgon l’accueille à peu de choses près à bras ouverts, même si l’on ne trouve pas l’élément proprement « prophétique » de sa venue, avec l’armure qu’Ulmo avait demandé à Turgon de laisser en arrière, etc. Il n’en reste pas moins que le récit de la bataille de Gondolin est fabuleux, sans aucun doute le très grand moment « original » de ce premier état du « Légendaire ».
Mais il est encore une autre dimension à noter, fort complexe, et qui correspond à l’intention de Tolkien derrière ses contes : il s’agissait en effet pour lui de « créer » une mythologie propre à l’Angleterre, et il est sans doute bon de garder cette idée en tête lors de la lecture des Contes perdus. Le problème est que cet aspect n’est véritablement traité que dans le dernier conte, réduit même pas à l’état de fragments, mais seulement d’esquisses, qui plus est contradictoires selon que le navigateur est Eriol (Tol Eressëa correspond alors à l’Angleterre) ou Ælfwine (auquel cas il vient d’Angleterre)…
Je pourrais continuer très longtemps ainsi, mais il serait sans doute absurde de se livrer à une exégèse érudite sur ce blog interlope, ce n’est guère le lieu. Il ne s’agit ici que d’un compte rendu de lecture. Le bilan, alors : eh bien, ce Livre des contes perdus est aussi fascinant qu’ardu… Répétons-le : c’est tout sauf une lecture récréative, et il y a de quoi écœurer le simple curieux. Mais pour qui veut approcher au plus près le processus de création tolkienien, c’est un régal de bout en bout ; il y faut du sang, de la sueur et des larmes, mais la récompense est au bout du chemin, et quelle récompense !
Aussi dois-je ici faire mon mea culpa. Non, « L’Histoire de la Terre du Milieu » inaugurée par ce Livre des contes perdus n’est pas une collection de fonds de tiroir ; l’immense entreprise de Christopher Tolkien (dont la connaissance de l’œuvre paternelle est stupéfiante, et les commentaires sont extrêmement pointus) est parfaitement louable ; à vrai dire, elle présente même un cas à part dans l’histoire de la littérature : une exception, une singularité, à la hauteur de l’œuvre immense de ce génie que fut J.R.R. Tolkien.
J’enchaîne avec Les Lais du Beleriand.


/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)







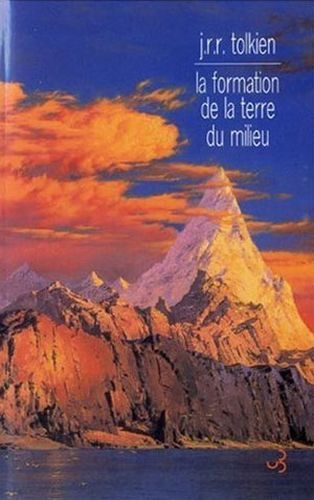


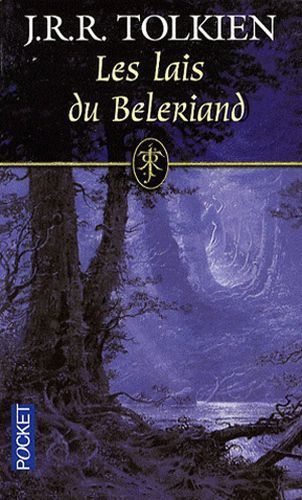





/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)