The Elder Scrolls V : Skyrim (PC)
J’ai déjà eu l’occasion d’en causer ailleurs, mais la série des Elder Scrolls a beaucoup compté dans mon vécu vidéoludique. Je l’ai véritablement découverte en 1996 (putain, vingt ans ?!) avec le deuxième volet, Daggerfall (je m’étais procuré auparavant le premier, Arena – qui tenait sur des disquettes, bon sang ! – mais n’ai jamais vraiment pu le faire tourner correctement…). Et ce fut une baffe colossale : le jeu avait beau être passablement moche et outrancièrement buggé, il était d’une richesse incomparable, avec sa carte immense comprenant des milliers de sites à fouiller, et donnait une sensation de liberté inédite jusqu’alors. J’y ai joué des centaines d’heures, alternant les personnages tous très différents, me régalant même à lire les bouquins qu’on trouvait un peu partout lors de nos déplacements entre Hauteroche et Lenclume (pas traduits alors, oui – j’avais naïvement pris sur moi de le faire, aha)…
Plus tard, en 2002, quand Morrowind est sorti, je me suis jeté dessus – et cela reste, toutes choses égales par ailleurs, à mon sens le meilleur opus de la série, et probablement le meilleur jeu de rôle jamais édité sur PC, notamment en ce qu’il combinait la liberté phénoménale de Daggerfall avec un cadre relativement original (Vvardenfell, la grande île des Elfes Noirs ou Dunmers, avait une belle singularité, tant dans le visuel que dans le fond), permettant d’exprimer une richesse plus fascinante encore car dépassant le caractère « aléatoire/automatique » (et donc très répétitif) du précédent volet (où tous les donjons se ressemblaient, et les villes presque autant) ; le jeu, enfin, bénéficiait d’une réalisation technique nettement plus aboutie – et on y découvrait le plaisir improbable d’errer dans la nature pour cueillir des fleurs aux fins de concocter telle ou telle potion alchimique…
Oblivion, en 2006, a radicalement changé la donne. Le jeu a plus encore mis l’accent sur le visuel, au détriment sans doute du fond – très beau, certes, mais aussi très convenu, la province impériale de Cyrodiil manquant terriblement de caractère en comparaison avec Vvardenfell… Le jeu était par ailleurs sans doute plus simple à aborder, mais aussi davantage tourné vers l’action, ce que l’on pouvait regretter… Mais ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : si, à envisager la série dans sa globalité, qui plus est aujourd’hui, Oblivion paraît un peu faible, et pouvait déjà décevoir à l’époque, ça n’en était pas pour autant un mauvais jeu, loin de là, et j’y ai passé bien des heures passionnantes (même si je m’y suis probablement moins abruti que sur Daggerfall et Morrowind).
Et puis, en 2011, est paru Skyrim, cinquième volet, forcément très attendu – et tout autant attendu au tournant. Le jeu a sans doute bluffé par sa réalisation – et reste très beau aujourd’hui sur le plan graphique, bénéficiant par ailleurs d’une très chouette bande originale hyper-épique et conanesque (que celui qui en doute se diffuse immédiatement en boucle le puissant thème d’introduction, remixant la mélodie classique des Elder Scrolls avec une finesse de mammouth en armure draconique égaré dans un Walhalla surpeuplé de brutes épaisses faisant office de chœurs on ne peut plus virils, AH !). Le cadre restait très fantasy classique : la province de Bordeciel, cette fois, patrie des Nordiques ; mais l’univers avait tout de même davantage de personnalité que le falot Cyrodiil, indéniablement – la montagne, la neige… mais surtout d’autres éléments plus discrets, tenant au background global, sur lequel je reviendrai ultérieurement. Pour le reste… eh bien, le jeu prolongeait clairement l’approche « graphique » et « fun » d’Oblivion, ce que l’on pouvait redouter – avec notamment un système plus « simple », se débarrassant des Classes et des Attributs pour se focaliser sur les seules Compétences, débouchant sur un ensemble d’Atouts.
Je me le suis procuré bien vite après sa sortie, forcément. Et j’y ai pris beaucoup de plaisir – que celui qui n’y a jamais jubilé en poutrant du dragon me balance la première pierre (même si, au bout d’un moment, les assauts de ces enflures, par ailleurs pas si difficiles à combattre une fois qu’on les a fait se poser quelque part, deviennent un brin ennuyeux). Mais j’y ai incontestablement bien moins joué qu’aux précédents épisodes, et l’ai sans doute bien vite remis de côté… En fait, je m’en suis lassé rapidement, et n’ai pas cherché à l’explorer à fond – je n’avais même pas poussé jusqu’au bout la Guilde des Voleurs et la Confrérie Noire, pourtant d’habitude les factions qui m’amusent le plus !
J’avais cependant envie de m’y remettre depuis quelque temps, bien conscient d’être largement passé à côté. Le fait d’avoir joué tout récemment à Fallout 4 – de Bethesda également, donc, je n’y reviens plus – m’a incité à réinstaller Skyrim. Pour voir. J’en avais tout oublié, ou presque… Mais je m‘y suis lancé, et ai ainsi, avec plusieurs années de retard, enfin découvert sa vraie richesse (et encore : en m’en tenant seulement au contenu officiel, Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn inclus – mais je n’ai pas encore utilisé de mods : on m’en a recommandé quelques-uns, mais ils ont l’air de tellement changer l’approche du jeu qu’il me paraît préférable de lancer une nouvelle partie pour en profiter au mieux, on verra le moment venu). Avec le recul, si je ne parviens toujours pas à mettre Skyrim au niveau de Morrowind, n’exagérons rien (toujours toutes choses égales par ailleurs, hein), je peux dire par contre qu’il est bien, bien meilleur qu’Oblivion, aucun doute là-dessus (et, effet secondaire inattendu, je révise nettement à la baisse la note de Fallout 4…). La richesse du jeu, le très grand nombre des quêtes, leur variété finalement étonnante (même si l’action est très présente, mais probablement moins que dans le bien trop bourrin Fallout 4, donc), m’ont très agréablement surpris, à y revenir après tout ce temps ; et j’ai aussi bien apprécié de retrouver Tamriel, et plus précisément Bordeciel, en apprenant à découvrir le caractère particulier de cette province nordique, certes moins inventive que Vvardenfell, mais dotée néanmoins d’une indéniable personnalité plutôt bien rendue.
Toutefois, sur cet aspect « background », ce qui m’a le plus parlé est d’ordre plus général : la déliquescence de l’Empire des Septim, qui n’a jamais été autant sensible – malgré les inévitables assassinats d’Empereurs des précédents titres. Nous commençons en l’an 201 de la Quatrième Ère, et l’Empire ne s’est jamais remis de la crise d’Oblivion (200 ans plus tôt, donc). Les Hauts-Elfes du Domaine Aldmeri se sont levés contre l’Empire au cours d’une grande guerre qui a à jamais marqué les esprits, et l’ont emporté ; l’Empire tient dès lors quelque peu du pouvoir fantoche, et on voit bien, derrière, les Elfes perfides qui tirent les ficelles (notamment via les magiciens du Thalmor, omniprésents quand bien même relativement discrets – et universellement haïs) ; ils ont par ailleurs extorqué le Traité de l’Or Blanc, qui a eu pour conséquence notable – et ô combien symbolique – de rendre le culte de Talos hors-la-loi ; oui, Talos, autrement dit Tiber Septim, le fondateur de l’Empire, l’homme devenu dieu ! Une hérésie inacceptable pour les Elfes du Domaine Aldmeri, qui ne l’ont jamais accepté parmi les Divins… L’Empire perd ainsi une grande part de sa puissance symbolique. Or Tiber Septim n’était pas n’importe quel homme, et si son Empire s’est fondé sur la province cosmopolite de Cyrodiil, il était quant à lui d’origine nordique… Rien d’étonnant, dès lors, à ce que le ressenti à cet égard soit tout particulièrement exacerbé en Bordeciel.
La province est à vrai dire ravagée par la guerre civile. L’Empire affaibli, incarné par une Légion bien éloignée de son prestige d’antan, a affaire avec la rébellion des Sombrages, des sortes de « nationalistes » nordiques (avec la dose de xénophobie qui va avec – on retrouve ainsi, mais renversé, un thème important de Morrowind, et le Quartier Gris de Vendeaume en est un témoignage éloquent) : à leur tête, Ulfric Sombrage, jarl de Vendeaume, qui a tué le Haut-Roi de Bordeciel dans la châtellenie de Solitude, et entend bien régner sur la province libérée de l’emprise injurieuse et absurde de l’Empire aux mains des Elfes fourbes ! La guerre civile est un thème majeur de Skyrim, et notre personnage est bien vite amené à choisir son camp (les factions de la Légion impériale et des Sombrages sont par ailleurs les seules à être totalement incompatibles dans le jeu de base), même s’il lui reste heureusement la possibilité de tracer son chemin sans se mêler de ces affaires.
On commence la partie – sans l’étape préalable de la conception du personnage, en fait, même si on est alors amené, dans le cadre d’une sorte de tutoriel déjà inscrit dans l’aventure, à choisir sa race et son apparence, mais en dehors de ça tous les personnages débutent sur la même base – de la même manière que dans les précédents volets des Elder Scrolls : en tant que prisonnier. Capturé par la Légion sur la frontière de Bordeciel, avec à côté une brochette de Sombrages (dont Ulfric en personne). Et on est immédiatement condamné à mort, sans autre explication (ce qui, d’emblée, ne donne guère envie de rejoindre ultérieurement la Légion, hein ? Mais, en face, les Sombrages et Ulfric au premier chef sont de tels connards qu’ils ne représentent pas forcément une alternative attrayante…). Mais, alors même que l’on pose la tête sur le billot, dans le fort d’Helgen, un putain de dragon surgit – on n’en avait pas vu depuis des siècles, à supposer qu’ils n’étaient pas de simples créatures mythologiques ! –, qui ravage les environs et tue à tout va. On s’en tire, bien sûr – en suivant, soit un Impérial, soit un Sombrage… On fait un petit tour du côté des pierres levées (Guerrier, Mage ou Voleur, afin de donner une orientation pour la suite en déterminant quelles sont les compétences qui évolueront le plus vite ; les autres pierres seront découvertes, ou pas, en cours de partie), et hop : on est lâché en Bordeciel, et on n’a plus qu’à se démerder.
Bien sûr, il y a une « quête principale », et qui se distingue bien vite du seul cadre de la guerre civile. Et, re-bien sûr, comme dans les précédents volets pour autant que je m’en souvienne, le prisonnier méprisé de tous que l’on incarne au début s’avèrera être une sorte d’ « Élu », dont le destin dépasse allègrement tout ce à quoi on pouvait raisonnablement s’attendre ; il s’avère que l’on incarne, Nordique ou pas, un « Enfant de Dragon » (semblable en cela à Tiber Septim lui-même…) directement lié à la réapparition de la créature mythique à Helgen – et ses frangins écailleux se réveillent partout dans Bordeciel, semant le chaos au fil de leurs pérégrinations, et constituant une menace de plus pour les habitants déjà marqués par la guerre. Il y a comme une odeur persistante d’apocalypse… Comme d’habitude, cette « quête principale » ne constitue pas pour autant l’essentiel du jeu, loin de là – elle est d’ailleurs plus ou moins palpitante, même si elle a ses beaux moments épiques (la « fin » m’a paru un poil terne, malgré l’emphase du dernier épisode – je regrette surtout le retentissement peut-être trop minime de nos hauts faits en Bordeciel même –, et surtout bien trop rapide…). Le jeu n’a cependant pas de fin à proprement parler, comme de juste : une fois cette trame globale achevée, on peut continuer d’arpenter Bordeciel, qui a encore des dizaines voire des centaines de quêtes à nous offrir.
Certaines de ces quêtes, classiquement, dépendent de factions, qui les enchaînent en séries. Outre la Légion et les Sombrages, outre aussi, sur un mode plus mineur, les classiques Lames de la « quête principale » (ou plutôt ce qu’il en reste, on constate tout particulièrement ici à quel point l’Empire n’est plus que l’ombre de lui-même, les Aldmeri ayant fait le ménage…), on se voit proposer quelques opportunités classiques, pourtant subtilement différentes de ce qui se trouvait dans les précédents épisodes. Ainsi, il n’y a plus de Guilde des Guerriers, pas plus que de Guilde des Mages – ces institutions officielles ont disparu au fil des siècles. Toutefois, un personnage axé « guerrier » pourra rejoindre les rangs des Compagnons d’Ysgramor, dans la salle de banquet de Jorrvaskr à Blancherive, qui constituent un ersatz de la Guilde des Guerriers… mais avec un petit secret qui change pas mal la donne. Un personnage axé « magicien » pourra quant à lui intégrer l’Académie de Fortdhiver – de tout temps indépendante de la Guilde des Mages, elle lui a donc survécu… même si elle suscite l’inimitié voire l’hostilité de beaucoup : les mages de l’Académie se voient reprocher bien des tragédies, et, de manière générale, les Nordiques préfèrent les épées, haches et marteaux de guerre aux arcanes de ces tafioles arrogantes... On trouve par contre toujours une Guilde des Voleurs – mais elle n’a plus rien de sa puissance d’antan, et est peu ou prou cantonnée à la seule ville de Faillaise, notoirement corrompue. Enfin, demeure aussi la Confrérie Noire, à même d’accueillir les assassins en herbe… mais son unique sanctuaire en Bordeciel est semble-t-il le dernier dans tout Tamriel ! Chacune de ces factions développe sa propre trame – au terme de laquelle, de manière plus ou moins crédible (et bien souvent trop rapide, c’est surtout ça le problème), on en devient le patron (mon dernier personnage, une Khajiit voleuse/assassin, a intégré l’Académie de Fortdhiver pour obtenir des éléments en rapport avec une quête indépendante – il me fallait négocier l’accès aux ruines de Saarthal ; j’en ai de temps à autre accompli les quêtes, au cas où, d’autant que celles-ci ne demandaient qu’un bien maigre talent magique… et j’ai ainsi fini par devenir archimage alors que j’étais à peine capable de jeter le moindre sort !) – mais elle offre aussi des quêtes « aléatoires » ou mineures (ainsi des très nombreuses activités illicites de la Guilde des Voleurs – casses, vols à la tire, falsifications de comptes, fausses preuves, etc. – ou des Compagnons ; les quêtes accessoires de l’Académie de Fortdhiver et de la Confrérie Noire sont semble-t-il moins nombreuses, mais plus « personnalisées »).
En dehors de ces différentes factions « classiques » et aisément identifiables, on peut trouver çà et là quelques autres groupes et institutions à même de confier des quêtes – de la cour de chaque jarl, bien sûr (les villes ont pour la plupart une certaine personnalité, au passage), aux cultes tant des Divins que des Princes Daedra (nettement plus rigolos, ces derniers…) en passant par l’Académie des Bardes de Solitude… Mais les quêtes dépassent allègrement les factions : j’ai l’impression qu’au moins un personnage sur deux est en mesure de confier une mission ou au pire de mentionner un endroit intéressant apparaissant dès lors sur la carte ! Les simples quidams que l’on croise dans les rues ou leurs boutiques ont ainsi, pour bon nombre d’entre eux, un passé, une attitude, qui les sortent de l’anonymat qu’on était tenté de leur accoler… Bon nombre de ces missions s’affichent dans le journal des quêtes avec un titre, quand les autres sont dites « diverses », et peuvent aller du simple emploi de coursier à des choses nettement plus amples et surprenantes. La carte, de manière générale, est très riche, relativement dense au regard de sa nature sauvage, et on y trouve partout nombre de choses à faire. Sans même parler des actions indépendantes de notre personnage, hors quête, qui peut explorer telle ou telle région, tel ou tel « donjon », pour son seul plaisir, pour trouver de quoi revendre, ou de quoi « créer » – nourriture, mais surtout alchimie, forge et enchantement (le système est chaque fois très simple, beaucoup plus facile à prendre en main que dans les précédents Elder Scrolls, et beaucoup plus profitable ; on notera par ailleurs que la magie est très simplifiée, et que le vieux système de création de sorts a logiquement disparu – je ne sais plus ce qu’il en était dans Oblivion ?) –, sans même parler du côté « Sims », renforcé dans le contenu téléchargeable officiel Hearthfire, où, au-delà des seules maisons classiquement acquises dans les différentes villes, on devient propriétaire terrien, dans un (ou des) gros manoir idéal pouvant accueillir des enfants adoptifs, voire un conjoint…
On a donc énormément de choses à faire, et des choses globalement variées – d’autant que les inévitables « donjons » sont bien mieux conçus que dans les opus précédents, ayant souvent leurs caractéristiques propres, pouvant éventuellement s’exprimer dans des énigmes (très simples la plupart du temps, certes, mais ça rajoute indéniablement quelque chose, de même pour les pièges même s’ils sont très rarement mortels), ou via des « histoires » singulières, perçues à travers des documents écrits… ou les cadavres de leurs auteurs. Cette variété d’environnements est quand même un brin relative, je ne prétendrai pas le contraire : au bout d’un moment, on peut légitimement en avoir assez des tumulus nordiques infestés de morts-vivants dits Draugrs (et tout particulièrement de leurs enfoirés de « Seigneurs », qui maîtrisent à l’instar de notre personnage la « Voix » draconique, ou « Thu’um », et se montrent en conséquence très, très pénibles, à sempiternellement nous envoyer voltiger dans les airs…) ; mais on peut varier quelque peu, avec les grottes abritant forcément nombre de bandits ou d’animaux sauvages, ou, autrement plus amusantes la plupart du temps, les ruines dwemer – souvent immenses et labyrinthiques, à s’y perdre –, infestées de Falmer (les « Elfes des neiges » dégénérés) et d’automates issus du génie des Nains. Par exemple, hein.
L’exploration de la carte est souvent intéressante, même si on y retrouve peut-être plus que jamais (enfin, à part pour Fallout 3, de sinistre mémoire à cet égard) quelques difficultés pour arpenter aisément la région – en l’occurrence parce qu’elle est très montagneuse ; on aura alors recours soit à un cheval (les canassons de Bordeciel parviennent parfois à grimper des parois presque verticales, autant dire qu’ils sont sacrément balaises…), soit au sort de l’école d’Illusion appelé « Clairvoyance », qui fait office de GPS fantasy bien pratique…
Quelques mots sur l’ergonomie, peut-être ? Ça n’était certainement pas le point fort des premiers volets des Elders Scrolls (au moins jusqu’à Morrowind inclus), mais on est là dans quelque chose de bien plus simple et aisé à prendre en main, probablement plus encore qu’Oblivion. Si l’on peut toujours pester devant la gestion parfois improbable des sauts (où un monticule à peine plus haut qu’une marche peut suffire à foutre le bordel), qui intervient aussi parfois pour monter sur les berges des cours d’eau, le reste se montre très satisfaisant. L’utilisation des armes et des sorts, via les deux mains, est ainsi élémentaire (on notera la possibilité, dont j’ai passablement abusé pour ma part, de combat avec une arme dans chaque main) ; les Favoris quels qu’ils soient, indispensables, plutôt que de se voir attribuer une touche chiffrée, apparaissent dans le cadre d’un menu déroulant qui fige le jeu, ce qui est au fond bien pratique. L’Inventaire comme la Magie se gèrent très aisément, de même. Ajoutons enfin qu’une touche (W, en principe) permet de faire intervenir des Pouvoirs indépendants des points de Magie, comme ceux découlant de la race (dans le cas de ma Khajiit, sa Nyctalopie, par exemple), ou, surtout, ceux de la Voix, les Cris draconiques que l’on est amené à apprendre un peu partout, et à déverrouiller en absorbant (automatiquement) des âmes de dragons…
Le système de jeu, au-delà, repose comme je l’avais déjà dit plus haut uniquement sur les Compétences (il n’y a pas d’Attributs, ce que je regrette un peu, mais bon…). La progression en expérience, d’ailleurs, ne dépend pas de l’accomplissement des quêtes, des ennemis abattus ou des endroits découverts (comme dans Fallout 4), mais uniquement de l’utilisation de ces Compétences – et d’une « vraie » utilisation, d’ailleurs : pas de levelling à la Morrowind ici, où on enchaînait les boules de feu frappant dans le vide pour faire progresser son score en Destruction… On trouve cependant toujours des livres de Compétence, quelques récompenses de quête vont dans le même sens, et il y a bien sûr des personnages à même de nous entraîner contre rémunération (jusqu’à un niveau dépendant de leur propre talent, avec un prix forcément de plus en plus élevé, et dans la limite de cinq points de Compétence – de manière globale – par niveau). Chaque fois que l’on gagne un niveau, enfin, on choisit d’augmenter une jauge, soit Magie, soit Santé, soit Vigueur, et on gagne en outre un Atout – à choisir dans le dessin des constellations accompagnant chaque Compétence, en fonction du score que l’on y a atteint, et pouvant en changer radicalement l’utilisation, ce qui permet de singulariser d’autant le personnage. Chaque Compétence est notée sur 100 – à terme, on peut choisir de rendre une Compétence à 100 points « légendaire », ce qui la ramène à 15 points en libérant les points d’Atouts qui y avaient été attribués, mais je ne l’ai pas fait pour ma part (la conséquence, bien sûr, était qu’à terme mon personnage ne progressait plus : j’avais en effet presque toutes les Compétences de Furtivité à 100, et quelques autres de même – Alchimie, Enchantement et Forgeage, notamment…).
Le jeu se montre ainsi d’une très grande richesse, et, s’il apparaît perfectible en quelques endroits (pour ma part, je relève ici surtout la progression à mon sens très et sans doute trop rapide dans la hiérarchie des factions), il a de quoi satisfaire pleinement les joueurs, procurant une expérience savoureuse, enthousiasmante et durable (avec une excellente rejouabilité) – encore une fois, Skyrim n’égale pas à mon sens Morrowind, mais je lui accorde volontiers la deuxième place, et c’est énorme en soi.
Le jeu a été complété, bien sûr. Au-delà des patchs, ainsi que des mods amateurs (apparus avec Morrowind), et dont je traiterai peut-être un de ces jours, on compte trois extensions officielles (plus une amélioration des textures).
J’ai déjà évoqué Hearthfire, plutôt gadget, mais pourquoi pas – j’avoue, je me suis quand même bien cassé le cul à construire et meubler ma maison de poup… mon manoir. Inutile sans doute d’y revenir.
Dawnguard tourne pour l’essentiel autour du thème du vampirisme. Des vampires multiplient en effet les assauts dans tout Bordeciel – développant parfois une attitude de, disons-le, terroristes, qui les rend redoutables et à vrai dire bien plus à craindre que les dragons (ils peuvent en effet tuer des PNJ lors de leurs incursions, et non des moindres – les commerçants, par exemple, mais aussi d’autres à même d’intervenir dans des quêtes. Une fois, j’ai ainsi subi l’assaut d’un « Nomade » sur le marché de Faillaise… qui a eu le temps de buter cinq personnages, dont trois commerçants, avant que je parvienne à m’en débarrasser avec l’appui de la garde locale !). D’où la possibilité de rejoindre la Garde de l’Aube, groupe de chasseurs de vampires (menés par une brute épaisse…), mais aussi celle de devenir un vampire et de rejoindre les rangs du seigneur Harkon, deux possibilités s’excluant mutuellement (pour ma part, j’ai choisi la voie de la Garde de l’Aube, même si j’ai été un temps un vampire, sans avoir rejoint Harkon – je trouvais ça un brin trop contraignant et ai donc préféré me soigner, mais ça peut être intéressant, j’imagine ; peut-être davantage que la lycanthropie, qui figurait dans le jeu de base, mais ne présente guère d’attraits à mes yeux…). La trame – de ce côté en tout cas – est assez correctement foutue, débouchant sur des quêtes parfois longues et plutôt bien ficelées. On appréciera sans doute le puissant Acolyte qu’est Serena – une vampiresse –, ainsi que les nouveaux objets qui apparaissent à l’occasion de cette extension, et notamment la redoutable arbalète, largement personnalisable.
Dragonborn adopte une approche bien différente, en adoptant carrément une autre carte. On est ainsi « invité » (par des « adeptes » un brin agressifs…) à se rendre sur l’île de Solstheim, au nord-est de Bordeciel, gracieusement donnée il y a longtemps aux Dunmer fuyant Vvardenfell asphyxiée par l’éruption du Mont Écarlate. Du coup, ce nouveau territoire à explorer a quelque chose du clin d’œil, renvoyant à l’esthétique et à l’expérience de Morrowind, ce qui est plutôt sympathique. La trame qui nous incite à nous y rendre m’a cependant paru frustrante, car bien trop brève – alors qu’elle avait quelque chose, à la base, de vraiment prometteur : on y fait face à un autre Enfant de Dragon, surgi du fond des âges – Miraak, un temps serviteur du Prince Daedra Hermaeus Mora (au doublage presque aussi insupportable que celui de Cicéron dans la storyline de la Confrérie Noire…). Son activité rend les autochtones fous et, pour l’affronter, on doit faire usage d’étranges et inquiétants grimoires nous plongeant dans un monde parallèle aussi mystérieux qu’effrayant, et passablement lovecraftien (au-delà des seuls et inévitables tentacules). C’est aussi l’occasion de rencontrer les Skaals – des Nordiques restés sur Solstheim, et bizarrement monothéistes… Au-delà, cependant, j’avoue n’avoir guère fouillé l’île – il y a sans doute bien plus à faire que je ne l’ai fait. Disons que ça ne m’a pas emballé plus que ça, mais il faudra peut-être que je retente l’expérience un de ces jours…
Après tout, retenter globalement l’expérience de Skyrim s’est avéré une bonne idée, je me suis vraiment amusé avec, pendant des dizaines et des dizaines d’heures de jeu – et ça peut très probablement se compter en centaines, selon la manière dont on s’y prend… Très bon jeu en définitive, donc. Ô combien.
Là, petite pause, quand même – mais je pense y revenir un jour prochain, histoire de tester quelques mods. Et, plus tard, peut-être, The Elder Scrolls Online : Tamriel Unlimited ? Je n’ai jamais vraiment fait de meuporgue, je n’y connais absolument rien, mais ça se tente peut-être…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



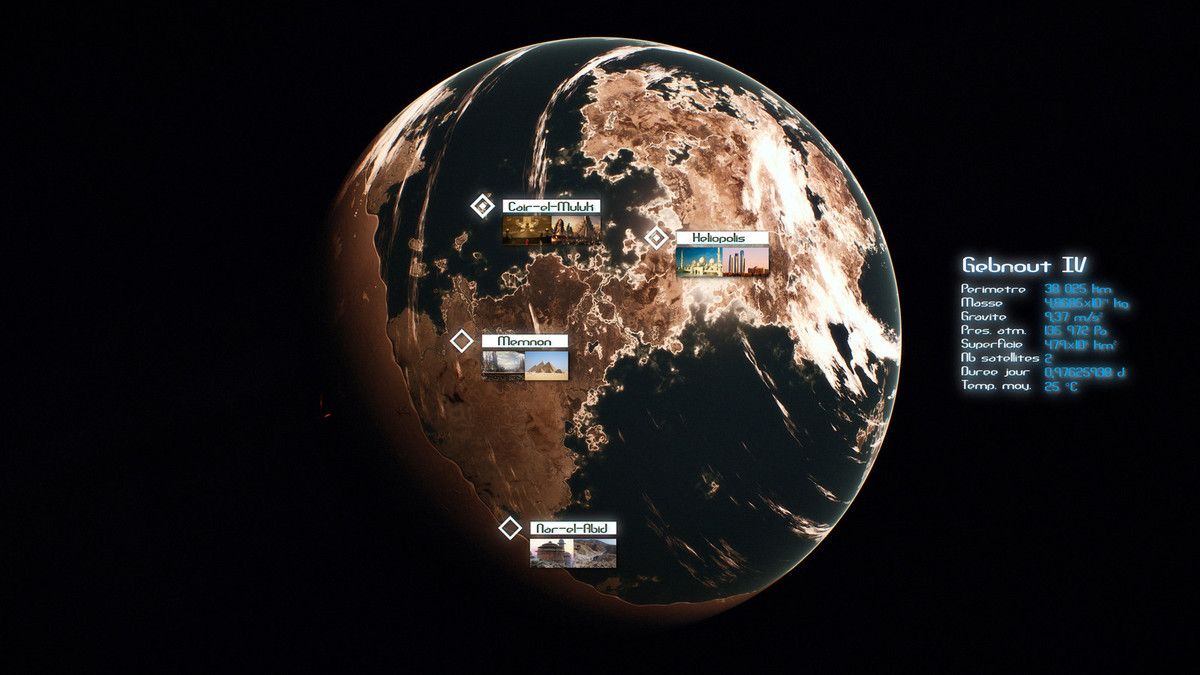
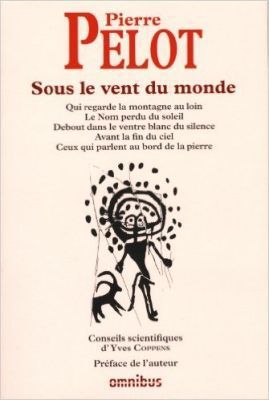




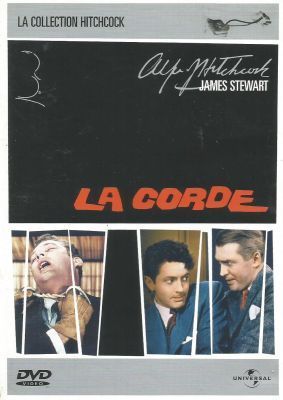




/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)