"L'Anniversaire du monde", d'Ursula Le Guin
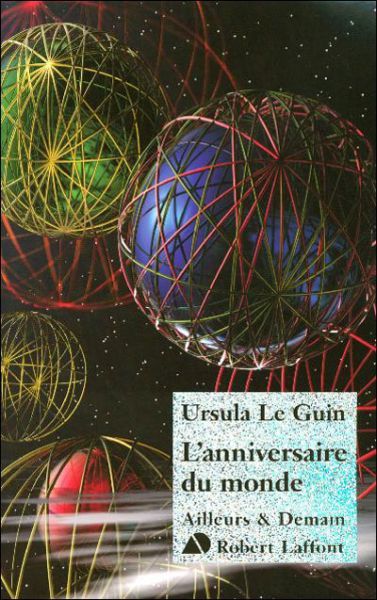
LE GUIN (Ursula), L’Anniversaire du monde, [The Birthday Of The World], traduit de l’américain par Patrick Dusoulier, Paris, Robert Laffont, coll. Ailleurs et demain, [2002] 2006, 406 p.
Ursula K. Le Guin est grande, et le « cycle de l’Ekumen » est un des plus grands chefs-d’œuvre de la science-fiction. Là, c’est dit. Enfin, re-dit. J’en étais convaincu depuis longtemps, mais ce n’est certainement pas ce recueil de nouvelles (... étrangement dépourvu de table des matières, faut croire qu’il n’y a pas de petites économies…) qui va me faire changer d’avis. Cette œuvre récente, qui constitue si je ne m’abuse la dernière incursion d’Ursula Le Guin dans cet univers, se montre en effet bien digne des plus beaux textes que l’auteur a eu l’occasion de nous prodiguer au fil des années.
Six des huit nouvelles composant L’Anniversaire du monde se rattachent explicitement au cycle ; pour ce qui est de la septième, Ursula Le Guin, dans sa « Préface » (pp. 7-14), considère que l’on pourrait éventuellement l’y rattacher (j’avoue trouver ça douteux…), tandis que la huitième et la plus longue, à l’en croire, n’a rien à voir (quand bien même on n’y verrait pas forcément de contradiction indépassable). Mais, au-delà de l’appartenance ou non au « cycle de l’Ekumen », ce passionnant recueil est de toute façon remarquablement cohérent. A bien des égards, on pourrait y voir une épure et un aboutissement des œuvres antérieures, tant l’intrigue, souvent, est reléguée au second rang, et l’accent mis sur la description de sociétés et de leurs institutions selon une perspective anthropologique (plus encore que dans Le Dit d’Aka ; en l’occurrence, ici, ce sont essentiellement la sexualité et les systèmes matrimoniaux qui sont envisagés) ; la science (humaine et sociale) est donc au premier plan, ce qui fait bien de ce recueil une œuvre de « hard science » pour le moins singulière ; mais Ursula Le Guin, dont le talent n’est plus à démontrer, n’en oublie jamais pour autant ses personnages et leurs émotions, et fait toujours preuve de sa subtilité et de son élégance coutumières.
« Puberté en Karhaïde » (pp. 15-38) donne le ton. Nous retrouvons dans cette courte nouvelle le cadre de Géthen, la planète où se déroulait La Main gauche de la nuit (et, accessoirement, « Le Roi de Nivôse »). L’élément qui avait retenu notre attention, alors, était bien sûr l’étrange hermaphrodisme des Géthéniens, et cette conséquence troublante : l’absence de division sexuelle dans la société. Mais Ursula Le Guin regrettait, semble-t-il, de n’avoir pu alors aborder la sexualité des Géthéniens « de l’intérieur » ; les notions de « kemma » et de « soma » étaient bien entendu évoquées, mais ces questions étaient néanmoins surtout envisagées par le biais d’un observateur étranger, et l’intrigue ne permettait pas forcément de s’y attarder. D’où cette nouvelle (p. 9) :
« […] je suis retournée à Géthen après vingt-cinq ou trente ans d’absence. Cette fois-ci, je n’avais pas de Terrien mâle, intègre mais désorienté, pour venir brouiller mes perceptions. J’étais à même de pouvoir écouter un Géthénien chaleureux qui, contrairement à Estraven, n’avait rien à cacher. Cette fois-ci, je n’avais pas l’ombre d’une intrigue. J’ai pu poser des questions. J’ai pu voir comment fonctionnait le sexe. J’ai pu enfin pénétrer dans une maison de kemma. J’ai pu vraiment m’amuser. »
Et le résultat est bien passionnant. C’est que la puberté a quelque chose de particulièrement traumatisant sur Géthen : les Géthéniens sont à la fois (ou alternativement) des hommes et des femmes ; mais le premier kemma, qui est ainsi la première « transformation », n’en est que plus perturbant… Les craintes des adolescents sont bien rendues, et la nouvelle se montre à la fois tendre et subtile, à la fois pudique dans sa justesse et libertaire dans sa conclusion. Un complément indispensable.
« La Question de Seggri » (pp. 39-88) adopte une forme bien différente : il s’agit cette fois d’une compilations de rapports adressés à l’Ekumen, d’origine variée, et décrivant le fonctionnement bien particulier de la planète Seggri sur plusieurs siècles. Sur Seggri, pour de complexes raisons, les hommes sont 16 fois moins nombreux que les femmes. L’organisation sociale s’en ressent nécessairement : les hommes, dans cette société, vivent à l’intérieur d’immenses châteaux, où ils passent l’essentiel de leur temps à s’entraîner en vue de compétitions sportives destinées à augmenter leur prestige individuel ; les femmes vivent à l’extérieur, dans des villes et villages, et ce sont elles qui travaillent. Pour les besoins de la reproduction, les hommes sortent régulièrement des châteaux, mais uniquement pour se rendre dans des « forniqueries », où les femmes les louent pour leur faire l’amour, le tarif variant en fonction du prestige de l’homme, de ses talents d’amant ou de reproducteur. Dans cette société, les hommes font à certains égards figure de privilégiés (on aurait d’ailleurs envie de dire « au sens strict » : leur sort n’est guère enviable !), mais ce sont indéniablement les femmes qui disposent du pouvoir. L’arrivée de l’Ekumen sur Seggri, inévitablement, va bouleverser la donne ; et, dans les châteaux, un vent de révolution va se mettre à souffler… Un ensemble de récits variés, tous passionnants et bien vus, rien à jeter.
Suivent deux nouvelles ayant la même planète pour cadre : mais il faut dire que, sur O, les relations sexuelles sont d’une complexité rare. Il y a à la base un système de parentés classificatoires : tout individu appartient en effet à une « moietié », qu’il hérite de sa mère biologique ; tout un chacun est donc, soit du « Matin », soit du « Soir ». Le tabou de l’inceste est logiquement étendu à l’ensemble de la moietié : une personne du Matin ne peut avoir de relations sexuelles qu’avec une personne du Soir, et inversement (ce qui exclut donc 50 % de la population). Rien de bien compliqué jusqu’ici ; mais il faut y ajouter la pratique du « sedoretu », qui y est une forme de mariage impliquant quatre partenaires : un homme et une femme du Matin, et un homme et une femme du Soir. Ce qui suppose plusieurs relations (p. 112) :
« On est censé avoir des rapports sexuels avec ses deux conjoints de l’autre moietié, mais pas avec le conjoint de sa propre moietié. Ainsi donc, chaque sedoretu comporte deux relations hétérosexuelles, deux relations homosexuelles, et deux relations interdites.
« Les relations sexuelles attendues dans chaque sedoretu sont :
« La femme du Matin et l’homme du Soir (le « mariage du Matin »)
« La femme du Soir et l’homme du Matin (le « mariage du Soir »)
« La femme du Matin et la femme du Soir (le « mariage du Jour »)
« L’homme du Matin et l’homme du Soir (le « mariage de la Nuit »)
« Les relations interdites sont entre la femme du Matin et l’homme du Matin, ainsi qu’entre la femme du Soir et l’homme du Soir, et elles ne portent pas de nom particulier, à part « sacrilège ». »
Un système complexe, donc, dans lequel le mariage ne peut se faire sur un coup de tête, mais doit être longuement préparé à l’avance ; et un système, notons-le également, qui, bien loin de condamner les relations homosexuelles, ou de se contenter de les tolérer, en fait une norme. Ajoutons pour finir que, sur O, la moietié et le sedoretu ne sont pas les seules institutions originales s’appliquant aux relations familiales : l’habitat est en outre collectif au-delà du seul sedoretu « nucléaire » (c’était plus ou moins le cas sur Géthen également, semble-t-il), sous la forme de groupes domestiques assez largement égalitaires pouvant faire penser à la zadruga autrefois pratiquée par les Slaves du Sud, mais préservant néanmoins l’intimité et l’individualité de tout un chacun… sans exclure pour autant, a fortiori dans le cadre du sedoretu, la pression du groupe. Et tout cela nous donne un cadre étoffé et cohérent, sur lequel Ursula Le Guin s’étend donc à travers deux nouvelles, qu’elle envisage elle-même comme des « comédies de mœurs » (p. 11). Pourquoi pas ? Dans « Un amour qu’on n’a pas choisi » (pp. 89-111), nous suivons essentiellement un jeune homme, étranger dans une communauté, confronté à la difficulté de choisir des partenaires pour former un sedoretu : lui est fou amoureux d’un garçon, mais c’est à quatre que l’on se marie, et il a bien du mal à s’intégrer… Une jolie nouvelle, étrangement teintée d’une légère coloration fantastique. J’y ai néanmoins préféré « Coutumes montagnardes » (pp. 112-141), variation originale sur l’amour impossible dans le cadre du sedoretu (sur une base à nouveau homosexuelle, mais lesbienne, cette fois), joli texte dont le cadre rural et montagnard, richement détaillé et pittoresque, m’a parfois rappelé l’étonnante Étude à propos des chansons de Narayama de Shichirô Fukazawa, superbement adaptée pour le cinéma par Shohei Imamura sous le titre de La Ballade de Narayama, en dépit d’une thématique bien différente et d’un ton incomparablement moins « dur »… A vrai dire, la nouvelle d’Ursula Le Guin n’est d’ailleurs pas dénuée d’une certaine frivolité, d’un certain humour en définitive, qui la rendent d’autant plus savoureuse.
La nouvelle suivante, « Solitude » (pp. 142-178), prend le contre-pied de ces deux récits. Autant O était caractérisée par une certaine promiscuité, et en tout cas un riche tissu de relations sociales, autant Onze-Soro réduit ces dernières à leur plus simple expression, à tel point que, pour bon nombre d’observateurs, il serait presque légitime de dire qu’il n’y a pas de société sur Onze-Soro. Sans doute l’histoire trouble de cette planète y est-elle pour quelque chose, quand bien même on ne saura jamais exactement comment on en est arrivé là : Onze-Soro est à l’évidence un monde post-apocalyptique, et son fonctionnement contemporain découle pour une bonne part du traumatisme causé par la catastrophe qui a anéanti l’ancienne société. Quoi qu’il en soit, hommes et femmes y vivent séparément : les hommes, élevés à la dure, s’isolent dans les déserts, tandis que les femmes vivent ensemble dans des « cercles de tantes » aux relations minimes. Il n’y a pas de couple formel, institutionnalisé : hommes et femmes ne se rencontrent qu’occasionnellement pour la reproduction (les femmes vont « prospecter »), et il est bien rare que des paroles soient échangées ; le risque est grand, en effet, de succomber alors à la « sorcellerie » de l’autre… L’individu semble valorisé par rapport à toute forme de groupe, et, par-dessus tout, l’introspection, la solitude, le détachement, certains diraient « l’indifférence »… Voilà qui ne facilite pas la tâche des observateurs de l’Ekumen : inutile d’espérer approcher les hommes, qui se montrent généralement agressifs ; quant aux femmes, elles ne se livrent pas davantage, et l’étrangère trop curieuse est bien vite ostracisée… La seule exception, ce sont les enfants. Et c’est pourquoi une ethnologue de l’Ekumen, Feuille, décide de s’installer sur Onze-Soro avec ses deux enfants, quitte à les instrumentaliser… Mais il y aura un prix à payer : sa fille Sénérité, la narratrice, sera ainsi élevée dans la culture d’Onze-Soro, jusqu’à ce qu’un fossé infranchissable s’établisse entre elle et sa propre mère. Une très belle nouvelle, à l’atmosphère lourde et perturbante, jolie variation sur la communication et l’acculturation où, pour une fois, c’est l’observateur qui s’abandonne à la culture observée.
Avec « Musique ancienne et les femmes esclaves » (pp. 179-241), on s’éloigne de la thématique des relations sexuelles et des institutions matrimoniales. C’est l’occasion de retrouver le monde de Werel, décrit dans Quatre Chemins de pardon, dont ce texte forme à certains égards la « cinquième nouvelle ». Postérieure aux autres, elle nous amène à suivre le calvaire de l’ambassadeur de l’Ekumen Musique Ancienne, emporté dans le chaos de la guerre civile, aux mains de factions radicales et prêtes à tout, dans le cadre d’une ancienne plantation largement abandonnée, mais où l’esclavage reste une réalité très concrète. Très différent des précédents, et nécessitant sans doute la lecture préalable de Quatre Chemins de pardon (disons au moins qu’elle est fortement conseillée…), ce récit cruel et désespéré ne manque cependant pas d’atouts, et marque durablement.
On retrouve la thématique des systèmes matrimoniaux, mais en-dehors du cadre de l’Ekumen (l’auteur dit que l’on pourrait éventuellement l’y rattacher, mais la – très – légère teinte de fantasy que l’on peut déceler dans ce texte me gêne quelque peu à cet égard – mais bon, je pinaille…), dans « L’Anniversaire du monde » (pp. 242-279). Ursula Le Guin s’est cette fois inspirée de sociétés anciennes (et en premier lieu de celle des Incas), pour livrer à nouveau un récit remarquablement subtil et détaillé. Dans ce monde anonyme, nous assistons, depuis la famille royale, à la décadence d’une théocratie, suite à des rivalités familiales et à une étrange prophétie. Le sacré imprègne ce texte, les personnages étant considérés comme d’essence divine : Dieu y est envisagé sous une forme double, le roi et la reine, son épouse, qui est également sa sœur ; Dieu-lui-même et Dieu-elle-même se voient confier le bon ordre du monde : ils peuvent lire l’avenir par-dessus l’épaule de l’autre, et la danse de Dieu-lui-même, lors de l’Anniversaire du monde, relance la course du soleil. Mais les enfants du couple royal / divin, dont la narratrice, destinée à devenir Dieu à son tour quand elle épousera son frère cadet à la mort de Dieu, sont eux aussi de nature divine, tabous, et par-là même coupés du monde. Le bouleversement global est joliment envisagé à travers cette cellule familiale hors-normes, distinguée du commun des mortels et ne connaissant pas le tabou de l’inceste. Une superbe nouvelle, incroyablement riche et juste (et, au passage, une belle réflexion, passablement libertaire, sur la religion et l’autorité).
Le recueil s’achève enfin sur une longue novella intitulée « Paradis perdus » (pp. 280-399), radicalement différente de tout ce qui a précédé, et ne s’intégrant « absolument pas » (p. 13) dans le « cycle de l’Ekumen » (quand bien même il n’y a pas à mon sens de contradiction essentielle). Il s’agit d’une variation sur un thème passionnant mais néanmoins éculé de la science-fiction : celui du vaisseau générationnel (ou « vaisseau-monde », ou « arche stellaire »…). J’avouais, au tout début, ne pas être certain d’y trouver grand chose d’intéressant : ce thème m’a toujours fasciné, certes, mais Ursula Le Guin pouvait-elle vraiment y apporter quelque chose, après (bien après !), notamment, Les Orphelins du ciel de Robert Heinlein et Croisière sans escale de Brian Aldiss ? Objectivement, pas grand chose de nouveau sous le so… sous l’éclairage artificiel ; mais le fait est que ça se lit très bien (et même vraiment très très bien) : les inévitables controverses philosophico-théologiques suscitées par le voyage y sont traitées avec une grande finesse et une profondeur que je n’avais probablement encore jamais rencontrée sur ce thème, le cadre est magnifiquement détaillé, les personnages sont humains et attachants, et les péripéties, quand bien même elles sont largement prévisibles (encore que...), n’en sont pas moins passionnantes (joli tour de force !) ; si l’on nage bien vite dans les complots, on reconnaîtra à l’auteur de ne pas verser excessivement dans le manichéisme (disons, plus exactement, que si la science est bien valorisée contre la religion, et s’il y a du « complot jésuite » dans l’air, les religieux ne sont pas pour autant présentés, soit comme des enflures, soit comme des victimes, mais comme des gens qui ont fait un choix finalement tout à fait défendable, et séduisant…) ; et j’ajouterai que la conclusion est d’une grande force, tout à fait poignante : le malaise qui suinte de ces pages est remarquablement bien rendu.
Alors, sans surprise, L’Anniversaire du monde est bien un excellent recueil, enrichissant encore l’extraordinaire « cycle de l’Ekumen » (et personnellement, j’en reprendrais bien volontiers…). La passionnante thématique des relations sexuelles et des institutions matrimoniales y est décortiquée avec adresse et profondeur ; le rappel de ce que ces relations et institutions ont de fondamentalement « social » (pour ne pas dire « juridique ») et non « naturel », contrairement à ce que certains ânes bâtés ne cessent de répéter, est par ailleurs fort bienvenu… Et l’on peut également y voir un bel éloge de la diversité des cultures et du relativisme, et en même temps une intéressante réflexion sur la coutume et le sacré. Du fait de son épure, je n’en ferais peut-être pas la meilleure porte d’entrée pour aborder ce monument de la science-fiction ; mais ceux qui ont déjà fait le premier pas ne pourront que se régaler avec cet excellent recueil.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



/image%2F1385856%2F20201027%2Fob_e27ed3_la-guerre-du-pavot.jpg)
/image%2F1385856%2F20200713%2Fob_a414dc_ecran-noir-04.jpg)
/image%2F1385856%2F20200618%2Fob_3ca18a_la-mort-du-fer.jpg)
/image%2F1385856%2F20200612%2Fob_f373f3_les-miracles-du-bazar-namiya.jpg)
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)
Commenter cet article