Contes d'un Rêveur, de Lord Dunsany
DUNSANY (Lord), Contes d’un Rêveur, [A Dreamer’s Tales], traduit de l’anglais par Anne-Sylvie Homassel, préface de Max Duperray, [illustrations de Sydney H. Sime], Rennes, Terre de Brume, coll. Terres Fantastiques, [1910] 2007, 143 p.
Contes d’un Rêveur est le quatrième petit recueil de Lord Dunsany que je lis, toujours chez Terre de Brume. Et, comme pour Les Dieux de Pegāna (surtout), Le Temps et les Dieux et L’Épée de Welleran, ce fut un régal absolu. Et, comme à chaque fois, naïvement peut-être, je me dis qu’il est proprement scandaleux qu’un auteur aussi brillant, à la voix aussi singulière, soit si peu édité et si peu lu aujourd’hui – il mérite pourtant bien qu’on s’y attarde, et plus encore… Étonnant paradoxe, tout de même, que Lovecraft soit aujourd’hui devenu, probablement, la principale porte d’entrée à l’univers de Dunsany (et c’est sans doute la même chose pour Arthur Machen et Algernon Blackwood, au moins). En tout cas, c’est bien ainsi que j’ai été attiré par Pegāna et compagnie – et je suis loin de le regretter. N’empêche : un auteur aussi extraordinaire mériterait bien qu’on le lise d’emblée pour lui-même…
Contes d’un Rêveur est un recueil d’allure étonnante, notamment en ce qu’il se montre très disparate – chose que j’avais déjà notée pour L’Épée de Welleran, mais qui me paraît encore plus frappante ici. Le recueil garde bien quelque chose de la fraîcheur onirique, teintée d’humour et baignée d’une fausse naïveté, des Dieux de Pegāna, mais au fil de textes relativement plus longs (même si aucun n’est long à proprement parler), et la dimension mélancolique que l’on pouvait déjà trouver dans Le Temps et les Dieux y est peut-être encore plus accentuée. Par ailleurs, Dunsany s’y accorde une grande liberté dans son choix des genres, au moins autant que dans le ton : les Contes d’un Rêveur sont tout à la fois des contes, oui, ou des allégories, ou des poèmes en prose, ou d’autres choses encore et tout ça à la fois. Et si la fantasy onirique domine relativement (« Poltarnees, qui surplombe la mer », « Bethmoora », « Jours oisifs sur le Yann », « La Ville paresseuse », « Dans Zaccarath »), elle se teinte un peu plus d’héroïsme à l’occasion (« Carcassonne »), tandis que d’autres textes résolument à part jouent de la carte d’un inquiétant fantastique maritime (« Le Pauvre Vieux Bill »), de l’anticipation horrifique peut-être pas science-fictive à proprement parler mais tout de même (« Là où la marée monte et se retire »), du récit des origines dans une préhistoire fantasmée (« L’Épée et l’idole »), en passant par un romantisme délétère (« La Folie d’Andelsprutz ») ou encore une touche décadente plus que jamais « fin de siècle », à l’aube d’un nouvel horizon imprévisible (« L’Homme au haschisch », qui entre cependant en résonance avec « Bethmoora ») – tandis que d’autres affichent tant leur singularité que l’on redoute de les classer où que ce soit, avançant éventuellement le qualificatif d’allégorie (« Blagdaross », « Les Mendiants », « Le Corps malheureux »), mais ne pouvant toujours le faire (« Le Champ », ou la satire « Le Jour du vote »)…
La dimension onirique est cependant affichée dès le titre, et Dunsany, régulièrement, balaie toute ambiguïté à ce sujet : il s’agit bien de rêves, et les habitants de ces rêves en sont d’ailleurs souvent conscients (dans « Jours oisifs sur le Yann », c’est explicite). Par ailleurs, il y a donc ce rêveur, qui emploie régulièrement la première personne dans ses pérégrinations oniriques, biaisant éventuellement la vision, mais à bon droit, affirmant ainsi sa personnalité ; car ce rêveur n’est pas nécessairement une abstraction : à bien des reprises, sans arborer son patronyme, il se révèle pour ce qu’il est – Dunsany lui-même. Dunsany qui évoque l’Irlande (« Jours oisifs sur le Yann ») ou arpente Londres (« Là où la marée monte et se retire », « Bethmoora », « L’Homme au haschisch », « Les Mendiants », « Le Champ »), et qui, hors de sa profession de rêveur, admet parfois être un écrivain (dans « L’Homme au haschisch », il rencontre un homme qui lui demande s’il est bien l’auteur de « Bethmoora » ; Dunsany acquiesçant, heureux de croiser un lecteur, l’homme lui dit alors quel est le fin mot de cette histoire…). Un écrivain, par ailleurs, qui a fait des rêves son domaine, accaparant ces contrées fantasques suscitées par son imaginaire débridé, mais qui semble par ailleurs comprendre, à regret, qu’il n’en sera peut-être pas toujours ainsi (dans « Jours oisifs sur le Yann », cette conclusion poignante : « Nous nous regardâmes longuement, sachant bien que nous ne nous reverrions pas, car mon imagination faiblit à mesure que le temps passe, et je vais de plus en plus rarement dans les Terres du Rêve. »).
Le recueil s’ouvre pourtant sur une belle pièce onirique, avec « Poltarnees, qui surplombe la mer », joli conte baigné d’une douce mélancolie, sur ces hommes des petits royaumes intérieurs, qui entendent un jour l’appel de la mer, au loin, et qui, parvenus à destination, s’absorbent dans sa beauté inégalée et ne reviennent jamais. Mais, tout en constituant une fort appréciable introduction, riche de souvenirs des précédents recueils, cette nouvelle ne doit pas induire en erreur quant à ce qui va suivre, et qui peut s’avérer très divers.
En témoigne aussitôt « Blagdaross », étonnant conte… à propos d’objets de rebut discutant de leurs hauts faits dans un terrain vague ! Mais le récit prend une tout autre dimension quand la corde évoque son pendu, puis quand hennit un cheval à bascule, qui a porté sur son dos bien des chevaliers avides de gloire, partis terrasser Saladin…
Je ne vais pas détailler ici toutes ces brèves nouvelles, mais me contenterai des meilleures à mon goût ; après les deux déjà citées, je passe donc directement à « Là où la marée monte et se retire », où l’étonnant supplice infligé à quelque traître à une cause indéfinie (il est enterré dans la boue des rives de la Tamise, où son cadavre ne connaît pas la paix ; et si la marée le délivre régulièrement, et si ceux qui le trouvent alors lui confèrent enfin une véritable sépulture, ses bourreaux pourtant, génération après génération, l’enlèvent à nouveau pour le rendre à la boue…) débouche sur un constat du temps passant et absorbant tout, dans un éternel et absurde mouvement.
« Bethmoora », à l’instar de plusieurs des contes ici rassemblés, traite d’une ville morte dans des circonstances mystérieuses, mais c’est probablement le plus réussi du lot, sans doute du fait de son appréciable ambiguïté – on notera donc qu’il se voit offrir plus loin un complément avec « L’Homme au haschisch », texte sans doute moins convaincant mais pas désagréable, insistant notamment sur la figure légendaire du détestable empereur Thuba Mleen.
Suit un gros morceau, si j’ose employer cette expression barbare, avec « Jours oisifs sur le Yann », qui est une des nouvelles les plus citées de l’aristocrate irlandais, et par ailleurs une des plus longues du recueil (avec « Carcassonne » un peu plus loin). C’est un récit de la plus pure veine onirique, avec cependant les bémols évoqués plus haut (faut-il y voir un quasi-adieu au genre ?) : le rêveur embarque sur L’Oiseau du Fleuve, avec la bénédiction de son aimable capitaine, pour un long périple sur le Yann, aboutissant à la porte du fleuve, ou Bar-Wul-Yann, là où le majestueux cours d’eau se noie dans la mer. Un voyage philosophique riche d’étapes fascinantes, où l’émerveillement est à son comble, sans exclure cependant une douce mélancolie. Incontestable réussite, d’un brillant délicieux. Je ne peux m’empêcher d’y voir un côté « Bateau Ivre » – peut-être à tort, mon ignorance en matière de polésie est notoire… Je suppose enfin que c’est là une inspiration essentielle de « The White Ship » de Lovecraft – une inspiration précise s’entend, l’influence globale de Dunsany sur ses récits dits des « Contrées du Rêve » est notoire (même s’il s’y était engagé avant de découvrir l’auteur irlandais).
Suivent quelques textes plus secondaires, sans doute, mais pas désagréables. Citons par exemple « L’Épée et l’idole », ou comment l’âge de pierre a pris fin – d’abord via une épée, ensuite via un dieu… « La Ville paresseuse », avec sa dîme de contes… « Le Pauvre Vieux Bill », qui joue de l’horreur maritime (alors, forcément mais peut-être naïvement, j’ai pensé à William Hope Hodgson)…
Mais il est encore un texte, bien plus long, qui écrase les vignettes l’environnant de son indéniable majesté, et c’est « Carcassonne ». Rien à voir avec la ville du sud-ouest de la France – Carcassonne, ici, nom dérivé d’une anecdote et sans doute prisé pour sa sonorité étonnante, est une cité imaginaire, dont la caractéristique essentielle est d’être inaccessible. Un prophète l’a bien dit au roi Camorak d’Arn : il n’ira jamais à Carcassonne. Le roi, dans son arrogance joviale, ses guerriers, dans leur servilité brute, comptent bien faire mentir cette provocation du Destin, et se lancent dans la quête de la ville impossible – une quête qui, après bien des années d’errance maudite, s’avèrera plus absurde encore que ce que l’on pouvait croire… « Carcassonne » est un très beau récit, à la puissance d’évocation remarquable, glissant de sa base de fantasy passablement héroïque vers la fable teintée d’absurde, que d’aucuns (Borges, semble-t-il ?) ont pu considérer comme quasi kafkaïenne. Au passage, je suppose que l’on peut voir dans ce récit célébré la source de la fameuse citation de Lovecraft, dans « He », écho de sa découverte fascinée de New York (ça n’allait pas forcément durer…) : « Then it had lighted up window by window above the shimmering tides where lanterns nodded and glided and deep horns bayed weird harmonies, and itself become a starry firmament of dream, redolent of faery music, and one with the marvels of Carcassonne and Samarcand and El Dorado and all glorious and half-fabulous cities. » Je m’étais toujours demandé ce que la ville médiévale restaurée par Viollet-le-Duc faisait dans cette liste… Peut-être est-ce donc plutôt le fantasme de Dunsany.
Les brèves nouvelles qui concluent le recueil sont globalement bien inférieures ; je relève cependant « Le Champ », plus qu’honnête – tandis que la satire un brin convenue de « Le Jour du vote » me paraît bien trop trancher sur le reste, et sans grande pertinence, constituant dès lors la seule vraie fausse note des Contes d’un Rêveur (encore que, un peu plus haut, la « perle de sagesse » de « Les Mendiants » puisse elle aussi faire cet effet, je suppose).
Mais globalement, ce petit recueil est bel et bien à la hauteur des précédents (même si je continue de placer Les Dieux de Pegāna tout au sommet de la pyramide). Riche de visions fantasques, bien servies par une plume souvent délibérément archaïque, qu’on devine plus que jamais sonore et aux appréciables accents bibliques (en même temps, si la Bible avait été écrite par Dunsany, j’en serais un lecteur autrement assidu…), laquelle plume est à son tour bien rendue par la traduction d’Anne-Sylvie Homassel, Contes d’un Rêveur me confirme dans la certitude que Lord Dunsany était bel et bien un immense auteur, à la voix sans pareille et fort d’une singularité rare. À lire et à relire – il faut le lire, et bien davantage encore…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)
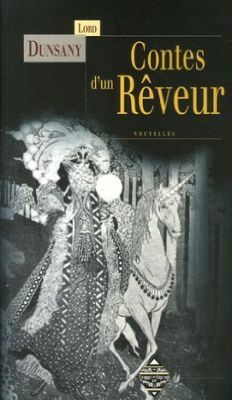


/image%2F1385856%2F20201027%2Fob_e27ed3_la-guerre-du-pavot.jpg)
/image%2F1385856%2F20200713%2Fob_a414dc_ecran-noir-04.jpg)
/image%2F1385856%2F20200618%2Fob_3ca18a_la-mort-du-fer.jpg)
/image%2F1385856%2F20200612%2Fob_f373f3_les-miracles-du-bazar-namiya.jpg)
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)
Commenter cet article