"Les Perséides", de Robert Charles Wilson

WILSON (Robert Charles), Les Perséides et autres nouvelles, [The Perseids and Other Stories], traduit de l'anglais (Canada) par Gilles Goullet, Saint Mammès, Le Bélial', [2000] 2014, 311 p.
Robert Charles Wilson est un auteur qui a beaucoup compté dans ma rééducation science-fictive ; après tout, je me suis attelé sérieusement au genre grosso merdo à l'époque de la sortie de Spin, à n'en pas douter un des meilleurs romans de SF de ces dernières années. Mais je crois cependant que le premier texte de l'auteur que j'ai lu était une nouvelle, en l'occurrence « Divisé par l'infini », qu'on retrouve dans le présent recueil, mais qui avait déjà été publiée par Bifrost en son temps. Cela dit, je n'avais quasiment aucun souvenir de cette nouvelle... si ce n'est celui de m'être pris une énorme baffe à sa lecture ; ce qui s'est vérifié en revenant dessus dans Les Perséides.
Je n'avais jusqu'à présent pas lu énormément de nouvelles de Robert Charles Wilson, cela dit ; quand le gros Mysterium est paru chez Lunes d'encre, je me suis empressé d'en faire l'acquisition... mais n'ai toujours pas trouvé le temps de m'y mettre. J'ai guetté cependant la parution au Bélial' de ces Perséides, que je sentais bien, ce qui s'est vérifié à la lecture. Autant le dire de suite : s'il n'est pas sans défauts, ce recueil me paraît néanmoins franchement brillant, et place Robert Charles Wilson parmi les meilleurs nouvellistes contemporains du genre, aux côtés de Ted Chiang et Greg Egan.
Il est toujours délicat de chroniquer un recueil de nouvelles ; on sombre aisément dans le catalogue, à vouloir détailler tous les textes par le menu, ce que j'aimerais éviter cette fois... Essayons donc de nous en tenir à la vue d'ensemble.
Neuf nouvelles. La science-fiction (ou le fantastique ? On en est parfois à la lisière, et certains textes relèvent assez clairement de l'horreur) y est généralement très légère, et se passe heureusement de l'attirail le plus tape-à-l'œil du genre. D'ailleurs, on pourra relever d'emblée qu'aucun de ces textes (avec une petite exception, certes phénoménale) ne se situe dans le futur : la SF, chez Wilson, se conjugue ainsi généralement au présent, parfois au passé, ce qui nous fait des vacances.
La SF y est donc très légère, mais il ne s'agit pas d'un vernis pour autant, elle est essentielle. On pourra d'ailleurs noter que, en dépit de la discrétion qui caractérise leur exposition, les idées fusent dans ce recueil. Souvent, un auteur se contente d'une idée par nouvelle, et je ne jetterais pas la pierre à cet auteur hypothétique, c'est déjà beaucoup. Mais dans certains de ces textes, Wilson balance facile une idée par page, nom de Dieu, ainsi dans « Les Champs d'Abraham », l'impressionnante nouvelle qui ouvre Les Perséides. On a de quoi être bluffé par une telle inventivité, d'autant qu'elle sait éviter le m'as-tu-vu.
Mais bon : présent ou passé, SF fondamentale mais discrète. Par ailleurs, la plupart de ces nouvelles se situent au Canada, et plus précisément à Toronto, la ville de l'auteur (qui fait d'ailleurs directement l'objet d'une des nouvelles, « La Ville dans la ville », mais on appréciera tout autant la finesse dans la description de certains quartiers, ainsi celui des immigrants au XIXe siècle dans « Les Champs d'Abraham »). Il y a cependant des exceptions. J'en relèverais notamment une, qui m'a bouleversé : « L'Observatrice », qui se déroule en Californie dans les années 1950, et fait intervenir quelques célébrités, dont l'astronome Hubble, qui se retrouve jouer le rôle d'une sorte de père de substitution pour une adolescente perturbée.
Ce qui nous amène à une caractéristique fondamentale de ce recueil, mais à vrai dire au-delà de l'ensemble de l'œuvre wilsonienne : sa profonde humanité. Si les idées de SF justifient les textes, on sent néanmoins que l'auteur ne peut s'empêcher de s'intéresser profondément aux relations (parfois houleuses) entre ses personnages. Le recueil fourmille ainsi de couples qui battent de l'aile (au mieux ; ce que j'ai trouvé d'ailleurs un tantinet lassant, si je puis me permettre...), d'amis qui se demandent s'ils en sont toujours, d'enfants plus ou moins délaissés, etc. On le devine : ce questionnement de l'humain n'est pas spécialement joyeux...
Les nouvelles sont par ailleurs (vaguement) liées entre elles, par des lieux (Toronto, donc, mais surtout, plus précisément, la librairie d'occasion Finders la bien nommée) ainsi que par des personnages (Oscar Ziegler, Deirdre Frank). Il ne faut sans doute pas y attacher trop d'importance : ces liens n'excluent pas des contradictions, à vrai dire guère gênantes. Il ne faut simplement pas voir en Les Perséides un fix-up à proprement parler. Cela participe néanmoins de son atmosphère singulière, et renforce l'impression d'unicité qui en émane. Au-delà, en effet, des lieux et des personnages, les nouvelles de ce recueil sont liées par leurs thèmes et leurs approches, cette SF délicate et discrète qui n'en est pas moins riche, et qui accompagne sans jamais de conflit l'humanité essentielle des Perséides. Le recueil explore la psyché humaine, d'une part, et, d'autre part, développe des interrogations philosophiques aussi passionnantes que subtiles sur la place de l'homme dans l'univers, illustrées soit par de passionnantes dissertations qui peuvent être aussi bien théologiques que scientifiques, soit par des hommages un peu plus poussés à la science-fiction « classique » et à ses questionnements « traditionnels ».
Une note, cependant : la quatrième de couverture place ce recueil sous « l'ombre des grands maîtres tutélaires de l'œuvre wilsonienne : Jorge Luis Borges, Howard Phillips Lovecraft et Clifford D. Simak en tête ». Je suis sceptique, il faut quand même se livrer à quelques contorsions pour repérer de ces trois auteurs illustres dans Les Perséides... Va pour Borges, à la limite, dans la discrétion, la subtilité, les questionnements philosophiques, admettons ; Lovecraft, c'est déjà plus dur (ne vous attendez certainement pas à voir débarquer Cthulhu et ses petits camarades – tant mieux, d'ailleurs), même si l'on peut peut-être s'attacher à cette horreur métaphysique qui oscille entre fantastique et science-fiction ; Simak, bof, bof, même si l'humanité caractérise aussi l'auteur entre autres de Demain les chiens (ou de Voisins d'ailleurs et Frères lointains, pour citer deux titres également parus au Bélial'), mais l'importante dimension urbaine des Perséides me gêne un peu en l'espèce. Pour ma part, s'il faut à tout prix jouer ce jeu des références, je crois que je dirais Theodore Sturgeon (voyez ici)...
Quoi qu'il en soit – après tout il me paraît plus profitable de mettre en avant la singularité de l'auteur et de ce recueil plutôt que de le caser à tout prix dans une tradition, une filiation –, Les Perséides m'a fait l'effet d'un recueil tout à fait brillant, d'une intelligence, d'une subtilité et d'une délicatesse rares. Une science-fiction exemplaire, dans un sens (même si on est libres, hein) : elle donne l'impression de ne pas trop en faire, en délaissant notamment la quincaillerie, mais, sous le vernis psychologique et humain, soulève des lapins pilosophico-scientifiques qui ont de quoi faire tourner la tête : le sense of wonder est là et bien là, mais au détour d'une conversation où est émise telle ou telle idée qui met à mal les conceptions traditionnelles ; inutile de faire péter les big dumb objects (même si l'auteur en a joué avec une grande astuce dans ses romans, Spin en tête). Avec des personnages profondément humains (et donc tourmentés) qui papotent, Robert Charles Wilson suscite l'émerveillement science-fictif ou la terreur métaphysique qui va de pair. C'est fort, très fort.
Un très bon recueil, donc, et une nouvelle réussite pour le Bélial', qui assure vraiment ces derniers temps (et je dis pas ça pour faire de la lèche, c'est on ne peut plus sincère).
EDIT : Gérard Abdaloff est un peu confus quand il en cause, là.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





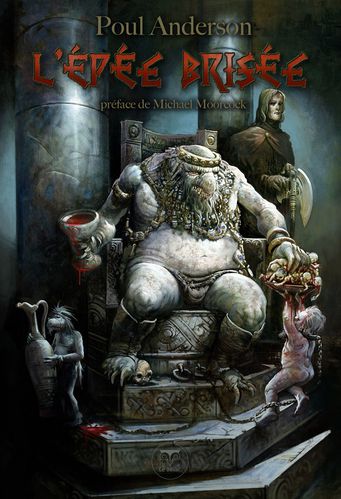
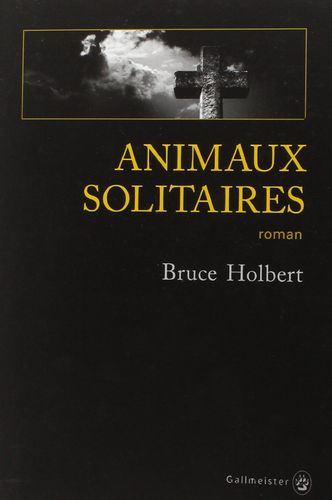
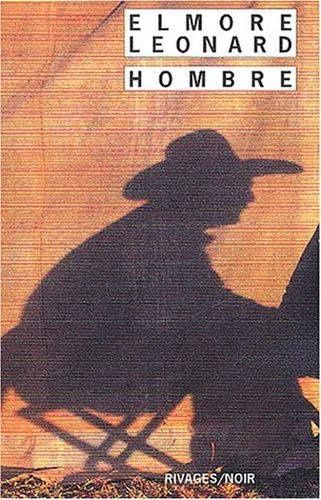



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)