CR Imperium : la Maison Ptolémée (29)
Le Navigateur Iapetus Baris, représentant de la Guilde Spatiale sur le marché-franc de la lune de Khepri.
Vingt-neuvième séance de ma chronique d’Imperium.
Vous trouverez les éléments concernant la Maison Ptolémée ici, et le compte rendu de la première séance là. La séance précédente se trouve ici.
Tous les joueurs étaient présents, qui incarnaient donc Ipuwer, le jeune siridar-baron de la Maison Ptolémée, sa sœur aînée et principale conseillère Németh, le Docteur Suk Vat Aills, et l’assassin (maître sous couverture de troubadour) Bermyl.
I : TIRER LE BILAN, PRÉVOIR LA SUITE
[I-1 : Ipuwer, Bermyl, Németh, Vat] Ipuwer et Bermyl sont au Palais de Cair-el-Muluk, où ils tirent le bilan de la catastrophe, une fois l’alerte tombée (soit aux environs de 23h ou minuit). Németh, quant à elle, se trouve au relais de chasse de Darius, au nord-est de Memnon, avec les invités de la Maison Ptolémée et quelques notables. Tenue au courant des événements durant son voyage en ornithoptère, sitôt arrivée, après une brève allocution destinée à rassurer ses compagnons de voyage, elle s’isole dans une pièce pour entrer en communication radio avec le Palais – dès lors, c’est comme si elle se trouvait avec Ipuwer et Bermyl. Le Docteur Suk Vat Aills, quant à lui, est encore en route – il vient de monter à bord d’un ornithoptère à la base du Mausolée, sur le Continent Interdit, et survole actuellement l’océan à l’ouest de Cair-el-Muluk ; sitôt arrivé, il se joindra aux autres.
[I-2 : Ipuwer, Bermyl : Vat Aills, Apries Auletes, Ngozi Nahab] Ipuwer et Bermyl, d’ici-là, font le point sur les informations reçues – et tout d’abord le bilan des victimes dans les grandes villes : on compte plusieurs milliers de morts à Cair-el-Muluk, le nombre précis est encore à déterminer ; il s’agit pour l’essentiel de victimes des mouvements de panique et des bousculades, puisque le tsunami n’a finalement pas frappé la ville ; néanmoins, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans une agglomération clairement pas conçue pour affronter ce genre de catastrophes impensables – si la partie « somptuaire » de la ville, soit le Palais, le Sanctuaire d’Osiris, et les jardins qui les ceinturent, n’a pas été vraiment affectée, plusieurs zones des quartiers populaires sont quant à elles sous les eaux, ce qui les rend inhabitables et pourrait présenter des risques sanitaires : au Docteur Suk de prendre en charge la situation (déjà, en vol, il réfléchit aux mesures à prendre – aux effectifs à déployer, à la mise en place de point de ravitaillement et de traitement, à la sécurisation des points d’eau, à la prévention des épidémies...). La situation est bien moins préoccupante à Heliopolis : il y a eu des victimes, mais moins d’une centaine ; là encore, il s’agissait de mouvements de panique, mais d’une ampleur bien moindre qu’à Cair-el-Muluk, puisque seulement provoqués en écho de ce qui se passait là-bas – la tempête n’a jamais véritablement menacé la capitale administrative. Ce qui peut s’avérer préoccupant, sur place, c’est la manière dont la crise a été gérée : le chef de la police, Apries Auletes, s’est avéré totalement inefficace (sans doute parce qu’il avait peur… pour lui), et ce sont en définitive les hommes de Ngozi Nahab, autant dire la pègre, qui ont fait régner l’ordre dans la ville... Mais les pertes les plus lourdes ont été subies en dehors de ces grands centres urbains, dans les archipels à l’est de Cair-el-Muluk et au nord-ouest d’Heliopolis, qui ont eux été balayés par le tsunami ; la zone n’est guère peuplée, mais il s’y trouve tout de même nombre de villages de pêcheurs, et les premiers ornithoptères à avoir survolé la zone après la levée de l’alerte ont fait état d’une situation apocalyptique…
[I-3 : Ipuwer, Vat, Bermyl : Ngozi Nahab] Se pose la question des camps de réfugiés, à Cair-el-Muluk, car il faut prévoir l’hébergement temporaire des victimes qui ne sont pas en mesure de regagner leurs quartiers inondés – ce qui inclut nombre de logements tout simplement inhabitables, même si les destructions au sens propre sont finalement assez rares ; il faut cependant compter avec des fondations fragilisées, etc. Outre les infrastructures, telles que les égouts qui ont débordé, autre problème à prendre en compte... Il est difficile pour l’heure de chiffrer les besoins – mais, dans l’immédiat, on peut tabler sur 500 000 personnes qui auraient besoin d’un hébergement d’urgence, à très court terme : une fois les inondations jugulées, l’affaire de quelques jours en principe, le nombre des réfugiés devant rester dans les camps tombera sans doute à 50 000 personnes, 100 000 au plus. Les jardins semblent appropriés pour établir ce genre de campements temporaires (éventuellement aussi les cours du Sanctuaire d’Osiris et du Palais qui accueillent encore les femmes et les enfants suite à la décision d’Ipuwer). L’urgence de la situation, et les capacités limitées de réaction de la Maison Ptolémée en l’espèce, compliquent la tâche… Il y a bien, à ce moment même, 500 000 personnes sans logis à Cair-el-Muluk, en proie à la nuit froide et à la pluie inhabituelle, dans les jardins, le Palais et le Sanctuaire ! Dans l’immédiat, ce sont des moyens militaires qui vont être déployés ; mais ça ne suffira pas – il faudra faire appel à des aides extérieures : on envisage des « appels d’offre », dans l’urgence, mais Ipuwer suppose que le plus efficace dans l’immédiat serait de faire appel directement… à la Maison mineure Nahab, qui n’aurait certes aucun scrupule à tirer profit de la situation – Ipuwer lui-même dira à Ngozi Nahab qu’il pourra sans doute, le moment venu, tirer de juteux profits de la reconstruction… et il a déjà des fantasmes haussmanniens et somptuaires en tête ! Ceci étant, la ville n’est pas détruite, loin de là, elle n’est pas à reconstruire intégralement… Vat approuve cette politique : ce serait un très bon moyen de s’assurer la fidélité de la Maison mineure Nahab durant cette période de crise – car les Ptolémée ne peuvent se l’aliéner : un prétexte tout trouvé, donc ! Et le Docteur Suk serait à vrai dire tout disposé à jouer de la table rase dans les quartiers les plus populaires et insalubres, des nids à vermine… Il est très optimiste, au fond, Ipuwer en fait même la remarque – non sans une vague gêne ? Mais il est vrai que Vat n’a pas assisté au phénomène et à la panique qu’il a suscité, à la différence d’Ipuwer et Bermyl… Dans l’immédiat, cependant, le Docteur Suk relève aussi que, outre ces campements dans les jardins, on peut sans doute abriter une partie de la population réfugiée dans des bateaux attachés au port de Cair-el-Muluk – c’est effectivement une solution bien pensée, et qui plaît à Ipuwer, même si, suite au traumatisme de la tempête, certains des habitants de la ville rechignent à s’installer ainsi sur la mer…
[I-4 : Bermyl, Ipuwer : Taho, Vat Aills, Elihot Kibuz, Kiya Soter, Németh, Hanibast Set] Se pose aussi, bien sûr, la question de la sécurité : Bermyl rappelle les soucis de loyauté dans ses services, et son manque d’agents fiables – a fortiori depuis la mort du fidèle Taho (dont il a fait transférer le cadavre dans les services du Docteur Suk)… Il lui faut retrouver des agents fiables, et il va s’atteler à la tâche ; mais, d’ici-là, il ne quittera pas Ipuwer d’une semelle. Le risque d’assassinat est non négligeable en cette période, et, d’ailleurs, on a tenté de tuer Bermyl via Taho, quelques heures à peine plus tôt ! Ipuwer en convient – que Bermyl mène son enquête, et, s’il le juge bon et dispose de preuves convaincantes, on se débarrassera d’Elihot Kibuz, plus suspect que jamais ; Ipuwer aimerait le faire parler, mais si Bermyl doit le tuer, qu’il n’hésite pas ! Maintenant, organiser une épuration en pleine crise risque d’être très problématique, et cela pourrait aggraver encore la situation… En même temps, sous le coup de la panique, les agents déloyaux pourraient commettre des erreurs dont il serait possible de tirer parti. Enfin, la sécurisation de la ville et du Palais est aussi une question militaire : il faut y associer le général Kiya Soter. Et, d’ores et déjà, rapatrier des troupes, plus utiles à Cair-el-Muluk que partout ailleurs – ainsi celles de la base du Mausolée sur le Continent Interdit.
[Je demande alors des jets à chaque PJ, en guise d’actions longues : Sécurité pour Bermyl, Stratégie pour Ipuwer, Médecine pour Vat Aills, et Lois pour Németh (à défaut de Commerce, l’apanage du Conseiller Mentat Hanibast Set, encore indisponible), pour voir comment ils gèrent la crise en tâche de fond. La réussite de Vat en Médecine garantit une situation sanitaire au pire correcte dans les jours qui viennent ; les autres jets sont bons sans être exceptionnels, ils appelleront à être complétés sans bonus ni malus en fonction des actions précises entreprises.]
[I-5 : Bermyl, Ipuwer] Bermyl fait aussi la remarque à Ipuwer qu’il ne faut pas laisser l’avantage en matière de communication à leurs adversaires… Il faut se rallier la population, en lui faisant comprendre qui sont ses véritables ennemis ! Ipuwer le sait bien, il l’avait prévu – sans doute lui faudra-t-il parler lui-même à son peuple… même s’il déteste cet exercice pour lequel il sait ne pas être doué.
[En termes de jeu, Ipuwer a beau être un noble et même le siridar-baron de sa Maison, il est totalement inepte en matière sociale – il ne dispose d’aucune Compétence en l’espèce, à l’exception d’un Niveau de Maîtrise de 4 en Étiquette, qui est en soi déjà insuffisant pour son rôle ; en pareille affaire, c’est encore pire, puisqu’il ne peut se reposer que sur son score de 2 en Aura, sans Compétence liée… Ce handicap est en fait une dimension essentielle du personnage.]
[I-6 : Ipuwer : Abaalisaba Set-en-isi, Németh, Suphis Mer-sen-aki, Hanibast Set] Il lui faudra prononcer un discours dans la journée du lendemain ; incapable de l’écrire lui-même, il devra se reposer pour ce faire sur quelqu’un d’autre – en l’occurrence, même si la décision ne sera prise que bien plus tard, il s’agira en définitive d’Abaalisaba Set-en-isi (Németh et le grand prêtre Suphis Mer-sen-aki avaient d’abord été envisagés, avec l’assistance d’Hanibast Set) ; or Abaalisaba, même surchargé de travail ces derniers jours, est toujours à même de faire des merveilles !
[Concrètement, Abaalisaba obtient un score proprement exceptionnel de 10 succès à son jet de Rhétorique ! Mais Ipuwer n’a pas son aisance pour s’exprimer : même sur la base d’un discours aussi parfait, même en prenant la précaution d’éviter de s’exprimer en direct, en définitive, l’Aura limitée d’Ipuwer pourra anéantir tous ces efforts… On verra bien lors de la prochaine séance ; par ailleurs, j’ai demandé au joueur incarnant Ipuwer de rédiger lui-même un bref discours.]
[I-7 : Ipuwer, Németh, Vat : Hanibast Set] Ipuwer et Németh se posent aussi la question, plus que jamais pressante, du retour du Conseiller Mentat Hanibast Set – isolé dans une institution de repos à quelque distance de Memnon par ordre du Docteur Suk Vat Aills, afin d’y récupérer de son « gel du Mentat »… Il n’est pas totalement remis, ses capacités ne sont pas optimales, mais, devant la gravité de la situation, et quoi qu’en disent les soignants, il décide de lui-même de retourner à Cair-el-Muluk pour faire bénéficier la Maison Ptolémée de son assistance.
II : CE QU’IL EN EST DE LA GUILDE
[II-1 : Németh : Iapetus Baris] Németh, ulcérée par le comportement de la Guilde dans cette affaire, considère qu’il est bien temps de tirer les choses au clair, et donc d’avoir une petite conversation avec le Navigateur Iapetus Baris, représentant de la Guilde Spatiale sur le marché-franc de la lune de Khepri.
[II-2 : Németh : Iapetus Baris] Mais Németh aimerait « court-circuiter » Iapetus Baris, même si elle doute de pouvoir le faire, car il est le plus haut gradé de la Guilde sur place, pour autant qu’elle sache, et elle ne dispose pas d’autres contacts ; toutefois, un rapport lui avait fait part que deux Navigateurs anonymes s’étaient rendus sur la lune de Khepri il y a quelque temps de cela… Mais comment les joindre, le cas échéant ? Ils pourraient être d’un grand secours, dans l’hypothèse où ils seraient des représentants sur place de la Guilde intègre, et Iapetus Baris seulement un agent d’une faction interne corrompue, sur lequel ils seraient venus enquêter… Mais ce n’est qu’une hypothèse : au fond, la Maison Ptolémée n’en sait absolument rien.
[II-3 : Ipuwer, Németh : Iapetus Baris] Mais ce serait un pari, quitte ou double, qui permettrait peut-être d’être fixé sur la question – Ipuwer suggère qu’une visite très démonstrative et en grande pompe pourrait décider ces Navigateurs anonymes à contacter Németh, car ils en auraient forcément vent. Iapetus Baris, à l’évidence, prohibera tout contact direct du fait de ses prérogatives, mais ce serait un moyen indirect de s’entretenir quand même avec eux, et d’en savoir un peu plus quant aux éventuelles factions au sein de la Guilde Spatiale.
[II-4 : Németh, Ipuwer : Nathifa, Mandanophis Darwishi, Abaalisaba Set-en-isi ; Iapetus Baris] Mais le timing est important dans cette affaire ; ils en discutent, et décident enfin que Németh se rendra sur Khepri et s’entretiendra avec Iapetus Baris (au moins…) avant que le discours d’Ipuwer ne soit diffusé par radio dans tout Gebnout IV, dans la journée du lendemain (probablement en milieu de journée, éventuellement dans la soirée, mais ce serait peut-être jugé un peu tardif dans ce cas). Németh quitte donc Darius pour se rendre à Heliopolis, et y monter à bord d’un vaisseau d’interface pour gagner Khepri (ce qui devrait prendre au moins six heures). Elle fait brièvement ses adieux à ses « invités », les rassure quant à leur prochain rapatriement à Cair-el-Muluk, confie à un des rares militaires sur place, la commandante Nathifa, la tâche de les chaperonner (pour rien au monde elle ne laisserait Mandanophis Darwishi s’en occuper), et à Abaalisaba Set-en-isi, pourtant surchargé, la tâche de travailler sur les contrats liant la Maison Ptolémée à la Guilde. Quatre heures plus tard, arrivée à Heliopolis, elle prévient cette dernière de sa visite (officiellement ; officieusement, la Guilde le savait déjà, puisqu’elle gère les vaisseaux d’interface entre Heliopolis et Khepri).
[II-5 : Ipuwer, Bermyl : Németh, Iapetus Baris] À Cair-el-Muluk, et quoi qu’en dise Bermyl, Ipuwer ne pense décidément pas avoir grand-chose à craindre, aussi ordonne-t-il finalement à son maître assassin réticent de gagner lui aussi Heliopolis pour assurer la protection de Németh sur Khepri (il n’a aucune confiance en « ce con de Baris »…) ; ils se rejoindront à l’astroport, où ils arriveront en gros en même temps. Bermyl renâcle un peu, mais obéit, après avoir désigné deux gardes du corps qu’il suppose fiables, chargés de suivre partout Ipuwer.
III : LES MAÎTRES D’HELIOPOLIS
[III-1 : Ipuwer : Bermyl, Apries Auletes, Németh, Iapetus Baris] Sitôt Bermyl parti, Ipuwer contacte Apries Auletes à Heliopolis. Il explique au chef de la police que Németh va arriver, et qu’il faut assurer sa sécurité à l’astroport. Mais Ipuwer ne veut pas d’un protocole « discret » : il s’agit cette fois de faire sentir qu’un personnage important va arriver, et se rendre officiellement sur Khepri, en grande pompe même – expressément, pour dénoncer la responsabilité de la Guilde et plus particulièrement de Iapetus Baris dans la catastrophe qui vient de se produire. Apries Auletes sait qu’il n’a pas été à la hauteur lors de la tempête, et cela ressort dans son comportement : à ce stade, il n’est même plus mielleux, mais très obséquieux, et sa consommation de zha ne suffit pas à masquer sa nervosité.
[III-2 : Ipuwer : Ngozi Nahab ; Apries Auletes] Après quoi Ipuwer contacte Ngozi Nahab, à Heliopolis également, et lui tient le même discours, à ceci près qu’il le félicite en outre pour sa « gestion de l’événement… ou plutôt du non-événement ». Il sait que la Maison mineure Nahab est désormais en position de force dans la ville – et Ngozi Nahab sait qu’il le sait… Il impute devant lui également la responsabilité du drame à la Guilde. Mais c’est le jour et la nuit, par rapport à Apries Auletes : Ngozi Nahab est digne, froid, austère, compétent… et un peu inquiétant aussi – comme il a toujours été. Ipuwer essaye de lui faire croire que la menace ayant pesé sur Heliopolis, de la part de la Guilde, était délibérément dirigée contre la Maison mineure Nahab, mais il n’est guère doué pour ce genre de subterfuges, même s’il s’applique ; Ngozi Nahab n’y croit pas deux secondes. Il ne s’embarrasse pas de répondre, d’ailleurs – de manière générale, il ne le fait pas s’il n’y a pas absolue nécessité ou demande expresse. Mais Ipuwer devine son avis sur la question ; il devine aussi que le chef de la Maison mineure Nahab n’a pas manqué de noter que le siridar-baron s’adressait maintenant directement à lui, plutôt que de passer par Apries Auletes en guise d’intermédiaire avec la pègre… D’ailleurs, Ipuwer conclut sa communication en disant qu’il « ne sera pas oublié » quand il faudra songer à la reconstruction, à Cair-el-Muluk – et cette fois Ngozi Nahab laisse passer, délibérément à l’évidence, un large sourire.
IV : UN POISON
[IV-1 : Vat] Vat Aills a convoqué à Cair-el-Muluk des médecins compétents pour s’occuper des questions sanitaires et épidémiologiques dans la capitale, qu’il déploie afin de quadriller au mieux les zones sensibles – il faut porter une attention particulière aux points d’eau. Ses bons réflexes en arrivant, et sa capacité à s’entourer de médecins compétents, jouent en sa faveur, mais il n’est guère formé à gérer des opérations de cette ampleur : ça devrait aller, mais quelques délais sont sans doute à envisager.
[IV-2 : Vat : Taho ; Bermyl] Mais Vat a d’autres tâches à effectuer – et il lui faut notamment se livrer à un examen du cadavre de Taho (qui avait été déposé à la morgue dans ses services ; dans l’agitation de la tempête, personne ne s’en est encore occupé) ; le Docteur Suk connaît les circonstances de la mort du loyal agent en raison du rapport de Bermyl – il s’est précipité sur lui dans la rue, l’air affolé, s’est effondré dans ses bras et a rendu son dernier soupir ; Vat sait aussi que Bermyl a été affecté par le poison responsable de la mort de Taho, mais trop faiblement pour que cela présente un réel danger – la mithridatisation à laquelle se livre le maître assassin a pu le protéger ; hélas, Bermyl est parti pour Heliopolis sans que le Docteur Suk ait pu lui prélever du sang ou d’autres échantillons… Cela peut laisser supposer une transmission cutanée – mais on peut envisager des modes plus précis, le sang, la transpiration, etc.
[IV-3 : Vat : Taho ; Bermyl] Vat avait pu croiser Taho dans le Palais : un beau jeune homme, aux traits quelque peu androgynes, voire elfiques… Le cadavre témoigne cependant de son empoisonnement, au-delà de la rigor mortis : il a les traits tirés, des rides marquent son front, le pourtour de ses yeux est très sombre, et ses veines, sur tout son corps, ressortent, bleues et saillantes (ce dernier symptôme était également sensible chez Bermyl, mais pas les autres). Mais impossible de déterminer quoi que ce soit sur la base de ces seuls symptômes très apparents, même s’ils vont dans le sens d’un principe de transmission cutanée.
[IV-4 : Vat : Bermyl, Elihot Kibuz] Vat se livre donc à un examen plus approfondi. Très vite, sans même identifier très précisément le toxique, il peut supposer qu’il n’y a pas lieu de redouter un poison particulièrement rare : ces symptômes laissent plutôt envisager l’emploi d’une substance somme toute banale (plusieurs pourraient correspondre), ce qui ne rendra que plus difficile la tâche de désigner un mode opératoire particulier – propre à telle Maison, par exemple ; ceci, de toute façon, ne serait pas du ressort du Docteur Suk, mais plutôt de Bermyl (évidemment, Elihot Kibuz, en tant que principal suspect, est hors-jeu…). Ce poison mis à part, comme de juste, le corps de Taho était celui d’un jeune homme en bonne santé. L’examen du Docteur Suk n’a guère d’autres résultats médicaux à livrer – et l’approche plus « policière » ne donne pas grand-chose, Vat ne sait pas dans quelle direction chercher.
[IV-5 : Vat : Taho ; Bermyl] Cependant, les poisons qui pourraient correspondre, à la connaissance du Docteur Suk, ont un effet rapide, et Bermyl n’a donc rien à craindre maintenant : si le poison avait dû le tuer, il l’aurait déjà fait. Par contre, on peut supposer que l’empoisonnement de Taho avait sans doute été calibré pour affecter aussi Bermyl – la durée, peut-être, et la résistance aux poisons du maître assassin, lui ont permis de s’en tirer à bon compte, mais il était probablement une cible indirecte.
[IV-6 : Vat : Bermyl, Hanibast Set] Vat sait qu’il n’en tirera rien de plus – pour l’heure, du moins. Il rédige un rapport à destination de Bermyl (qui est en route pour Khepri), mais aussi pour Hanibast Set – le Docteur Suk suppose que les capacités de déduction du Conseiller Mentat pourraient s’avérer utiles pour en savoir davantage.
[IV-7 : Vat, Ipuwer] Vat retourne ensuite à ses tâches d’ordre sanitaire – en liaison avec Ipuwer, qui gère (avec compétence, si guère d’autorité) le rapatriement des troupes du Mausolée et des autres bases temporaires dont le maintien n’est pas prioritaire en cette heure de crise ; il s’adjoint les services de Kiya Soter à cet effet.
[IV-8 : Vat : Ipuwer, Anneliese Hahn] Quand Vat lui fait son rapport, Ipuwer l’enjoint aussi à se rendre au chevet d’Anneliese Hahn, ce qu’il fait aussitôt. Un examen médical superficiel confirme qu’elle n’a pas de blessures physiques – tout au plus quelques égratignures. Sur ce plan, elle est en parfait état. Au moral, c’est autre chose… Mais son état empêche d’en savoir plus pour l’heure ; elle a de toute évidence besoin de repos, et le Docteur Suk lui donne un tranquillisant. Il redoute une chose, cependant – s’agit-il bien de « la vraie » Anneliese Hahn, de « l’originale » ? Un examen plus approfondi serait nécessaire pour avoir une certitude à cet effet, examen auquel il ne peut pas se livrer maintenant.
V : UN POISSON
[V-1 : Németh, Bermyl : Apries Auletes, Ipuwer, Iapetus Baris] Après la poussée d’adrénaline qui les avait maintenus éveillés jusqu’alors, Németh et Bermyl, conscients que leur corps ne pourra pas encaisser longtemps pareil surplus d’activité, profitent de leurs voyages respectifs à destination d’Heliopolis, de quatre heures environ, pour se reposer un peu. Ils arrivent peu ou prou en même temps à l’astroport, où Apries Auletes a suivi à la lettre les consignes d’Ipuwer. La Guilde, avertie de la venue de Németh et Bermyl, a tenu à leur disposition un vaisseau d’interface spécial, et ils montent à bord, direction la lune de Khepri… et un entretien tendu avec Iapetus Baris.
[V-2 : Németh, Bermyl : Iapetus Baris, Ra-en-ka Soris, Ipuwer] Montés à bord de la navette à destination de Khepri, Németh et Bermyl discutent de leur approche. Németh doit rencontrer Iapetus Baris – mais ce sera un entretient de pure forme, car chacun sait très bien ce qu’il en est. Peut-être Bermyl devrait-il alors enquêter auprès de Ra-en-ka Soris ? Toute information serait bonne à prendre – mais tout particulièrement concernant les deux mystérieux Navigateurs qui s’étaient rendus sur Khepri il y a quelque temps de cela… Bermyl a cependant de nombreuses questions de sécurité en tête, et souhaite veiller sur Németh – il ne pense pas que la Guilde, ou du moins Baris (car il ne conçoit par ailleurs pas que la Guilde puisse être « inféodée » au Bene Tleilax), tentera quoi que ce soit ici, mais, dans ces circonstances, on n’est jamais trop prudent… Il souhaite donc accompagner Dame Németh auprès du représentant de la Guilde Spatiale ; ils pourront voir Ra-en-ka Soris ensemble par la suite – elle a beaucoup de choses à voir avec lui, il serait regrettable que Bermyl soit seul à s’entretenir avec le chef de la Maison mineure marchande Soris… Par ailleurs, la « couverture » de Bermyl ne leurre certainement pas la Guilde, il n’a rien à perdre à cet égard. Németh est d’abord hésitante, mais se plie enfin aux recommandations de son maître assassin. Mettre ainsi en avant que la Maison Ptolémée « se méfie » pourrait d’ailleurs inciter des éléments « secrets » (les Navigateurs anonymes ?) à passer à l’action et à les contacter ? C’était ce qu’Ipuwer pensait...
[V-3 : Németh, Bermyl : Iapetus Baris, Ipuwer, Ra-en-ka Soris, Vat Aills, Soti Menkara, Ngozi Nahab] Difficile de « présager » grand-chose concernant Iapetus Baris (Bermyl est cependant convaincu que le Navigateur a, de son côté, prévu leur visite, et la possibilité qu’ils « déballent tout », comme Ipuwer le leur avait suggéré avant leur départ)… mais Németh et Bermyl profitent de ce trajet pour faire le point concernant Ra-en-ka Soris et l’aide qu’il pourrait leur apporter. Le vieux bonhomme s’est toujours montré très sympathique à leur égard (Németh et Vat lui ont rendu visite à plusieurs reprises), loyal (même s’il faut prendre en compte son rapprochement récent avec Soti Menkara contre Ngozi Nahab ; cela n’affecte pas directement ses relations avec la Maison Ptolémée mais c’est tout de même un aspect à prendre en compte – en relevant que, dans cette affaire, Soris n’était visiblement pas très enthousiaste et donnait à tout prendre l’impression d’un homme à qui on avait forcé la main…), et éventuellement de bon conseil. Mais Németh et Vat ont eu l’occasion de percevoir une dimension déconcertante du personnage – qui est certes un bon marchand, mais relativement aveugle sur les plans social et politique : un peu « autiste », Ra-en-ka Soris est souvent totalement inconscient de ces réalités qui le dépassent – ou, plus exactement, il n’en mesure pas la portée, généralement. Il bénéficie par contre d’une force de concentration et d’une capacité de calcul, disons, hors du commun (pour un non-Mentat, mais sans doute use-t-il de divers expédients pour accroître encore ses capacités de calcul et de projection, des drogues notamment) : s’il est un bon marchand, c’est parce qu’il sait compter. Mais il est aux premières loges, sur Khepri : peut-être ne pensera-t-il pas de lui-même à « révéler » des choses importantes – mais, en le « guidant », il devrait être possible d’en retirer bien des informations intéressantes : il faut simplement le mettre sur la bonne voie – les Ptolémée ont eu l’occasion de voir ce que cela pouvait donner concernant les « cargaisons disparues ».
[V-4 : Németh, Bermyl : Iapetus Baris] Németh et Bermyl arrivent sur Khepri. Sans plus attendre, ils se rendent très officiellement à la représentation de la Guilde sur le marché-franc, exigeant de voir Iapetus Baris. Mais le Navigateur et ses services, à leur habitude, les font d’abord patienter un bon moment… Leur moyen habituel de rappeler qui est le maître, ici. Németh n’est pas reçue avant trois quarts d’heure – durant lesquels elle fulmine et ne cesse d’interpeller les agents de la Guilde, afin de susciter le scandale ; ce qui ne produit certes aucun effet : « le représentant Iapetus Baris vous recevra bientôt... » Pas d’autre réponse. C’est la Guilde : elle « accorde » des audiences, elle « octroie » des faveurs… Il en a toujours été ainsi, et c’est bien une chose qui ne changera jamais : Németh, et les Ptolémée avec elle, peuvent être tentés de se poser en « partenaires » de la Guilde, mais cette dernière est plus pragmatique – elle se sait infiniment supérieure à la médiocre Maison Ptolémée, qui n’est certes pas en position « d’exiger » quoi que ce soit : la Guilde est surpuissante, aussi n’a-t-elle pas à se montrer courtoise, et les faufreluches ne s’appliquent pas vraiment à son cas.
[V-5 : Németh, Bermyl : Iapetus Baris] Puis un domestique – même pas déférent – annonce que le représentant Iapetus Baris va recevoir Németh et Bermyl dans la salle d’audience. Les Ptolémée s’y rendent, et y trouvent le Navigateur, indescriptible, flottant dans sa cuve – deux de ses agents, d’apparence encore humaine, restent à ses côtés. La salle est bien sûr sécurisée, et entièrement protégée par des cônes de silence propres à la Guilde (et qui empêchent tout enregistrement). Baris salue froidement « Dame Németh », sans s’enquérir de la raison de sa visite. Németh réclame des « éclaircissements » sur la cause des milliers de morts qui ont endeuillé Gebnout IV la veille, et rappelle les « engagements » de la Guilde en matière de contrôle climatique ; à sa connaissance… Baris l’interrompt – indéchiffrable sous son aspect résolument non humain, mais clairement pas le moins du monde impressionné : « À votre connaissance ? » Németh est un peu déstabilisée, mais poursuit : ces phénomènes ne sont pas normaux sur Gebnout IV, ils ne peuvent qu’avoir été provoqués. « Et ? » Németh insiste : ils ont un contrat, dont les termes doivent être respectés ! Iapetus Baris lui demande si elle compte intenter un procès à la Guilde devant le Landsraad. Németh dit que la Maison Ptolémée « étudiera toutes les possibilités ». Silence… Puis Iapetus Baris ajoute laconiquement : « Bien. Autre chose ? » Németh s’attendait à ce genre de discussion, mais n’en est pas moins décontenancée par la sécheresse du Navigateur ; cependant, elle parvient dans l’ensemble à se contrôler – sa discipline paye en définitive. Toutefois, il est impossible de le « lire », du fait de son apparence, et les agents mutiques qui l’accompagnent, s’ils ont toujours un aspect humain, ne sont guère plus déchiffrables – c’est comme s’ils n’avaient pas d’âmes, d’une certaine manière. Németh avance enfin que les Ptolémée ont « des alliés ». Iapetus Baris ne répond pas.
[V-6 : Bermyl, Németh : Iapetus Baris] Bermyl glisse à l’oreille de Németh qu’elle devrait lui demander de s’expliquer sur le « dysfonctionnement » qui a provoqué la tempête, de manière plus précise – car elle est restée très évasive à ce sujet. Ce que fait Németh – qui décide d’évoquer en outre la Tempête permanente dans le Continent Interdit : s’il ne leur dit rien à ce propos, alors elle saura à quoi s’en tenir ! Mais Baris lui rétorque qu’elle sait déjà à quoi s’en tenir… « Un dysfonctionnement. Un léger dysfonctionnement. Un problème vite réglé, et tout va maintenant pour le mieux. Les satellites de la Guilde, en orbite autour de Gebnout IV depuis des millénaires, ont pu connaître un léger raté – c’est dans l’ordre des choses : ces technologies vous dépassent, de toute façon. » Németh exige un rapport écrit et détaillé sur ce « dysfonctionnement ».
[V-7 : Bermyl, Németh : Iapetus Baris ; Rauvard Kalus IV] Bermyl, qui perçoit bien que Németh est contenue par le protocole, décide de brusquer les choses en prenant la parole, en surjouant l'homme du commun : Iapetus Baris se moque d’eux ! La Tempête du Continent Interdit, est-ce encore un « dysfonctionnement » ? Et la catastrophe climatique qui a affecté Cair-el-Muluk et les archipels à l’est de la capitale, elle n’a bien évidemment aucun rapport avec les investigations menées par la Maison Ptolémée sur ce phénomène clairement artificiel dans le grand désert de sable ? La Maison Ptolémée est certes de peu de poids face à la Guilde – mais l’affaire sera bien portée devant l’Imperium, car elle dépasse la seule Gebnout IV ; et aussi puissante soit la Guilde, elle ne pourra s’en tenir à ce mépris inqualifiable quand la Maison Corrino et le Landsraad lui demanderont des comptes, ce qu'ils ne manqueront pas de faire ! Iapetus Baris prend son temps, mais répond – sur un ton différent : « Je crois que vous n’avez pas compris comment les choses fonctionnent dans l’Imperium. Vous n’arriverez certainement à rien de cette manière. Je ne vous présenterai pas d’excuses. La Guilde ne vous présentera pas d’excuses. Elle n’en présentera à personne, pas même à l’empereur Rauvard Kalus IV, pas même au Landsraad. Elle n’en a pas besoin. Nous sommes la Guilde. Nous sommes le pouvoir. » Bermyl rétorque qu’il n’attend pas d’excuses – ce qu’il dénonce, c’est que la Guilde « fricote » avec des « ennemis de l’Imperium », et ceci sera porté à l’attention des autres pouvoirs de la galaxie. Iapetus Baris émet comme un soupir : « C’est bien ce que je disais, vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent. Vous avez l’air horripilé par cette idée d’un simple dysfonctionnement, vous mettez en avant que c’est totalement improbable… Bien sûr que c’est totalement improbable. Mais c’est justement ce qui est magnifique dans cette situation : si d’autres factions venaient à enquêter sur ce qui s’est passé sur cette planète, nous leur répondrions exactement la même chose – qu’il s’agit d’un dysfonctionnement… Et tous comprendraient les implications de ce terme. » Bermyl l’interrompt : tous comprendraient que la Guilde s’est compromise avec le Bene Tleilax ? « Inutile d’envisager cette hypothèse. Non, ils comprendrait simplement que c’est la Guilde qui tire les ficelles – depuis le début, et pour l’éternité encore. Ils comprendraient que si la Guilde "ment" en parlant d’un "dysfonctionnement", ma foi, elle peut se le permettre, étant la plus puissante… Les autres intérêts de l’Imperium ne souhaiteront certainement pas souffrir à leur tour de ce genre de "dysfonctionnements" ; clairement, ils ne feront… rien. Personne ne fera jamais rien contre la Guilde. Ne le comprenez-vous toujours pas ? Croyez-vous que la menace d’un procès au Landsraad, ou que sais-je, dissuaderait d’autres "dysfonctionnements" ? Plus conséquents le cas échéant ? Vous le croyez vraiment ? » Bermyl est plus colérique que jamais – mais sait ne pas avoir d’arguments à lui opposer…
[V-8 : Németh, Bermyl : Iapetus Baris] Németh n’est guère plus à l’aise… mais, si son « visage » demeure indéchiffrable, elle perçoit bien que Iapetus Baris, attiré sur un terrain moins protocolaire par Bermyl, jubile, d’une certaine manière, à faire la démonstration de sa puissance écrasante. Ce n’est certes pas un imbécile qui se laissera prendre au piège de la conversation, et sans doute ne dira-t-il pas davantage que ce qu’il devrait, mais il y a peut-être moyen de le titiller ?
[V-9 : Németh, Bermyl : Iapetus Baris] Németh tente donc une autre approche : les choses sont claires, dit-elle, à un point près – est-ce à la Guilde qu’elle s’adresse, ou au Bene Tleilax ? À moins qu’il n’y ait pas de différence ? Qui dirige vraiment cet univers ? Iapetus Baris reprend, sur un ton subtilement différent : « Voyez les choses autrement. Nous autres à la Guilde n’avons aucun intérêt à nous... "séparer" des Ptolémée. Les Ptolémée ne sont certes pas grand-chose, mais, ma foi, en 5000 ans de présence conjointe sur cette planète, nous avons pu conclure des arrangements profitables aux deux partis – dans la mesure bien sûr où ces deux partis sont totalement asymétriques. Il n’y a aucune raison pour que cela cesse. Vous devez prendre conscience de ce que la Guilde peut faire en pareil cas – sur cette planète, sur d’autres, peu importe. Vous semblez croire que l’on peut nous menacer – or vous ne le pouvez pas, personne ne le peut. Personne ne peu arguer d’un vieux bout de papier et de quelques considérations éthiques ou religieuses en sus pour dire que la Guilde ne respecte pas ses "engagements" et qu’elle doit être sanctionnée : il n’y aura pas de procès, de quelque manière que ce soit, il n’y en aura jamais. Soyons francs – la Guilde pourrait atomiser la Maison Corrino, et on ne dirait pas autre chose, dans l’Imperium entier, que ceci : la Guilde a le pouvoir… Ce qui est la vérité. Et c’est la seule chose qui compte. Encore une fois, ce petit… "dysfonctionnement"… est un simple "rappel" de la situation dans laquelle se trouve la Maison Ptolémée, qui ne peut pas, ou ne devrait pas, succomber à la folie des grandeurs, ne serait-ce qu’en s’imaginant régner sur "sa" planète, non, nous savons très bien, vous et moi, ce qu’il en est. Quand un… "domestique" tend à devenir pénible de par son ambition, eh bien, on le remplace. Cela pourrait se produire – les candidats à la succession ne manquent pas. Mais pourquoi se séparer autrement d’un… disons, par exemple, un bon maître d’écurie, qui connaît ses chevaux, qui sait les soigner, les maintenir au meilleur de leur forme ? Si les relations entre la Guilde et la Maison Ptolémée peuvent demeurer cordiales, tout le monde en profitera. Ce "dysfonctionnement", dès lors, pourrait être perçu non pas comme une menace, ou un avertissement, mais comme… une main tendue. »
[V-10 : Németh, Bermyl : Iapetus Baris] Mais Németh fait alors valoir que, si la Maison Ptolémée n’est rien aux yeux de la Guilde, ce n’est visiblement pas le cas de Gebnout IV. Pour le coup, Iapetus Baris marque un temps d’arrêt, puis revient à sa sécheresse originelle : « Et ? » Bermyl chuchote à l’oreille de Németh que c’est bien joué de sa part… et elle poursuit – en gardant pour elle le contenu implicite de sa remarque, mais peut-être le Navigateur la comprend-elle très bien : elle menace en fait la Guilde, peu ou prou, de faire sauter Gebnout IV ! Et, techniquement, c’est tout à fait possible... Németh poursuit donc dans cette voie : la Guilde fait aux Ptolémée la faveur de s’adresser à eux comme à des domestiques raisonnables ; sans doute sont-ils des domestiques, guère plus… mais sont-ils si raisonnables que cela ? Iapetus Baris, sur un ton plus nerveux, répond : « Vous êtes des marchands – il n’y a rien au monde de plus raisonnable que des marchands. Je ne peux toutefois exclure qu’avec le temps vous soyez devenus de mauvais marchands – et, encore une fois, on peut remplacer un employé devenu incompétent. Cela peut être désagréable, car il est toujours délicat de se séparer d’un petit personnel auquel on s’est attaché avec le temps… S’il faut le faire, nous le ferons. »
[V-11 : Németh, Bermyl : Iapetus Baris] Németh répond qu’elle le laisse à ses spéculations quant à ce que sont au juste les Ptolémée, et lui fait ses adieux – avec un signe de la tête à Bermyl pour qu’il la suive hors de la salle d’audience. Lequel s’exécute, non sans un dernier regard courroucé à l’adresse du Navigateur, accompagné d’un sarcasme sur le poisson dans son aquarium…
VI : AU CHEVET DE LA FINE LAME
[VI-1 : Ipuwer : Anneliese Hahn, Vat Aills] Après une courte nuit, trop courte sans doute, mais qui a permis à chacun de reprendre un peu ses forces après la tension de la veille, Ipuwer considère de son devoir de se rendre au chevet d’Anneliese Hahn – laquelle a réintégré ses quartiers, sous surveillance médicale. Il a pris connaissance du rapport de Vat Aills témoignant de ce qu’elle ne souffrait pas de traumatismes physiques.
[VI-2 : Ipuwer : Ludwig Curtius ; Anneliese Hahn, Namerta] Toutefois, avant d’aller la voir, Ipuwer prend soin de se renseigner auprès de son maître d’armes Ludwig Curtius (un Delambre également), qui l’a bien plus souvent vue que lui-même. Sans doute est-il meilleur escrimeur que psychologue, mais n’aurait-il pas quelque conseil concernant Anneliese Hahn ? Comment la sent-il ? Curtius a un temps d’arrêt, puis, assez froidement, concède qu’il a déjà vu ce genre de réactions – de la part de ces gens qui se croient infiniment supérieurs au reste du monde, et qui découvrent au pire moment qu’ils sont en fait comme les autres, ni plus ni moins… C’est ce qui s’est produit avec la jeune femme – et le choc en retour est proportionnel à la morgue qu’elle avait déployée durant toutes ces années. Et à raison, pour partie du moins : c’était assurément une brillante épéiste, probablement une des meilleures de tout l’Imperium… et issue d’une des meilleures familles… Consciente de ce qu’elle était un très beau partie, mais compensant ce statut par ce qu’il fallait de rébellion pour la rendre plus séduisante encore, et pimenter une existence qui lui aurait été autrement insupportable, car bien trop monotone. Mais elle n’était certes pas habituée à ramper dans la boue, à être bousculée par la populace, presque écrasée par elle, sans même avoir la moindre opportunité de faire la démonstration de ses talents avec une rapière en main… Qu’y a-t-il de plus à en dire ? Ipuwer suppose que Curtius a raison – et songe que son père Namerta avait très bien fait de l’envoyer, au cours de sa formation, auprès des militaires lambda de sa Maison, ce qui l’a beaucoup instruit : oui, il faut de temps en temps ramper dans la boue… Il va aller la voir – et lui proposer un entraînement commun ; Ludwig Curtius lui souhaite bonne chance…
[VI-3 : Ipuwer : Anneliese Hahn] Ipuwer se rend donc dans les quartiers d’Anneliese Hahn – dont il fait se retirer les domestiques présents (mais des gardes restent toujours à la porte). La jeune femme a pris une bonne douche et changé ses vêtements – ce qui produit un contraste avec le tableau pitoyable de la veille, et elle a récupéré un peu de son aura… mais guère, car tout cela demeure superficiel : dans ses yeux, dans ses attitudes et ses gestes, elle reste visiblement très affectée par son expérience. Et la morgue n’est plus de la partie : jusqu’à présent, chaque fois qu’Ipuwer l’avait rencontrée, elle se montrait d'emblée arrogante, et ne tardait guère, soit à lancer avec brutalité quelque remarque salace et crue, soit à offrir de manière insistante de lui livrer une humiliante leçon d’escrime… Ce n’est plus du tout le cas.
[VI-4 : Ipuwer : Anneliese Hahn ; Clotilde Philidor, Németh, Ludwig Curtius] Ipuwer s’enquiert de la santé d’Anneliese Hahn : tout va bien ? Comment se sent-elle ? Sans être totalement bloquée, sans être hostile non plus, elle est atone – et, assise au bord de son lit, elle garde les yeux fixés sur le sol. Ipuwer constate que son corps est rétabli, mais pas son âme… Veut-elle lui raconter ce qui lui est arrivé ? On l’avait fait chercher quand la tempête s’était mise à menacer, mais il avait été impossible de la trouver à temps pour qu’elle évacue Cair-el-Muluk avec sa cousine Clotilde Philidor ainsi que d’autres notables, sous la protection de Németh… Il s’en excuse, un peu confusément, mais Anneliese Hahn perçoit sa sincérité sous la maladresse, ce qui n’est pas plus mal. Mais elle lui fait comprendre qu’elle n’a pas envie, pour l’heure du moins, d’en parler – nulle hostilité dans ces paroles : c’est factuel, d’une certaine manière. Ipuwer sent bien que ce n’est pas le moment, et il sait tout autant ne pas être le plus apte à la réconforter... Elle se confiera sans doute à un moment ou à un autre – mais probablement pas à lui, et certainement pas maintenant. Il se contente donc de lui offrir, quand elle sera remise, dès demain le cas échéant, d’échanger quelques coups d’épée en compagnie de Ludwig Curtius.
[VI-5 : Ipuwer : Anneliese Hahn ; Clotilde Philidor, Németh] Il précise enfin que Clotilde Philidor est en sécurité et en bonne santé, et qu’elle a fait part de son inquiétude la concernant – elle a été mise au courant de ce que sa cousine se trouve maintenant au Palais, loin de toute menace. Cela éveille très vaguement Anneliese Hahn, mais surtout car cela la surprend – et peut-être cela lui fait-il un peu honte ? Clotilde Philidor, dans l’ornithoptère avec Németh, avait fait part de son inquiétude concernant le sort de sa cousine – mais Anneliese Hahn n’a visiblement pas pensé un seul instant à Clotilde Philidor ; c’est comme si on lui rappelait son existence, et leurs liens familiaux… Et Ipuwer comprend bien que c’est la honte qui domine chez son invitée – la honte qui l’affecte depuis les tragiques événements de la veille, et qui se trouve encore renforcée, maintenant, par la prise de conscience de ce qu’elle n’a jamais pensé à qui que ce soit d’autre qu’elle-même sur le moment ; et, maintenant, elle s’en veut – ce qui ne se serait jamais produit un jour plus tôt. Ipuwer le comprend – et lui assure que « la boue, ça se lave » ; la veille, elle aura probablement réagi en lui collant une gifle, mais ce n’est plus le cas maintenant. Il insiste : elle se relèvera plus forte.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



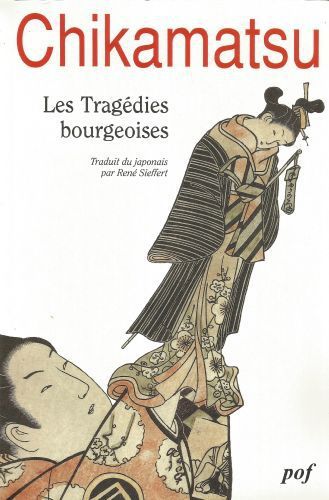



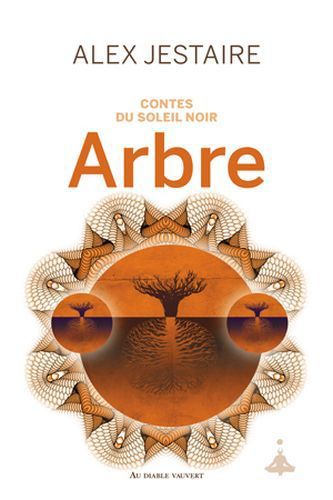




/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)