La Nature des choses, de Lucrèce
LUCRÈCE, La Nature des choses, [De rerum natura], traduit [du latin] et présenté par Chantal Labre, Paris, Arléa, coll. Poche – Retour aux grands textes – Domaine latin, [1995] 2014, 312 p.
Lucrèce a pour lui de ne pas être grec (en ce moment, ça vaut mieux) ; mais il a surtout livré ce qui constitue à mon sens le plus grand joyau de la philosophie antique, avec son De rerum natura, fascinant poème philosophique, la principale – et presque la seule, à vrai dire – exposition des principes de la philosophie d’Épicure, loué à chaque livre comme le plus sage des hommes, qui a combattu les ténèbres et révélé la lumière à l’homme, en le délivrant notamment de la crainte de la mort. Ce qui n’est pas rien. Aussi, en dépit de son titre « physicien », renvoyant aux plus anciens des Présocratiques, La Nature des choses se révèle un exposé plus vaste, où la physique et la métaphysique débouchent sur l’éthique. Lucrèce, aussi, n’est peut-être pas un grand « créateur » (ou, du moins, on peut lui contester ce titre), lui qui expose avant tout Épicure, en remontant à ses influences antérieures tels Leucippe et Démocrite. Pourtant, La Nature des choses séduit et étonne de par la modernité de ses conceptions (atomistes et matérialistes), ce qui suffit déjà à en faire un livre unique en son genre ; mais si l’on y ajoute la forme poétique, toujours à la rescousse du fond, et qui transcende le texte en œuvre d’art aussi belle que profonde, on ne peut que s’avouer tétanisé devant l’incroyable habileté du texte, sa puissance phénoménale, sa subtilité, sa perfection même.
Je l’avais déjà lu, il y a de ça… longtemps. Et j’avais été conquis, déjà, par cette merveille. Un citoyen s’étant fait l’écho de cette nouvelle traduction, j’ai été pris de l’envie irrépressible de le lire à nouveau, avec un regard probablement plus mature (si, un peu, quand même). Et bien m’en a pris, puisque j’ai à nouveau été fasciné par la portée de ce classique.
Je crois me souvenir que Voltaire, cité dans la première édition que j’avais lue, disait de Lucrèce qu’il était grand poète mais piètre philosophe, ou quelque chose comme ça… Une histoire d’hôpital et de charité, ou de poutre et de paille. Car Lucrèce – à la différence de l’Arouet –, tout autant qu’un grand poète qui a fait suer des générations de latinistes (« Suave, mari magno… »), était bien un grand philosophe, aussi habile à la démonstration d’un système rigoureux qu’à son exposition lumineuse. Et son ouvrage, qui prend donc la forme d’un poème, dédié à l’ami Memmius, présente un système du monde unique en son genre, quand bien même il emprunte pour une bonne part à des doctrines plus anciennes. Le De rerum natura, seul en son genre, a traversé les siècles, ce qui est d’ailleurs un tantinet étonnant au vu de son contenu plus qu’à son tour blasphématoire…
Lucrèce part d’hypothèses foudroyantes, qui chamboulent tout ce que la philosophie antique – et notamment celle des « Physiciens » – prétendait. Un postulat essentiel affirme ainsi, dans un monde infini, l’infini de la matière, mais aussi l’existence du vide. Car seul le vide peut autoriser le mouvement des atomes. Deuxième intuition phénoménale, donc : la réalité est construite d’atomes, corpuscules infimes, aux formes diverses, dont on peut avoir une idée en observant les particules s’agitant dans un rai de soleil. Or il faut que ces atomes se meuvent, et la perception, notamment – d’une importance extrême aux yeux des épicuriens, car on ne peut se fonder que sur nos sens pour interpréter le réel –, résulte des mouvements des atomes qui se heurtent. Mais les atomes connaissent du coup un mouvement bien particulier, et fondamental dans la philosophie de Lucrèce : c’est la « déclinaison », le clinamen, qui génère les autres mouvements, et rend seul la vie possible. Et ce n’est pas la moindre merveille du De rerum natura que de placer ce clinamen au centre d’un système aux implications certes physiques et métaphysiques, mais aussi éthiques, cette déviation entraînant (au terme d’une démonstration que, je plaide coupable, je serais bien en peine de reproduire) la possibilité du libre-arbitre.
Ces considérations scientifiques étonnamment avancées décrivent effectivement La Nature des choses, avec un brio jamais constaté auparavant. Or c’est bien ici la nature le maître-mot. Et cette nature se passe des dieux. Lucrèce a beau faire quelques allusions ici ou là (à Vénus, notamment), il n’en reste pas moins que sa philosophie est agnostique, et tend vers l’athéisme. Nul besoin des dieux, ici, pour expliquer les phénomènes les plus étranges (ainsi les « météores » du dernier livre, qui sont tout autant les tremblements de terre, les éruptions volcaniques ou les épidémies – très fortes dernières pages, passablement abruptes, du poème philosophique, qui pour le coup ne manquent pas d’évoquer l’immense Thucydide – mon chouchou chez les Grecs) : ils trouvent tous leur raison d’être dans la nature, et donc dans le jeu incessant des atomes de matière à travers le vide.
L’ambition essentielle de Lucrèce – et donc à l’en croire de son maître à penser Épicure – est en effet de libérer l’homme de la peur et des superstitions qu’elle entraîne. Ce qui n’en fait pas pour autant un auteur « optimiste » (le dernier livre, notamment, est éloquent à cet égard) ; et il faut bien évidemment, en abordant le De rerum natura, se libérer des connotations improbables et stupides que des siècles de dénigrement et de mauvaise foi ont accolé à l’épicurisme : si le sage épicurien vit pour le plaisir, celui-ci, cette ataraxie, consiste en l’absence de douleur, et pas en un hédonisme sans frein (dommage ?).
Mais l’important, ici, est donc que les superstitions n’ont pas lieu d’être – et les dieux rentrent bien dans cette catégorie. La nature, observée par la science – par les sens, donc, mais il faut néanmoins faire attention aux « simulacres » et aux interprétations erronées de l’esprit –, explique tout, sans qu’il soit besoin de recourir à un plan déterminé, un « dessein intelligent » si j’ose dire. La nature progresse certes à tâtons, fait des erreurs, mais suscite d’elle-même à terme une harmonie dans l’évolution. Et, pour expliquer les phénomènes, bien loin de s’en tenir à une cause unique de l’ordre de la foi, Lucrèce recourt continuellement à des hypothèses multiples, scientifiques, et pas forcément exclusives les unes des autres – démontrant par là même que le recours à la superstition a quelque chose d’absurde.
La peur de l’homme génératrice de mythes se fonde essentiellement sur la terreur qu’il éprouve devant la mort. Lucrèce entend l’en libérer, en démontrant qu’il n’y a pas d’âme immortelle, et donc pas de jugement post-mortem conduisant le dévot dans un paradis et le méchant dans les enfers – pas plus qu’il n’y a de métempsycose, d’ailleurs. Cependant, la matière, pour être infinie dans l’univers, n’en est pas moins soumise aux cycles naturels de la vie et de la mort : oui, le corps – et l’âme avec – est amené à périr ; mais cette mort « rend » des atomes qui susciteront la vie ailleurs : harmonie de la nature, une fois de plus.
Aussi le sage épicurien, n’ayant plus à craindre le trépas et libéré des frissons que lui imposent les « météores », peut-il élaborer une éthique concrète, qui lui assurera, sinon le bonheur, du moins l’absence de douleur. Et c’est sans doute en cela que La Nature des choses dépasse toutes les œuvres antérieures de la philosophie antique (celles dont on a connaissance, du moins…) : il résulte de cette observation minutieuse de la nature un véritable système du monde, cohérent et rassurant en tant que tel.
La postérité de Lucrèce est énorme, bien sûr. Au fil des siècles, bien des penseurs se sont référés à cet ouvrage hors-normes (de manière parfois paradoxale : Chantal Labre évoque ainsi des philosophes très chrétiens, tels Bossuet ou Pascal, piochant çà et là dans le poème impie…). Sans doute les matérialistes des Lumières s’y sont-ils souvent référés, et ceux qui les ont suivi de même – et parfois des scientifiques plus que des philosophes (et peu importe que, dans le détail, certaines intuitions de l’auteur se soient avérées fausses : il faut bien évidemment remettre ici les choses dans leur contexte, il y a plus de 2000 ans de cela… et se prendre la baffe qui va avec).
Oui, La Nature des choses est une œuvre exceptionnelle, un livre rare et d’autant plus précieux, à vrai dire sans doute un des livres les plus importants de l’histoire des lettres. La philosophie y est aussi profonde que belle, aussi implacable que libératrice – et dès lors nécessaire.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)
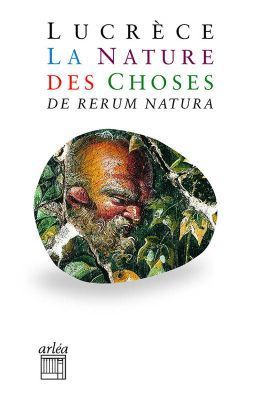


/image%2F1385856%2F20201027%2Fob_e27ed3_la-guerre-du-pavot.jpg)
/image%2F1385856%2F20200713%2Fob_a414dc_ecran-noir-04.jpg)
/image%2F1385856%2F20200618%2Fob_3ca18a_la-mort-du-fer.jpg)
/image%2F1385856%2F20200612%2Fob_f373f3_les-miracles-du-bazar-namiya.jpg)
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)
Commenter cet article