Le Journal de Tosa
Le Journal de Tosa, suivi de Poèmes du Kokin-shû, [Tosa nikki 土佐日記], traduit du japonais et présenté par René Sieffert, Lagrasse, Publications Orientalistes de France – Verdier, [935, 1993] 2018, 73 p.
Une fois n’est pas coutume, je vais vous entretenir d’un texte qui, tout grand classique de la littérature japonaise qu’il soit (et là je parle vraiment de littérature du Japon ancien, vers 935), s’avère extrêmement bref : dans ce petit volume très aéré, il tient en une trentaine de pages seulement. Qu’importe : je vous ai déjà fait part, et à plusieurs reprises, de mon adoration des Notes de l’ermitage de Kamo no Chômei, qui sont probablement plus brèves encore…
Et je trouve Le Journal de Tosa fascinant – simplement, cette fois, je ne suis pas certain qu’il produira le même effet sur tous ? Le petit opuscule de Kamo no Chômei a d’une certaine manière quelque chose d’universel, potentiellement du moins – mais Le Journal de Tosa ne peut probablement être pleinement apprécié qu’à la condition cette fois impérative de le replacer dans son contexte. Cela ne signifie certainement pas que le contexte fait tout – mais je crois qu’en avoir au moins un aperçu est nécessaire pour savourer pleinement la beauté, l’élégance, la tristesse, l’audace, l’astuce de ce bref texte – et sa saveur poétique. Et, notamment, il faut avoir au moins une idée de son importance pas seulement historique et littéraire mais… linguistique ? Je ne suis certainement pas le plus calé dans ces matières, cela dit. Mais je vais tenter le coup, en espérant ne pas trop écrire de bêtises...
Et, d’abord, quelques mots sur l’auteur. Son nom n’apparaît pas sur la couverture, pour quelque raison que ce soit, mais nous savons sans l’ombre d’un doute qu’il s’agit de Ki no Tsurayuki (ca. 872-ca. 945), un bonhomme assez fascinant et c’est peu dire. Au Japon, il est considéré sans l’ombre d’un doute comme étant le plus grand poète de son temps – et un des plus grands poètes de toute l’histoire du Japon.
Mais son importance en matière de poésie ne réside pas seulement dans sa production personnelle, par ailleurs pléthorique. En effet, jeune homme encore, il a été désigné par l’empereur pour superviser la compilation de la première anthologie impériale officielle de la poésie japonaise, le Kokin Wakashû, ou Kokinshû. Si le Man.yôshû, antérieur, avait pour lui d’exprimer les vertus d’une poésie japonaise davantage « primitive » et formellement variée, et si d’autres anthologies impériales suivront, sur lesquelles travailleront d’autres poètes illustres comme Teika, le Kokinshû est souvent considéré, et encore aujourd’hui, comme l’expression la plus pure de la poésie japonaise classique.
Mais Ki no Tsurayuki ne s’est pas contenté de compiler des poèmes. D’une part… eh bien, il figure lui-même dans le Kokinshû – en fait, avec 105 poèmes retenus, il est le poète le plus cité dans l’anthologie qu’il a lui-même compilée ! On n’est jamais mieux servi que par soi-même ? À moins que les responsables ne soient les autres compilateurs…
Mais il y a plus : d’autre part, en effet, Ki no Tsurayuki a également livré une préface au Kokinshû – et, aussi brillante soit sa poésie, cet essai est probablement plus important encore au plan historique. Vu de loin, c’est une dissertation sur l’esthétique poétique, savante et compétente, mais ce n’est pas là ce qui fait la valeur du texte – c’est qu’il a par ailleurs une dimension qu’on pourrait être tenté, de nos jours, de qualifier de « militante » (et René Sieffert, dans sa brève présentation, avance que ce texte a probablement suscité un certain « scandale », ajoutant que Ki no Tsurayuki avait nécessairement en cette affaire le soutien préalable de l’empereur, si déterminer qui se trouvait à l’origine de cette initiative n’est peut-être pas aussi assuré).
En effet, Ki no Tsurayuki y fait l’éloge de la poésie japonaise, mais aussi de la langue japonaise. Et, allant plus loin encore, il fait cet éloge en employant une écriture spécifiquement japonaise : les kana.
Ici, un petit rappel s’impose peut-être, pour mémoire et sans rentrer dans les détails. Adonc, premier point : les langues chinoise et japonaise n’ont rien de commun, et n’appartiennent pas le moins du monde à la même famille, elles sont aussi différentes que le français et le japonais le sont. Cependant, l’écriture chinoise a été progressivement importée au Japon, assez tardivement – le problème est qu’elle ne permet en fait pas d’écrire le japonais : parce que la phonologie n’a rien à voir, la grammaire est on ne peut plus différente, etc. Les lettrés japonais se sont escrimés pendant des siècles pour contourner cette difficulté, avec des expérimentations plus ou moins couronnées de succès, comme le Kojiki (on le présente souvent comme « le premier livre de la littérature japonaise », mais il était en fait peu ou prou illisible, et ne sera véritablement redécouvert et sublimé que bien plus tard, vers notre XVIIIe siècle) ou le Man.yôshû – l’idée étant de recourir à certains caractères, non en tant qu’idéogrammes, mais en tant que phonogrammes, ce qui est indispensable pour le japonais. Et, au fur et à mesure, on développera ainsi au Japon les kana (hiragana et katakana), qui sont des syllabaires purement phonétiques, dérivés des idéogrammes, ou kanji, mais sous une forme simplifiée.
On peut écrire le japonais intégralement en kana – ils ne sont indispensables que pour la grammaire, en gros, mais là n’est pas la question. Seulement, si c’était possible, ça n’était pas ce que l’on faisait pour autant – ne serait-ce que parce que l’écriture chinoise, mais aussi la langue chinoise, bénéficiaient d’un statut de « prestige », toutes choses égales par ailleurs comparable au latin dans la France médiévale (avec tout de même une nuance importante, d’ordre politique : le Japon n’a jamais été soumis à la Chine). Kana ou pas, le chinois demeurait la langue de l’administration, largement dérivée dans son principe même du modèle chinois, mais c’était aussi une langue de la littérature.
Le cas de la poésie est cependant plus ambigu. Les poètes japonais devaient être en mesure de composer des « poèmes chinois », ou kanshi, et Ki no Tsurayuki lui-même en avait composé de nombreux. Maintenant, la tradition des « poèmes japonais », ou waka, les poèmes du Yamato, était ancienne et s’était maintenue : le Kokinshû compile bien des waka – et ils sont rédigés en kana, une solution autrement pratique que les expérimentations complexes du Man.yôshû. Mais on considérait par principe que tout ce qui ne relevait pas des waka à proprement parler – en y incluant donc le paratexte de pareille anthologie – devait être rédigé en chinois, en kanbun, et il ne pouvait pas en être autrement.
Le fait pour Ki no Tsurayuki d’écrire sa préface en kana avait donc quelque chose de révolutionnaire, qu’on ne pèse peut-être pas très bien aujourd’hui, a fortiori en France – mais le contenu de la préface y était lié : pour Ki no Tsurayuki, l’admiration pour la culture chinoise, la langue chinoise, la poésie chinoise, aussi fondée soit-elle, ne devait pas contraindre les Japonais à juger leur propre culture, leur propre langue, leur propre poésie, comme étant d’essence inférieure – la poésie japonaise peut être aussi raffinée et sensible que la poésie chinoise, elle peut même l’être davantage ; et la langue et l’écriture japonaise (entendre : les kana) sont parfaitement en mesure d’exprimer la sensibilité poétique, et, en l’espèce, du fait de leur caractère pratique et cohérent, bien mieux qu’un chinois d’importation tant bien que mal bricolé.
Mais ces questions liées au Kokinshû ont d’autres implications – qui nous amènent au Journal de Tosa : oui, j’y arrive enfin ! Mais, honnêtement, je crois ces longs développements préalables indispensables…
Kana ou pas, préface du Kokinshû ou pas, le chinois demeurait la langue de l’administration – et donc des hommes (nous parlons bien sûr de la très haute société, hein…). Ils rédigeaient notamment en chinois des « journaux », ou nikki, qui n’avaient pas spécialement de valeur littéraire, leur contenu était essentiellement pratique. Et les femmes ? Exclues de l’administration, elles n’avaient pas à maîtriser les complexes kanbun… On ne les leur enseignait donc pas – et, semble-t-il, cela allait au-delà, il était interdit pour elle de les apprendre (on rapporte parfois une anecdote, dont je ne garantis pas l’authenticité, selon laquelle la grande Murasaki Shikibu avait appris les kanbun en assistant en secret aux leçons données à ses frères, je crois…). Pas d'idéogrammes chinois pour les femmes, donc ; mais libre à elles de s’amuser avec les kana, si ça leur chantait !
On en a parfois dérivé l’image d’une société dans laquelle il y avait une « langue des hommes » et une « langue des femmes » (au passage, il y a de ça, ou il y avait encore tout récemment de ça, dans la langue japonaise contemporaine, mais ce sont d’autres aspects de la langue qui sont concernés que ceux que j’évoque dans cette chronique) ; c’est peut-être un peu exagéré… mais, de fait, on désignait alors parfois les kana comme étant onna moji, « l’écriture des femmes » (l'écriture masculine, en kanji, étant otoko moji). Et cette dichotomie aura bien des conséquences notables : là encore, ou plus encore, la formule est peut-être un peu excessive, mais on a parfois dit qu’à l'apogée de l'époque de Heian, tout particulièrement au regard de la prose, les hommes faisaient de la mauvaise littérature en mauvais chinois, et les femmes de l’excellente littérature en excellent japonais. Et de fait, si le cas de la poésie est donc un peu à part, les grandes gloires littéraires de l’apogée de l’époque de Heian, vers l’an mil, sont toutes des femmes : Murasaki Shikibu, donc, mais aussi Sei Shônagon, Izumi Shikibu, l’autrice anonyme du Journal de Sarashina…
Mais nous avons sauté une étape, déterminante – et c’est Le Journal de Tosa. Ki no Tsurayuki, s’il était un grand poète et brillait de mille feux du temps de la compilation du Kokinshû, avait ensuite eu une carrière administrative passablement médiocre. Il avait fini par être nommé gouverneur de la (pauvre) province de Tosa, sur l’île de Shikoku – ce qui ressemblait tout de même pas mal à une mise au placard. Il y a séjourné plusieurs années, et y a été très affecté par le décès précoce de sa fille. En l’an 935, il est rappelé à la capitale, Heian (l’actuelle Kyôto) ; le voyage de retour, en bateau, durera… cinquante-cinq jours : la distance est somme toute assez courte, mais c’est que la mer est dangereuse, les tempêtes fréquentes, la piraterie endémique – on se montre donc extrêmement prudent, on a recours au cabotage, et on ne se risque à prendre le large que si les conditions sont parfaitement idéales. Au fond, ce voyage n’a donc absolument rien d’une odyssée, et, pour dire les choses, il respire l’ennui...
Ki no Tsurayuki, cependant, a envie de raconter son voyage ; car il y a bien des choses à en dire, malgré tout. Seulement voilà : il est un homme – en tant qu’homme, et membre de l'administration impériale, il lui faudrait recourir aux kanbun… C’est ainsi, après tout, que l’on devait rédiger ces ennuyeux nikki. Mais il n’en a aucune envie : il veut écrire ce « journal » à sa façon – en japonais, en kana.
Et il a donc recours à un stratagème : il se fait passer pour une femme – car, pour une femme, l’emploi des kana est non seulement légitime, mais c’est en fait la seule possibilité. Le récit s’ouvre donc sur ces mots (p. 15) : « Ce que font les hommes et qu’ils appellent "journal", une femme va tenter de le faire à sa façon. »
Mais ce stratagème a quelque chose de plus ambigu, « l’imposture » va au-delà : Ki no Tsurayuki ne se fait pas passer pour n’importe quelle femme, mais pour une servante… de Ki no Tsurayuki – il ne se désigne jamais ainsi, mais, qu’importe si le texte a circulé sans nom d’auteur, peu de temps après le voyage en lui-même, ses lecteurs n’éprouvaient certes aucune difficulté à identifier ce gouverneur qui rentrait de Tosa… Et, à vrai dire, Le Journal de Tosa étant abondant en waka brillants, avec peut-être une certaine patte caractéristique, il ne faisait absolument aucun doute pour les lecteurs d’alors que « l’autrice » était Ki no Tsurayuki lui-même.
« L’imposture » était donc très relative – mais de manière délibérée ; et là on est clairement confronté, pour partie du moins, à un procédé littéraire de romancier, je le crois, qui peut avoir un certain caractère ironique. Et je suis tenté de mettre en regard de l’incipit… eh bien, la dernière phrase du Journal de Tosa (p. 46) : « De toute manière, je ne vais pas tarder à détruire ces griffonnages. » Un ultime pieux mensonge, dont la littérature connaîtra bien des avatars…
Le choix d’endosser le rôle d’une femme a donc mille implications, littéraires aussi bien que prosaïques. Mais cet artifice a une autre fonction essentielle dans Le Journal de Tosa, qui est moins flagrante, mais a probablement son importance. Ki no Tsurayuki, donc, avait été très affecté par la mort de sa fille pendant son séjour à Tosa. Le voyage retour à Heian la lui rappelle sans cesse, et il veut en témoigner ; cependant, un homme tel que lui était supposé conserver une certaine réserve dans l’expression de son chagrin – les sentiments sont très utiles à la poésie, et on ne compte pas les poèmes galants où tant d’hommes dévastés par le chagrin amoureux mouillent leurs manches, mais, en dehors des particularismes de l’activité poétique, les femmes sont plus libres d’exprimer leur douleur. La servante qui est supposée prendre la plume témoigne donc du digne chagrin de Ki no Tsurayuki, mais, en tant que femme, elle peut se permettre d’exprimer son propre chagrin d’une manière plus vibrante.
Et tout cela aura son importance sur la suite des événements. Très vite, Le Journal de Tosa sera lu et admiré – et il suscitera à terme des émules… à ceci près qu’ils seront cette fois véritablement écrits par des femmes ! En fait, le nikki deviendra un des genres les plus florissants de la littérature de Heian – et, en mettant un peu à part Le Journal de Tosa du fait de son statut particulier à plus d’un titre, nous pouvons en citer notamment trois exemples particulièrement célèbres, Le Journal de Sarashina (d’une autrice anonyme – pour ce que j’en ai lu, le plus beau, le plus touchant des nikki), Le Journal de Murasaki Shikibu, l'autrice du Dit du Genji, et Le Journal d’Izumi Shikibu (tous trois figurent dans le recueil Journaux des dames de cour du Japon ancien, traduit de l’anglais cependant – les deux premiers se trouvent séparément chez Verdier, dans une traduction du japonais de René Sieffert). Et si les fabuleuses Notes de chevet de Sei Shônagon ne relèvent pas techniquement du nikki (on parle plutôt de zuihitsu), elles puisent pour partie dans les mêmes thèmes et les mêmes modèles.
Mais il y a éventuellement un autre aspect à prendre en compte, plus généralement, et c’est que, même si la forme du Tosa nikki mêle constamment prose et poésie, à la manière de ce que l’on appellera ultérieurement les uta monogatari (comme par exemple les Contes d’Ise ou Le Dit de Heichû), il n’en reste pas moins que le récit en prose y revêt une importance bien supérieure – et peut-être était-ce pour le coup déterminant, de sorte à paver la voie pour les grandes œuvres en prose qui suivraient, et au premier chef le roman-fleuve de Murasaki Shikibu, Le Dit du Genji.
À peu près à la même époque que Le Journal de Tosa commence par ailleurs à circuler le Taketori monogatari, ou Conte du coupeur de bambou (également connu sous le nom de Conte de la princesse Kaguya, titre de son adaptation en dessin animé par Takahata Isao), qui est considéré comme étant « le texte narratif japonais le plus ancien » (formulation à prendre avec quelques pincettes, j’imagine). À vue de nez, on ne sait pas avec certitude quel texte a précédé l’autre, mais peut-être faut-il en déduire tout bonnement qu’il y avait quelque chose dans l’air du temps…
Maintenant, Le Journal de Tosa, si c’est bien un récit, est donc perpétuellement entrelacé de poèmes – tous des tanka, le poème court classique (obéissant à une structure rythmique 5-7-5/7-7). Ki no Tsurayuki est probablement l’auteur de la majorité sinon de tous, mais, là aussi, il profite de son procédé littéraire pour contextualiser les poèmes et leur donner une saveur et une signification supplémentaires.
De fait, tout au long des cinquante-cinq jours que dure le voyage de Tosa à Heian, avec ces très longues escales décrétées par le pilote, toujours à l’affût de l’évolution du vent et de la pluie, les passagers s’ennuient à mourir. Ils ont donc recours à tous les moyens qui leur sont disponibles pour se distraire – et la poésie est probablement le principal d’entre eux. En fait, Le Journal de Tosa exprime bien, à sa manière un peu ambiguë, combien la création poétique était centrale dans la vie d’alors (et pas seulement des aristocrates ?) : tout le monde y compose des poèmes – les hommes comme les femmes, les hauts gradés de l’administration comme les marins, les vieillards et jusqu’aux enfants.
Cela ne signifie pas que tous ces poèmes sont bons – et Ki no Tsurayuki, joueur peut-être ? pointe plus qu’à son tour sous son déguisement d’humble servante, quand elle se livre à des critiques parfois acerbes des vers des autres… qui pourraient donc très bien être les siens. Les figures plates sont impitoyablement dénoncées comme telles – mais les efforts sont relevés, et la narratrice n’est pas la dernière à louer les charmants waka, un peu naïfs, de tel gamin qui contemple la mer… Et certains sujets touchent plus particulièrement – au premier chef, bien sûr, tout ce qui renvoie au douloureux deuil de Ki no Tsurayuki.
Et c’est ainsi que ce long voyage – bien trop long –, cette anti-odyssée placée sous le signe de l’ennui et de la lassitude, acquiert une certaine beauté, souvent mélancolique, qui lui est propre. Ou peut-être n’est-ce pas tout à fait le mot ? Car il y a peut-être là quelque chose de plus essentiel, que d’aucuns plus tard considéreraient comme révélateur d’une certaine « âme japonaise », une sensibilité au temps qui passe, à l’éphémère, au caractère fuyant et impermanent du monde – ce que, bien plus tard, au XVIIIe siècle, l’érudit Motoori Norinaga étudiant Le Dit du Genji qualifierait de mono no aware… Il faut se méfier de ces discours essentialistes, mais la poignante évocation de l’enfant trop tôt partie produit bien des sentiments de cet ordre – tout spécialement quand les personnages, retrouvant tel lieu qu’ils avaient fréquenté bien des années plus tôt en compagnie de la petite fille, ont le cœur serré par le constat implacable de son absence.
Cette édition se conclut sur une sélection de poèmes du Kokinshû ; la formulation est un peu ambiguë, mais je suppose qu’il s’agit bien de poèmes de Ki no Tsurayuki lui-même.
C’est peut-être d’ailleurs l’occasion de relever que, passé la présentation de René Sieffert, et un très bref lexique en fin de volume, cette édition, comme toujours dans ces volumes de littérature japonaise classique repris chez Verdier, est autrement dépourvue de notes, etc. – je le regrette un peu parfois…
Le traducteur, par ailleurs, a sans surprise recours à son procédé habituel en la matière, dont j’ai donné bien d’autres exemples sur ce blog, et sa plume a donc quelque chose de délibérément archaïsant – c’est généralement très beau, mais peut-être parfois un peu forcé ? Et certains poèmes en deviennent peut-être un peu obscurs à l’occasion…
Quoi qu’il en soit, ces poèmes, classés par thèmes (d’abord les saisons, mais ensuite des choses comme « Séparation », « Amours », « Élégies », etc.), et parfois introduits par une brève phrase de contextualisation, donnent un aperçu séduisant de la poésie japonaise classique sublimée dans le Kokinshû. On pourrait y relever bien des belles pièces, par exemple celle-ci (p. 53) :
Fleurs de cerisier
Du vent qui les dispersa
Je garde regret
Et des vagues qu’il dressa
Dans un ciel dépourvu d’eau
Un complément de choix pour le très bref Journal de Tosa à proprement parler.
Voilà – je me suis étendu sur le contexte, trop peut-être, mais Le Journal de Tosa me paraît un exemple typique de ces œuvres qui peuvent certes séduire de prime abord et pour elles-mêmes, mais qui séduisent bien davantage, bien plus profondément, quand on les replace dans leur contexte historique et littéraire. Un point de vue très discutable, j'en suis conscient…
Quoi qu’il en soit, ce texte me fascine et me parle – toujours un peu plus à chaque relecture (oui, tiens, je ne l’avais pas mentionné, ça, mais j’avais déjà lu ce texte à plusieurs reprises, dans une tout autre traduction, dans l’anthologie Mille Ans de littérature japonaise), ce en quoi je pourrais être tenté de l’associer aux Notes de l’ermitage de Kamo no Chômei, même si ces dernières constituent une de mes œuvres littéraires favorites de manière générale, que je place tout au sommet. Mais, toutes choses égales par ailleurs, Le Journal de Tosa est un grand texte – aussi important qu’il est beau.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)
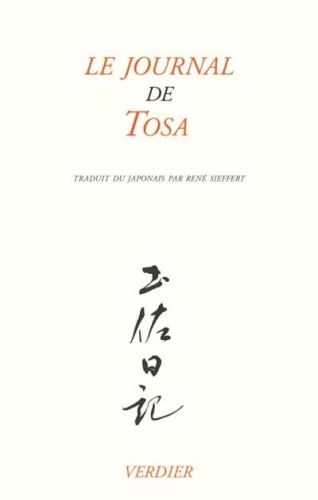


/image%2F1385856%2F20201027%2Fob_e27ed3_la-guerre-du-pavot.jpg)
/image%2F1385856%2F20200713%2Fob_a414dc_ecran-noir-04.jpg)
/image%2F1385856%2F20200618%2Fob_3ca18a_la-mort-du-fer.jpg)
/image%2F1385856%2F20200612%2Fob_f373f3_les-miracles-du-bazar-namiya.jpg)
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)
Commenter cet article