Ces, mettons, deux ou trois dernières années, j’ai été amené, à plusieurs reprises, à faire une chose autrefois impensable sur ce blog, en parlant de poésie – moi qui posais au couillon insensible aux pouètes (et le demeure sans doute pour l’essentiel, hein), je me faisais l’écho de lectures essentiellement nippones en la matière, et plus qu’à leur tour classiques ; à vrai dire, c’était souvent les œuvres les plus « classiques » (au sens de « lointaines ») qui me saisissaient le plus – les tanka issus du Man’yôshû ou du Kokinshû avaient généralement ma préférence sur les poèmes plus raffinés/subtils/artificiels de Kamakura, sans même parler des haïkus, notamment ceux de Bashô, qui me sont demeurés largement hermétiques.
Cependant, il m’a paru utile de compléter ces quelques lectures… en allant voir un peu ailleurs ? Pas n’importe quel ailleurs, certes : l’ailleurs proche et hautement influant qu’était la Chine classique. Si la poésie japonaise a de très longue date développé des caractéristiques propres, qui la singularisent à vrai dire à un point peut-être inouï, il demeure que les érudits japonais maîtrisaient par définition les classiques chinois et la poésie chinoise – le modèle continental indépassable, même si le Japon n’a jamais été soumis à la Chine, et si, à vrai dire, l’histoire des relations entre les deux pays, sur plus de deux millénaires, alterne sans cesse entre périodes d'échanges intenses et fermetures propices à la fermentation, de part et d’autre, d’identités culturelles propres. Quoi qu’il en soit, avec des hauts et des bas, les thèmes, voire le lexique, de la poésie chinoise, pouvaient infuser dans la poésie japonaise. Une « influence » à ne pas trop exagérer non plus, car, j’y reviendrai très vite, l’extrême différence entre les deux langues, que tout oppose (sinon l’emploi au Japon des caractères chinois, avec cependant des évolutions marquées, la plus cruciale étant celle des syllabaires), cette différence plus que marquée donc prohibe les transpositions directes, et implique de se référer, dans les deux langues, à des procédés poétiques et prosodiques qui n’ont en fait absolument rien de commun. Les passerelles demeurent, mais les variations sont cruciales – et ce qui est tout d'abord « copié » au Japon cède somme toute assez rapidement la place, chez les meilleurs poètes nippons, à des équivalents nationaux autrement signifiants : les poèmes gagnent ainsi en authenticité, et donc en puissance d'évocation.
Ce qui ne changeait rien à ma curiosité pour la poésie chinoise classique – dont je ne connaissais bien sûr absolument rien. J’avais pu croiser, avant mes lectures japonaises, quelques noms çà et là, les plus fameux, Li Po, Tou Fou, peut-être même Po Kyu-yi, et il n’est pas totalement exclu que j’en ai lu (et oublié, hélas) quelques vers çà et là, mais c’était plus que flou. Et, depuis, la lecture de poèmes japonais classiques a biaisé mon intérêt pour leurs équivalents chinois en mettant l’accent sur les thèmes et – chose très naïve à écrire, mais qui a eu son importance, je suppose – sur la découverte, dans les deux cas, de procédés poétiques entièrement inconnus de la poésie française ou plus largement européenne, tenant à la différence marquée des langues, qui implique une dichotomie aussi profonde.
J’y reviens tout de suite ; mais, pour en finir avec ces premiers développements, j’ai supposé que cette Anthologie de la poésie chinoise classique de la collection « Poésie » de Gallimard répondrait bien à mon goût, dans la même série, pour l’Anthologie de la poésie japonaise classique composée par Gaston Renondeau. Le présent ouvrage a quelque chose d’assez monumental, ayant été composé par une quinzaine de personnes sous la direction de Paul Demiéville, professeur au Collège de France, dans les années 1950 : 600 pages compilant des dizaines et des dizaines d’auteurs et de poèmes, couvrant près de 3000 ans d’une tradition poétique peu ou prou ininterrompue.
Mais une introduction de Paul Demiéville s’impose, détaillée, par moments un peu ardue, cependant indispensable et très édifiante. En effet, exprimer l’essence de la poésie chinoise rend nécessaires des considérations techniques liées à la langue chinoise en elle-même. On connaît l’adage : traduire, c’est trahir. Tandis que j'évoquais sur ce blog la poésie japonaise classique, ou à vrai dire aussi contemporaine, il m’a fallu y revenir à plusieurs reprises, mais, dans le cas de la poésie chinoise classique, les difficultés sont telles qu’on est en droit de se demander si l’entreprise même de traduction est seulement possible, d’une certaine manière.
Plusieurs caractéristiques du chinois jouent en effet un rôle crucial dans cette expression poétique, qui ne connaissent pas d’équivalent en français (ou dans les autres langues européennes, ou en japonais, d’ailleurs). Il en va ainsi tout d’abord du caractère monosyllabique du chinois, qui a nécessairement des conséquences d’ordre rythmique – mais la rythmique est aussi affectée par un autre trait essentiel de cette langue, qui est son caractère tonal ; la où, mettons, la poésie française s’attacherait essentiellement aux rimes et aux pieds, deux dimensions par ailleurs également présentes dans la poésie chinoise classique (avec des évolutions historiques marquées – le nombre de pieds, notamment, et leur régularité, changent considérablement selon les époques), cette dernière, pas dès les origines semble-t-il mais de plus en plus à mesure que le temps passe, développe des structures plus ou moins rigides liées à la tonalité, où tons plans et obliques s’opposent, se répondent, etc., et il est absolument impossible de rendre cela en français.
Il en résulte d’ailleurs une autre conséquence notable, qui est le caractère essentiellement musical de la poésie chinoise classique, laquelle pouvait s’exprimer sous la forme de poèmes chantés, notamment ceux que l’on appellerait les ts’eu, et qui sont présents à chaque époque, en miroir d’une poésie plus libre sur le plan mélodique. Ces poèmes chantés ont pu participer à conserver à la poésie chinoise classique une dimension plus populaire que la prose, mais il faut rapidement relativiser cette assertion, car l’élite s’est volontiers exercée dans ces poèmes chantés, tandis que le passage des années amenuisait le substrat musical initial de ces pièces – les mélodies sombraient tout bonnement dans l’oubli, en même temps que la production poétique de l’élite tendait toujours plus à l’exercice de style. Ceci, pour le coup, a pu me rappeler des évolutions sommes toute assez proches dans la poésie japonaise classique – dont les sources pouvaient avoir ce caractère musical, et avaient en tout cas cette dimension originellement populaire.
Mais il faut hâtivement relever que d’autres traits de la langue chinoise compliquent au moins autant la tâche du traducteur, voire la rendent impossible à maints égards. L’un est valable d’ailleurs pour la poésie japonaise également, comme de juste : l’écriture même peut produire des effets poétiques – les caractères chinois, dans leur dessin ! Comment rendre ceci dans un alphabet ? C’est peine perdue… Mais les poètes chinois sont aussi calligraphes, et leurs poèmes égayent plus qu’à leur tour des dessins ou peintures : l’ensemble est à la fois graphique et poétique. D’aucuns, traitant de cette anthologie, ont du coup regretté qu’elle ne soit pas bilingue, plus exactement qu’elle ne comporte pas les caractères chinois – honnêtement, pour un béotien dans mon genre, cela n’aurait pas fait la moindre différence, mais je suppose qu’il peut être utile de relever ce point.
Et le chinois présente au moins une autre difficulté à cet égard : son caractère invariant, que Paul Demiéville exprime notamment en relevant qu’un même mot, en chinois, sans la moindre variance (de désinence, etc.), peut être aussi bien un nom qu’un verbe – la langue en elle-même ne spécifie pas ; et comme il en va de même pour ce qui est du genre, du nombre, etc., dans une langue essentiellement contextuelle (ceci pour le coup vaut également pour le japonais, qui connaît cependant des variations grammaticales dans d’autres registres, une différence fondamentale), la traduction devient d’autant plus périlleuse, et il serait peut-être plus juste, dans bien des cas, de parler d’ « adaptation ». Or la langue chinoise peut de la sorte se montrer étonnamment souple et susciter des associations en elles-mêmes signifiantes, et en elles-mêmes poétiques, que le français ne peut en aucune façon rendre.
Mais la langue n’est bien sûr pas seule en cause, et la culture chinoise, comme de juste, s’exprime de mille et une manières dans cette abondante et très ancienne tradition poétique. Le contrepoint sémantique peut se montrer aussi important que le contrepoint rythmique, et éventuellement tout aussi codifié. Il y a tout un lexique, aussi ample que précis, de connotations liées aux couleurs, aux saisons, aux lieux, etc. À vrai dire, j’ai tout particulièrement prêté attention aux très nombreux toponymes évoqués dans ces poèmes, propices à la métonymie. Pour le coup, j’avais quelques souvenirs un peu déconcertants d’une poésie japonaise classique recourant à l’évocation de paysages chinois inconnus des auteurs, mais suscitant des associations d’idées parlant à tout Japonais érudit – ceci étant, en Chine, ces évocations pouvaient tout autant parler au peuple, et s’immiscer dans la tradition poétique populaire, notamment des poèmes chantés.
À cet égard, les liens entre l’Empire du Milieu et celui du Soleil Levant vont peut-être au-delà ? Car un même phénomène semble s’y être produit : avec le temps, la référence aux anciens, notamment au travers de ces archétypes tendant à devenir autant de clichés, a débouché sur une poésie élitiste d’un extrême raffinement, d’une subtilité revendiquée, mais qui tendait à ressasser les mêmes thèmes sans plus de dimension proprement créative, au point parfois de la copie. Les poèmes des Han et des Tang, sauf erreur, sont particulièrement tenus en estime, et sans cesse évoqués par les poètes ultérieurs – comme au Japon la poésie de Kamakura se référait sans cesse à celle de Nara ou de Heian. Mais, si un lecteur occidental peut, probablement à bon droit, se sentir quelque peu assommé par ce ressassement perpétuel durant des siècles et des siècles, il est capital de relever qu’un Chinois (ou un Japonais, donc, pour le coup) pourra percevoir les choses différemment, en identifiant des évolutions marquées que la traduction dans un contexte culturel tout autre n’est pas en mesure de rendre – et ces évolutions sont aussi bien formelles que thématiques ; l’histoire des idées, tout particulièrement, semble avoir joué un grand rôle ici, notamment en matière spirituelle : selon les époques, ce sont des inspirations taoïstes, confucianistes ou bouddhistes qui dominent, et cela peut changer considérablement la donne.
Il va de soi que la simple lecture, en béotien, de cette anthologie, ne me qualifie absolument pas pour tenir un discours véritablement pertinent sur les thèmes traités par la poésie chinoise classique. Je vais tout de même essayer d’en relever quelques-uns, qui ont plus particulièrement éveillé mon attention – et citer quelques poèmes au passage, assez peu par rapport à mes chroniques nippones, pas nécessairement les meilleurs mais du moins quelques-uns qui m’ont séduit pour une raison ou une autre.
Je relève par exemple qu’un certain nombre de ces poèmes traitent de sujets guerriers, ou peut-être plutôt militaires, mais d’une manière qui a pu m’étonner. De fait, ces poèmes font assez rarement dans la geste épique ou héroïque – même s’il y en a, et parfois un brin inattendus, je ne résiste pas à l’envie de vous citer, d'essence populaire, La Ballade de Mou-Lan, poème à chanter des dynasties du Nord, anonyme, entre le IVe et le VIe siècles :
Tsi-tsi et puis tsi-tsi :
Mou-lan tisse à sa porte.
Ce qu’on entend n’est plus le bruit de la navette ;
On entend seulement les soupirs de la fille.
La fille, qu’y a-t-il ? Est-ce pensée d’amour ?
La fille, qu’y a-t-il ? Quel souvenir d’amour ?
« Non, je n’ai rien, nulle pensée d’amour ;
Non, je n’ai rien, nul souvenir d’amour. »
Hier au soir, elle a vu la liste d’appel aux armes :
Le Khan fait grand recrutement de troupes.
Le texte de l’armée couvre douze rouleaux,
Et chacun des rouleaux porte le nom du père.
« Père n’a point de fils adulte,
Et je n’ai point de frère aîné.
Qu’on m’achète cheval et selle,
Et je pars en campagne à la place du père ! »
Elle achète au marché de l’Est un beau cheval ;
Elle achète au marché de l’Ouest selle feutrée.
Elle achète au marché du Sud rênes et mors ;
Elle achète au marché du Nord longue cravache.
Au matin prend congé du père et de la mère ;
Le soir s’en va camper au bord du Fleuve Jaune.
La fille n’entend plus l’appel de ses parents ;
Elle n’entend qu’un bruit : les eaux du Fleuve Jaune qui roulent et mugissent.
Au matin prend congé des eaux du Fleuve Jaune ;
Le soir parvient au pied de la Montagne Noire.
La fille n’entend plus l’appel de ses parents ;
Elle n’entend qu’un bruit : le cri sur les Monts Yen des escadrons barbares.
Elle a franchi dix mille stades, au gré des armes ;
Elle semble voler, par-delà monts et passes.
Le vent du Nord transmet le son des gongs d’airain ;
Un jour glacé reluit sur les cottes de fer.
Au bout de cent combats, le général est mort ;
Après dix ans, le preux soldat rentre chez lui.
À son retour, il se présente au Fils du Ciel.
Le Fils du Ciel, assis dans le Palais Sacré,
Consigne les hauts faits, élève aux douze grades,
Et distribue ses dons, par cent et mille et plus.
Le Khan parle à Mou-lan : quels sont ses vœux ?
Mou-lan n’a pas envie d’être ministre.
« Je voudrais un fameux coursier, courant mille stades d’une traite,
Et qui me reconduise à mon pays natal. »
Père et mère ont appris le retour de leur fille ;
Ils sortent des remparts, et vont lui faire escorte.
La fille aînée apprend le retour de sa sœur,
Et refait sur le seuil son maquillage rouge.
Le jeune frère apprend le retour de sa sœur ;
Aiguisant son couteau, il va quérir en hâte un porc et un mouton.
Mou-lan ouvre sa porte, au pavillon de l’Est,
Et s’assied sur son lit, au pavillon de l’Ouest.
Elle enlève son long manteau du temps de guerre,
Et revêt ses habits du temps jadis ;
À sa fenêtre, ajuste un nuage de boucles,
Et devant son miroir se colle au front une mouche jaune.
Mou-lan franchit le seuil, revoit ses compagnons,
Et tous ses compagnons sont frappés de stupeur :
Pendant douze ans ils ont fait route ensemble ;
Nul ne savait que Mou-lan était fille.
Lapin mâle sautille,
Et lapine voit trouble.
Lorsque les deux lapins courent à ras de terre,
Bien fin qui reconnaît le mâle et la femelle !
Mais ce qui m’a le plus frappé, dans ces poèmes traitant de guerres et de batailles, c’est justement que nombre d’entre eux ne sont absolument pas héroïques – au point même parfois de faire l’apologie de la désertion, voire du pacifisme, d’une certaine manière ? Voyez par exemple Le Vieillard manchot de Sin-fong, poème de Po Kyu-yi (772-846) :
Le vieillard de Sin-fong a quatre-vingt-huit ans ;
Tête et tempes, sourcils et barbe, il est blanc comme neige.
Soutenu par un fils de son arrière-petit-fils, il se rend à l’auberge.
Son bras gauche s’appuie sur la jeune épaule ; le bras droit est brisé.
« Depuis quand votre bras est-il ainsi brisé ?
Et dites-moi comment cela est arrivé ? Quelle en est la raison ? »
« Je suis inscrit à la sous-préfecture de Sin-fong.
Né dans une période sainte, sans expédition ni guerre,
Je fus élevé au son des chants et flûtes du Jardin des Poiriers.
Je ne connaissais bannières ni lances, arcs ni flèches.
Mais bientôt ce fut la grande levée de l’ère T’ien-Pao ;
Dans chaque famille on pointa le nom d’un adulte sur trois.
Et tous ces recrutés, où les a-t-on conduits ?
En plein cinquième mois, et à dix mille lieues, ils partirent vers le Yun-nan.
On disait qu’au Yun-nan était la rivière Lou,
D’où montent des miasmes malsains quand tombent les fleurs de poivrier.
Quand les soldats de la grande armée passent le gué, les eaux sont comme de l’eau bouillante ;
Sur dix hommes, il en est deux ou trois qui périssent…
Au Sud et au Nord du village, ce n’étaient que lamentations et plaintes ;
Les fils quittaient leurs parents, les maris quittaient leurs épouses,
Et tous disaient : Depuis toujours, de ceux qu’on envoie contre les Barbares,
Mille, dix mille partent, aucun n’est revenu. »
« En ce temps-là, le vieillard que je suis avait vingt-quatre ans ;
Sur la liste du Ministère de la Guerre, il y avait mon nom.
Au plus profond de la nuit, sans rien dire à personne,
Furtivement, avec un gros caillou, je martelai mon bras et le brisai.
Je ne pouvais plus tendre l’arc ni brandir les bannières ;
Et ainsi je fus exempté de l’expédition au Yun-nan.
La rupture de mes os, la blessure de mes muscles, n’allèrent pas sans douleur ;
Mais je ne pensais qu’à être renvoyé dans mon village.
Depuis que mon bras est brisé, soixante ans ont passé ;
Si l’un de mes membres est infirme, au moins mon corps subsiste.
Aujourd’hui encore, par les nuits de vent et de pluie, quand le temps est humide et froid,
Jusqu’au lever du soleil la douleur m’empêche de dormir.
La douleur m’empêche de dormir ;
Mais, après tout, je ne regrette rien !
Je me félicite au contraire d’être seul à rester en vie !
Sinon, je serais alors resté sur les bords de la rivière Lou.
Corps mort, âme esseulée, mes os non recueillis,
Il m’aurait fallu devenir au Yun-nan un esprit qui de loin regarde vers le pays natal ;
Et sur le tumulus des dix mille soldats, je crierais yeou-yeou ! »
Ces paroles du vieillard,
Écoutez-les, retenez-les !
Ne savez-vous pas que Song K’ai-fou, le Grand Ministre de l’ère K’ai-yuan,
Pour ne pas galvauder la gloire militaire, ne récompensait pas les exploits aux frontières ?
Et ne savez-vous pas aussi que Yang Kouo-tchong, le Grand Ministre de l’ère T’ien-pao,
Pour gagner la faveur impériale, recherchait ces mêmes exploits ?
Avant d’avoir réussi, il suscita le courroux du peuple.
Interrogez là-dessus, je vous prie, le vieillard manchot de Sin-fong !
Cela dit, le thème presque sempiternellement associé à ces poèmes traitant de la guerre, c’est l’éloignement considérable, du fait des dimensions intimidantes d’un immense empire impliquant des campagnes à l’autre bout du monde. Et c’est là semble-t-il quelque chose que l’on peut faire remonter à très loin – voyez Les Soldats, issu du Canon des poèmes, le plus vieux monument de la poésie chinoise, compilant des œuvres composées entre le XIe et le VIe siècles avant J.-C. :
Quelle plante n’est déjà jaunie ?
Quel jour n’avons-nous à marcher ?
Quel homme qui ne soit appelé
Pour défendre les quatre frontières ?
Quelle plante n’est déjà noircie ?
Quel homme qui ne soit pitoyable ?
Hélas sur nous, pauvres soldats,
Qui ne sommes plus traités en hommes !
Sommes-nous rhinocéros ou tigres,
Pour que parcourions ces déserts ?
Hélas sur nous, pauvres soldats,
Ni jour ni nuit n’avons repos !
Les renards à la toison dense
Parcourent ces épaisses prairies ;
Nos chariots couverts de clayons
Vont à pas lents sur la grand-route.
Pour le coup, ça ne relève peut-être pas du chant de marche – à moins que l’idée ne soit de démoraliser ses propres troupes.
Mais ce thème de l’éloignement est omniprésent. Bien loin de n’être associé qu’aux soldats partis combattre à l’horizon, il touche tout autant les fonctionnaires (bien souvent les poètes eux-mêmes, donc) que les vicissitudes de la carrière comme de la politique, haute ou basse, contraignent à traverser la Chine de part en part – on ne compte pas les poèmes qui évoquent ces voyages, et mettent en avant, surtout, la séparation. Celle-ci concerne aussi bien les amis que les amants – il y a toute une poésie amoureuse sur ce thème, la séparation étant en fait le motif même, par excellence, du poème amoureux (il en va de même dans le Japon classique, bien sûr) ; mais avec peut-être une part non négligeable d’exercice de style, car une grande majorité de ces poèmes qui évoquent à la première personne les lamentations d’une femme délaissée (parce que son mari a été muté voire exilé au loin ou parce qu’il l’a abandonnée) sont en fait écrits par des hommes (sauf erreur, il n'y a que très peu de poétesses dans cette compilation, s'il y en a). Mais l’éloignement peut parfois être connoté différemment, et, de même, on ne compte pas les œuvres dans lesquelles des fonctionnaires fatigués par leur office, ou, pas moins souvent, par les errances de dynasties qui ne tarderaient guère à se voir retirer le Mandat Céleste, à refuser ainsi d’écouter les bons conseillers, ces fonctionnaires, donc, évoquent avec émotion l’ultime retour au pays, ou parfois la retraite dans quelque humble ermitage. Ceci étant, la vieillesse et la retraite ont leurs lots propres de déconvenues – j’ai été très ému par ce poème de Tcheou Pang-yen (1056-1121), intitulé Sur l’air long « Les vagues baignent le sable » :
Mille feuilles frissonnent ; l’automne bruit, et la forêt se fige.
L’oie sauvage a franchi les syrtes sablonneuses ;
Mais l’herbe fine, enveloppée de brume, verdoie toujours.
Quand vient le soir, s’accuse l’azur des montagnes lointaines.
À la lisière des nuages paraît, confuse et pâle, une lune nouvelle ;
Sur les mille façades, les jalousies et les rideaux renvoient les rayons du couchant.
On entend quelque part, au bord d’un étage, les notes d’une flûte,
Dont la touche embellit les couleurs de l’automne.
Lourd de pensées muettes,
Le cœur du voyageur en secret se consume.
Je songe au temps des perles et du jade : au bord des eaux, déjà l’angoisse me prenait.
C’est bien pis aujourd’hui, que j’erre au bout du ciel !
Je me souviens de mes jeunes années, des chansons et du vin,
Des aventures d’autrefois.
La fleur de l’âge aisément se flétrit.
Des vêtements, la taille se relâche ; à force de soucis, le cœur étouffe.
L’essaim s’est dispersé, les gracieux compagnons ne se rejoignent plus.
Jusqu’au pont bleu des rendez-vous, la longueur du chemin me fait perdre courage.
Et comme un vieux cheval hennit encore
Quand son sabot franchit les rues et les chemins de jadis,
De même je soupire : des souvenirs de mon passé, chacun suffit à me blesser.
Au loin mes yeux se perdent :
Mais mon esprit soudain se glace, et de nouveau, du poing, je frappe la clôture.
Pour finir sur une note plus légère, et qui n’est en même temps pas sans lien avec tout ce qui précède, il est un autre thème très récurrent qui m’a séduit dans cette anthologie, et c’est la célébration de l’ivresse – un sujet dont, sauf erreur, le grand Li Po s’était fait le plus talentueux exégète. Ce thème peut déboucher sur des poèmes très divers, de la méditation solitaire agréablement éméchée à l’éloge lié de l’amitié la plus touchante.
Le choix même de ces thèmes, dans cet article, doit beaucoup à mes biais, bien sûr. Mais ceux-ci m’ont d’autant plus marqué, en tout cas plus que bien d’autres que j’aurais pu citer, parce qu’ils m’ont éventuellement surpris ? La poésie chinoise classique, très codifiée dans les formes, m’a en même temps fait l’effet d’une liberté de ton qui peut étonner – et ces soldats qui rechignent à se battre, comme ces amis qui boivent ensemble quelques coupes avant l’inéluctable séparation, sous la plume de ces fonctionnaires élevés pourtant dans une certaine austérité morale prisant le dévouement voire le sacrifice, m’ont plus qu’à leur tout ému. C’est bien entendu un ressenti très personnel, et bien d’autres poèmes, de qualité tout aussi notable, pourraient aisément susciter un sentiment tout différent, voire carrément contradictoire.
Qu’importe ? Dans tous les cas, j’ai beaucoup apprécié cette lecture – édifiante, émouvante, stimulante. Belle, enfin. Une appréciable porte d’entrée pour un univers littéraire d’une ampleur sans commune mesure, d’une richesse unique.
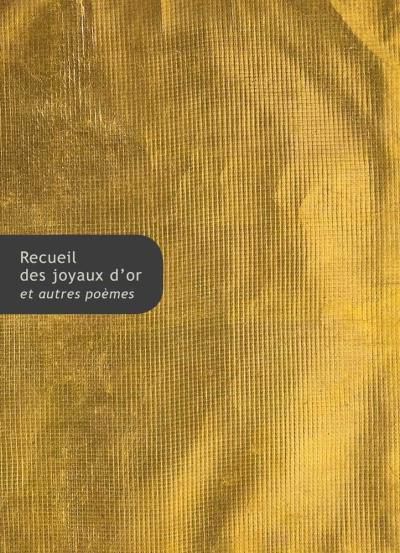

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



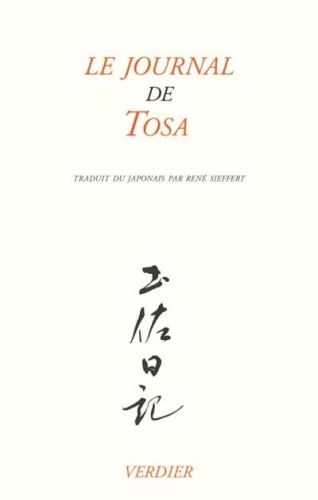
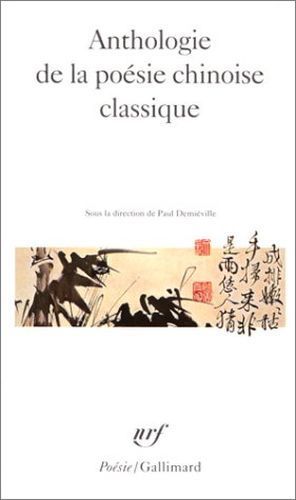



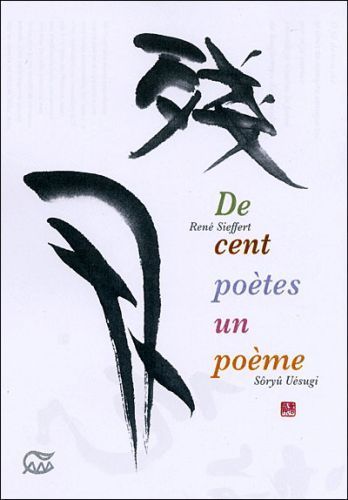
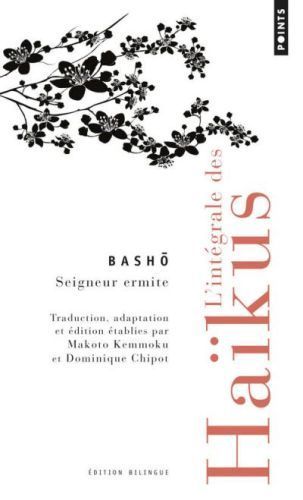

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)