Les 12, 13 et 14 novembre 2008, il m’a été donné d’assister à un colloque (quoique le terme de « rencontre » ait été très tôt privilégié) à l’Université des Sciences Sociales Toulouse 1, organisé par le Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques, avec pour responsable scientifique Philippe Nélidoff (professeur, Toulouse 1), secondé par un comité d’organisation composé de Frédéric Audren (chargé d’études CNRS – Maison française d’Oxford), Pierre Bonin (professeur, Nantes), Philippe Delvit (professeur, Toulouse 1), Olivier Devaux (professeur, Toulouse 1), Nader Hakim (maître de conférences, Montesquieu – Bordeaux IV), Jean-Louis Halpérin (ENS Ulm), Jacques Krynen (professeur, directeur du CTHDIP, Toulouse 1) et Jacques Poumarède (professeur, Toulouse 1).
Il s’agissait donc de se pencher sur le thème des Facultés de droit de province au XIXe siècle, et d’en tirer des bilans et perspectives de recherches. Le vœu des organisateurs était en effet que cette première rencontre soit régulièrement prolongée, afin d’approfondir cette thématique de recherche étrangement peu abordée jusqu’à présent. Des actes de ce colloque seront prochainement édités (fin 2009, ou plus probablement courant 2010). Sans doute me sera-t-il alors possible d’en tirer un compte rendu plus ou moins approfondi, « scientifique ». Ce n’est pas l’objet de cette note, qui ne se veut qu’un compte rendu « à chaud », passablement lapidaire, et incontestablement subjectif : béotien largement incompétent dans ces matières, et simple spectateur, je n’entends ici rapporter que mes premières impressions à l’issue du colloque dans son ensemble et des communications qu’il a suscitées.
Le colloque se tenait dans la salle Maurice Hauriou du site des Anciennes Facultés. Ce choix de la ci-devant salle du conseil n’était certainement pas innocent : ainsi que Pierre Bonin en a fait la remarque lors de la conclusion des travaux, cette petite salle obscure dont les hauts murs sont parsemés des portraits quelque peu grandiloquents des plus fameux professeurs et doyens de la Faculté de droit toulousaine a très certainement marqué de son empreinte les travaux, suscitant une atmosphère particulière, permettant régulièrement d’illustrer le propos, mais tendant peut-être également à lui conférer une fausse impression « d’immobilisme » et de « majesté ». D’autant que ce thème de recherche pouvait présenter le risque d’alimenter un vain sentiment cocardier, s’appuyant sur les gloires locales au préjudice de l’analyse. L’université toulousaine, forte de son ancienneté – c’est une des plus vieilles universités de France et plus largement d’Europe, puisque constituée en 1229 ; c’est d’autant plus vrai pour ce qui est de la Faculté de droit, Toulouse étant une vieille ville « de robe » (instauration du premier Parlement de province en 1444) –, est il est vrai coutumière du fait, et la deuxième journée du colloque, consacrée à Toulouse, en témoignera assez… Cet état d’esprit, à vrai dire, semble toujours d’actualité, quand bien même il ressortait le plus souvent de traits « d’humour » à froid, heureusement non exempts d’autodérision, témoignant des rivalités entre facultés de province… et a fortiori de leur statut particulier, « inférieur », par rapport à Paris. Il fut en effet très tôt et très justement affirmé que l’exclusion parisienne du titre ne devait pas être prise au pied de la lettre, toutes les facultés de province tendant tout naturellement à se définir par rapport à la capitale. Mais sans doute aurait-il été intéressant d’aborder plus en détail ces diverses rivalités, mais aussi les autres formes de relations qui pouvaient exister entre les universités de province : si la thématique des « réseaux » a souvent été relevée, le fait est que les travaux n’ont à mon sens guère avancé sous cet angle (on aura par contre l’occasion de revenir sur les « écoles de pensée »…).
Quelques mots, justement, sur cette salle et ces portraits. J’avais déjà eu l’occasion de pénétrer dans ce « saint des saints » à plusieurs reprises (notamment pour une expérience traumatisante : la présentation de mon projet de thèse en vue de l’obtention d’une allocation de recherche, devant une auguste assemblée de professeurs ; encore aujourd’hui, je reste persuadé que le fauteuil alloué aux candidats était rabaissé…) ; mais j’avoue ne guère partager les sentiments dont bon nombre d’interventions – toulousaines… – se sont fait l’écho. Peut-être est-ce parce que je suis un jeune sauvageon ne respectant rien, réfractaire à l’esprit de corps, à la « tradition » et à la glorification des prédécesseurs (sans doute sont-ils très glorieux, mais je ne vois pas pour quelle raison les étudiants et professeurs contemporains devraient en retirer la moindre fierté…) ? Toujours est-il que devant les évocations enflammées de la beauté et du prestige de cette salle, je me suis toujours montré pour le moins circonspect. Ces portraits, en effet, ne me semblent guère à l’honneur des portraiturés – et je ne m’en tiens pas ici à la seule qualité d’exécution, pour le moins variable… Frédéric Audren mentionnait tout naturellement le côté « anglo-saxon » de cette salle (Harry Potter à l’école des juristes ?). Mais pour ma part, chaque fois que j’y pénètre, et que je me retrouve environné de ces arrogantes reliques du XIXe siècle, je ne peux m’empêcher de penser au Procès de Kafka, et à la figure de Titorelli, le peintre officiel du Tribunal… et, je plaide coupable, ces représentations officielles passablement prétentieuses me paraissent généralement d’autant plus ridicules. Un tableau, notamment – mais le nom du doyen représenté m’échappe – m’interloque énormément : j’ai l’impression qu’il a été malhabilement retouché pour y faire figurer une décoration supplémentaire… mais peut-être la faute en incombe-t-elle à un reflet. Toujours est-il que j’ai été quelque peu soulagé quand, passé un certain nombre de louanges, il s’est trouvé quelques intervenants pour blaguer les illustres. Je pense notamment à (l’inénarrable) Marie-Bernadette Bruguière, évoquant une ancienne anecdote, celle d’un étudiant confronté au gigantesque portrait du doyen Campistron (à la moustache incomparable), et en concluant : « Si quelqu’un avec une telle tête d’idiot a pu devenir professeur de droit, je ne vois pas pourquoi je n’y arriverais pas… » J’ajouterais cependant que Campistron, à la figure relativement débonnaire, n’est pas à mon sens le plus ridicule des portraiturés… Mais il y eut aussi Philippe Delvit, passionné par cette salle, et connaissant nombre d’anecdotes s’y rapportant, qui nous raconta quelques faits de la petite histoire, notamment à partir d’une photographie représentant l’inauguration du buste de Maurice Hauriou : le caractère peu amène de la veuve, les dissensions – notamment politiques – entre le fils d’Hauriou et le professeur Ourliac… Pierre Bonin, enfin, s’interrogeant sur le teint hépatique de quelques augustes juristes. Il y a cependant un tableau que j’avoue trouver impressionnant. Peut-être suis-je en définitive rattrapé par l’esprit de corps, etc., dans la mesure où il s’agit de celui de la principale gloire toulousaine (on sait depuis longtemps que Cujas ne compte pas, et que sa récupération par Toulouse est une imposture…), à savoir le doyen Maurice Hauriou, qui a donc donné son nom à cette salle, et dont le buste, fort apprécié des pigeons, orne le petit jardin en travaux perpétuels séparant l’ancienne faculté proprement dite de l’amphi Cujas (…) et de l’IEP. Son portrait n’est pas plus intéressant que les autres sur le seul plan artistique. Mais deux éléments me paraissent notables : d’une part, il est assez amusant de constater que cet illustre s’il en est, immense publiciste dont la pensée reste encore influente de nos jours, n’est représenté que sur un des plus petits tableaux de la salle, bien plus discret que ceux de ses confrères et prédécesseurs pour la plupart sombrés dans l’oubli… Modestie authentique, ou fausse à la Chateaubriand ? Je n’oserai pas trancher. Mais d’autre part, on remarquera que le doyen Hauriou, à mon sens bien plus élégant que les autres, est le seul à ne pas être représenté de face ou trois-quarts face, les décorations bien en évidence (et souvent en pied ou peu s’en faut)… mais de trois-quarts dos (et en buste). Je laisserai à d’autres plus compétents le soin de conclure.
Mais trêve de billevesées, pour reprendre les mots d’un fameux procureur, et abordons plutôt le colloque en lui-même. Celui-ci s’est ouvert le mercredi 12 novembre 2008 par un Propos introductif de Jacques Krynen (professeur, directeur du CTHDIP, Toulouse 1), après quoi Philippe Nélidoff (professeur, Toulouse 1) a officiellement ouvert les travaux.
La première session, intitulée État de la recherche, et présidée par Jacques Krynen, adopta une forme assez particulière, mais fort bien vue. En effet, il fut demandé à divers chercheurs d’établir des rapports (de forme variée : historiques, bibliographies, sources…) concernant les facultés de droit de province. Ces rapports ont été compilés dans un polycopié d’environ 130 pages, qui, je l’espère, sera repris dans les Actes du colloque (c’est en effet un document qui sera à n’en pas douter très utile pour des recherches ultérieures). Aix fut ainsi étudiée par Jean-Louis Mestre (professeur, Aix – Marseille III), Alger par Jean Bastier (professeur, Toulouse 1), Bordeaux par Marc Malherbe (maître de conférences, Montesquieu – Bordeaux IV), Caen par Anne-Sophie Chambost (maître de conférences, Paris V – René Descartes), Dijon par Boris Bernabé (maître de conférences, Université de Bourgogne), Grenoble par Cyrille Marconi (allocataire-moniteur, Pierre Mendès France – Grenoble II), Lille et Douai par Farid Lekeal (maître de conférences, Lille II) et Sylvie Humbert (maître de conférences, Institut catholique de Lille), Lyon par Catherine Fillon (maître de conférences, Jean Moulin – Lyon III), Montpellier par Fabien Valente (maître de conférences, Montpellier), Nancy par François Lormant (ingénieur d’études, Nancy II), Poitiers par Jean-Marie Augustin (professeur, Poitiers) et Mathieu Touzeil-Divina (maître de conférences, Paris X), Rennes par Tiphaine Le Yoncourt (maître de conférences, Rennes II), Strasbourg par Céline Pauthier (maître de conférences, Robert Schuman – Strasbourg), et enfin Toulouse par Olivier Devaux (professeur, Toulouse 1). Mais, plutôt que de faire une présentation, sans doute rébarbative et répétitive, de chaque rapport, on laissa le soin à Frédéric Audren (chargé d’études CNRS – Maison française d’Oxford) d’élaborer une Synthèse des enquêtes menées pour chacune des Facultés de droit du XIXe siècle, ce qui permit déjà de dégager d’intéressantes pistes de recherches, en définissant le sujet d’une manière à la fois globale et précise. Cette synthèse d’environ une heure fut suivie d’un Débat avec les auteurs des rapports (du moins ceux qui étaient présents…), parfois lourd de redites, mais à l’occasion très enrichissant ; je note ainsi, plus particulièrement, le propos de Marc Malherbe concernant les sources privées et leur accès parfois « difficile » (en l’occurrence, si je ne m’abuse, il s’agissait de la bibliothèque du doyen Duguit, et sans doute d’une partie de sa correspondance…) ; celui de Farid Lekeal et Sylvie Humbert sur Lille et Douai, le lien avec la Belgique, les raisons de la création tardive de la Faculté, et les relations entre facultés d’État et « écoles libres » (essentiellement confessionnelles… ce qui amena Philippe Nélidoff à lancer une diatribe, guère surprenante de sa part, à l’encontre de l’anticléricalisme endémique… mais sa compétence et son ouverture d’esprit l’autorisent assez, d’autant que, si je ne pourrais en aucun cas prétendre avoir les opinions du souriant professeur quant au problème général de la religion et de ses rapports à l’État – « ça se discute », pour reprendre le laconique et tout aussi souriant commentaire du professeur Jacques Poumarède… –, et si la forme enflammée de son intervention avait quelque chose d’excessif, je lui donne tout à fait raison pour ce qui est du fond dans cette question précise ; quoi qu’il en soit, ce fut l’inauguration d’un running gag de la rencontre…) ; celui de Jean-Marie Augustin et Mathieu Touzeil-Divina sur la concurrence entre les facultés de Poitiers et de Toulouse se disputant le rang de « première Faculté de droit de province » (nouveau running gag, inévitablement…) ; enfin et surtout, celui, tout à fait passionnant, de Céline Pauthier concernant le sort particulier de la Faculté de droit de Strasbourg, passant incessamment de la France à l’Allemagne (et se dédoublant parfois, ainsi lors de la deuxième Guerre Mondiale, c’est du moins ce que j’ai cru comprendre…), par voie de conséquence ayant un rapport différent à la question religieuse, mais aussi ayant un caractère politique plus affirmé, et, enfin, étant bien évidemment centrale dans la question de l’influence du modèle allemand (d’abord l’école historique du droit – on y reviendra à maintes reprises – et sans doute aussi la science romaniste allemande, ensuite le BGB, etc., j’imagine). On définit ainsi quelques priorités, concernant notamment les sources, mais aussi et surtout la nécessité d’établir la généalogie des chaires.
La journée s’est enfin conclue sur une communication, qui aurait sans doute été davantage à sa place le vendredi suivant. Nicole Dockès (professeur émérite, Jean Moulin – Lyon III) était supposée nous entretenir de La Faculté de droit de Lyon sous la direction d’Exupère Caillemer (1875-1918), mais a finalement abordé un tout autre sujet, préférant se concentrer sur l’école libre qui a précédé la Faculté de droit de Lyon. Une communication intéressante et vivante, qui permit déjà d’aborder le problème de l’implantation des facultés d’État face aux écoles libres, et les diverses difficultés rencontrées par ceux qui souhaitaient l’établissement d’un tel enseignement, notamment du fait des rivalités locales (ici essentiellement avec la Faculté de Grenoble). Cela me permit aussi, je dois l’avouer, de prendre conscience de ce que le « XIXe siècle » de l’intitulé général du colloque pouvait correspondre à des réalités bien différentes, nombre de facultés non négligeables (parmi lesquelles, justement, Lyon, mais aussi Bordeaux) sont de création récente (souvent postérieures à la guerre de 1870, ligne de partage souvent relevée dans les communications).
Les travaux reprirent le lendemain à 9h30, pour une journée entièrement consacrée à la Faculté de droit de Toulouse. La deuxième session, dans la matinée, s’intitulait Une Faculté de droit de province au XIXe siècle, Toulouse : cadres et organisation ; elle fut tout d’abord présidée par Germain Sicard (professeur émérite, Toulouse 1), puis par Marie-Bernadette Bruguière (professeur émérite, Toulouse 1).
Sonia Moussay (historienne de l’art, conférencière du Patrimoine) nous entretint tout d’abord de L’Architecture de la Faculté de droit de Toulouse. Une communication passablement scolaire et dépassant allègrement (et inévitablement) le sujet, mais néanmoins fort intéressante et instructive : une introduction tout à fait bienvenue.
Marielle Mouranche (conservateur SICD – Service du livre ancien, Toulouse 1) souleva ensuite Quelques pistes pour une histoire de la bibliothèque de la Faculté de droit de Toulouse au XIXe siècle ; une communication pointue et quelque peu abstraite à mon sens, mais non dénuée d’intérêt.
Il en est allé de même pour la communication suivante, Registres, parchemins et papiers : les archives de la Faculté de droit de Toulouse (1805-1914), due à Philippe Delvit (professeur, Toulouse 1) et à Delphine Floreck (archiviste, Mission Archives Toulouse 1), parfois confuse… ce qui témoignait assez de la complexité de la question et de l’éparpillement des archives de l’université. Or Toulouse 1, qui dispose donc d’une « Mission Archives », est pourtant loin d’être la plus mal lotie sous cet angle !
Suivit un débat et une pause, après quoi Mathieu Peter (doctorant, Toulouse 1) évoqua Les rentrées solennelles de la Faculté de droit de Toulouse (1840-1870) : une communication intéressante et solidement documentée, mais qui ne m’a étrangement pas appris grand chose, à l’instar d’un certain nombre d’autres interventions de cette journée un peu molle…
Heureusement, Caroline Barrera (Centre universitaire de formation et de recherche Champollion, laboratoire Framespa, CNRS – Toulouse 2 – Le Mirail), démontra assez la bêtise du préjugé anti-Mirail sarcastiquement évoqué par (l’inénarrable, donc, mais aussi « intouchable » et prévisible) Marie-Bernadette Bruguière en livrant ce qui constitua à mon sens et de très loin la communication la plus intéressante et pertinente de la journée : Les étudiants étrangers et coloniaux de la Faculté de droit de Toulouse au XIXe siècle. Ce fut une des très rares interventions à mettre en avant les étudiants comme composante à part entière de l’université (il faudra attendre les deux dernières communications grenobloises pour que ce thème pourtant fondamental ressurgisse, tout un symbole…). Un travail souvent surprenant et toujours instructif (j’ai été particulièrement intéressé par l’évocation des étudiants « réfugiés politiques », accueillis à bras ouverts et protégés par la Faculté – même si souvent surveillés… –, notamment Polonais – ce qui rejoint dans un sens ma recherche – mais aussi Russes – parce que juifs ou socialistes, dans ce dernier cas…), reposant en outre sur des documents d’archive véritablement remarquables (je pense notamment aux caricatures tirées d’une revue humoristique publiée par des soldats américains étudiant le droit à Toulouse au cours de la première Guerre Mondiale…).
La troisième session, l’après-midi, prolongea la précédente : Une Faculté de droit de province au XIXe siècle, Toulouse : les enseignements et les implications intellectuelles, sous la présidence de Jean-Marie Augustin (professeur, Poitiers). Ce fut hélas à mon sens la moins intéressante de toutes…
Jean-François Babouin (chef du département GEA, IUT de Bourges) évoqua tout d’abord Le premier cours de droit administratif à la Faculté de droit de Toulouse (1807), à partir d’un manuscrit anonyme. La communication était certes sérieuse, et parfois intéressante (je relève notamment la question des liens établis avec les institutions de l’Ancien Régime, le préfet étant comparé à l’intendant, etc.), mais à mon sens trop pointue et précise pour s’intégrer parfaitement dans la thématique de cette rencontre ; et je doute qu’il soit véritablement possible d’en tirer des enseignements productifs…
Pierre-Louis Boyer (doctorant, Toulouse 1) nous parla ensuite de La fondation de l’Académie de Législation : un cercle juridique au sein des sociétés savantes toulousaines. Une communication savante et intéressante, mais qui m’a fait tout d’abord l’effet d’être à la limite du hors-sujet (si les professeurs de la Faculté de droit sont présents dans cette institution, au même titre que les magistrats et avocats, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une institution extra-universitaire) ; elle ne fut cependant pas dépourvue d’intérêt, loin de là, dans la mesure où il s’agit finalement d’une des rares communications ayant véritablement abordé la thématique des « réseaux », en évoquant l’action de l’Académie de Législation (unique en son genre) en faveur du modèle allemand et de l’école historique du droit, contre l’école de l’exégèse ; et Mathieu Touzeil-Divina témoigna de la portée de cette action auprès des autres universités (et notamment celle de Poitiers).
Mais les deux communications suivantes ne furent hélas pas aussi pertinentes : certes, elles ont été faites sérieusement, je ne remettrais certainement pas ceci en cause ; le problème, cependant, est qu’elles se sont largement répétées (et qu’une troisième communication le lendemain allait encore faire de même !), et qu’elles ne m’ont hélas pas appris grand chose (les cours d’histoire du droit privé – centrés plus précisément sur l’histoire de la propriété – du professeur Jacques Poumarède, en Licence Droit – surtout – et dans une moindre mesure en Master 2 Histoire du droit, contenaient déjà la majeure partie des éléments de ces communications…). Jacqueline Begliuti-Zonno (doctorante, Toulouse 1) évoqua donc Les sciences d’État à la Faculté de droit de Toulouse au XIXe siècle, plus précisément au début de la IIIe République, et en se focalisant essentiellement sur l’économie politique ; après quoi Ludovic Azéma (docteur, Toulouse 1) nous parla… de L’apparition des enseignements économiques à la Faculté de droit de Toulouse au XIXe siècle. Ce qui fut pour le moins redondant. Je retiendrais des deux communications une petite « controverse » concernant l’intéressante figure de Rozy… mais aussi, hélas, leur tendance, à mon sens, à envisager le problème de manière quelque peu unilatérale (que l’hostilité au socialisme ait favorisé le développement des enseignements économiques, aucun doute à cet égard ; mais, dans cette opposition, bien des idéologies différentes pouvaient être impliquées…).
Hervé Le Roy (maître de conférences, Toulouse 1) traita ensuite d’une autre intéressante figure locale, avec L’Aspect régionaliste de l’œuvre de Jean-Baptiste Brissaud (traitant essentiellement de l’activité de Brissaud dans le cadre des sociétés savantes, et de sa tendance à la « dispersion », diront les mauvaises langues, à la « pluridisciplinarité » diront les plus charitables – je me situe parmi ces derniers). Une communication assez « scolaire », cela dit.
Bien autrement intéressante fut la dernière communication de la journée. Caroline Javanaud (doctorante, Toulouse 1) n’eut pas grand chose à présenter à l’oral, mais son travail de recherche bibliographique sur le doyen Hauriou, qui figurera dans les actes, sera sans doute du plus grand intérêt. Mais elle introduisit ainsi brièvement la recherche de Philippe Nélidoff intitulée Le doyen Maurice Hauriou et la liberté des cultes. L’hypothèse émise par le professeur, d’un positionnement « libéral » du doyen Hauriou quant à la question de la liberté des cultes, a pu être débattue, de même que celle de son influence sur la jurisprudence du Conseil d’Etat. Mais ce fut étrangement la seule communication de tout le colloque à avoir fait intervenir la question du rôle de la doctrine, notamment par rapport à la jurisprudence, et donc de l’influence éventuelle des universités de province… Ce fut enfin l’occasion de sortir résolument l’université de ce monde illusoire et détaché qu’elle revendiquait et revendique étrangement encore aujourd’hui parfois, prétendument immobile et insensible aux troubles de la société civile… Là encore, pour approfondir ce thème, il faudra surtout se reporter aux deux dernières communications grenobloises…
La quatrième session, le lendemain matin, était intitulée Écoles et enseignements dans les Facultés de droit de province au XIXe siècle, et fut présidée par Jean-Louis Mestre (professeur, Aix – Marseille III). Exit Toulouse, donc. L’ordre des communications fut quelque peu chamboulé par rapport au programme initial. La journée débuta avec Mathieu Touzeil-Divina (maître de conférences, Paris X Nanterre), dynamique jeune publiciste (mais très à l’aise au milieu des historiens, et n’hésitant pas à contredire ou nuancer ses aînés avec finesse…), auteur d’une thèse que tout le monde s’accorda à qualifier de monumentale, et dont il développa ici un aspect : L’inexistence d’une école de Poitiers ou l’enseignement du droit public à Poitiers de 1834 à 1900. Une communication vivante, à la fois solide et abordable, et indéniablement pertinente dans sa remise en cause d’une idée reçue pourtant très prégnante aujourd’hui encore. Ce fut l’occasion de poser plus largement la question de l’existence des « écoles », et d’y apporter une réponse extrêmement nuancée : nombre d’entre elles semblent bien être des reconstructions a posteriori, dues aux fiertés locales ou au poids des « autorités » (en l’occurrence, ici, les Toulousains Maurice Hauriou et Achille Mestre…). Une des meilleures communications du colloque à mon sens.
Ahmed Slimani (maître de conférences, Amiens) évoqua ensuite Les débuts de l’enseignement de l’histoire du droit à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence (1879-1918), prolongeant ainsi, dans un sens, l’étude de « l’histoire de l’histoire du droit » qui avait fait l’objet d’un précédent colloque toulousain (sous la direction de Jacques Poumarède, si je ne m’abuse). Un travail solide et intéressant, très vivant… d’autant qu’il reposait à l’occasion sur des sources orales, pour le moins rares en histoire du droit !
Marc Malherbe (maître de conférences, Montesquieu – Bordeaux IV) traita quant à lui de La science romaniste bordelaise au XIXe siècle, ce qui nous valut à nouveau une communication à la fois pointue et vivante, et parfois surprenante.
Suivit la communication « dijonnaise », qui aurait en principe dû intervenir plus tôt dans la journée. Le programme annonçait une communication d’Hugues Richard (professeur, Université de Bourgogne) et de Boris Bernabé (maître de conférences, Université de Bourgogne), intitulée Existe-t-il une école de droit dijonnaise ? Mais – peut-être à cause de la remarquable communication de Mathieu Touzeil-Divina ? –, c’est un tout autre sujet qui fut abordé, et par Hugues Richard seul… Celui-ci nous entretint donc de La Faculté de droit de Dijon dans la première moitié du XIXe siècle et le rôle du doyen Proudhon (Jean-Baptiste-Victor, un cousin du bien autrement bouillant Pierre-Joseph…). Du moins était-ce le titre de sa présentation ; mais j’avoue n’avoir pas du tout été convaincu par cette communication largement hors-sujet (très longue introduction pré-révolutionnaire…), sentant quelque peu le réchauffé, et en même temps faite un peu de bric et de broc…
La matinée s’acheva enfin avec Nelly Hissung-Convert (docteur, Montesquieu – Bordeaux IV), qui nous parla… de L’enseignement de l’économie politique à la Faculté de droit de Bordeaux au XIXe siècle. Des trois communications « économiques », ce fut à mon sens la plus riche et la plus pertinente ; mais elle eut le malheur d’arriver en dernière position…
La cinquième et dernière session, l’après-midi, m’intéressa particulièrement : sous la présidence de Jacques Poumarède (professeur, Toulouse 1), il s’agissait de s’interroger sur La Faculté de droit dans sa ville en province au XIXe siècle. Elle commença avec Jean-Marie Augustin (professeur, Poitiers) évoquant Les professeurs de la Faculté de droit de Poitiers et la vie locale. Une communication relativement intéressante, dont j’ai essentiellement retenu la forte implication des professeurs poitevins dans le Barreau.
Mais suivirent deux communications grenobloises, qui m’ont tout à fait passionné (il est vrai qu’elles se rapprochaient davantage de mon objet de recherche…). Cyrille Marconi (allocataire-moniteur, Pierre Mendès France – Grenoble II) nous parla tout d’abord de Jean-Paul Didier (1758-1816), premier directeur de l’École de droit de Grenoble : un destin singulier. C’est le moins qu’on puisse dire : étrange personnage, mené par une ambition dévorante, et qui acheva sa carrière sur la guillotine, après une invraisemblable conspiration supposée détrôner les Bourbons… Une communication remarquable, pertinente et relativement originale.
Et l’enchaînement se fit tout naturellement avec la dernière communication, celle de Jean-Christophe Gaven (professeur, Pierre Mendès France – Grenoble II) portant sur La Faculté de droit de Grenoble dans la tourmente politique durant la Restauration, et plus précisément sur la suppression de la Faculté entre 1821 et 1824, suite à un prétendu complot impliquant des étudiants (on les retrouve enfin !) grenoblois. J’ai retrouvé dans ce passionnant finale bien des thématiques m’intéressant (au passage, le mémoire de DEA de Jean-Christophe Gaven, consacré au procès du maréchal Ney, et repris dans une des premières publications du CTHDIP, m’avait déjà été fort utile, pour les mêmes raisons, quand j’étais moi-même en Master 2…). Une des meilleurs communications du colloque à mon sens, mais je suis peut-être un tantinet partial…
On passa enfin à la Conclusion des travaux, par Pierre Bonin (professeur, Nantes), puis Nader Hakim (maître de conférences, Montesquieu – Bordeaux IV), dont les précédentes interventions s’étaient toujours montrées très pertinentes, et qui sut, à l’instar de son confrère, tirer les plus précieux enseignement de cette première rencontre. Reste maintenant à attendre la publication des Actes, puis une nouvelle rencontre, dans une nouvelle université…


/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)






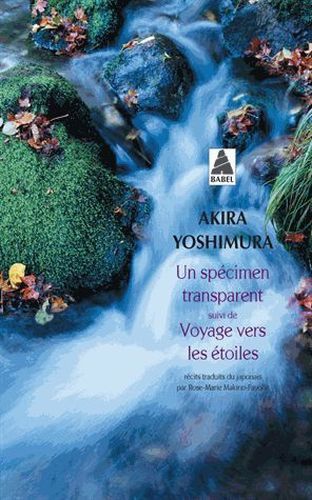






/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)