Annonçons franchement la couleur : je suis un adorateur fanatique du Roman de Renart. C’est en ce qui me concerne une œuvre exceptionnelle, unique en son genre, et qui a gardé une part remarquable de sa saveur et de sa subversion près de huit siècles après sa composition.
Et c’est, à n’en pas douter, une œuvre qui a considérablement imprégné les mentalités françaises, et peut-être même plus largement occidentales. Un fait qui en témoigne assez : le nom commun de « renard » pour désigner l’animal est dérivé du nom propre Renart (lui-même dérivé du germanique Reginhart ou Rheinhart, toujours employé aujourd’hui comme prénom) désignant le « héros » de ces malicieuses aventures ; quant au terme exact pour désigner ce mammifère, celui de « goupil » (plus proche assurément du latin vulpes), il est largement tombé en désuétude… Au-delà, l’association du renard à la ruse a perduré : si l’on n’emploie plus guère les expressions courantes autrefois de « renardie », de « confession Renart », de « malin comme Renart », etc., l’image de l’astucieux renard anthropomorphe a largement perduré : ce n’est sans doute pas un hasard si le Robin des Bois de Walt Disney est un renard. Au passage, le film d’animations a connu des déclinaisons plus « officielles » du Roman, quand bien même destinées à la jeunesse (j’y reviendrai…), ainsi le film de marionnettes de Ladislas Starewitch, que je me souviens avoir vu gamin dans un cadre scolaire et dont je garde encore aujourd’hui en tête certaines images, ou encore, dans les années 1980, la série animée Moi Renart (aaaaah, ce générique… toute mon enfance !), déclinant astucieusement la fantaisie renardienne dans le monde contemporain – certes, le public visé était jeune là encore, mais faire de Renart un yuppie arriviste (pléonasme) et amateur de jolies filles était plutôt bien vu : de Renart à Patrick Bateman et Jim Profit, dans un sens…
Bien sûr, cette image du rusé goupil dépasse le seul Roman de Renart : la simple observation des mœurs de l’animal (ainsi, par exemple, son aptitude à feindre la mort pour tromper ses proies, astuce d’ailleurs régulièrement employée dans le Roman, qui se montre souvent très fin dans ses allusions aux comportements animaux) a contribué à forger cette représentation de manière quasi universelle : pour ne citer qu’un exemple bien lointain, au Japon, la culture populaire comme l’imagerie animiste véhiculent un important mythe de l’esprit-renard, astucieux et facétieux, et incomparablement dangereux le cas échéant… Mais c’est également, en Occident, une image qui a perduré dans les fables animalières : tous, à l’école, nous avons à un moment ou à un autre appris « par cœur » Le Corbeau et le renard de La Fontaine… Mais cette fable se rencontrait déjà auparavant, entre autres, chez Marie de France, et encore auparavant chez Phèdre (il me semble), et, bien sûr, Ésope (rappelons d’ailleurs qu’aux Moyen Âge, les recueils de fables sont souvent appelés « isopets »). Inévitablement, cette célèbre histoire figure également dans Le Roman de Renart… à ceci près que Renart, cette fois, ne se contente pas de flatter le corbeau (Tiécelin) pour lui voler son fromage, mais essaye, tant qu’à faire, de bouffer également le volatile.
Ce qui en dit long. En effet, si Le Roman de Renart a largement imprégné nos mentalités, c’est pourtant une œuvre finalement très méconnue, car largement trahie. Pour dire les choses clairement, Le Roman de Renart, originellement, n’est pas du tout, mais alors PAS DU TOUT, destiné aux petits nenfants. C’est un texte violent, cru, subversif, immoral, ne rechignant pas à la vulgarité grivoise et/ou scatologique. Renart n’est pas simplement une astucieuse et souriante boule de poils, qui fait des mauvais tours, certes, mais relativement innocents en fin de compte : non, c’est une authentique ordure, un salopard fini, non seulement voleur et escroc (et assez sympathique…), mais aussi violeur et assassin, et fondamentalement cruel. Les mauvais tours de Renart, comme les railleries qui s’ensuivent (les « gabs »), témoignent de sa propension au mal : s’il use régulièrement de sa ruse pour sauver sa peau (au sens littéral…), en bien des occasions il trompe, trahit et fait souffrir uniquement parce que cela l’amuse... Les textes les plus anciens du Roman de Renart ne le jugent généralement pas (ou très hypocritement), et offrent simplement ses mauvais tours aux lecteurs et aux auditeurs dans un pur but de divertissement (ce qui, dans un sens, ne fait que renforcer l’aspect subversif de la chose… j’y reviendrai) ; mais les déclinaisons les plus tardives tentent de réintégrer la morale dans le Roman, et l’image du seigneur de Maupertuis (le « mauvais trou ») en fait les frais : le rusé goupil devient rien moins qu’un avatar du Diable… Et c’est pourtant le « héros », celui dont on suit les aventures avec plaisir, et dont les mauvais tours parfois franchement ignobles nous font tant rire et nous défoulent... dans la mesure où nous avons la chance de ne pas en être les victimes !
Pourtant, depuis longtemps déjà, Le Roman de Renart est souvent présenté comme une œuvre de littérature enfantine, et on l’étudie parfois, à l’école ou au collège, dans des versions drastiquement abrégées et expurgées, en provenance directe d’un XIXe siècle imprégné d’ordre moral, qui a privilégié l’élégance sur la rudesse originelle, gommé les traits les plus inacceptables et moralisé le tout ; tiens, ça me rappelle quelque chose de plus actuel... Il ne s’agit pas ainsi seulement d’un affadissement, mais d’une véritable trahison dans certains cas. Je me souviens, quand j’étais gamin, de ma découverte du Roman, dans une minuscule édition scolaire, saturée d’exercices de compréhension, puis, plus tard, de ma lecture en Folio de la version dite « classique » de Paulin Paris ; c’était déjà un régal en ce qui me concerne, mais le choc fut assez grand quand je découvris ultérieurement des éditions plus « pures ».
Tenez, juste un exemple, concernant ce fragment pourtant essentiel du Roman de Renart qui conte l’origine de la guerre entre les barons Renart le goupil et Isengrin le loup (l'opposition de ces deux personnages étant le thème central du cycle).
Version propre-nenfants-XIXe : Renart se rend chez son compère, absent, et discute avec sa commère Hersent ; mais, subitement, il se moque de la portée de louveteaux et s’enfuit ; Hersent, furieuse, le suit à Maupertuis ; mais la louve, trop grosse, ne peut rejoindre le goupil dans son terrier et y reste bloquée ; Renart sort de son repaire par une autre ouverture, et profite de ce que Hersent est coincée, le postérieur à l’air, pour lui asséner quelques petits coups de bâton sur les fesses, à la Guignol ou Scapin, bref, comme un gamin facétieux.
En version originale, c’est quelque peu différent : Renart, chez Isengrin, séduit (ou est séduit par) Hersent ; la louve, nécessairement lascive et nymphomane, saute sur l’occasion de tromper son époux, guère satisfaisant sur le plan sexuel, et les deux canidés de forniquer allègrement. Après quoi, Renart, qui est un bien meilleur amant qu’Isengrin, s’en prend aux louveteaux ; prenant acte de sa coucherie récente (qui n’était probablement pas une première), il les traite de bâtards, considérant qu’il pourrait aussi bien être leur père, il leur pisse dessus (façon très animale de marquer sa propriété) et les roue de coups. Renart s’en va alors, laissant la famille des loups en larmes. Isengrin rentre chez lui, Hersent essaye de dissimuler l’aventure, mais les louveteaux dénoncent la mère infidèle et le traitement que leur a infligé Renart. Hersent se défend aussitôt en affirmant que Renart l’a violée, et qu’Isengrin doit la venger. Aussi Isengrin et Hersent se mettent-ils en quête de Renart. A Maupertuis, tandis qu’Isengrin fouille les environs, Hersent, donc, reste bloquée dans le terrier ; Renart en sort par une autre issue… et profite de ce qu’elle est coincée les fesses à l’air pour la violer brutalement, à plusieurs reprises, et finalement devant les yeux d’Isengrin, tout en insultant copieusement (et de manière très fleurie) la traînée et le cocu.
Non, décidément, ce n’est pas tout à fait la même chose… Et, de manière générale, c’est tout de même bien autrement riche, et saisissant, dans la version originelle. Cela faisait un petit moment déjà que j’étais pris de l’envie de relire Le Roman de Renart dans une version plus complète et authentique que tout ce que j’avais pu lire jusqu’alors ; l’édition de cette œuvre phare dans la fameuse (et coûteuse, argh) collection de la Bibliothèque de la Pléiade me paraissait donc toute désignée. Et je ne regrette certainement pas cet achat : je me répète, je le sais, mais Le Roman de Renart fait décidément partie de ces livres rares que j’emporterais sur l’hypothétique île déserte…
Mais qu’est-ce donc, au juste, que Le Roman de Renart ? Une erreur à ne pas commettre : il ne faut pas prendre ici le terme de « roman » au sens où nous l’entendons aujourd’hui, quand bien même, à l’époque (essentiellement la deuxième moitié du XIIe siècle et le début du XIIIe, donc en gros les règnes de Louis VII et de Philippe-Auguste), on trouvait déjà des romans dans ce sens-là (dans la Matière de Bretagne, et plus largement la tradition courtoise) ; Le Roman de Renart, en effet, est écrit en vers, en savoureux (quand bien même truffés de béquilles, et parfois irréguliers) octosyllabes, et si l’on parle de « roman », c’est parce qu’il est écrit en langue « vulgaire », comprendre par-là non en latin, mais en « vyeu françoys » (aha ; pour les amateurs de précision, disons en langue d’oïl, avec souvent des traits picards ; mais on trouve aussi quelques allusions toponymiques normandes, et certains des textes les plus tardifs – et surtout parmi les déclinaisons postérieures – montent jusqu’en Flandre ; notons par ailleurs que l'on trouvera ultérieurement des versions du Roman dans d'autres pays et d'autres langues, notamment en Italie et en Allemagne, mais ce n'est alors plus Le Roman de Renart au sens strict, production française).
Mais il s’agit bien d’une œuvre écrite, et non pas issue de la tradition orale (quand bien même jongleurs, trouvères et troubadours, bien sûr, récitaient le Roman pour leur audience ; le texte est d’ailleurs farci de traits oraux et d’interpellations du public) : nous n’en sommes plus, aujourd’hui, aux débats virulents et plus ou moins politisés des érudits de la fin du XIXe et du début du XXe siècles opposant les tenants d’une origine « populaire » et les partisans d’une origine « savante » ; aujourd’hui, la thèse « savante » l’a dans l’ensemble emporté (j’y reviendrai).
Le Roman est une œuvre polygraphe : il est parvenu jusqu’à nous par plusieurs manuscrits très différents, comprenant un nombre plus ou moins complet de « branches », qui sont autant de variations. Notons que celles-ci sont présentées dans des ordres variables, n’obéissant ni à la chronologie de leur rédaction, ni à la chronologie interne du cycle renardien (guère aisée à établir, l'entreprise pouvant d'ailleurs être jugée passablement illusoire...) : ainsi, bon nombre de manuscrits, dont celui qui fournit l’essentiel de cette édition, débutent par la branche du « Jugement de Renart », qui évoque des textes rédigés antérieurement par « Perrot » (Pierre de Saint-Cloud ? voir plus bas), et se situe nécessairement après l’épisode du « Viol d’Hersent », lequel ne figure que bien plus loin dans le manuscrit. Du fait de cette composition en « branches », le Roman a un aspect répétitif assumé, les auteurs multipliant les références aux autres textes dans les « gabs » ou les « confessions Renart » (où le goupil énumère ses méfaits, feignant le remords, mais se vantant en fait de ses innombrables mauvais tours), les allusions étant fréquentes à certains épisodes fondamentaux (« Le Viol d’Hersent », notamment), et certaines scènes étant largement reprises, l’intérêt résidant alors dans les variantes apportées, où l’auteur peut déployer toute son originalité (ainsi dans les nombreuses séquences judiciaires : « Le Jugement de Renart » ; « Le Siège de Maupertuis » ; « Le Duel judiciaire » ; « L’Escondit » ; « Renart le noir » ; « Renart médecin » ; « La Mort de Renart » ; « Renart magicien »…) ; on peut d’ailleurs dresser un schéma classique des branches : Renart, poussé par la faim, quitte son terrier pour aller chercher de quoi se nourrir dans le monde des hommes (généralement le poulailler d’une ferme isolée ou d’une riche abbaye), puis rencontre hors des sentiers battus un animal à qui il joue un mauvais tour…
Les différents auteurs sont mal connus, quand bien même quelques noms sont parvenus jusqu’à nous (et notamment celui de Pierre de Saint-Cloud, dont on suppose qu’il aurait écrit les branches originelles). En tout cas, nombre d’indices laissent supposer qu’ils étaient pour la plupart membres du clergé, et en tout cas relativement cultivés : en effet, si le Roman emprunte certains traits aux fables et fabliaux qui avaient déjà largement intégré la culture populaire (tout en en gommant souvent l’aspect édifiant, du moins dans les textes les plus anciens), il n’a que peu de liens avec les farces, mais témoigne par contre régulièrement de connaissances littéraires, théologiques, philosophiques, juridiques, etc., et descend en droite ligne de textes « classiques », rédigés en latin, dont l’Ysengrimus de Nivard à peine antérieur, mais aussi des sources bien plus anciennes remontant à l’Antiquité.
Il ne s’agit en tout cas pas, contrairement à ce que l’on affirme parfois, d’un exemple de littérature « bourgeoise », et il suffit de lire le texte pour s’en rendre compte : la ville n’apparaît jamais (ou presque) dans Le Roman de Renart, dont l’univers est campagnard, fait de champs et de forêts, de châteaux et de villages, de fermes et d’abbayes isolées : le terrain de prédilection des aventures de Renart se situe à la lisère de la nature et de la culture, de la forêt et des champs, et généralement dans les essarts, ces terres récemment gagnées sur la forêt, en friches et destinées à être cultivées, qui se multipliaient alors (parallèlement à l’explosion urbaine, certes). Les emprunts à la littérature « bourgeoise » sont rares, et s’intègrent généralement très mal ; les sources essentielles se trouvent dans la tradition religieuse plus ou moins populaire (Le Roman de Renart s’inspire énormément de la pratique de la « Fête des fous », par exemple, et fait maintes allusions à ces réjouissances consistant en une complète inversion des valeurs, dont le carnaval contemporain n’est qu’un bien piètre ersatz) et, surtout, dans la littérature courtoise : le Roman est en effet une œuvre largement parodique, où les stéréotypes courtois sont impitoyablement moqués (je dois dire que, personnellement, n’ayant jamais aimé la tradition courtoise en général et la Matière de Bretagne en particulier, cette parodie me semble particulièrement jubilatoire, gniark gniark !). Une œuvre chevaleresque, cependant, résonne plus particulièrement avec le Roman : celle de Tristan et Yseult, qui mêle à l’amour courtois un soupçon d’immoralité, de ruse et d’adultère. Et l’on peut bien trouver une exception : le personnage d’Hermeline, l’épouse de Renart, qui, dans certains textes (et notamment parmi les meilleurs, je pense en particulier au « Puits »), a tout de la pure châtelaine courtoise, fidèle et aimante (mais il est des branches, je vous rassure, où c’est une pétasse comme les autres). Mais on ne verra guère ici de preux chevaliers : Renart, seigneur de Maupertuis, est donc une enflure qui agit dans le dos ; son pire ennemi, le connétable Isengrin, est une brute épaisse et un crétin fini, et les autres seigneurs, tels l’ours Brun ou le mâtin Roonel, ne valent pas mieux. Tous, enfin, grands ou petits, nobles ou roturiers, clercs ou laïcs, sont des hypocrites cupides, égocentriques et parfaitement immoraux.
Car Le Roman de Renart ne fait pas dans la parodie « gratuite ». Si les premières branches ne sont pas édifiantes à la manière des fables ou des branches les plus tardives, toutes n’en sont pas moins généralement portées sur la satire, extrêmement virulente, et parfois puissamment subversive. Le Roman de Renart se montre impitoyable, et tout le monde y passe, jusqu’au roi Noble le lion, qui, si l’on excepte une branche un peu timorée, n’est pas davantage épargné que les autres : despote hypocrite et corrompu, foncièrement cruel, fondamentalement injuste, mais en même temps manquant régulièrement de poigne et cocufié par Renart, il n’a finalement pas grand chose pour lui. Les offices et la justice seigneuriale sont de même très sévèrement raillés. Mais le Roman s’en prend essentiellement à trois cibles privilégiées :
1°) Les membres du clergé… comme les auteurs, qui savent donc de quoi ils parlent ! Rappelons que nous sommes alors à une époque suivant de peu la réforme grégorienne, marquée par les conflits politiques suscités par les ambitions de théocratie pontificale, et par d’importantes réformes au sein du clergé régulier : l’ordre cistercien est encore récent, et plus encore son développement par saint Bernard de Clairvaux, et c’est une première cible de choix. Les abbayes, supposées austères et pieuses, sont présentées comme étant d’une richesse écœurante, a fortiori en ces temps où la famine est commune (et la faim est bien un thème omniprésent du Roman de Renart) ; les moines, et notamment les cisterciens hypocrites, sont des fainéants, impies et gras, incultes, cupides enfin… Plus tard, on retrouvera ces mêmes critiques contre les ordres mendiants (et plus urbains) des dominicains et des franciscains (notamment dans les déclinaisons postérieures au Roman, voyez par exemple les pamphlets du polémiste Rutebeuf). Le clergé séculier n’est pas davantage épargné : le curé de campagne, dans la fantaisie renardienne, est généralement un rustaud inculte (le chat Tibert, par exemple, connaît bien mieux que lui les écritures saintes, et c’est dans un sens à bon droit qu’il lui vole sa Bible, dans la mesure où lui, au moins, sait la lire…) ; il est par ailleurs presque systématiquement marié (on était alors en plein dans la lutte contre le nicolaïsme) et, forcément, dominé par sa femme… Mais les ermites et a fortiori les pèlerins sont également critiqués, et, de manière plus audacieuse, certaines pratiques religieuses : le culte des reliques suscite quelques scènes cocasses, les miracles sont mis en doute, de même que le succès des croisades… et la sincérité des croisés. La « Fête des fous » amène régulièrement les animaux à accomplir les actes liturgiques (généralement complètement bourrés au vin de messe et gavés d’hosties…), et les prières et litanies sont parodiées et ponctuées de pets… La « confession Renart » est un thème récurrent, et la foi populaire, naïve et superstitieuse, est souvent raillée (ainsi dans « Le Puits », une des branches les plus réussies et les plus subtiles, l’image simpliste d’un paradis « matériel » où les plus grands criminels, dès l’instant qu’ils se sont confessés, même de manière peu sincère, s’emplissent la panse entourés par les anges…). Notons par ailleurs qu’une des branches les plus tardives, « Les Enfances de Renart », qui raconte la naissance de Renart et d’Isengrin, consiste en fait en une version apocryphe de la Genèse, même s’il ne faut sans doute pas voir une véritable subversion, cette fois, dans ce texte à la limite du corpus et « moral ».
2°) Les paysans : tous sont stupides, lâches, indignes de confiance, superstitieux, âpres au gain… Quant Renart les spolie, à vrai dire, on n’a le plus souvent guère envie de les plaindre !
3°) Les femmes… Le Roman de Renart est bien le produit de son temps, et qui plus est de clercs ! La misogynie, essentiellement cléricale, y est frappante. « Les Enfances de Renart » explique ainsi que c’est Adam qui a créé les animaux « bons » (domestiques : le mouton, le chien, etc.), et Ève qui est responsable de l’apparition des animaux « mauvais » (sauvages : le loup, le goupil, etc.). Les femmes, dans le Roman, sont essentiellement maléfiques, souvent rusées (de vraies complices en renardie !), et presque systématiquement lascives (elles ne pensent qu'au sexe et ne parlent que de ça, ou presque) et infidèles : Hersent, on l’a dit, est une louve perpétuellement en chaleur ; son « viol » est très contestable, et elle est à l'origine parfaitement consentante… La reine Fière de même : elle aussi violée par Renart, elle obtient la clémence de son époux Noble, et désire volontiers revoir en cachette le goupil… Dans « Renart Empereur », après la mort d’Hermeline, Renart s’empresse d’épouser Fière en proclamant la fausse nouvelle de la mort de Noble à la croisade ; quand ce dernier revient, Fière ne se montre pas exactement joyeuse… Les exceptions sont bien rares : Hermeline, le plus souvent, certes ; mais il est des branches où, croyant son époux mort, elle s’empresse bien vite de jouer à la veuve joyeuse… Et Hersent et Hermeline, mutuellement jalouses, se crêpent parfois le chignon avec une violence fort peu courtoise. Peut-être pourrait-on retenir alors la poule Pinte, de bon conseil ? A voir… Plus que des attaques personnelles, de toute façon, c’est essentiellement dans des discours tenus par les personnages qu’éclate la misogynie des auteurs. Il n’est qu’à voir l’étrange allégorie de « Comment Renart parfit le con », où Renart et Noble se voient confier l’invention même du sexe féminin, ce « trou hideux » si semblable à l’anus…
Evoquons maintenant brièvement cette édition en particulier. Tout d'abord, joie, joie : c’est une édition « bilingue », le haut de page faisant figurer une traduction en français moderne, tandis que les octosyllabes en langue d’oïl occupent le bas de page (honnêtement, seuls, ils me paraissent largement illisibles... mais il peut être très utile de s'y reporter, et, honnêtement, les insultes et grivoiseries y sont souvent particulièrement fleuries !). Les notices et notes, comme de coutume, sont abondantes, et souvent d’un grand intérêt. On notera cependant que la traduction se veut ici plus « scientifique » qu’élégante ; d’où ce choix du manuscrit « H » (Manuscrit de Paris, Arsenal 3334), assez complet, mais encore jamais édité. Nous y trouvons, dans l’ordre, la fameuse trilogie comprenant « Le Jugement de Renart », « Le Siège de Maupertuis » et « Renart teinturier. Renart jongleur ». Nouvel épisode judiciaire ensuite, et du plus grand intérêt (le mélange entre anthropomorphisme et zoomorphisme y est particulièrement savoureux, et la satire acerbe), « Le Duel judiciaire ». Suit « La Confession de Renart », un texte assez tardif et lourdement moral… On y préfèrera le très amusant « Le Pèlerinage de Renart », et plus encore « Le Puits », une des plus célèbres aventures de Renart, puissamment symbolique. « Le Jambon enlevé. Renart et le grillon » est sans doute plus anecdotique. « L’Escondit », par contre, est sans doute un des textes judiciaires les plus intéressants (notamment du fait du sabotage de l’ordalie par Isengrin et « saint Roonel »). « Les Vêpres de Tibert » est également une excellente branche, où Renart et le chat Tibert rivalisent de ruse et de malice, et se livrent à une réjouissante parodie de l’office religieux (l’influence de la « Fête des fous » s’y fait particulièrement sentir). Suivent plusieurs branches relativement intéressantes, mais dans lesquelles, généralement, Renart est pris en défaut et ne parvient pas à tromper ses proies (et notamment Tibert, donc…) : « Chantecler, Mésange et Tibert », avec son amusante parodie des rêves prémonitoires de la tradition courtoise ; « Tibert et l’andouille », texte cocasse et vif ; « Tibert et les deux prêtres », plus mineur. Un gros morceau ensuite : « Tiécelin. Le Viol d’Hersent », soit à la suite Le Corbeau et le renard et l’événement fondateur de la guerre des barons Renart et Isengrin… Suit une autre jolie réussite, très imaginative, et qui figure là encore parmi les plus célèbres pages du Roman : « Renart et les anguilles ». « Pinçart le héron », qui, si je ne m'abuse, ne figure que dans cet unique manuscrit, n’a guère d’intérêt, par contre… « Renart et Liétard » est une branche étrange, à la fois intéressante et un peu dérangeante : les humains y jouent un grand rôle (le Liétard du titre est un paysan), et Renart va cette fois jusqu’à (faire) tuer un de ses adversaires, le très stupide ours Brun… « Renart et Primaut » est également assez déstabilisant (Primaut y est, au choix, une variante d’Isengrin ou le frère de ce dernier ; c’est en tout cas un sacré benet à qui Renart en fait voir de toutes les couleurs !). Suivent trois branches assez tardives, plus morales, mais aussi plus fantaisistes, et incomparablement plus longues que la plupart de celles qui précèdent : « Renart le noir » consiste surtout en variations de thèmes précédemment vus ; « Renart médecin » figure à la base parmi les textes judiciaires, mais débouche sur une ruse renardienne particulièrement cruelle, et qui confirme en définitive son statut de grand seigneur ; il en profitera dans « Renart Empereur »… « Le Partage des proies », ensuite, est une autre histoire célèbre (qui sera d’ailleurs également reprise par La Fontaine, il me semble), très critique pour le pouvoir seigneurial ou royal : Noble y fait résolument figure de despote, et Renart y est plus bassement flatteur que jamais. « La Mort de Renart », comme son nom l’indique, vise à clore le cycle… mais Renart ne peut pas vraiment mourir, bien sûr.
Le manuscrit « H » est ici lacunaire. La fin de « La Mort de Renart » est donc empruntée à un autre manuscrit, de même que tous les textes suivants regroupés sous le nom générique des « Autres branches du « Roman de Renart » ». Celles-ci sont d’un intérêt très variable. Les premières, « Isengrin et le prêtre Martin », « Isengrin et la jument » et « Isengrin et les deux béliers », comme leur nom l’indique, mettent en avant, non pas le rusé goupil, mais le stupide loup, et ce sont des textes très brefs, simples adaptations très vaguement renardiennes de fables classiques. Pas grand intérêt, et il en va de même pour « La Monstrance du cul »… « Comment Renart parfit le con », évoqué plus haut, est autrement plus intéressant, quand bien même à nouveau déstabilisant. « Renart magicien », ensuite, est une réussite, une variante très bien vue et très inventive de « Renart médecin », et un des rares textes du Roman à introduire un élément clairement surnaturel (si l’on excepte, bien sûr, ces animaux qui parlent, mais c’est envisagé comme étant la norme…) : Renart s'y montre un talentueux « nigromancien ». « Les Enfances de Renart », également évoqué, est un texte assez sympathique. « L’Andouille jouée au morpion », par contre, n’a guère d’intérêt : c’est une simple variante de « Tibert et l’andouille ».
Cette compilation s’achève enfin sur un choix « d’Autres écrits renardiens », qui témoignent de la portée immédiate du Roman. Ces textes ultérieurs (XIIIe, XIVe siècles…), en effet, ne s’intègrent pas dans le Roman à proprement parler et ne se présentent pas comme de nouvelles branches, mais n’en usent pas moins, quoique dans une perspective généralement bien plus morale et plus ouvertement satirique, des thèmes et des personnages développés par Pierre de Saint-Cloud et ses continuateurs. Les querelles des grands seigneurs (notamment successorales, ainsi la complexe affaire de Flandre et d’Artois) autorisent ainsi bien des scènes renardiennes à la façon des dernières branches, qui se veulent des dénonciations de l’injustice. C’est le cas dans « Du noble lion ou la compagnie de Renart », dans un extrait des « Mémoires » de Philippe de Novare ou encore dans « Exemple d’Isengrin et de la chèvre », tiré des Récits d’un ménestrel de Reims. Le polémiste Rutebeuf n’hésite pas, de même, à puiser son inspiration dans le Roman, ainsi qu’en témoignent ses pamphlets « Renart le bestourné » et « Sur Brichemer ». Après quoi « Le Couronnement de Renart » est un long poème relativement maladroit (seul un extrait en est donné), où Renart symbolise un cruel usurpateur bien réel. Jean de Condé procède différemment dans son « Dit d’entendement », poème didactique consistant en une succession de tableaux édifiants, dont une partie emprunte au Roman de Renart. On notera enfin un dernier poème, le « Dit de la queue de Renart », plus métaphorique, et qui vaut surtout pour sa description de l’immoralité urbaine, si peu entrevue dans le Roman au sens strict.
Suit, donc, un abondant appareil critique de près de 500 pages…
Et le tout constitue une très belle édition de ce texte majeur, difficilement comparable à quoi que ce soit. Le Roman de Renart, aujourd’hui encore, reste très drôle et incroyablement subversif.
Lisez Le Roman de Renart. C’est très très très bien.

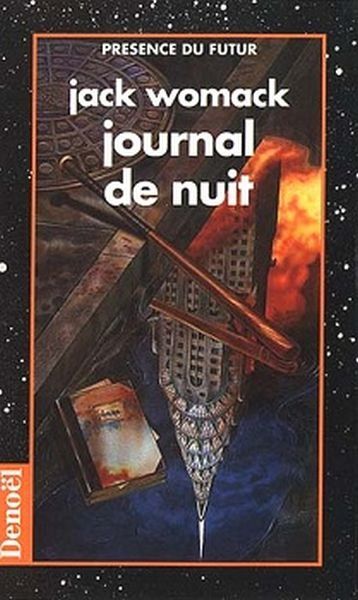

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)











/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)