Jacques
Par le passé, il m’est arrivé à plusieurs reprises de rédiger sur ce blog de brefs billets nécrologiques ; quelques lignes, probablement maladroites et sans doute convenues, mais néanmoins sincères, pour évoquer diverses personnalités disparues que je ne connaissais évidemment pas, mais que j’admirais pour une raison ou pour une autre.
Je n’aurais jamais cru avoir à le faire pour un ami, qui plus est de ma génération.
Mais voilà : Jacques Mucchielli s’est éteint le samedi 26 novembre dernier, et c’est insupportable.
Ce bref article que je lui consacre aujourd’hui me rongeait depuis un certain temps déjà – j’ai un peu honte de le dire, mais j’y songeais avant même son décès, que je voyais percer à l’horizon, même si le déni m’empêchait d’y croire totalement. Je ne voulais cependant pas être celui qui annonce, et craignais en outre de passer pour – ou pire encore, d’être effectivement – un vulgaire charognard. Mais la nouvelle de ce départ prématuré s’est diffusée très vite – trop vite, peut être ? Nous sommes à l’heure des réseaux sociaux et, comme on le sait, la rumeur court plus vite que la lumière…
Aujourd’hui, dès lors que la nouvelle a été rendue par la force des choses « officielle », je me sens tenu d’évacuer ma tristesse et ma frustration, ma colère aussi, dans cette note ; on pourra, j’imagine, me taxer d’exhibitionnisme bloguesque, y voir un certain manque de pudeur, peut-être, et regretter le temps où l’on savait garder ces choses pour soi. J’avoue ne pas être certain moi-même de la pertinence et de l’opportunité de cet article. Mais il y a cette compulsion qui me pousse à écrire, pour moi dans un premier temps, pour d’autres ensuite, à expulser cette horrible réalité à laquelle j’ai encore du mal à me faire : Jacques Mucchielli n’est plus. Et, si j’ai pu écrire quelques lignes en hommage à des gens que je ne connaissais ni d’Ève ni d’Adam, qu’en est-il pour cet homme que je voyais régulièrement ? Peut-être suis-je en train de me chercher des justifications, je ne sais pas…
Je n’aurai pas l’outrecuidance de me qualifier de « proche », nombreux sont ceux qui méritent ce titre bien autrement que moi. Mais j’ai bel et bien perdu un ami. Quelqu’un avec qui j’ai eu la chance de déconner comme de travailler (bon, d’accord, un peu plus déconner que travailler…), et que j’aimais et admirais profondément, comme j’admirais son œuvre en construction : quelques nouvelles en solo ici ou là – je pense notamment à son très bel hommage à Ballard dans le Bifrost consacré à cet auteur – et, bien sûr, ce qu’il avait écrit en collaboration avec Léo Henry, Yama Loka Terminus et Bara Yogoï, et plus puisque affinités.
Les mots me manquent. Je n’ai pas envie de verser dans les excès de l’éloge funèbre, exercice de style jamais bien éloigné des larmes de crocodile – j’avoue quant à moi être complètement asséché devant ce deuil, le premier à frapper dans mon entourage, et ne sais trop qu’en penser. Je ne sais pas véritablement comment exprimer ma tristesse – je n’ai jamais été très doué pour ça, c’est le moins qu’on puisse dire…
Mais il y a plus ; il y a ce sentiment, irrationnel j’en ai bien conscience, de révolte devant ce que je ne peux qualifier que d’injustice ; car ce décès est d’autant plus choquant qu’il vient frapper trop tôt, et de la plus stupide des manières. Aussi ai-je envie, quelque part, de pasticher Michael Bishop dans son Requiem pour Philip K. Dick :
Las, Jacques Mucchielli n’est plus
Dieu va prendre mon pied au cul
C’est un peu vain, je sais. Mais quand même. C’est qu’il me manque, cet enfoiré de Corse.
Toutes mes condoléances à sa compagne, sa famille et ses proches.
Si long, Jacques…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





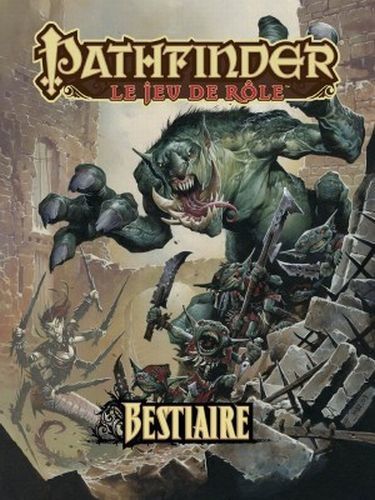











/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)