"Terreur", de Dan Simmons

SIMMONS (Dan), Terreur, [The Terror], traduit de l’américain par Jean-Daniel Brèque, Paris, Robert Laffont, [2007] 2008, 703 p.
Bon, ben, je crois que ça y est. On le tient. L’événement, veux-je dire. Le livre important entre tous parmi tous ceux qui ont déferlé dans les librairies au cours de cette Rentrée Littéraire 2008©. Bon, cela dit, mon jugement est peut-être un peu biaisé : c’est que je l’attendais, ce pavé, avec une impatience certaine (mais ça, je l’avais déjà dit).
Il y avait plusieurs raisons à cela. La première, bien entendu, étant l’auteur : Dan Simmons est bien à mes yeux un des plus brillants écrivains contemporains, qui a en outre le bon goût de s’exercer dans bien des genres différents. Inévitablement, on pensera ici à Hypérion, sans doute un des plus grands chefs-d’œuvre de la science-fiction contemporaine. Mais Dan Simmons a su également nous régaler avec de superbes romans d’horreur, et en premier lieu L’Échiquier du mal, la plus belle réussite dans le genre depuis, ouf, au moins. Rien d’étonnant, sous cet angle, à ce qu’on trouve régulièrement, en quatrième de couverture de ses romans fantastiques, une citation élogieuse de Stephen King. Et Terreur ne déroge pas à la règle. Vous me direz, Dan Simmons n'est pas le seul dans ce cas, et l'éloge des pairs (essentiellement King et Gaiman... ?) en quatrième de couv' est un travers promotionnel typiquement anglo-saxon, qui n'engage le plus souvent à rien. Sauf que là, ben, effectivement, si si, ça se comprend, c'est mérité, et parfaitement justifié.
Mais Terreur n’est pas seulement un roman d’horreur et de suspense. C’est aussi un roman historique et un roman d’aventure, empruntant le plus fascinant des cadres (et qui, personnellement, m’a toujours passionné), celui des grandes expéditions polaires. On ne peut que rester stupéfait devant l’épopée de ces hommes partant pour un voyage de plusieurs années (l’hivernage étant généralement inévitable pour les expéditions maritimes) dans les pires régions du globe, et dans des conditions invraisemblables. Et je ne parle pas ici que de la conquête des pôles, mais plus largement de ces nombreuses expéditions, maritimes ou terrestres, visant à cartographier l’immense continent inhabité qu’est l’Antarctique, ou, à l’autre bout du monde, à traverser l’océan glacial arctique. Ici, l’héroïsme allait de pair avec l’aberration la plus totale, et l’histoire de ces voyages de découverte est une longue succession de drames atroces et d’actes de bravoure indépassables, de bêtises consternantes et de coups de génie. Au-delà de Peary et Amundsen, on peut penser notamment, pour le pôle sud, à la tragique dernière expédition de Scott, ou à l’extraordinaire aventure de l’expédition Endurance, conduite par Sir Ernest Schackleton (si c’était le fruit de l’imagination d’un romancier, on n’aurait probablement pas hésité à le taxer d’invraisemblance…) ; mais le pôle nord n’est pas en reste, et si, cette fois, des hommes parviennent à (sur)vivre dans ses environs depuis des milliers d’années (la civilisation Inuit m’a toujours fasciné ; à ce sujet, je vous recommande chaudement – si j’ose dire… – la lecture des passionnants ouvrages de Jean Malaurie, le fondateur de la collection « Terre humaine », Les Derniers Rois de Thulé, surtout, et, dans un genre un peu différent, Hummocks ; ça peut même être assez utile pour apprécier pleinement certains aspects de Terreur...), l’histoire de son exploration est tout aussi riche en épopées grandioses et horribles, notamment pour ce qui est de la longue quête du mythique passage du Nord-Ouest. Et c’est justement sur l’épisode le plus effroyable de cette folle aventure que se base le roman de Dan Simmons, puisque l’auteur nous conte ici à sa manière le tragique destin des 129 hommes de l’expédition Franklin, partis en 1845 à bord des navires Erebus et Terror… et dont on a perdu toute trace (ou presque).
Dan Simmons nous plonge d’entrée de jeu dans le cauchemar le plus total. Octobre 1847. Le Terror et l’Erebus sont pris dans les glaces par 70° 05’ de latitude nord et 98° 23’ de longitude ouest. La température descend fréquemment à – 45 °C, et même au-delà. L’été n’a pas entraîné de dégel, et les membres de l’expédition se préparent tant bien que mal à un troisième hivernage, dans les ténèbres de la nuit arctique. Sir John Franklin (dont Dan Simmons dresse un portrait peu flatteur…) est mort, et c’est désormais Francis Crozier, le rude capitaine irlandais du HMS Terror, qui prend en charge le commandement de l’expédition. Mais inutile de se leurrer : celle-ci, mal préparée (on touche à l'absurde, à vrai dire...) et mal conduite, est d’ores et déjà un échec. Il ne s’agit plus que de survivre. Et la tâche s’annonce rude. Au froid et aux ténèbres, il faut bien vite ajouter la faim et la maladie (scorbut, saturnisme), les conserves embarquées par le navire étant pour bon nombre d’entre elles impropres à la consommation ; et il est impossible de pêcher dans ces conditions, mais aussi de chasser, les ours ne se montrant que rarement, les phoques, jamais.
Mais il y a pire : une étrange créature, définie faute de mieux comme un gigantesque ours polaire, s’en prend aux hommes et les massacre les uns après les autres. Et ce n’est pas le seul mystère : il y a aussi cette jeune Inuit à la langue coupée, que les hommes du Terror ont baptisée « Lady Silence » ; on ne sait trop comment elle a pu survivre jusqu’alors dans cette région désolée : peut-être est-elle un peu sorcière ? Serait-elle liée à la créature démoniaque et insaisissable qui sème la terreur parmi les hommes désemparés ?
La mutinerie menace, et l’espoir ne semble plus de mise. Au service religieux, Crozier cite le Léviathan de Hobbes : « La vie est solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève. » Dans cet enfer blanc plus que partout ailleurs.
La construction du roman est relativement classique, mais imparable. Après cette attaque en force digne de Poe et de Lovecraft, Dan Simmons joue des points de vue multiples et des flashbacks pour rapporter en alternance les événements se déroulant à partir de cette introduction et comment on en est arrivé là. Et il fait preuve d’une rare maîtrise du cliffhanger, à la différence de bons nombres d’écrivaillons commettant du thriller. Le suspense est permanent, la passion immédiate et constamment entretenue.
Et le cadre est splendide. Terreur est un roman extrêmement documenté et « réaliste », riche en détails facilitant l’immersion du lecteur, sans jamais tomber dans la gratuité ou le didactisme. En suivant Crozier et ses hommes dans leur quotidien, ou en lisant le journal intime du jeune chirurgien Goodsir, on se retrouve ainsi très vite nous-mêmes sur le pont du Terror ou de l’Erebus. On succombre aux morsures du vent glacial, on entend la banquise craquer dans un tonnerre d’artillerie, on peine à distinguer les silhouettes dans la nuit éternelle, sur l'horizon d’une effroyable blancheur, régulièrement tachée de sang. On ressent la faim et la souffrance des protagonistes – tous très humains et détaillés : on croise bien des personnages tout au long du roman, mais l'identification est aisée sans verser dans la caricature (allez, il y a bien quelques exceptions, mais elles sont bienvenues...) et l'on ne s'y perd jamais –, et on vit leur peur.
Car, si le fantastique est diffus, la peur est là, et bien là. Simmons a retenu les leçons de ses maîtres, son cadre évoquant immanquablement – référence explicite – La Chose d’un autre monde d’Howard Hawks, mais aussi, aurais-je envie d’ajouter, « Les Montagnes hallucinées » de Lovecraft, superbe nouvelle résonnant de l’écho de l’Arthur Gordon Pym d’Edgar Poe. Mais ce dernier est également convoqué pour son « Masque de la mort rouge », au cours d’un extraordinaire pastiche versant dans l’horreur la plus effroyable. Et la peur dépasse la seule créature mystérieuse, à peine entrevue à l’occasion, à l’instar de l’Alien de Ridley Scott, ou de La Féline de Jacques Tourneur, et qui joue finalement un rôle assez secondaire. Dan Simmons use habilement de tous les registres de la peur, du fantastique le plus « psychologique » et ambigu, celui de l’hallucination et de la folie, au gore démonstratif des démembrements et des festins cannibales. La peur est tour à tour lancinant sentiment d’oppression et de malaise, et brusque montée d’adrénaline, l’horreur inéluctable pouvant susciter le suspense comme la terreur glacée. Il y a la peur de la souffrance et de la mort, une peur matérielle devant le danger imminent et concret, mais aussi une peur plus abstraite, peur des fantômes et des démons, peur du jugement des hommes ou de Dieu. Mais l’Enfer, avec ses flammes éternelles, peut-il vraiment être pire que ce que les hommes du Terror et de l’Erebus ont le malheur de vivre ? Et qu’est-ce qui, dans ces conditions, est le plus à craindre, des démons, de la nature… ou de l’homme ?
Terreur, précisons-le, n’est pas un roman « facile ». C’est un roman d’horreur et d’aventure, certes, mais pointu et exigeant : si je me suis régalé du début à la fin, si je ne me suis jamais ennuyé – pas un seul instant, vous dis-je ! – au cours de ces 700 pages denses et resserrées (écrites avec un talent de conteur qui n'est plus à démontrer ; quand à la traduction de Jean-Daniel Brèque, si elle n'a probablement pas été de tout repos, elle est, sans surprise, irréprochable), il m’a néanmoins fallu prendre le temps de vivre au jour le jour cette terrible épopée (cela faisait une éternité que je n’avais pas mis autant de temps à lire un roman, sans m’ennuyer pour autant…). Je ne m’en plains pas, loin de là. Mon scepticisme coutumier à l'encontre des pavés n'a pas fait long feu, et j'ai savouré ce monstre romanesque avec une fascination et un plaisir (malsain ?) permanents. C’est que Terreur touche juste : c’est un roman atroce, terrible, tragique, poignant, oppressant, éprouvant, écoeurant, déprimant, désespéré…
Superbe.
N'en jetez plus : Terreur est un remarquable roman historique à l'érudition sans faille, un excellent roman d’aventure palpitant de bout en bout, et un très, très, très grand roman d’horreur. Probablement le meilleur du genre depuis…
…
Depuis L’Échiquier du mal ?

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



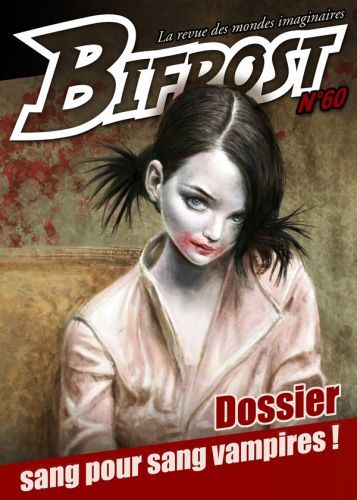





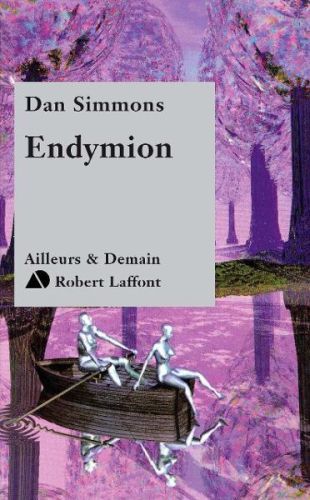

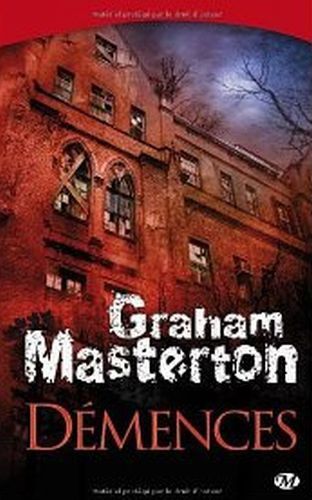

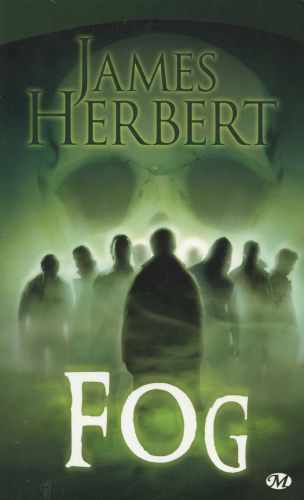





/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)