"Cold Gotha", de Guillaume Lebeau

LEBEAU (Guillaume), Cold Gotha, [s.l.], Baleine, coll. Club Van Helsing, 2007, 223 p.
Mmmh, je me dois de gommenzer ze gompte rendu mideux (et enrhubé, snrfl) bar un mea gulpa agombagné d’audo-flagellazion à base d’ordies fraîgement goubées.
Snrfl.
… yeuaaAAAAAA-TCHA !
(A tes souhaits.)
Berzi.
Bon (snoaaAAArfl... gub). Rappelez-vous (si vous le voulez bien, je ne vous force pas, non plus). J’ai lu dans le courant de l’année 2007 la plupart des romans de la première saison du Club Van Helsing. Et j’en ai tiré un bilan globalement positif : j’ai adoré le volume de Catherine Dufour, beaucoup aimé ceux de Johan Heliot et Bretin & Bonzon, et apprécié aussi (quand bien même avec davantage de réserves) celui de Xavier Mauméjean, et même, même, celui de Jean-Luc Bizien, qui m’a fait agréablement ricaner (gras). C’est plus qu’honnête, non ? Une collection de littérature « populaire » (bouh le vilain mot), divertissante et le plus souvent drôle, et qui se paye le luxe d’inviter quelques jolies plumes… Oui, j’aime bien, décidément.
Seule exception : l’abominable étron de Maud Tabachnik, qui a en son temps généré une simili-polémique ridicule sur le forum du Cafard cosmique. Et, à l’occasion de cette triste péripétie, j’avais dit beaucoup de mal de cet affligeant bouquin. Ca, je ne reviendrai pas là-dessus. Le problème, c’est que, d’un naturel chatouilleux sur certaines questions, j’avais aussi écrit à cette occasion quelques méchancetés concernant le directeur de collection Guillaume Lebeau.
Or, voyez-vous, il y a peu, Guillaume Lebeau est venu en dédicace à l'indispensable librairie Album à Toulouse en compagnie de Jean-Marc Lofficier pour le lancement de la deuxième saison du CVH (étaient également présents Randy Lofficier et Philippe Ward, pour la collection Rivière blanche ; une après-midi fort sympathique au cours de laquelle je me suis ruiné en bouquins, mais je vous en parlerai prochainement). J’étais confronté à un cruel dilemme : en bon acheteur et lecteur compulsif, je me suis précipité sur les trois nouveaux CVH. Et là, les sinistres petits démons hantant ce sordide lupanar bibliophile m’ont de nouveau tendu une embuscade. « Voyons, Nébal, il ne t’en manque que deux de la première saison… Autant les ACHETER et les lire avant de passer à la deuxième ! En plus, Guillaume Lebeau dédicace, profites-en… » Ah, les fourbes. Ils n’ont pas eu de mal à me convaincre… Mais, en m’approchant de la table de dédicace, la crainte m’envahit : Guillaume Lebeau n’allait-il pas me casser la gueule ? N’allait-il pas me trouver gonflé ? Honnêtement, il aurait pu…
Mais non, en fait. Et quand l'excellente M’âme Martin a fini par me vendre, le Monsieur, bien loin de me casser la gueule, m’a très chaleureusement serré la main et a entamé la causette. D’où je retire tout ce que j’ai pu dire de mal (gratuitement, en plus) sur le Monsieur, qui m’a fait à l’évidence l’effet de quelqu’un de très sympathique, et d’un enthousiasme qui fait plaisir. Bon, on a échangé nos points de vue, je ne suis pas d’accord sur tout ce qu’il a pu me dire (et il a dit beaucoup de choses : c’est qu’il a du débit, M. Lebeau, quand moi je suis un gros timide n’osant guère en placer une…), je n’ai pas été convaincu sur la triste affaire dite « du jeu de mot », je trouve toujours qu’il en a trop fait dans la défense de son bébé, mais j’ai davantage accédé à d’autres de ses arguments… Bref, une discussion fort sympathique et enrichissante. Et qui a achevé de me convaincre dans le bon droit de mon affirmation plus haut : le CVH, j’aime bien ; ça me paraît une heureuse initiative, et je me suis bien amusé avec la première saison ; j’espère que la seconde ne me décevra pas. Mais sur le principe comme sur le bonhomme, rien à redire. Bref, dans l’histoire, le con était nécessairement Nébal.
…
La logique voudrait qu’après cette introduction méaculpesque à la limite du passage de vaseline éhonté, j’enchaîne immédiatement et avec une vile hypocrisie sur quelque chose du genre de : « Donc, j’espère et j’imagine que Guillaume Lebeau ne m’en voudra pas de dire que son bouquin est une purge. »
On l’a dit, après tout. On l’a même proposé pour le razzie.
Je ne serais pas aussi méchant. Non que j’aie limé mes dents dans la crainte que Guillaume Lebeau me casse la gueule la prochaine fois, hein (j’entends venir les perfides accusateurs) : non, non, franchement, on a lu bien pire, y compris dans le CVH (Tabachnik of course… mais, hélas, je vais devoir fournir bientôt un autre triste exemple). Mais l’honnêteté m’impose néanmoins de dire que Cold Gotha m’a paru franchement pas gégé. Disons médiocre moins.
Reprenons.
…
Donc, j’espère et j’imagine que Guillaume Lebeau ne m’en voudra pas de dire que son bouquin est quand même franchement pas gégé, disons médiocre moins.
Mais là je mets un peu la charrue avant les bœufs. L’usage voudrait que je commence par raconter l’histoire… Mais c’est un peu le soucis, en fait. Pas facile, ma bonne dame, parce que ça part très vite en couille…
Bon, commençons par poser que « les événements qui vont suivre se déroulent entre le 10 et le 11 septembre 2001 » (p. 6). Ce qui ne sert à rien, et n’est pas du meilleur goût, probablement, mais bon. Le roman est structuré en brefs chapitres reprenant la formule de 24 heures chrono. En poussant le vice à la seconde près, ce qui peut faire sourire, gentiment ou méchamment, ça dépend de l’humeur du moment… Le clin d’œil aux séries TV n’est pas forcément mal vu dans l’optique du CVH, mais pour le coup ça n’apporte pas grand chose, et est à vrai dire peu crédible… Bon. Mais encore ?
Hollywood. Winona Seward (double aha), célèbre et richissime actrice porno, vient de mourir dans des circonstances dignes d’un gonzo vraiment mais alors vraiment crade. Hugo Van Helsing himself (on se demande bien pourquoi, mmmh ?) se rend dans la Cité des Anges pour enquêter sur le drame, secondé de l’avocat pourri cocaïné Zigor Side, puis, bien vite, de la chasseuse de prime Samsonite, ex-amante de la victime. Ces gens-là dézinguent à tout va des loups garous et des vampires, dont le big boss en personne (logique), mais qui fait un peu petit joueur pour le coup. Et ça défouraille sévère, sans qu’on sache trop pourquoi au juste. Yaaaaaaaah pan pan pan boum aaaaaaaargh takatakatakatak fiouuuuuuuuuuuuuuuuu BOUM argh motherfucker switch gargl splortch. Autant dire que c’est pas très fin.
Bon, sous cet angle, sûr que c’est pas fameux… Mais, malgré tout, ça se laisse lire pendant un bon moment ; disons jusqu’à ce qu’on ait acquis la certitude qu’il n’y a rien derrière (ou que si, peut-être, mais qu’on arrivera pas à le comprendre au milieu des fusillades, alors ça revient au même). L’action est plutôt bien menée... Si Van Helsing est insipide au possible, certains de ses comparses sont plus intéressants, comme la Domino de service ou Side et son amour immodéré pour Joe Dassin. C’est saturé de références plus ou moins bien venues, dont certaines (mais pas toutes, hein) peuvent faire sourire, comme ce « me bave pas sur les rouleaux » chucknorrissien en diable de la page 28.
Hélas, au bout d’un moment, ça devient lourdingue, tout de même. Et quand les avions commencent à se crasher dans les tours jumelles de l’autre côté du continent, on ne tourne plus les pages que par automatisme pavlovien depuis un certain temps déjà. D’autant qu’il y a de temps à autre des tics d’écriture passablement pénibles, ainsi une hyper-technicité qui va jusqu’au fond du fond du détail, ce dont on se passerait allègrement, tout de même. Exemple (p. 112) : « La cartouche .454 Casull toucha sa cible à cinq cent soixante-dix mètres par seconde et développa une énergie cinétique de plus de mille joules. » Dans une baston, c’est le genre de précision qui me paraît « un peu » malvenue… L’abus du procédé est d’autant plus ennuyeux qu’il est le plus souvent gratuit ; j’avoue avoir soupiré dans certains passages tenant du catalogue d’armes à feu, ou, pire encore, du magazine de tuning (non, franchement, j’ai du mal à voir Van Helsing s’enthousiasmer pour une voiture…). Et bien sûr, dans cette ligne de l’ultra-détaillé machin truc, on bouffe plein de noms de marque ici ou là. Dans American Psycho, c’est déjà lourd, mais utile, et même indispensable ; ici, c’est juste surfait et chiant…
Surtout, ce roman, en dehors de quelques passages du coup particulièrement sympathiques, manque cruellement de l’humour qui vient salutairement faire passer la pilule dans les autres volumes de la série jouant la carte de la bourrinade couillonne. Bizien, Heliot, Bretin et Bonzon, Mauméjean, lorgnent chacun à leur manière du côté du gros bis ou Z décomplexé et drôle, là où le bouquin de Lebeau fait davantage penser à des blockbusters fantastiquisants, type Underworld (ou Van Helsing, justement…), qui se la pètent pour pas grand chose, avec du nichon, de la fumée, des CGI partout et un filtre bleu nuit tout le temps, mais rien du côté de l’inventivité ou du pur plaisir bêtement rigolard d’une soirée bière-pizza entre potes devant une bizarrerie récupérée dans un bac à soldes ou un vrai vidéo-club résistant encore un peu à l’invasion de Vidéo-Futur… Autant dire que pour le coup, j’ai choisi mon camp, camarades.
Reste que Cold Gotha, premier véritable roman du Club Van Helsing (parce que désolé, mais non, Tous ne sont pas des monstres, ça compte pas…), pose le cadre et définit les principes de la saga d’une manière correcte. Van Helsing contre Dracula, c’est sûr qu’on ne donnera pas à Guillaume Lebeau la palme de l’originalité dans le choix du chasseur comme du monstre… Mais quelques scènes réussies de temps à autre relancent l’intérêt limité du lecteur ; je ne peux pas prétendre m’être excessivement ennuyé, non… Médiocre moins, disais-je. Mauvais, on peut le dire à la limite, si on a davantage d’exigences. Pas aussi nul qu’on a pu le dire, quand même. Mais on lit Cold Gotha et on l’oublie presque aussi sec : c’est de la littérature pour faire passer le temps, et rien d’autre. Pas déshonorant, mais sans grand intérêt. Dans le genre, on a certes vu bien mieux… mais aussi bien pire.
D’ailleurs, après avoir refermé Cold Gotha, je me suis dit que, tant qu’à faire, je pouvais bien lire aussi Léviatown de Philip Le Roy ; que, si ça se trouve, c’était pas si pire qu’on l’avait dit…
Je suis un grand naïf, des fois.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



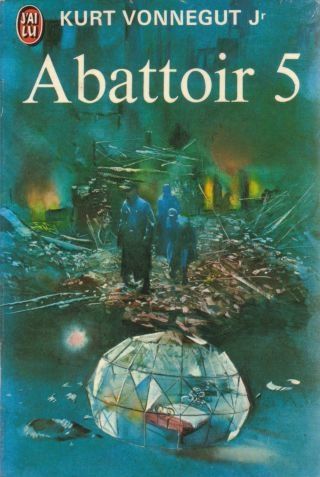

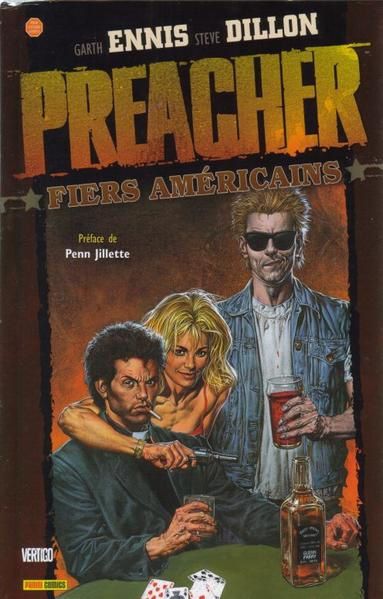



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)