"La Vie secrète et remarquable de Tink Puddah", de Nick DiChario

DICHARIO (Nick), La Vie secrète et remarquable de Tink Puddah, [A Small and Remarkable Life], traduit de l'américain par Claudine Richetin, Paris, Télémaque – Gallimard, coll. Folio Science-fiction, [2006, 2010] 2012, 321 p.
La Vie secrète et remarquable de Tink Puddah, premier roman de l'illustre inconnu Nick DiChario, est un livre dont je me suis tout d'abord fortement méfié, parano que je suis. Il faut dire qu'il avait été publié en français par Télémaque, qui m'avait fait sortir de mes gonds pour Un peu de ton sang de Theodore Sturgeon, avec une quatrième de couverture pour le moins prometteuse (j'adore le « croisement inédit entre E.T. et Croc-Blanc »). Parallèlement, ce titre français sonnait un peu trop comme celui d'un récent prix Pulitzer pour être tout à fait honnête. Mais quand ce roman est sorti en Folio SF, je me suis malgré tout laissé tenter... en dépit d'un bandeau moche et menaçant affirmant que Jan Kounen « en ferait bien son prochain film ». Ce qui, vous en conviendrez, faisait pas mal de handicaps à surmonter.
Nous sommes donc aux Etats-Unis, essentiellement dans l'Etat de New York, au milieu du XIXe siècle. Tink Puddah est un étranger. Il faut dire qu'il pousse le vice jusqu'à avoir la peau bleue (outre diverses malformations dont je vous passe le détail), ce qui en fait un nègre tout à fait remarquable. Sur Terre, il est bien loin de l'Eauspace de ses parents, tués dès leur arrivée sur notre planète, et laissant le petit Tink orphelin.
Quelques années plus tard, un service funéraire est organisé pour l'étranger Tink Puddah, bien que celui-ci ait proclamé son athéisme, au grand dam du pasteur Jacob Piersol. Mais c'est l'occasion pour plusieurs des villageois de Skanoh Valley de venir témoigner de la profonde gentillesse et de la serviabilité du défunt. Quitte à heurter un peu les sentiments de Jacob.
Mais l'histoire ne fait que commencer. En effet, suite à l'intervention d'un jeune morveux, on en vient à s'interroger sur la mort de l'étranger. Et de découvrir que celui-ci a été tué d'une balle dans le crane, chose que les autorités et témoins se sont empressés de cacher...
Dès lors, l'histoire se déroule sur deux plans : d'une part, on suit Tink Puddah l'étranger dans sa vie sur Terre, où il doit faire face à bien des dangers et souffre régulièrement de la cupidité et de la haine aveugle des humains ; d'autre part, on suit l'enquête concernant la mort de Tink Puddah, et ce essentiellement à travers le personnage de Jacob Piersol... qui en vient étrangement à voir en Tink Puddah le Messie. Jusqu'à un dénouement qui ne surprendra personne tant il coule de source, mais peu importe.
Oui, peu importe. Parce qu'il faut reconnaître que c'est pas mal du tout, La Vie secrète et remarquable de Tink Puddah. Ce récit de contact avec l'autre est assez bien foutu, dans une veine qui peut rappeler, en moins dur, Eifelheim de Michael Flynn, mais évoque surtout quelques Grands Anciens de la science-fiction la plus humaniste, en l'occurrence Clifford D. Simak – le cadre rural y est pour beaucoup – et Theodore Sturgeon.
Nick DiChario, pour son premier roman, a su renouveler intelligemment un thème éculé, et poser à travers cette relecture les bonnes questions. Sans avoir grand-chose d'original, La Vie secrète et remarquable de Tink Puddah se lit avec un plaisir constant, et s'autorise quelques surprises (bonnes). Certes, la plume n'est pas exceptionnelle (mais peut-être la traduction est-elle en cause). Mais la profonde humanité des personnages et du propos l'emportent, et suscitent l'adhésion du lecteur, qui se laisse doucement entraîner dans cette évocation sur le mode de la parabole de la vie d'un étranger loin de chez lui.
Roman frais et éminement sympathique, La Vie secrète et remarquable de Tink Puddah n'a sans doute pas de quoi entrer au Panthéon du genre, mais s'avère des plus appréciables. Il s'en dégage une saveur toute particulière, devenue bien rare dans la science-fiction contemporaine, plus dure et plus froide (à mes yeux en tout cas). Alors on pourrait peut-être faire à La Vie secrète et remarquable de Tink Puddah un procès en gnangnantise, mais, pour ma part, je m'avoue tout à fait satisfait de cette lecture certes un brin naïve, mais qui fait du bien. Faudra voir la suite de sa production, mais ce Nick DiChario pourrait bien être un auteur prometteur, dans une veine paisible, bucolique et profondément humaniste, au sens le plus doux...

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



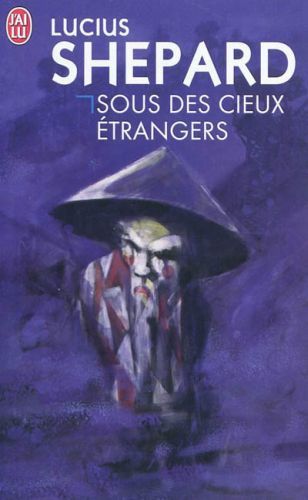














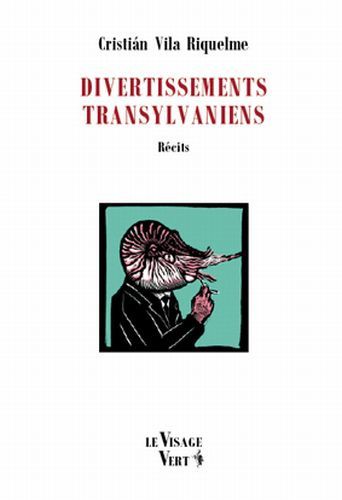

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)