
Voici ma première nouvelle achevée. J'avais 17 ans, je crois... et ça se sent. En fait, malgré ses deux publications en son temps (d'abord dans une expo d'art, ensuite dans un fanzine), je doute que ce soit encore lisible aujourd'hui. Mais le thème continue de me parler, alors que j'ai presque deux fois l'âge que j'avais au moment de sa rédaction. Et, des fois, me prend l'envie de la réécrire... Je ne sais pas si ça en vaudrait le coup. Mais, en attendant, voici le texte original, tel quel. Oui, vous pouvez pouffer.
0 : 00<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
François était sur le point de s’assoupir quand la sonnerie de son fax le tira brusquement des limbes. Il se leva lentement, les yeux brouillés, pour retirer la feuille de la machine, et manqua de tomber en franchissant les longs cinq mètres qui l’en séparaient : il avait trop bu, comme d’habitude... Au prix d’un effort surhumain, il parvint malgré tout à son but, et lu le message : un simple J, c’était tout. Putain, le réveiller à minuit pour ça... François déchira la feuille, sans chercher à en déterminer sa provenance, et revint s’asseoir à son bureau, où l’attendait un pack de thé glacé. Il s’en servit un verre, et le but lentement. Sa gorge était dans un sale état, aussi la fraîcheur du breuvage lui fit bien mal, dans un premier temps, avant de lui donner la force nécessaire pour fuir Morphée et ses bras enjôleurs. Une cigarette suivit, et François s’affala dans son fauteuil, d’où il alluma sa chaîne hi-fi : le schuffle l’emmena sur l’un de ses morceaux favoris de Nine Inch Nails, Something I Can Never Have. Une belle oeuvre d’art, qui décrivait bien son attitude en cet instant. Depuis quelque jours, François se cantonnait dans un rôle de maniaco-dépressif et nihiliste à tendance suicidaire qui lui convenait à merveille.
Il faut dire que, ces derniers jours, la vie du prometteur François Yanek ne lui avait réservé que trop peu de bonnes surprises. Il s’était fait plaqué, était atteint d’un méchant syndrome de la page blanche, et d’une envie terriblement rassurante mais ennuyeuse de ne rien faire, à l’exception de boire et de fumer. Cela faisait bien trois jours maintenant que François était un véritable zombie, ce que tant son corps que son amour propre avaient du mal à supporter. François avait désormais envie d’arrêter les conneries, tout de suite, là, maintenant, et de se remettre à bosser. Ses “nombreux” fans attendaient de lui un nouveau chef-d’oeuvre, et il ne pouvait pas les décevoir.
Il vira donc son écran de veille d’un vif coup de souris, et se retrouva devant cette satanée page blanche, le seul spectacle que lui prodiguait son logiciel de traitement de texte depuis des lustres.
Bon.
Et maintenant ?
L’inspiration ne venait décidément pas.
François se leva à nouveau, retira le CD, en mit un autre (toujours ce vieux Trent), et monta le son : tant pis pour les voisins, pour un artiste tel que lui, faut ce qu’il faut, et la méthode “Poppy Z. Brite” lui avait été profitable dans le temps. Lui, un artiste. Ca le faisait doucement rigoler, désormais. Oh, le jeune François dont les maisons d’édition s’étaient arraché le premier opuscule, lui ne rechignait pas à se flatter d’être un artiste. Mais l’épave qu’il était désormais se rendait bien compte de la futilité de cette dénomination.
François n’était ni Rimbaud, ni Burroughs : il ne se défonçait pas la gueule pour produire de l’art, ça n’avait jamais donné de bons résultats avec lui. Non, c’était une fin en soi, un moyen comme un autre de s’occuper, de se la péter, aussi : certaines jeunes filles crédules chaviraient sous le regard terne d’un cadavre ambulant en quête des Paradis Artificiels. Il le savait, il en avait profité. La principale différence, déjà, c’est que Rimbaud et Burroughs se défonçaient avec classe. Lui, ses maigres ressources le poussaient à chercher l’inspiration dans les packs de kro, ce qui déjà le faisait nettement moins.
François n’avait aucun talent, il le savait désormais. Et le succès de son Baron ne tenait qu’au fait que cette navrante resucée de Dracula était sortie en même temps que le film de Coppola, et à sa mince atmosphère imprégnée de vaudou. Le public était énorme pour de telles conneries. Baron était même entré dans les best-sellers, aux côtés de Mary Higgins Clark et de Stephen King. Mais son éditeur l’avait endoffé, et François n’avait reçu que très peu des dividendes escomptés. Une vague période de grosse tête avait suivi cette “consécration”, pour tomber bien vite. Question de mode, sans doute...Dans son genre, il avait établi une sorte de record : passer en moins de six mois du statut d’espoir à celui de has-been.
Page blanche, donc. Il s’agissait désormais de la remplir.
François farfouilla un moment dans un pack de 24, et finit par trouver, au milieu de nombreux cadavres, une bière intacte. Il l’ouvrit, en but une bonne gorgée, et se lança. Enfin, essaya de se lancer...
Oh, les idées ne lui manquaient pas forcément. Il avait toujours eu une imagination débordante, ainsi qu’un don certain pour recycler les vieux mythes de la littérature fantastique et gothique. Seulement, il lui fallait un déclic, ce qu’un autre que lui aurait pu se permettre d’appeler un éclair de génie. Le personnage du vampire l’avait toujours fasciné, et il maudissait Anne Rice d’avoir eu les mêmes idées que lui, mais vingt ans auparavant. Il avait une fâcheuse tendance à être inconsciemment un plagiaire. Mais que dire de plus sur les vampires. Anne Rice, Stephen King, Poppy Z. Brite, Tanith Lee, Richard Matheson, entre autres avaient déjà dit tout ce qui pouvait être dit au sujet du vampire, et avec un brio dont François se sentait incapable. Exit le vampire, donc.
Alors quoi ? Goules, harpies, chimères, zombies, extra-terrestres, maniaques avec une tronçonneuse ? Tout ça ne l’intéressait pas vraiment. Il y avait bien là matière à écrire une belle merde qui fournirait de quoi survivre encore quelque temps, mais bon... Il commença malgré tout à écrire, se disant que le choix du monstre terrible se ferait au fur et à mesure, en fonction de l’ambiance qui se dégagerait de ses textes.
SANS TITRE
par François Yanek
Hum... un début prometteur, ne put s’empêcher de penser François.
Il resta pensif un moment, fixant l’écran de ses yeux fatigués, et jetant de temps en temps un coup d’oeil à sa bibliothèque, qui fourmillait de séries noires fantastiques et SF, ce que les critiques appellent poétiquement des “oeuvres alimentaires”. La pertinence du terme fit sourire François, mais d’un sourire empli de tristesse. Tout, dans sa maison, semblait lui rappeler qu’il était un raté. Il chassa vite cette pensée et se mit à pianoter.
La maison semblait entourée d’une aura malsaine. C’était une évidence pour Nancy, et elle en fit la remarque à Paul dès leur arrivée. Elle avait du mal à concevoir une vie de famille dans cet endroit lugubre et isolé au coeur d’une forêt perpétuellement embrumée... Paul, lui, était charmé.
Ah Ah ! Alors, Baron a trouvé son successeur !
Franchement, non.
Fichier - Quitter - “Voulez-vous enregistrez les changements dans nouveau document.wps ?” - Non
François éteignit son ordinateur, se crama une dernière clope en attendant la fin du CD, et alla se coucher. Une nuit qui promettait d’être sans rêves ni cauchemars : il n’avait même plus l’inspiration pour ça. Son inconscient était mort, un fantôme pitoyable au milieu du charnier de neurones qui constituait son cerveau avachi par la bière.
7 : 00
Ce fut à nouveau le fax qui réveilla François. Cette nuit avait été bien courte, mais il avait l’habitude de ce train de vie, et n’eut pas trop de difficultés à se lever, même si une sérieuse gueule de bois lui taraudait le crâne. Il n’était donc guère frais et plutôt d’humeur maussade quand il prit la feuille et y vit un nouveau J , immense au milieu d’une feuille diaphane.
Alors, de deux choses l’une : ou bien, un petit comique avait décidé de lui pourrir la vie, ou bien il avait un ange gardien désireux de faire de lui un honnête travailleur, un grand écrivain. Hélas pour François, il ne put avoir la réponse à cette question de suite, étant dans l’impossibilité de retrouver l’expéditeur du mystérieux message.
J.
François ne comprenait pas. Et il n’était guère en état d’y réfléchir. Pas avant un bon petit déjeuner, en tout cas.
L’avantage de dormir tout habillé, c’est que l’on ne perd pas un temps fou le matin à choisir ses fringues de la journée, et c’est toujours ça de gagné. François n’eut qu’à enfiler une veste, et il était fin prêt à quitter son havre de paix et de débauche pour le monde de tous les jours, dans une quête mystique de croissants. Ainsi fit-il donc, d’autant plus qu’il était tenaillé par la faim, n’ayant rien mangé depuis deux jours (son état était trop lamentable n’aurait-ce été que pour passer une commande). Tout juste se passa-t’il un peu d’eau fraîche sur le visage, et il était parti.
Son appartement était pas trop mal situé. Un cinéma à deux blocs, une supérette à un, un bureau de tabac et, surtout, “Marcel Marcel” juste en face.
Marcel Marcel, était son boulanger. Des parents dotés d’un étrange sens de l’humour et d’un mépris total des sarcasmes qu’auraient à encourir leur fils étaient responsables de ce nom ridicule, que le boulanger avait accepté tant bien que mal, jusqu’à en faire une marque de fabrique. Il était bon, le pain de Marcel Marcel, et ses croissants étaient pas mal non plus. C’était sa femme Ginette qui tenait la caisse, comme si tous les noms ridicules issu du passé ouvrier parisien étaient faits pour s’entendre. La Ginette était l’archétype de la ménagère de (plus ou) moins de cinquante ans : elle parlait de la météo, était aimable avec tout le monde, mais n’aimait pas trop les Arabes, même si elle ne savait trop pourquoi. La Ginette était très fière d’avoir un exemplaire dédicacé de Baron, même si, bien sûr, elle ne l’avait jamais lu : trop de sexe, trop de sang, et trop peu de bons sentiments pour cette bonne femme bien élevée. Cela ne l’empêchait pas de dire à qui voulait bien l’entendre que François Yanek était le meilleur écrivain du monde en plus d’être son voisin, en tout cas le meilleur qu’elle connaissait (il aurait été plus juste de dire le seul).
La joie de vivre de la Ginette était légendaire. Aussi François sursauta-t’il d’étonnement lorsqu’il vit le sourire de la caissière disparaître brusquement à son entrée dans le magasin. Quoi, il avait la braguette ouverte ? Non, ça devait être autre chose, sinon comment expliquer l’attitude de cette cliente, qui le fuyait comme un pestiféré et s’empressa de quitter le magasin, passant la porte telle un avion supersonique ? François décida de faire comme si rien n’était, comme à son habitude lorsqu’il ne comprenait pas quelque chose.
-Bonjour, madame Ginette, vous allez bien ?
-Oh... Oui, monsieur Yanek... très bien... oui...
Comment ? Par encore une seule remarque sur ce maudit temps qui se dégrade avec l’effet de serre et toutes les fusées qu’ils envoient dans l’atmosphère et si c’est pas malheureux tout çà mon bon monsieur ?
-Euh... Deux croissants, SVP.
Pendant qu’elle s’affairait dans son étalage, François osa un vague “sale temps, non ?”, et eut pour toute réponse un nerveux “les fusées... les fusées... euh... Je vous le met sur votre compte, monsieur Yanek.”.
Alors qu’elle lui tendait la poche, une larme roula sur sa joue. “Excusez-moi”. Et elle se retourna, sortant un énorme mouchoir, dans lequel elle éclata en sanglots. François lui tapota sur l’épaule, tentant de la réconforter. Il n’était guère doué pour ça. Il lui demanda ce qui se passait, si il pouvait faire quelque chose, si elle avait perdu un être cher...
-Non, monsieur Yanek, mais ça ne saurait tarder, hélas... Partez maintenant, je vous en prie, monsieur Yanek...
Il partit sans lui tourner le dos, et s’empressa de retourner dans son appartement déguster ses croissants. Pour lui, l’incident était déjà clos : après tout, cela ne le concernait pas...
12 : 00
Il n’avait rien pu écrire de la matinée. Il comatait purement et simplement devant son ordinateur quand son fax s’enclencha à nouveau.
J.
Encore une fois.
François débrancha le fax et se prépara des pâtes.
En mangeant son plat du pauvre (pâtes au sel, beuh...), François pensait à tout et à rien : à son chef-d’oeuvre en préparation (ou du moins à l’excuse bidon qu’il devrait sortir à son agent pour lui faire croire en l’existence du bijou en question), à la conjoncture économique, à Elfie, à la vanité d’être artiste, à Elfie...
A Elfie...
Et oui, il l’aimait encore, bien qu’en gros macho, il prétendait ne pas croire en l’amour, vanité inventée par l’homme, et surtout par les religieux, pour légitimer la sexualité, trop animale, trop sale en elle-même pour être admirable et saine selon les critères de la morale. Enfin, macho n’est peut-être pas le mot. François avait un profond respect des femmes, et n’avait rien d’une brute misogyne. Mais c’était une image qu’on lui avait souvent attribuée. Image grotesque. François ne faisait pas que respecter les femmes, il les aimait, mieux, il les admirait. Il aurait aimé être une femme. Non pas qu’il eut été homosexuel. Non. La vérité était qu’il détestait les hommes pour leur violence, leur brutalité, leur vulgarité, leur laideur, leur football. Les femmes, elles, étaient belles, douces, délicates. Oui, il aurait aimé être une femme. Mais une lesbienne. François se rendait parfaitement compte de la naïveté manichéenne de ce raisonnement, mais il n’arrivait pas à penser autrement.
Elfie l’avait plaqué il y a trois jours, et François n’arrivait pas à s’y faire. Elle lui manquait terriblement. Elle était la femme de ses rêves. On dit toujours ça, bien sûr, mais là, cela semblait bien être la réalité : elle était belle et intelligente, cultivée, de bon goût, chaleureuse et tendre, décoincée sans être vulgaire pour autant, une militante de la cause des femmes et de bien d’autres, mais qui ne tombait pas dans les dérives d’un stupide féminisme à tout prix, extrémiste au point d’en devenir une autre forme de sexisme. Un rêve. Et les rêves sont les antithèses de cauchemars tels que François dans ses mauvaises passes, et la dialectique fonctionne peut-être en philosophie, mais pas dans la vie quotidienne. François était devenu insupportable aux yeux d’Elfie, un gamin capricieux, un fouteur de merde, et pire que tout, un égocentrique : or Elfie, qui portait bien son nom, était bien un de ces petits lutins affectueux et resplendissants qui ont besoin de tendresse, cette tendresse que la canette de bière ambulante qu’était devenu François ne pouvait plus lui prodiguer.
Elfie avait joué un rôle décisif dans sa vie d’auteur. C’était elle, en juge impartial et parfaitement fiable, qui avait fini par le persuader que Baron était une vraie merde. Mais elle croyait en lui. Dans les lignes maladroites de son premier roman, elle avait trouvé un génie qui ne demandait qu’à se révéler, et elle encouragea donc François en ce sens. Elle ne jurait que par Houellebecq, Despentes, John King, Irvine Welsh... et François se sentait un nain face à ces géants. Il n’avait jamais cru en lui. Déjà, c’était un conseil d’ami qui l’avait poussé à contacter des éditeurs pour Baron. Sans lui, le manuscrit aurait fini à la poubelle, comme toutes les autres nouvelles qu’il écrivait lors des cours de philo, pendant que son prof s’extasiait sur Descartes et Bachelard. Une oeuvre très prolifique, mais à jamais perdue. François se dit qu’il aurait bien besoin de cours de philo.
Mais pour l’heure, son con de prof, il s’en foutait. Il voulait appeler Elfie, lui dire qu’il avait changé, qu’il avait arrêté de boire (pieux mensonge), qu’il s’était remis à écrire, mais qu’il avait besoin d’elle, qu’elle était sa muse.
Il n’avait jamais rien pu écrire quand ils vivaient ensemble. Et pourtant, François était très sincère lorsqu’il pensait cela.
Alors il l’appela.
“Bonjour ! Vous êtes bien chez Elfie ! Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore sauf si vous êtes un trou du cul du nom de François Yanek, auquel cas je vous conseille le suicide. 3-2-1... BIIIP !
Sympa.
“Elfie, c’est François. Il faut qu...” CLIC.
A peine avait il commencé à parler, à peine avait-elle eu le temps de reconnaître sa voix qu’elle avait raccroché. François avait des injures sexistes plein la tête.
Inutile de rappeler.
François s’alluma une clope, et se remit à écouter Nine Inch Nails. Hurt. Sans doute le morceau le plus déprimant, mais aussi le plus beau qu’il connaissait. Une merveilleuse ballade, fragile et délicate, et son final apocalyptique, ces trois notes de guitare saturée iconoclastes, et les ambiances oppressantes qui suivaient. Un chef-d’oeuvre. Le rêve de François avait toujours été d’écrire quelque chose qui serait de cette perfection, qui aurait cette force unique, quelque chose qui transporterait le lecteur loin, très loin de tout ce qu’il avait pu lire auparavant. Un rêve, encore un...
François s’attela ensuite à son ordinateur. Non pas qu’il voulut soulager ses frustrations sur un quelconque “http://www.chiennenchaleur.com”, ce n’était pas vraiment son genre, et ce n’était pas pour une question de sexe qu’il avait appelé Elfie. Non, il voulait avant tout parler à quelqu’un. Thierry, par exemple. Cet agoraphobe forcené ne sortait jamais. Il faisait donc un confident parfait pour François, d’autant plus que ce Thierry était parfaitement au courant de ses problèmes étant lui-même un pseudo-écrivain en manque d’inspiration.
François : Ya quelk1 ?
Thierry : A ton service. 1 problM ?
François : Besoin 2 parler.
Thierry : Suis la pour ça.
François : Reçois D fax avec D “J” dessus. C toi ?
Thierry : Nan. Chui prolo. Pas 2 fax. C bizarre... Grave ?
François : Pense pas. Elfie me manque.
Thierry : Bourre-toi la gueule.
François : Mauvaise réponse.
Thierry : Dsolé. Pas envie parler 2 ça.
François : OK. Te comprends.
Thierry : Ca avance ton bouquin ?
François : Yes. ID en Bton.
Thierry : C quoi ?
Même sur un écran d’ordinateur, un silence peut être éloquent.
Thierry : T la ?
Thierry : Youhou !
François ne se sentait pas la force de mentir.
François : Dsolé. Ai menti. Pas d’ID. Page blanche totale.
Thierry : Navré. Même problème. Peut peut-être s’aiD mutuellemt ?
François : OK. Veux Horreur. C quoi qui te terrifie le + ?
Thierry : “Toute marche, irrésistible et mystérieuse, vers un destin”. Le grand HPL.
François : C vague...
Thierry : Nan. C riche. Nuance.
François : Sinon ?
Thierry : 1 zombie nécrophile qui tue D infirmières à chaque nuit 2 Walpurgis et se fait traquer par 1 exorciste bouddhiste non-violent ?
François : Tu te fous 2 ma gueule ?
Thierry : Ouais.
François : S1pa. Tchao.
“Toute marche, irrésistible et mystérieuse, vers un destin”. C’est vrai que c’est terrifiant. N’empêche, c’est vague. François se sentait pas beaucoup aidé. Il se dit qu’une histoire telle que celle du zombie nécrophile lui permettrait d’arrondir ses fins de moi, mais il était désormais, depuis Elfie, un auteur avec de l’amour-propre. Pas question de se salir. Son prochain ouvrage serait son chef-d’oeuvre.
15 : 00
Rien. Il n’avait strictement rien fait depuis sa conversation avec Thierry. Encore cette foutue page blanche, qu’il avait rempli par provocation avec la phrase de Lovecraft. Mais l’inspiration ne venait toujours pas. Alors François enfila sa veste en cuir, et sortit faire une promenade du côté du Champ de Mars. Auparavant, celle-ci était quotidienne, mais cela faisait un petit moment que François n’était pas sorti de chez lui, un bon mois sûrement.
Le parc était ravagé par la tempête. François se souvint qu’au lendemain de celle-ci, le spectacle était tout bonnement apocalyptique. Jamais le parc n’avait été aussi beau selon les critères de François : la Tour Eiffel, grande idole industrielle, au milieu d’un champ de ruines végétal. La scène avait quelque chose de surréaliste, de visionnaire aussi : à quoi pourra bien ressembler Paris dans cinquante ans ? François avait toujours été pessimiste, et ce n’était pas près de changer.
Des touristes partout, venus admirer la grande dame de fer. François était toujours étonné par la vérité de certains clichés les concernant : les provinciaux ébahis, les Japonnais, d’une rigidité militaire, qui photographient tout, les Américains en pays conquis...
Les Américains étaient les pires. Et François était mort de rire en matant un couple et leur gosse, des bons rednecks du fin fond de l’Alabama, venus à Paris principalement pour visiter Eurodisney, dont ils revenaient à coup sûr : une vraie caricature. Imaginez-vous un peu le gamin avec sa salopette, son sac-banane et son chapeau Mickey (bon, c’est un gamin, on l’excuse), la mère, obèse, avec une odieuse chemise à fleur et un bob et un pantalon moulant (Beuh...), mais surtout, le père : l’archétype du buveur de bière, avec sa chemise à carreau ouverture sur un marcel taché, et rendu encore plus ridicule par sa stupide casquette Dingo (celle avec les grandes oreilles). C’était monstrueusement risible. Mais François déchanta quand il entendit de quoi retournait leur conversation, quand il entendit le gamin dire à sa mère d’une petite voix flûtée à l’accent nasillard : “Look mum, he’s got a J”.
Le gamin pointait François du doigt.
-Mummy ! See ! Look at that man, overthere ! He’s got a J. What does it mean, mum ?
La mère ne répondit rien, mais le père le regarda d’un air mauvais :
-Shut up ! You mustn’t say when you see somebody who’s got a J. It’s very bad.
-But...
-We go now...
Mais le gamin, têtu comme le sont les gamins en général, surtout quand on ne leur fournit aucune explication, n’avait pas dit son dernier mot. Et, alors qu’ils s’en allaient, il continua de fixer François de ses petits yeux rieurs, et se mit à chantonner “He’s got a J ! He’s got a J !” sur un air de comptine, jusqu’à ce que son père lui foute une baffe, qui le fit éclater en sanglots.
Putain.
PUTAIN !!!
CA VEUT DIRE QUOI, “J” ? CA VEUT DIRE QUOI ? QU’EST-CE QUI M’ARRIVE ?
18 : 00
Le retour fut particulièrement éprouvant. François se sentait épié, le regard de la foule parisienne pesait de tout son poids sur son dos fragile. Il ne s’en était pas rendu compte auparavant, mais désormais cela lui crevait les yeux : depuis ce matin, les gens étaient bizarre. Du moins, quand ils entraient en contact avec lui. La boulangère, ce matin, les touristes... le monde entier, oui ! Et ce J. Qu’est-ce qu’il pouvait bien signifier ? Pourquoi revenait-il sans cesse depuis ce matin ? François avait l’impression d’être dans un de ses écrits. Un des plus mauvais.
Il rasa les murs, fuyant la masse et son jugement, allait dans les ruelles les plus sombres, dans les nombreux déserts de Paris. Il fit des détours, nombreux, pour fuir, et pour tenter de trouver une explication rationnelle à ce J, mais non, rien. Il n’y arrivait pas. Il hurlait intérieurement, littéralement, son affolement était indescriptible. Il avait toujours eu une vie tranquille, sans surprise. Et avait toujours souhaité que cela change. C’est toujours mauvais, un souhait, quand ça se réalise...
Il avait beaucoup marché. Il était à peu près dix-huit heures quand il arriva à son appartement. Essoufflé par son excursion (il avait plusieurs fois couru, se sentant inexplicablement menacé par la foule), il gravit lentement l’escalier, et faillit hurler quand il arriva sur le palier.
Trois hommes. Ils étaient là, devant sa porte. Ils l’attendaient, de toute évidence. Un grand blond, à l’allure de top-model, avec un sourire ultra-brite, du genre de ceux qu’on ne croit possible que dans les publicités et les sitcoms, vêtu d’un smoking qui détonait sur le papier-peint pourri de l’immeuble. Avec un noeud-papillon (Il y a encore des gens pour en porter ?). A ses côtés, un petit vieux décrépi avec des lunettes, vêtu lui d’une tenue beaucoup plus traditionnelle, costume de ville classique du cadre sup classique. Et comme tel, il regardait sa montre en permanence. “Il est dix-huit heures, monsieur”, dit-il à Ultra-Brite, lequel ne répondit que par un sourire encore plus large. Le troisième type était différent. Grand, baraqué, un imperméable. Froid. Le genre de type dont on ne sait rien à première vue, si ce n’est que, quand on le cherche, on le trouve. “Il ne devrait plus tarder, maintenant”, dit Ultra-Brite. Aucun commentaire des deux autres.
Ils n’avaient pas encore vu François, qui se replia dans un coin sombre. Pour une fois, il bénissait ce foutu concierge de n’avoir pas changé les lampes.
Que faire ? Il n’allait pas rester ici toute la nuit. Fuir ? Pour aller où ! Et pourquoi, après tout ? Ces types-là étaient peut-être (étaient sûrement) des admirateurs, ou bien des représentants d’une maison d’édition intéressée par son travail. Allons ! Des types qui attendent sur le palier, il n’y a que dans les mauvais films qu’ils veulent du mal. François prit son courage à deux mains, et s’avança vers sa porte comme s’il n’y avait personne sur son chemin.
A peine avait-il fait un pas qu’Ultra-Brite lui adressa un sourire inhumain :
-Monsieur Yanek, enfin ! Nous vous attendions.
Sans déconner ?
-Vous désirez, monsieur... Monsieur ?
-Vous offrir un verre.
Le salaud n’avait pas voulu dire son nom, comme s’il cherchait volontairement à plonger un peu plus François dans la psychose.
-C’est à dire que...
-Vous n’allez pas nous faire l’affront de refuser, j’espère ? Oh, ne vous en faites pas, nous n’en aurons pas pour longtemps. Juste le temps de papoter en sirotant un demi...
François se dit qu’il n’aurait guère été judicieux de refuser. Ainsi donc, il accompagna ses trois visiteurs dans un bar pas très éloigné, assez miteux, genre PMU. Il avait craint un moment qu’ils ne le forcent à monter dans une voiture, que ce soit un enlèvement. Mais il écarta bien vite cette idée stupide : il n’y avait de toute façon personne qui aurait payé une rançon pour lui. Non, voilà trois gars bien sympathiques qui m’offrent un verre, et c’est tout, se dit le François rationnel. Mais il serait faux de prétendre qu’il était rassuré pour autant. Il craignait d’un instant à l’autre que ces types lui disent qu’il avait un gros J de tatoué sur la gueule. Tiens, à propos, eux ne me regardent pas d’un air bizarre. Bof. J’ai du halluciner.
Le type baraqué se prit un demi, le vieux un café, et Ultra-Brite un Martini, de même que François. Le patron était un vieux poivrot en phase terminale de sa cirrhose, et le lent fonctionnement de ses synapses entraîna un retard inopportun dans son servie, mais bon : les boissons arrivèrent, et elles n’étaient pas mauvaises.
Jusque là, personne n’avait dit un mot. Ultra-Brite se contentait de sourire , le vieux regardait sa montre, et l’autre ne fit que chausser ses lunettes noires (à la tombée de la nuit, c’est malin, se dit François, qui détestait les types qui se façonnaient un style), puis resta bras croisés, tête baissée. A l’arrivée des consommations, ce fut, fort logiquement, Ultra-Brite qui attaqua la conversation :
-Alors, monsieur Yanek...”. Il s’interrompit pour laper son Martini. “Parlez-nous de vous, monsieur Yanek, je vous en prie. Quand je parle affaires, j’aime savoir avec qui je traite.
François se sentait chez le psychanalyste. Allongez-vous sur le divan, et parlez-moi de votre enfance... Ce qu’il fit, pensant lasser bien vite Ultra-Brite, et l’amener sur un autre sujet. Peine perdue : celui-ci buvait ses paroles. Il en redemanda même, voulant des anecdotes croustillantes, sur les plus grands moments de la courte vie de François.
-Et voilà..., dit ce dernier à la fin de son récit. Si vous me disiez ce que vous me voulez, maintenant ?
Ultra-Brite s’apprêtait à répondre, mais le vieux le regarda d’un air furibond : “C’est pas encore l’heure !”.
L’heure de quoi ? François détestait les emplois du temps, les vies chronométrées. Il avait une furieuse envie de se lever, au revoir messieurs et merci pour tout, et de rentrer dans son appart reprendre une vie normale selon ses critères très personnels de la normalité. Mais un coup d’oeil en direction du grand gars l’en dissuada. Plus la soirée avançait, plus le Martini lui dégommait les neurones, et plus François se mettait à voir en lui un Terminator.
20 : 00
Les consommations s’enchaînaient, alors qu’Ultra-Brite ne cessait d’en demander plus à François, dont le discours devenait de plus en plus incohérent. Son interlocuteur nageait maintenant au tréfonds de son inconscient, et François lâchait tout : Elfie, les artistes, Baron, Nine Inch Nails, son sentiment d’être un parasite... Le sourire d’Ultra-Brite s’amenuisait au fur et à mesure pour se changer en un air de sollicitude. Il devenait un confident, un ami sûr.
Au cinquième Martini, François s’arrêta enfin. Il n’avait aucune notion de l’heure qu’il pouvait bien être, et s’en foutait. Il avait fini par apprécier la compagnie d’Ultra-Brite, et ne prêtait plus aucune attention à ses taciturnes compagnons. Il y eut alors un blanc assez prolongé, de ceux qui traduisent une gêne profonde. Puis Ultra-Brite retrouva son sourire, et proposa d’un ton enjoué d’offrir le resto à François, lequel accepta sans y réfléchir. Le vieux paya les consommations, et ils s’en allèrent, prenant le métro jusque dans les quartiers rupins, où Ultra-Brite avait visiblement réservé une table dans un établissement de renom, du genre de ceux où François dînait couramment il y a un an, et qu’il ne pouvait plus se permettre, même exceptionnellement, dorénavant. La collation fut somptueuse, et François se demandait comment il avait pu faire pour vivre auparavant en mangeant ce qui semblait n’être que des déchets face à ces oeuvres d’art culinaires. Il y avait toujours un blanc, toutefois. Mais au bout d’un moment, quand vint le plat de résistance, le vieux leva les yeux de sa montre et fit un petit signe de la tête à Ultra-Brite, lequel prit la parole :
-Monsieur Yanek, j’aimerais encore savoir certaines choses. Euh... êtes-vous croyant ?
-Hein ?
-Croyez-vous en Dieu, en Allah, où qui que ce soit ?
-Ah... euh, je dirai non, à première vue. Je ne suis peut-être pas un athée véritable, mais disons que quand je m’adresse à un être supérieur, c’est que j’en ai vraiment besoin, et je ne colle jamais d’étiquette sur cet être, ou ces êtres, si ça se trouve. Mais ce n’est peut-être pas du déisme pour autant. La plupart du temps, j’ai tout de même tendance à nier toute existence divine, même si je n’en ferais pas un combat philosophique.
-Ah... c’est intéressant. Oui, oui, oui. Et... croyez-vous au destin ?
-Sans plus. Je dirai plutôt que je crois au hasard, à un enchaînement de circonstances qui nous définissent. Mais votre question m’étonne ; si je ne crois pas en Dieu, il me semble difficile de croire en même temps au destin...
-Oui... oui, on peut voir ça comme ça, c’est vrai...
-Enfin, des fois, bien sûr, comme tout le monde, je me laisse bercer par des illusions. Quand Baron est sorti, j’étais persuadé d’avoir une destinée extraordinaire, d’être voué à l’écriture et de devoir la révolutionner. Cette idée m’est bien vite sortie de la tête. Non, je conçois plutôt le destin comme un monstre, de ceux qui errent dans mes écrits : je n’y crois pas, mais ça me fait peur.
-Pourquoi donc ?
-Vous ne trouvez pas ça terrifiant de savoir que, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez rien changer à votre avenir ? Le malheur des prophéties : à mon avis, Nostradamus, s’il croyait en ce qu’il écrivait, devait être sacrément perturbé et dépressif. Je me rappelle que, quand j’étais gamin, quand j’ai lu Oedipe Roi, j’en ai fait des cauchemars. Oui, Lovecraft avait raison...
-Pardon ? Ah, oui. Je vois ce dont vous voulez parler : “Toute marche, irrésistible et mystérieuse, vers un destin”...
-Tout à fait.
-Alors, vous pensez que, même si la vie est faite d’un hasard certain, on peut en décider plus ou moins ?
-Oui, si on réagit à temps. Si on voit les signes, si on les interprète correctement...
-Pour quelqu’un qui ne croit pas en Dieu, je vous trouve bien mystique.
-Ah ! Cela doit être mon côté auteur de fantastique. Je nage dans le mystique et le surnaturel en permanence, même si je n’y crois pas, et cela finit par déteindre sur mon attitude, sans doute...
-A propos... vous écrivez, en ce moment ?
-Oui, oui. J’ai plein d’idées, et ma prose est en constante amélioration.
C’est à ce moment là que François se rendit compte que, pour une fois, le vieux s’était intéressé à la conversation : il avait émis un petit rire. François rougissait de son mensonge, et se rendait bien compte qu’Ultra-Brite non plus ne l’avait pas cru, même s’il ne le fit pas remarquer. François ne savait plus où il en était, il avait perdu le contrôle, et avait le désagréable sentiment de se contredire à tout bout de champ.
Un blanc, à nouveau, qui se prolongea jusqu’à la fin du repas.
22 : 00
Le vieux laissa de quoi payer le repas sur la table, et se leva sans dire un mot, bientôt suivi par Ultra-Brite, François et Terminator. Ils prirent à nouveau le métro, en sens inverse, et retournèrent au bar miteux d’auparavant, désormais presque désert, y prendre encore quelques verres. Aussi inconcevable que cela puisse sembler, l’état du tenancier semblait s’être aggravé entre temps. Mais François n’y prêta guère attention, il hallucinait bien depuis ce matin : sans doute son isolement prolongé avait-il fait naître en lui un sentiment d’agoraphobie qui l’avait rendu un brin parano. Un gros brin.
-Rien de mieux qu’un bon digestif, déclara Ultra-Brite de son ton jovial qui n’exaspérait maintenant plus du tout François, lequel ne répondit pas pour autant : ce n’était pas une question, après tout...
Chacun avait devant lui un Armagnac de plutôt bon tonneau, mais seul Ultra-Brite semblait réellement le déguster. François avait trop bu, la notion même de plaisir semblait complètement inconnue au Terminator, et le vieux était de plus en plus obsédé par sa montre. Ultra-Brite reprit la parole :
-Moi, j’y crois, au destin. Et j’ai vu le votre, monsieur Yanek. C’est celui d’un grand.
-Merci. Je n’y crois pas pour autant.
-Oh, vous devriez ! Vous ne pouvez pas savoir la chance que vous avez, et je peux vous assurer que cette journée va changer votre vie du tout au tout : fini, les considérations bassement matérielles. Fini, les problèmes de sexualité. Fini, fini, fini.
23 : 59
Ils sortirent tardivement, et se dirigèrent vers le logis de François. Il était bien bourré, maintenant, mais pas du genre à brailler des chansons obscènes. Il était plutôt morose, perdu. Le vieux était de plus en plus nerveux. Presque devant la porte de l’immeuble de François, il s’arrêta brusquement, et leva la main droite, doigts écartés, gardant les yeux fixés sur sa montre. Tout le cortège s’arrêta. Il abaissa un doigt, puis un deuxième, puis tous les autres, tel un métronome. En même temps, Terminator sortait un flingue d’une taille surréaliste de son imperméable.
-H.
Il tira sur François à bout portant.
24 : 00
Le corps sans vie de François Yanek tomba mollement dans l’indifférence générale, alors que sa trinité de bourreaux s’en allaient, satisfaits, Ultra-Brite souriant de plus belle.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)







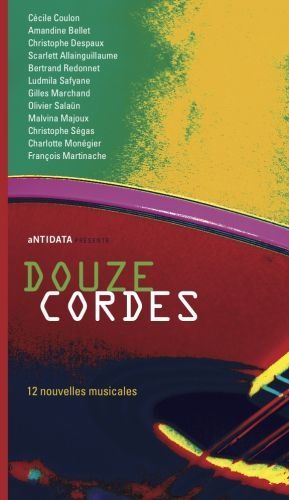

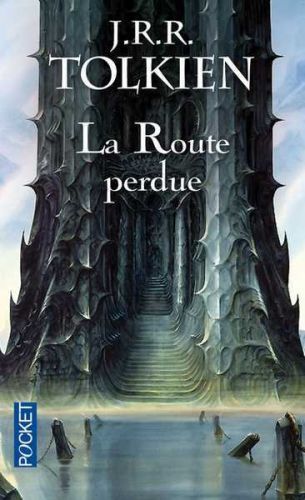


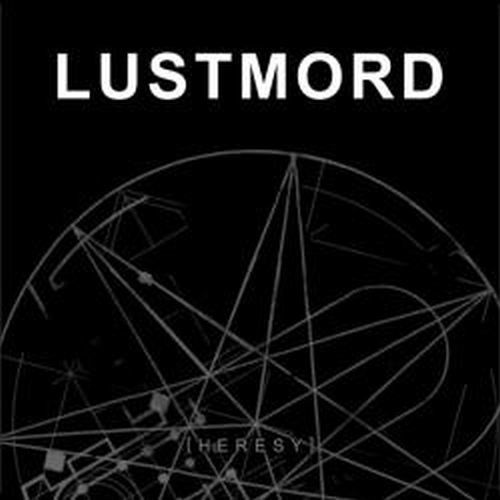
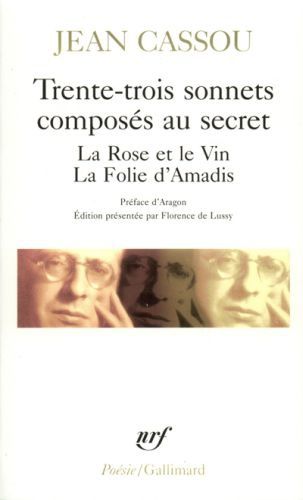

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)