
ROWLING (J.K.), Harry Potter et les Reliques de la Mort, traduit de l’anglais par Jean-François Ménard, [Paris], Gallimard, coll. Jeunesse, 2007, 809 p.
ATTENTION LES GENS ! Parler d’Harry Potter sans spoiler est au-dessus de mes forces ; surtout, je n'aurais pas grand chose d'intéressant à dire... (Oui, je sais, là non plus, mais bon...) Il y aura donc, dans le compte rendu qui suit, un certain nombre de révélations, concernant l’ensemble de la saga. Pour faire simple : que ceux qui n’ont jamais lu Harry Potter parce que « commerce, blah blah, gamins, blah blah, forcément nul, blah blah » sachent qu’ils se trompent ; que ceux qui ont commencé la saga mais n’en sont qu’aux premiers volumes sachent que ça se poursuit très bien ; que ceux qui n’ont pas encore lu ce dernier volume et comptent le lire, bavant d’impatience après avoir passé plusieurs mois à fuir tous les articles parlant dudit phénomène et abondant en « révélations » vraies comme fausses, n’aillent pas plus loin, sous peine de gâcher leur plaisir… Les autres, vous pouvez continuer. Merci de votre attention.
Harry Potter, donc. Pas la peine de le présenter, on le connaît tous. Qu’on l’aime ou pas, on peut difficilement y échapper. Harry Potter en bouquins, Harry Potter au cinéma, Harry Potter en jeux vidéos, Harry Potter partout et tout le temps. Evidemment, à force de surcharge, ça peut être agaçant. On ne compte pas les critiques et/ou sarcasmes à l’encontre de la saga, émanant généralement de gens qui ne l’ont pas lue (et même de Benoît XVI, mais lui, après tout, c’est juste un con). Face à ces tristes énergumènes, on en trouve d’autres tout aussi navrants, les fans ultimes qui ont fait la queue en cosplay pour être les premiers à lire ce dernier opus… Et puis il y en a heureusement plein d’autres au milieu, dont moi.
Ouais, j’aime bien Harry Potter. J’aime beaucoup, même. Je ne trouve strictement rien de scandaleux à ce succès, que j’estime même assez mérité, quand bien même démesuré. Franchement : pourquoi se plaindre que la sortie d’un livre devienne un événement ? A ce point, c’est du jamais vu. Ultime camouflet à des générations de pédagogues ineptes et de profs de français plus ou moins compétents, pour en rester à notre sinistre pays : il s’est bien trouvé quelqu’un pour redonner le goût de la lecture aux gamins, et c’est une Anglaise qui écrit de la fantasy. C’est certainement pas moi qui vais m’en plaindre ; bien au contraire, ça me donnerait presque envie de brûler un cierge… Tiens, acte de foi : mon cher Dieu, si tu existes, merci beaucoup pour J.K. Rowling et son apprenti sorcier ; sinon, ça montre bien qu’on peut se débrouiller sans toi.
Après, il se pourrait que Harry Potter soit effectivement nul, mal écrit, tout ça. Sauf que non. N’étant pas un fan hystérique, je lui reconnais volontiers bien des défauts : ce n’est effectivement pas très original, les derniers volumes tiraient méchamment à la ligne, et, bien souvent, j’avoue avoir nettement préféré les amusantes saynètes prenant place à Poudlard plutôt que l’histoire de chaque volume, souvent assez poussive (avec une exception, Le prisonnier d’Azkaban, qui reste clairement à mon goût le meilleur de la série), ou à la « méta-histoire » plutôt convenue et qui tendait à me laisser froid.
Mais il y a bien des qualités, au-delà. Déjà, j’avoue être fasciné par la pertinence du concept d’un héros qui grandit en même temps que ses lecteurs (pertinence à tous les niveaux, d’ailleurs ; sur le plan littéraire, la progression entre les différents volumes est à la fois nette et subtile, pour ainsi dire réalisée de main de maître ; et sur le plan mercantile, je ne peux que reconnaître cyniquement que c’est très très fort…). Au-delà, J.K. Rowling s’est montrée très astucieuse dans son recyclage des thèmes les plus éculés de la fantasy, constituant au final un univers particulier, riche et bien construit, où l’on prend beaucoup de plaisir à vadrouiller au fil des volumes. D’autant que ses romans sont bien terriblement addictifs : bien que de plus en plus longs, ils se lisent toujours avec beaucoup de plaisir, et l’on tourne les pages sans même s’en rendre compte. Il faut également reconnaître que J.K. Rowling a su créer de bons personnages, auxquels on s’identifie facilement : Harry Potter lui-même, à vrai dire, est probablement beaucoup moins intéressant que bon nombre de seconds rôles, et notamment le superbe professeur Severus Rogue. Ce qui m’amène à un point important en faveur de la saga : sa relative absence de manichéisme ; celui-ci étant le fléau d’une bonne part de la fantasy « commerciale » et a fortiori de la littérature jeunesse, l’aspect davantage « gris » d’Harry Potter (notamment dans ce dernier volume, d’ailleurs) est très séduisant et bienvenu, et confirme que J.K. Rowling ne prend pas ses lecteurs pour des cons. C’est d’ailleurs un dernier point positif que j’aurais envie d’évoquer : J.K. Rowling a su créer un univers finalement plutôt sombre et déprimant, de plus en plus violent aussi, et autorisant à l’occasion chez ses jeunes lecteurs la réflexion sur des thématiques graves, comme la présomption d’innocence, la peine de mort, le racisme, le pouvoir de la presse, la violation des libertés individuelles, la délation, la résistance à l’oppression, etc. On sent à vrai dire la militante d’Amnesty International pointer à l’occasion sous l’auteur, et pour le mieux, dans le sens où elle a le bon goût de ne verser que rarement dans le moralisme à dix balles pour favoriser bien au contraire la réflexion personnelle de ses jeunes lecteurs. Pour tout ça, chapeau.
Mais je dois reconnaître que je redoutais ce dernier volume. Etant d’un naturel pessimiste, je crains toujours d’être déçu par les choses que j’aime… Or j’avoue sans l’ombre d’un doute que, quand bien même je ne regrette pas la lecture des volumes 4 à 6, ils m’avaient paru néanmoins beaucoup moins convaincants que les trois premiers. Certes, le ton enfantin disparaissait au fur et à mesure, l’univers devenait plus sombre et violent, ce qui était positif. En même temps, j’y retrouvais moins le charme des scènes scolaires à Poudlard (sans surprise absentes de ce dernier volume, où ces petits cons anarchistes d’Harry, Ron et Hermione font très légitimement l’école buissonnière), sans que la trame de fantasy banale (et même de plus en plus banale au fur et à mesure que les poils poussaient au menton d’Harry) m’intéresse véritablement pour autant : des six premiers, seul Le prisonnier d’Azkaban me paraissait véritablement avoir une bonne histoire, encore une fois ; d’autant plus que les romans s’achevaient assez souvent (sauf celui-ci, donc) sur une queue de poisson, ne lésinant pas éventuellement sur le deus ex machina. Certes, ce n’était pas le cas pour Le Prince de Sang-Mêlé, qui avait une fin que l’on pouvait bien dire dramatique : le meurtre d’Albus Dumbledore par Severus Rogue. Et là, problème en ce qui me concerne. Que le vieux Dumbledore crève, c’était une bonne chose. Mais que Rogue (clairement mon personnage préféré, donc) soit l’assassin me laissait un peu perplexe. Je craignais la suite. Il me paraissait hors de question de ressusciter Dumbledore, comme on le voit trop souvent dans les comics, et J.K. Rowling n’a bien entendu pas joué cette carte mesquine. Mais ma véritable crainte concernait les motivations de Rogue : soit Rogue devenait résolument méchant, et c’était du gâchis, le manichéisme ressurgissant en fin de saga comme un triste passage obligé ; soit Rogue n’était pas si méchant que ça (hypothèse heureusement la plus probable), mais je souhaitais bien du courage à J.K. Rowling pour expliquer de manière crédible son attitude ambiguë…
Ben elle a réussi. Les doigts dans le nez, même. Rogue s’en retrouve encore grandi en fin de volume, devenant à certains égards le véritable héros de la saga, et, en tout cas, de très loin son plus courageux protagoniste. Le plus humain et le plus émouvant, aussi. Bref : une très grande réussite. Chapeau, une fois de plus.
Mais là, je commence un peu par la fin… Revenons donc au début de ce dernier tome. Guère attrayant, d’ailleurs, trouvé-je, avec un Rogue très méchant, zélé serviteur du cruel Voldemort, puis une scène très enfantine et à mon sens plutôt dispensable chez les agaçants Dursley, et de très nombreuses références aux précédents volumes qui m’échappaient un peu depuis le temps ; le ton change vite, ceci dit. Bientôt, Harry, Ron et Hermione, le trio inséparable (ou presque…), obéit aux dernières instructions de Dumbledore et se met en quête des Horcruxes, ces objets dans lesquels Voldemort a dissimulé son âme ébréchée, pour les détruire. Un point très intéressant, ceci dit, c’est que cette quête croise bon nombre d’histoires parallèles, tissant un maillage tout d’abord extrêmement complexe mais pourtant très limpide et cohérent à l’arrivée (trop, peut-être ? c'est un peu artificiel, parfois...) : se pose ainsi, au bout d’un certain temps, la question de ces « Reliques de la Mort » qui donnent son titre au roman, objets légendaires à l’existence douteuse, mentionnés à l’origine dans un conte pour enfant ; parallèlement, les « révélations », plus ou moins authentiques, sur le passé trouble de Dumbledore se multiplient, dressant un portrait beaucoup moins unilatéral qu’auparavant du gentil papa gâteau directeur de Poudlard. Plus tragique, enfin, voire surtout (décidément, à mon goût, le cadre l’emporte sur le récit, chez J.K. Rowling…) : Voldemort prend clairement en main les rênes du Ministère de la Magie, qui met dès lors en place une politique raciste et cruelle, visant ni plus ni moins qu’à l’éradication progressive des Sang-de-Bourbe (rebaptisés de manière très politiquement correcte « Nés-Moldus »…) ; politique qui ne suscite d’ailleurs guère d’opposition : un mince réseau de résistance constitué essentiellement des débris de l’Ordre du Phénix et, à Poudlard, de l’Armée de Dumbledore conduite par Neville Londubat (mon deuxième personnage préféré de la saga, si je dois poursuivre dans les aveux…) tente bien de réveiller l’espoir des opprimés par les émissions radios clandestines de « Potterville » et de poursuivre la lutte de mille et une manières, mais bien plus nombreux sont ceux qui se terrent dans une lâche indifférence, ou, pire encore, dans la collaboration éhontée, à base de délation et de chasse au « sang impur ». Il y a bien du Vichy dans cette Angleterre des sorciers, réaliste et horrifiante… De quoi méditer, en somme.
Et tout ça fonctionne terriblement bien, une fois de plus. Si le roman, de même que les deux précédents volumes, aurait à mon avis gagné à être un peu écourté, il se lit néanmoins avec un plaisir constant, voire grandissant au fur et à mesure que la résolution de la saga approche. On n’a pas envie de refermer le roman, on se dit que, décidément, c’est bien ennuyeux d’avoir à dormir des fois, ou à manger aussi, que l’on perd du temps de la sorte quand tout ce qui compte est la destinée d’Harry Potter. Le retour à Poudlard, après bien des scènes remarquables et éventuellement cruelles (les scènes d’action sont parfois franchement impressionnantes, ainsi pour l’évasion du 4, Privet Drive, l’intrusion dans le Ministère ou le cambriolage de Gringotts, scènes vraiment haletantes) laisse présager une bataille épique entre le bien et le mal (mais avec beaucoup de nuances, fort heureusement), parfaitement bien menée et captivante.
Ce qui me fait penser, tiens : on a beaucoup glosé sur les morts de ce dernier volume. On a même fait des paris… Bon, sans surprise, ni Harry, ni Ron, ni Hermione ne meurent ; je ne souhaitais pas pour ma part la mort d’Harry (ce qui lui aurait donné une tonalité trop christique, franchement pas appropriée…). Ron ou Hermione, par contre, peut-être… Bon. Mais je dois dire qu’à ce niveau on a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose, la plupart des décès de cet ultime opus (assez nombreux, il faut bien le reconnaître) ne concernant que des personnages secondaires, aussi réussis soient-ils (Fol-Œil et Lupin, notamment). Un bon point à nouveau, ceci dit : la mort la plus marquante est incontestablement celle du sympathique Elfe de maison (non, Elfe libre, d’ailleurs…) Dobby. Une scène très touchante. Et il ne faut pas oublier, dans cette optique, la mort absurde de Rogue, éclairée a posteriori par les révélations de la Pensine ; on a pu trouver le procédé artificiel, mais ce n’est pas mon cas : j’aime ce personnage, nom de Lui…
Inutile d’épiloguer. Enfin, si, d’ailleurs, puisque épilogue il y a. Manière pour l’auteur, sans doute, et en dépit des nombreuses pressions en sens inverse, de mettre un terme bienvenu, quand bien même tout gentil mignon, à sa saga.
On pourra donc dire ce que l’on voudra d’Harry Potter et de son incommensurable succès. Pour ma part, j’y ai vu une série parfaitement attrayante et tout à fait estimable, un très bon divertissement et même un peu plus que ça, dont Harry Potter et les Reliques de la Mort constitue sans doute la meilleure conclusion que l’on pouvait espérer. Les amateurs ne seront pas déçus. Moi, en tout cas, j’ai passé un excellent moment à la lecture de ce pavé. Et j’attends désormais avec curiosité la carrière ultérieure de J.K. Rowling, qui pourrait nous apporter encore bien des bonnes choses. C’est tout le mal que je lui souhaite.



/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)







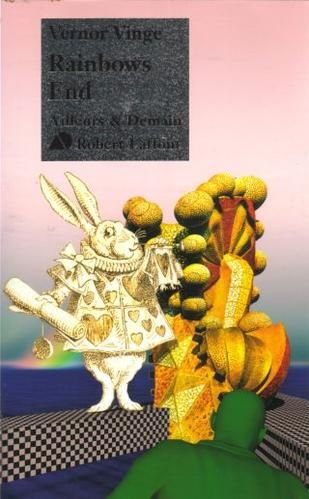



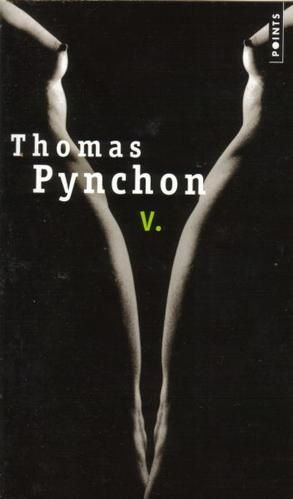

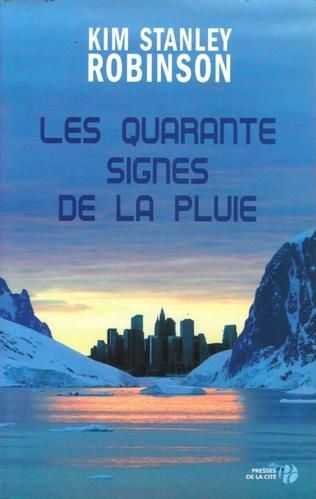







/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)