"L'Empire du Baphomet", de Pierre Barbet

BARBET (Pierre), L’Empire du Baphomet, Paris, J’ai lu, 1977, 157 p.
ATTENTION : ce compte rendu va débuter par une longue phase « 3615 MyLife », pour reprendre l’expression obsolète consacrée. Vous êtes prévenus.
…
Aaaaaaaaaaaaah, les Templiers ! Je partage avec bon nombre d’imbéci… de gens une bizarre et pourtant si commune passion pour le fameux et mystérieux ordre de moines-soldats, de sa création par Hugues de Payns (ici orthographié « Payn ») à la mort sur le bûcher du dernier Grand-Maître Jacques de Molay… et au-delà, mouhahaha.
Cette lubie doit remonter, je suppose, à ma lecture et relecture quand j’étais tout minot de L’Histoire de France en bande-dessinée, qui était alors mon œuvre de prédilection et décida de bien des choses au cours de ma vie ; cette histoire « à l’ancienne », riche en anecdotes édifiantes, m’a fait une forte impression, et j’en conserve encore aujourd’hui bien des souvenirs, sous forme d’images marquantes ; pour ce qui est de l’histoire du Temple, j’en retiens surtout deux : la mort de Guillaume de Beaujeu le 8 mai 1275 à Saint-Jean-d’Acre en défendant la Tour Maudite, et plus encore la malédiction prononcée par Jacques de Molay en 1314 sur le bûcher de l’île aux Juifs (aujourd’hui le square du Vert-Galant, au bout de l’île de la Cité, où je vais de temps à autre faire mon pèlerinage). Déjà, cette première lecture m’avait étrangement enthousiasmé pour les Templiers et le mystère de leur procès (affaire lancée en 1307 par Philippe le Bel), et de tout ce qui s’ensuit : la malédiction, donc, mais aussi le fameux « trésor », la survivance éventuelle chez les Francs-Maçons, etc. Où l’ésotérisme vient assez rapidement se mêler à l’histoire…
L’étape suivante, ce fut inévitablement Les Rois maudits de Maurice Druon, saga constituant à mes yeux le roman historique par excellence, et que j’ai dévorée et re-dévorée (d’ailleurs, je tenterais bien un jour une troisième lecture… faut voir).
Et puis il y eut, cette fois, le thriller ésotérique par excellence, ou pas tellement il est hors-catégorie et surclasse avec élégance, finesse et érudition toutes les abjectes soupes qui affichent cette étiquette, à savoir Le Pendule de Foucault d’Umberto Eco, là encore dévoré et re-dévoré (et là aussi, peut-être qu’une troisième lecture…). Il y a tout, dans ce roman, le plus sérieux comme le plus absurde, mêlé avec un brio narratif sans pareille par l’auteur du Nom de la rose. Et ce fut en ce qui me concerne le point d’orgue de mon obsession templière : je me mis à lire tout et n’importe quoi dès l’instant que ça parlait du Temple (y compris les plus douteuses des publications : je me souviens notamment d’une revue bidon liée aux Rose-Croix de l’AMORC, lui-même lié au sinistre Ordre du Temple Solaire…), et fis à l’occasion quelques pèlerinages, déjà ; aujourd’hui encore, mon porte-clefs, acheté il y a des années à Domme, représente le sceau des Templiers (oui, celui avec les deux tarlouzes sur un seul canasson).
C’est bête, une passion. Qu’est-ce que j’ai pu lire comme conneries sur le Temple, à cette époque ! Et, au final, la question se pose toujours, dans un sens : coupables ou non-coupables, les moines-soldats ? Adoraient-ils vraiment l’étrange divinité appelée « Baphomet » ? C’est peu probable, certes ; le procès des Templiers, peut-être le premier exemple de ces grands procès politiques qui m’ont tant intéressé, tient à bien des égards de la mascarade judiciaire orchestrée par Philippe le Bel et son fidèle Guillaume de Nogaret, avec la complicité plus ou moins volontaire du pape Clément. Les accusations de ce genre, de même que celles de sodomie, étaient un lieu commun de l’époque. De même, le fameux « trésor caché » n’a très probablement jamais existé. Quant à la survivance du Temple, au-delà de certaines revendications maçonniques ou rosicruciennes pas vraiment crédibles, elle est de toutes façons attestée dans d’autres pays européens, où l’Ordre, loin de subir le triste sort qui fut le sien en France, se contenta à peu de choses près de changer de nom… Je suis bien conscient de tout cela, mais la fascination reste… même si je ne suis plus aujourd’hui à même de lire n’importe quoi sur le sujet.
Ou presque…
FIN DU 3615 MYLIFE.
Aussi, il était inévitable qu’un jour ou l’autre je lise L’Empire du Baphomet de Pierre Barbet, souvent présenté comme un « classique » de la science-fiction française (mais on aura l’occasion d’y revenir…), et dont je me souvenais avoir lu une chronique rigolote chez l’ami cafard Yossarian. La lecture récente de La Science-fiction en France de Simon Bréan m’a décidé à sauter le pas, et j’ai sorti le court roman de ma commode de chevet où il prenait la poussière dans sa réédition chez J’ai lu (sous une couverture comme d’hab’ indicible de Caza ; le roman a été originellement publié au Fleuve Noir « Anticipation »).
L’histoire commence en octobre 1118 en France. Le chevalier Hugues de Payn, lors d’une chasse en solitaire, fait une étrange découverte : celle d’un vaisseau spatial échoué sur notre bonne vieille Terre… À son bord, une étrange créature d’apparence démoniaque, de la race des Baphomets. Ladite créature bénéficie (donc) d’une technologie très avancée, a fortiori pour un chevalier français du début du XIIe siècle. Et elle propose à Hugues de Payn d’en bénéficier, en échange de vivres lui permettant de subsister jusqu’à ce qu’elle puisse réparer son vaisseau… Hugues, d’abord un peu méfiant devant la bestiole cornue, accepte le marché (très vite…), et se plie à ses volontés : c’est ainsi qu’il crée un ordre de moines-soldats, destiné à terme à régner sur un empire sans pareil, le Baphomet lui en a fait serment. Longtemps, l’extraterrestre se contente d’aider le Temple en lui fournissant d’amples réserves d’or, et des statuettes à son effigie qui sont en fait des appareils de communication.
Mais les choses changent en 1275, alors que le Grand-Maître est Guillaume de Beaujeu (voir plus haut). Cette fois, le Baphomet fournit au Temple des « grenades atomiques », armes d’une puissance sans commune mesure, capables à elles seules de bouleverser le cours des batailles. C’est ainsi que Guillaume et ses compagnons, bien loin de finir leurs jours lors du siège de Saint-Jean-d’Acre, font une sortie et écrasent littéralement l’armée pourtant bien plus nombreuse de Baïbars.
Mais ce n’est pas fini : encouragé par le Baphomet, Guillaume de Beaujeu se lance dans une gigantesque entreprise de conquête, qui l’amènera à batailler bien au delà de la seule Terre Sainte, en Mésopotamie, puis jusqu’en Cathay, sous la domination du légendaire Qoubilaï Khan (là encore, j’adopte l’orthographie de l’auteur) ! Et de constituer ainsi un empire tel que la Terre n’en a jamais connu, plus vaste encore que celui du païen Alexandre le Grand… Mais Guillaume se méfie quelque peu du Baphomet… et à juste titre.
Voilà, en gros, pour le pitch. On pourra donc qualifier, après un départ relevant de l’histoire secrète, L’Empire du Baphomet d’uchronie. Mais, en pratique, on pourrait tout aussi bien le résumer par un seul mot : BASTON ! Ça se latte du début à la fin ou presque (et c’est du coup un peu lassant, même sur une aussi courte distance). On va de bataille en bataille, avec de temps à autre (heureusement) quelques conseils de guerre et, surtout (c’est le plus intéressant), des discussions « scientifiques » (ou alchimiques…) concernant la nature et l’utilisation des objets fournis par le Baphomet et la possibilité, éventuellement, de les reproduire. Car Guillaume ne bénéficie pas d’un stock illimité de grenades atomiques… Pour le reste, Barbet applique de manière très professionnelle un schéma récurrent : on-se-lance-dans-une-entreprise-folle, les-difficultés-s’accumulent-et-ça-geint-dans-les-rangs (notamment avec les personnages supposés gouailleurs que sont les frères Tholon), la-bataille-décisive-s’engage-mal, mais-ouf-grâce-aux-armes-du-Baphomet-et-à-une-brillante-stratégie-les-Croisés-l’emportent. Répétitif, donc.
Ce qui n’empêche pas L’Empire du Baphomet d’être plutôt rigolo et, malgré tout, distrayant, surtout si l’on est bon public. Mais bon, faut pas pousser mémé dans les orties : je me souviens d’un fil édifiant d’ActuSF où ledit roman était qualifié de « chef-d’œuvre de la science-fiction française », c’est quand même n’importe quoi. Au mieux, L’Empire du Baphomet est un roman de gare honnête ; au pire, il a tout de même quelque chose d’un peu (un peu ?) ridicule, a fortiori aujourd’hui (le roman a pris un coup de vieux), notamment du fait de son accumulation de clichés, de ses personnages bien falots, de son style médiévalisant guère convaincant (sans parler de l’accent suisse à couper au couteau d’Otto de Granson, chef des croisés anglais, et des populasseries de deux des trois Tholon…) et, surtout, oui, j’y reviens encore, de sa trame ultra-prévisible car ultra-répétitive.
Quant à la fin, c’est peu de dire qu’elle n’est pas satisfaisante (mais les contraintes de publication au FNA n’y sont sans doute pas pour rien), tant elle relève à la fois de la queue de poisson et du deus ex machina. Et le roman appelle de toute évidence une suite, Croisade stellaire, si j’ai bien tout compris. Je ne sais pas si je la lirai un jour, c’est peut-être un peu de la perversion…
…
Mais en même temps, si y a des Templiers dedans…
…
GLOIRE AU BAPHOMET !

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



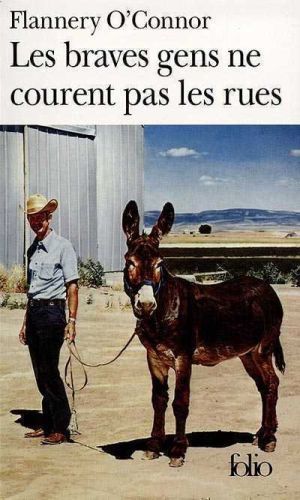

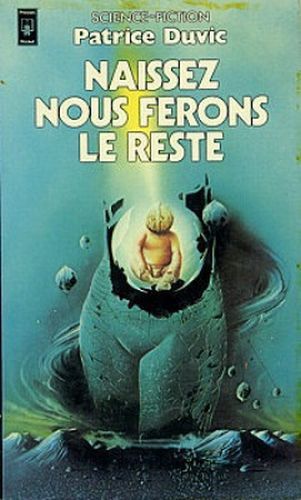

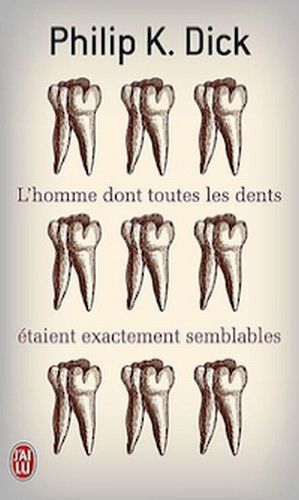







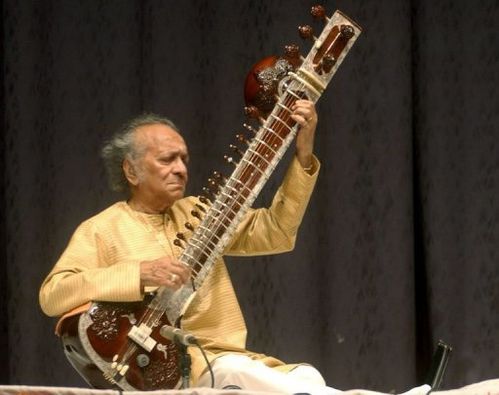



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)