"Nouvelles du Disque-monde", de Terry Pratchett

PRATCHETT (Terry), Nouvelles du Disque-monde, traduit de l’anglais par Patrick Couton, Nantes, L’Atalante, coll. La Dentelle du cygne, [1992-1993, 1998, 2004-2005, 2007] 2011, 124 p.
Terry Pratchett n’est à l’évidence pas un nouvelliste. Son œuvre abondante est constituée pour l’essentiel, et de très loin, de romans – je ne vous apprends rien. Lui-même s’est expliqué à ce sujet :
« Les nouvelles me coûtent sang et eau. J’envie ceux qui les écrivent avec facilité, du moins ce qui ressemble à de la facilité. Je serais étonné d’en avoir écrit plus de quinze dans ma vie. »
On peut en tout cas chiffrer celles qui se rattachent à l’univers des « Annales du Disque-monde » : il y en a six, et elles sont toutes présentes dans ce très petit volume qui tranche donc passablement sur le reste de la production disque-mondiale. Six nouvelles, c’est tout ; dont une qui, à elle seule, fait la moitié du bouquin. En plus de trente ans d’écriture, c’est effectivement peu…
Voyons voir un peu ce que ce petit recueil a à nous offrir, malgré tout – eh : en bon lecteur fanatique, je ne pouvais pas décemment passer à côté. Et puis ma seule expérience avec Pratchett nouvelliste, à savoir « Drame de troll » (texte qui conclut ces Nouvelles du Disque-monde, mais avait en son temps été édité sous la forme d’une plaquette dont j’ai récupéré je ne sais combien d’exemplaires…), avait été plutôt positive. C’est donc avec curiosité que j’ai entamé ce bouquin hors-normes, qui promettait d’être vite plié, mais qui pouvait néanmoins contenir quelques surprises.
…
Le fait est que ça commence mal. Les premiers textes, très courts, sont à peu de choses près sans intérêt. « Rejet par l’Université de procédés diaboliques » aurait pu offrir une intéressante satire du monde universitaire, qui perce par endroits, mais le texte n’en est pas moins franchement raté, et on en ressort plus que perplexe : on sent effectivement Pratchett très mal à l’aise dans ce format, et on craint pour la suite…
« La Mort et tout ce qui s’ensuit » n’est guère plus convaincante : petite variation sur le chat de Schrödinger et plus puisque affinités, ce très court texte permet peut-être vaguement d’esquisser un sourire, mais guère plus. Sans intérêt une fois encore.
« Minutes de la réunion en vue de concrétiser le projet de fédération de scouts d’Ankh-Morpork » est heureusement un peu plus réussie : cette fois, si on ne va pas jusqu’à rire, on sourit plus franchement, et le format court est bien adapté au fond. On peut donc être bon prince, et y voir un succès.
Suit « La Mer et les petits poissons », de très loin la plus longue nouvelle du recueil, puisqu’elle en occupe environ la moitié. Cette nouvelle, exceptionnellement écrite de manière « spontanée », figurait dans l’anthologie de Robert Silverberg Légendes. Elle met en scène nos très chères sorcières, et principalement Mémé Ciredutemps et Nounou Ogg. La première est considérée comme indésirable aux prochains Jugements des sorcières (parce qu’elle gagne tout le temps). Cela va sans dire : sa vengeance sera terrible… Très correct, heureusement. Pas transcendant pour autant, mais amusant, et c’est déjà ça.
« Le Théâtre de la cruauté » est une brève variation sur Punch et Judy, sous la forme d’une enquête de Carotte. Honnête, allez, mais sans plus.
Reste enfin « Drame de troll », que je connaissais donc déjà, mais que j’ai relu avec plaisir. Cette nouvelle impliquant le légendaire Cohen le Barbare est très satisfaisante, et séduit par sa nostalgie aigre-douce du bon vieux temps où il y avait un troll sous chaque pont. Je pense très sincèrement que c’est le texte le plus abouti de ce petit recueil… ce qui n’est pas sans poser quelque problème, puisque je le connaissais déjà.
Aussi suis-je tenté de conclure ce compte rendu par où je l’ai commencé : non, Pratchett n’est à l’évidence pas un nouvelliste… La lecture de ce petit recueil le confirme : on le sent régulièrement mal à l’aise dans ce format étroit, et l’on comprend d’autant mieux l’inflation de ses romans, assez sensible au fil du temps. Je ne peux donc pas véritablement recommander ces Nouvelles du Disque-monde, souvent bancales, et tout juste amusantes (au mieux). Sans être véritablement mauvais, ce bref recueil se montre peu convaincant, et on peut légitimement renâcler à lâcher 10 € pour ça… à moins d’être un authentique fan décérébré dans mon genre, bien sûr. À bon entendeur…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



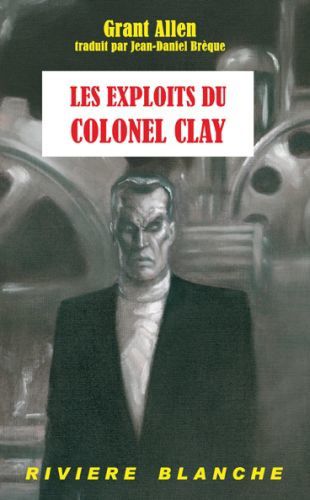




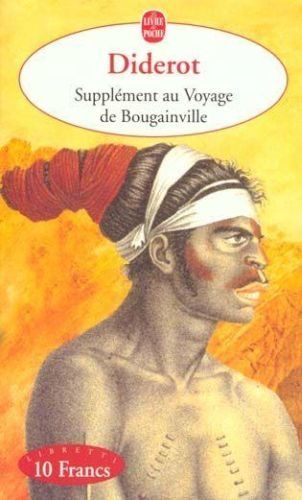

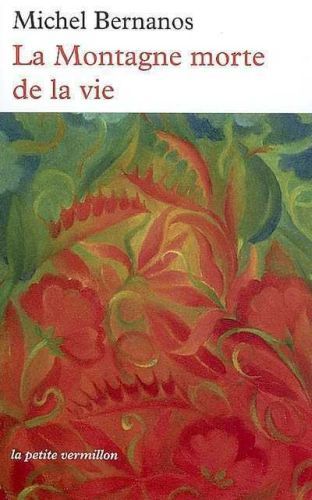







/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)