FOUILLER LE KOFUN
Ces dernières années, même s’il demeure une production contemporaine non négligeable, j’ai tout de même le sentiment que Mnémos a abordé un certain tournant patrimonial en opérant nombre de rééditions, essentiellement dans le genre fantasy qui lui est globalement associé, et souvent sous la forme d’omnibus pesant leur poids. Une entreprise parfois salutaire : citons par exemple, hors CF, l’intégrale d’Imaro, de Charles R. Saunders, et c’était une putain de bonne idée (et pour le coup je crois me souvenir qu’il y avait une part d’inédit ?). Dans d’autres cas, c’était sans doute bien moins heureux : oui, Brian Lumley, par exemple…
L’entreprise, si c’est bien de cela qu’il s’agit, se poursuit aujourd’hui, éventuellement sous une forme un peu différente, car au travers de la collection « de poche » Hélios, que se partagent les trois Indés de l’Imaginaire. Sauf que de format « de poche », ici, il n’en est pas vraiment question, avec ce volume un peu le cul entre deux chaises, pesant tout de même ses 610 pages relativement tassées – comprenant quatre romans, outre un peu de contenu additionnel inédit tout à fait bienvenu.
Et, pour le coup, cette réédition porte sur des textes sans doute un peu obscurs, et qui méritaient bien qu’on les exhume : quatre (courts) romans composant le cycle du Jeu de la Trame, écrits par le couple Sylviane Corgiat et Bruno Lecigne, et publiés entre 1986 et 1988 dans la forcément mythique collection Anticipation du Fleuve Noir – forcément mythique, oui, mais pas forcément prévue pour assurer la perpétuité à ses publications, au cycle de commercialisation bien particulier… Aussi bien des livres de valeur ont-ils pu être oubliés, dans ce contexte ?
Éventuellement des livres assez inattendus, d’ailleurs – ce dont Le Jeu de la Trame témoigne à sa manière, ne serait-ce que parce qu’il ne s’agit en fait pas du tout d’anticipation, mais bien de fantasy ; et une fantasy qu’on dira « japonisante », ce qui, alors, n’était probablement guère commun. Quatre romans, par ailleurs, dus à un duo d’auteurs qui s’est exercé dans bien des registres différents, incluant semble-t-il un imaginaire assez léché, sous forme de nouvelles, et d’autres publications plus populaires, des polars par exemple – et sans doute les quatre présents romans, cependant conçus avec une application notamment stylistique qui fait mentir les préjugés affligeant toujours, plus ou moins consciemment, la littérature populaire.
Je n’en avais jamais entendu parler, de tout ça – ce qui, en soi, n’a rien d’étonnant : j’étais un mioche quand ces livres ont été publiés, et, même plus tard, ado, je n’ai finalement que très peu fréquenté le FNA (le Fleuve, pour moi, c’était alors essentiellement des licences rôlistiques, Donjons et Dragons surtout, avec des couvertures flashouilles qui faisaient mes délices, et souvent du prêt à consommer, et que je consommais volontiers, même en ayant à l’esprit que ce n’était « probablement pas très bon », le cas échéant). C’était de toute façon depuis longtemps bien trop tard pour revenir sur le « vrai » FNA, ces livres certainement pas voués à demeurer éternellement dans les rayonnages de la librairie de province lambda.
Mais je dois dire que j’ai été curieux, à l’annonce de cette réédition de romans dont je ne savais rien (et des auteurs pas davantage). Faut dire, c’était un peu me prendre par les sentiments, en cette période où le mot « Japon » suffit parfois à m’inciter à faire péter la carte bleue (qui ne peut pas du tout se le permettre)… La quatrième de couv’, exercice périlleux, a renforcé cette curiosité, et quelques (rares mais enthousiastes) retours çà et là m’ont incité à tenter l’expérience.
Et je ne le regrette pas, parce que, pour expédier la chronique TL;DR, tout ceci était vraiment très sympathique – rien d’inoubliable sans doute, mais un divertissement bien foutu, bien écrit, qui se lit avec un plaisir toujours renouvelé où une certaine audace a sa part, faisant dès lors plus que remplir méthodiquement le cahier des charges ; ça vaut bien mieux que ça. Non, ce n’est pas indispensable ; mais on s’en fout – c’est très chouette.
Bon, tentons quand même de creuser un peu – on a embarqué la pelle dans le kofun, c’est pas pour rien…
JAPONISANT ?
Commençons peut-être par ce qui constitue probablement l’accroche essentielle de ce cycle ? Ou, en tout cas, ce qui l’a constitué pour moi… La dimension « japonisante », donc (pour l’essentiel ; mais, côté Asie, il y a aussi des emprunts marqués à la Chine, à la Mongolie… mais aussi d’autres choses encore, louchant sur le grand nord, probablement bien au-delà d’Hokkaidô).
Précision d’emblée : ces romans ne se déroulent certainement pas au Japon – et même quand on parle d’un « japon médiéval parallèle », il y a risque d’induire en erreur. Non : nous sommes ici dans un monde totalement imaginaire – un de ces « mondes secondaires » qu’affectionne la fantasy, carte incluse (il y en a une ici, hélas pas forcément bien placée, hélas aussi et surtout pas très rigoureuse et dès lors inutile ?). Simplement, ce monde autre a au moins un vernis nippon – et peut-être plus que ça, c’est à débattre. Je n’ai jamais pratiqué Legend of the Five Rings, sous quelque format que ce soit (d’abord un jeu de cartes, ça tombe bien), mais je suppose à vue de nez que l’on pourrait dès lors faire la comparaison avec Rokugan, quelques années plus tard.
Ce vernis, au stade minimal, passe sûrement tout d’abord par les noms propres – qui, à défaut d’être toujours japonais (certains le sont), sonnent du moins japonais. Notre « héros » se nomme Keido, sa sœur Kirike, et on croise, dans le désordre, un Yumi, une Naoyame, un Otomo, un Ayashi, un Soga… Ces noms sont régulièrement l’occasion d’allusions explicites à quelques figures notables de « notre » Japon – Sôseki aussi bien que Hiroshima ; et quelques personnages, au-delà de leur nom, font plus qu’à leur tour penser à des modèles bien réels, comme Hokusai ou Hiroshige.
Ça ne fait pas tout – si ça fait quelque chose. Finalement, en opposition avec ce que ce procédé peut avoir d’un peu « brutal », la dimension japonisante du Jeu de la Trame relève surtout de détails générateurs d’ambiance ; ce qui, dans le cadre de cette intégrale, dépasse les seuls romans, entourés de haïkus qui m’ont semblé pas dégueu (mais bon : je ne suis vraiment pas une référence…), et poursuivis par d’intéressantes annexes.
Dans le cadre des romans, au-delà du sabre régulièrement sorti de son fourreau, il y a ainsi des petites touches, dans les vêtements, l’architecture, les arts – mais aussi, à ce compte-là, la philosophie, la manière de voir le monde, peut-être aussi certaines coutumes, le comportement de tel ou tel personnage en fonction de sa caste ; probablement enfin des allusions, généralement discrètes juste ce qu’il faut (même si certaines sont moins discrètes), à tel ou tel livre, tel ou tel film…
L’ambiance est bien un atout notable du Jeu de la Trame. Cependant, je crois qu’il y a certaines limites à la dimension japonisante du cycle – que j’ai surtout sentie, ou peut-être trouvée convaincante et enthousiasmante, dans le premier roman, et dans le dernier : le deuxième et le troisième ne sont pas sans qualités, mais je crois que, dans leur cas, on ne va guère au-delà du vernis, donc, pour finalement livrer une fantasy somme toute assez classique et libérée de ce référent culturel supposé fondamental. Il y a toutefois, dans le deuxième roman surtout, suffisamment de petites exceptions çà et là pour me faire mentir.
UNE PARTIE DE CARTES
Donnons un aperçu de l’histoire. Et même d’abord de l’Histoire, avec le grand H qui va bien – même si, comme de juste, tout ceci est censé demeurer assez flou jusqu’à la toute fin. Disons du moins qu’il y a eu, il y a bien longtemps de cela, un mythique empereur du nom de Soga, qui a fait bâtir une immense Muraille de Pierre pour séparer les Terres Fertiles, au nord, des Terres de Cendre, au sud : un enfer au parfum d’apocalypse, où les hommes désespérés livrent toute leur courte vie un combat parfaitement vain contre un environnement meurtrier – au nord, on redoute toujours que le Mal de Feu traverse la muraille, mais, gloire à Soga et à ses architectes, cela n’a pour l’heure jamais été le cas.
L’histoire de Soga et de la Muraille de Pierre, tout le monde dans les Terres Fertiles la connaît. Certains croient en savoir davantage – qui ont eu vent de l’existence du Jeu de la Trame, un jeu de 39 « cartes » (en fait des carrés de tissu), dont chacune a été attribuée à un seigneur vassal de Soga ; et l’empereur confiait auxdits seigneurs la garde des 39 Portes qui émaillent la Muraille de Pierre (et qui sont appelées la Première Porte, la Deuxième Porte, etc.). Or chaque carte conférait un pouvoir magique unique. Il y a bien longtemps de cela, les seigneurs dévorés par l’ambition se sont affrontés pour rassembler les cartes, lors d’une terrible et tragique guerre où personne n’a gagné – mais ce n’est plus qu’un lointain souvenir, et encore, pour les rares qui s’en souviennent… Ils sont encore moins nombreux à soupçonner l’existence du Jeu de la Trame – et à supposer que ces cartes existent encore, simplement égarées ; et qu’un homme habile et avisé pourrait peut-être les rassembler, pour acquérir un pouvoir hors du commun – divin, au fond, tel celui de Soga lui-même…
Notre « héros » (je reviendrai juste après sur ces guillemets…) se nomme Keido, et il est le personnage point de vue de la majeure partie du cycle (bizarrement, le quatrième roman, surtout au début, rompt avec ce principe). Keido est de la Caste des Guerriers, il est le fils du seigneur du Manoir du Roseau, dans le Pays des Collines (les toponymes sont généralement très prosaïques dans l’ensemble du cycle) – et il est fou amoureux… de sa sœur, Kirike. Laquelle se suicide après avoir été violée par leur père… Keido, fou de chagrin, cherche à réparer l’irréparable : il prend en considération la légende du Jeu de la Trame, comprend que le Manoir du Roseau n’est pas le plus mal loti à cet égard, et part en quête de l’intégralité du jeu – supposée conférer le pouvoir absolu : le pouvoir, donc, de ressusciter Kirike ! Keido quitte le manoir dans un grand bain de sang – sa manière, sans doute, de brûler les navires pour s’interdire tout retour en arrière. Il va parcourir les Terres Fertiles (et au-delà ?) en quête des 39 cartes : chaque roman lui fournira l’occasion de mettre la main sur plusieurs d’entre elles, accroissant d’autant son pouvoir de sorcier, au point où la possibilité qu’il s’empare bel et bien de l’ensemble, si risible au départ, devient de plus en plus tangible…
TOUS DES AFFREUX (SALES ET MÉCHANTS) !
Et là, un point essentiel : Sylviane Corgiat et Bruno Lecigne ne font certainement pas dans la fantasy manichéenne, et même la moralité bien plus relative des héros de sword’n’sorcery a quelque chose d’un peu timoré ici…
Disons-le : notre « héros », Keido, est un GROS CONNARD. Narcissique, égoïste, ambitieux, fourbe, menteur, cruel, mesquin, traître, lâche, pervers, j’en passe et des pires… Ce n’est pas simplement une crapule, comme la fantasy en a beaucoup produit (et d’excellents par ailleurs), en se « darkisant » : c’est vraiment un personnage détestable à tous points de vue. Au fil des quatre romans, il commet les pires saloperies sans l’ombre d’un remord, et régulièrement sans que cela soit nécessaire non plus – simplement parce qu’il le peut et qu’il en a envie. C’est un GROS CONNARD, une enflure, une ordure, etc. Le bain de sang inaugural, quand Keido quitte le Manoir du Roseau, en témoigne assez, très vite, mais les exemples ne manqueront jamais dans les pages suivantes.
Par ailleurs, on n’envisagera certainement pas sa relation avec sa pauvre sœur Kirike comme une « geste amoureuse et romantique » : seuls comptent les désirs de Keido, qui n'est pas homme à avoir vraiment des sentiments – il n’est probablement pas en mesure d’apprécier ceux de Kirike, de toute façon, mais sans jamais se poser la question. Et le thème de l’inceste, d’emblée, même à s’en tenir à la seule masturbation, l’obsession de la fillette (?), contaminent l’érotisme du cycle d’une certaine perversion, qui demeurera jusqu’à la fin – les scènes de sexe sont brèves mais récurrentes dans l’ensemble du cycle, et elles ont le plus souvent ce petit quelque chose qui met un peu mal à l’aise ; ne serait-ce, à titre d’exemple, que la compulsion de Keido l’amenant à copuler avec des simulacres de sa défunte sœur…
En fait, même avec ce que le thème implique de vaguement pervers, cette dimension n’est pas en tant que telle une raison valable pour condamner le personnage, bien sûr – mais, rassurez-vous, il ne cesse de nous en donner de bien plus convaincantes, au fur et à mesure qu’il enchaîne les saloperies au cours de sa quête, dont le véritable motif, plus ou moins conscient, est bien la soif du pouvoir absolu (vous savez : celui qui corrompt absolument).
Il est cependant une chose cruciale, même si elle n’excuse rien : c’est que, dans l’ensemble du cycle, tous les personnages, bien au-delà du seul Keido, sont plus affreux les uns que les autres. Ils sont tous des enflures, des collections de défauts et de vices, et il n’y en a pas un pour rattraper l’autre – pas un seul. Même les personnages qui, au premier abord, semblent pouvoir rédimer un brin le monde, s’avèrent en définitive d’autres variations sur le principe du GROS CONNARD.
Très sincèrement : de la première à la dernière ligne, je ne crois pas avoir rencontré un seul personnage que l’on pourrait qualifier de « positif », même avec les guillemets de rigueur. Pas dit, au fond, que Keido soit vraiment pire… Même si son pouvoir de plus en plus démesuré lui offre des occasions de nuire inaccessibles au détestable quidam. Ce qui peut avoir son importance, eh.
À titre personnel, cette approche très noire, très nihiliste, misanthrope à fond les ballons, amorale, me convient tout à fait. Je suppose que cela ne sera pas forcément le cas de tout le monde, et n’ai rien à y redire : effectivement, si vous ne jurez que par les héros, les personnages positifs, et le bon droit qui triomphe, l’eucatastrophe et les aimables aigles même un peu tardifs, mieux vaut pour vous lire autre chose que Le Jeu de la trame.
UN PEU DE FORMULE, MAIS BEAUCOUP D’EFFICACITÉ
Sur cette base, Sylviane Corgiat et Bruno Lecigne livrent quatre romans qui se doivent d’obéir à certains canons de la collection Anticipation : ils sont courts, mais, sur ce format, ils doivent être denses et rythmés – ils le sont.
Même si c’est parfois un peu au prix de la formule ? Dans les quatre romans, on peut dégager une sorte de schéma, même si jamais totalement déterminant (le quatrième roman, notamment, outre la question du point de vue envisagée plus haut, a des singularités à cet égard) : Keido apprend où trouver des cartes supplémentaires du Jeu de la Trame, longue et minutieuse préparation, grosse scène d’action finale, assez brève mais très efficace (ou, dans le dernier roman, changement complet de perspective), fin. C’est assez répétitif, mais suffisamment bien fait pour que ça ne porte pas à préjudice.
Le rythme peut certes paraître un peu étrange, en plusieurs occasions, mais c’est aussi, je suppose, que les auteurs composent franchement avec les impératifs de publication : il faut aller à l’essentiel. Dès lors, même si la préparation de l’ultime scène de chaque roman prend son temps, elle ne s’embarrasse jamais de superflu, et pratique volontiers l’ellipse – dans les deux premiers romans, Le Rêve et l’Assassin et L’Araignée (prix 1987 du Titre Quand Même Pas Hyper Bandant), c’est tout particulièrement sensible au regard des voyages accomplis par Keido : il y traverse peu ou prou les Terres Fertiles en l’espace d’un ou deux paragraphes, après quoi le rythme redevient plus posé, mais toujours concentré sur l’objectif final. C’est un peu déconcertant, mais peut-être pas plus mal, au fond… Le troisième roman, Le Souffle de cristal, est différent, car le voyage en est justement l’objet.
Reste, à cet égard, le cas du dernier roman, Le Masque d’écailles… où c’est la conclusion du cycle qui pose problème. Après les événements constituant le cœur du récit, paf, d’un seul coup ou presque, les auteurs nous amènent à tout autre chose – La Grande Révélation du Secret Derrière Tout Ça. Celle-ci n’est pas inintéressante, et je ne la crois pas forcément bâclée, comme j’ai pu le lire, mais, par contre, elle est indéniablement précipitée : l’ellipse, cette fois, appuie sur le défaut de rythme, elle n’est même plus un cache-misère à ce stade – et ça, c’est vraiment dommage. L’ultime impression, à cet égard, est donc plus que frustrante ; même si je suppose que l’on n’a pas à se plaindre : le cycle a une conclusion, ce n’était peut-être pas gagné d’avance…
Il a heureusement d’autres atouts pour lui – et le style y a sa part : l’écriture à quatre mains produit ici quelque chose de plus que satisfaisant, il y a une âme dans tout ça, une certaine poésie le cas échéant, de saisissantes visions aussi, à la force d’évocation admirable.
Le vernis japonisant ne tient pas toujours, à cet égard, mais il y a bien en dessous une fantasy de la plus belle eau, parfois plus inventive qu’elle n’en a l’air, avec son ambiance soignée, et, tranchant sur une certaine abstraction de principe pas malvenue, son caractère presque « ethnographique » parfois, mais toujours de manière futée – un exotisme vancien, et une toile de fond qui pourrait évoquer Ursula K. Le Guin.
Et tout cela dans quatre romans qui se veulent divertissants, et qui le sont. Le populaire a sa noblesse. Belle idée, donc, que de rééditer ce cycle, qui mériterait sans doute d’être bien davantage connu.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





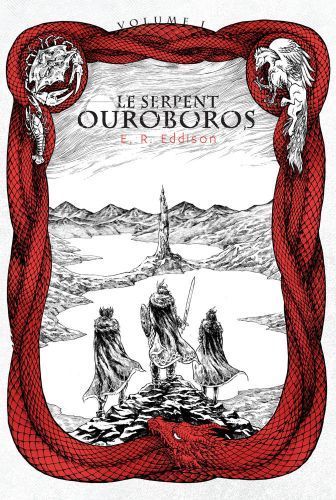

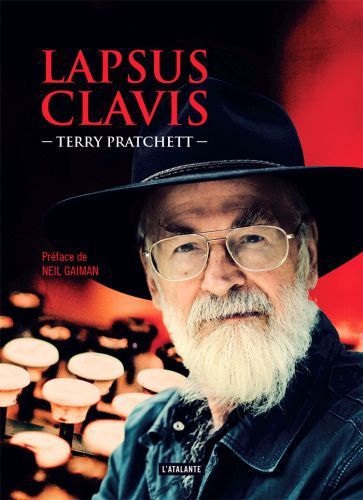





/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)