"La Nuit des morts-vivants", de George A. Romero
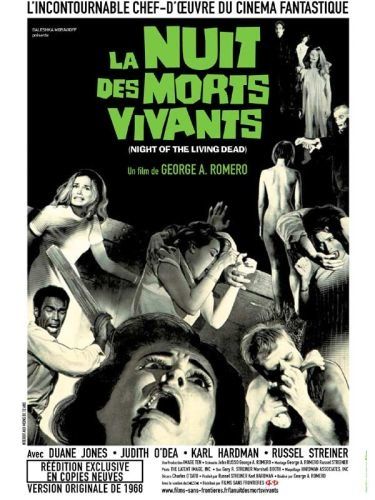
Titre original : Night of the Living Dead.
Réalisateur : George A. Romero.
Année : 1968.
Pays : États-Unis.
Genre : Horreur / « Gore » ? / Science-fiction ? / Fantastique ?.
Durée : 96 min.
Acteurs principaux : Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Hardman, Marilyn Eastman…
Il y a peu, ma curiosité malsaine et quelque peu perverse m’a poussé à faire l’acquisition du roman de John Russo La Nuit des morts-vivants, novélisation du célébrissime film de George A. Romero (dont Russo était le co-scénariste). Oui, vous pouvez me traiter de fanboy. Mais avant de vous en faire le compte rendu, il m’a semblé nécessaire de faire la même chose pour l’œuvre originelle (et autrement plus essentielle). Adonc, voilà (purée, ça faisait un bail que j’avais pas chroniqué de film, tiens…).
Et, histoire d’annoncer franchement la couleur, autant vous le dire tout de suite : s’il n’est certainement pas irréprochable, et si ce n’est pas à mon sens le meilleur film de Romero (voyez Zombie – le plus grand film de zombies de tous les temps – et Martin – le film de vampires le plus intelligent de tous les temps –), ce film séminal est en ce qui me concerne un des plus importants de l’histoire du cinéma. Du cinéma fantastique, du cinéma de science-fiction, du cinéma d’horreur, oui, mais aussi du cinéma tout court. Et je pèse mes mots (ah mais).
Contexte : dans les années 1960, George A. Romero (qui est Américain, et pas Mexicain, contrairement à ce que j’avais pu lire dans Les Inrocks, revue sérieuse et pertinente s’il en est…) est un jeune réalisateur fauché de Pittsburgh. Avec quelques amis également sans le sou, il a fondé Latent Image, une petite compagnie de production tournant essentiellement des spots publicitaires et des films d’entreprise. Mais Romero, notamment, et son ami John Russo, aimeraient bien faire autre chose, et tourner un « vrai » film. Le problème est de trouver le financement… On est encore clairement dans l’ère des studios, l’idée d’un cinéma indépendant est à peu près inconcevable, et Pittsburgh n’est certainement pas Hollywood… Mais Russo soutient, un peu par bravade, qu’il suffirait de rassembler une dizaine de personnes apportant chacune quelques centaines de dollars, pour avoir un budget, dérisoire certes, mais suffisant pour tourner un petit film d’horreur, un film d’exploitation qui ferait la joie des drive-in et des salles de quartier (à la Corman, disons) ; probablement pas une grande œuvre d’art, mais quelque chose qui pourrait rapporter assez d’argent pour passer à quelque chose de plus solide ultérieurement. Romero se montre assez enthousiaste. Avec Latent Image, il commence à mettre un peu d’argent de côté, fait quelques tentatives infructueuses, et se met en quête d’investisseurs. Ceux-ci seront au final 10, et fonderont une compagnie qui prendra du coup le nom d’Image Ten. Chacun apporte initialement 600 $, conformément à la « vision » de Russo ; au fil des rallonges, le film coûtera finalement 114 000 $ (dont 60 000 investis, le reste étant constitué d’emprunts). Dès lors, il n’y a pas de petites économies : comédiens amateurs et totalement inconnus – parfois membres d’Image Ten, d’ailleurs (Karl Hardman, Marilyn Eastman…), – matériel « emprunté » à l’Université, pellicule – noir et blanc – plus ou moins volée, diverses autres petites magouilles ici ou là, musique de stock, effets spéciaux réduits au strict nécessaire, implication totale de la petite équipe initiale dans le film (chacun ou presque adoptant plusieurs casquettes)…
Évidemment, dans ces conditions, il est impensable de faire un film d’horreur « comme les autres ». Romero, plus ou moins contraint et forcé par les circonstances (et plus lucide et talentueux qu’un certain Ed Wood – mais on avouera que, jusqu’à présent, l’histoire de ces réalisateurs présente des similitudes…), ne peut pas jouer la carte de l’esthétique « classique » des films d’horreur, des productions de l’Universal des années 1930, et a fortiori du chatoiement technicolor de la Hammer et de ses rivales (productions fauchées de Roger Corman incluses, dans l’ensemble), qui rencontrent à l’époque le succès que l’on sait avec leurs productions gothiques. Sa posture, pour le coup, ne manque pas de rappeler celle du fameux duo constitué jadis par Jacques Tourneur et Val Lewton, mais dans des conditions pires encore puisqu’il ne bénéficie pas du soutien de quoi que ce soit de comparable à la RKO, et que les goûts du public ont changé. Mais là où Tourneur, notamment dans La Féline, avait brillamment pallié à ce manque en jouant la carte de l’ambiance et du fantastique « psychologique », qui l’autorisait à ne rien « montrer », Romero, lui, va prendre une direction radicalement opposée et extrêmement audacieuse : celle du « cinéma-vérité ». Dans la foulée du néo-réalisme italien – je pense notamment aux splendides Rome ville ouverte et Allemagne année zéro de Roberto Rossellini –, et probablement aussi des premiers coups d’éclat de la Nouvelle Vague française, il relègue aux oubliettes théâtralisation, artifice et esthétisme pour y privilégier le réalisme et l’authenticité. Son film d’horreur sera contemporain, américain, tourné en extérieurs, et plus ou moins à la manière d’un documentaire : on est aux antipodes de Terence Fisher comme de Mario Bava. Mais, à l’encontre de Tourneur ou de Carnival of Souls, le « réalisme » s’appliquera également à la matière même du film : il s’agira de « montrer » l’insoutenable, de livrer une horreur graphique. Avec les moyens du bord, certes ; mais, déjà auparavant, Hershell Gordon Lewis, influencé par le grand-guignol, avait procédé de la sorte, avec des budgets tout aussi ridicules, pour ses mythiques films d’exploitation fondateurs du cinéma « gore », le nanardesque Blood Feast (1963) et le bien plus réjouissant 2000 Maniacs (1964). Certes, avec La Nuit des morts-vivants, on est très loin des déferlements de gore des épisodes ultérieurs de la série des zombies, sans même parler des films de cannibales ou de zombies d’un Lucio Fulci, d’un Ruggero Deodato ou d’un Umberto Lenzi, ou des joyeux délires outranciers d’un Sam Raimi ou d’un Peter Jackson premières périodes ; mais les maquillages, quand bien même rudimentaires, et la mémorable séquence anthropophage (même s’il ne s’agit que d’abats dégoulinant de chocolat…), suffisent à conférer une place particulière à La Nuit des morts-vivants dans l’histoire du genre, alors à ses premières expérimentations. Le tollé que suscitera le film à sa sortie en témoigne assez…
Reste à trouver un scénario, tout de même… George A. Romero n’a jamais caché s’être inspiré du chef-d’œuvre de Richard Matheson Je suis une légende (déjà « adapté » au cinéma en 1964 sous le titre The Last Man on Earth, avec Vincent Price), et Matheson lui-même a plus ou moins reconnu son bébé quand il a vu La Nuit des morts-vivants… Mais il était bien sûr impensable d’en faire une adaptation « officielle ». Finalement, ne restera que l’idée de cette « épidémie » submergeant la planète, et d’adopter le point de vue des survivants plus ou moins combatifs. Sans le savoir, en s’inspirant ainsi de la science-fiction vampirique de Matheson, George A. Romero a posé les bases du mythe moderne du zombie (complètement coupé de ses bien différentes racines vaudoues, déjà illustrées au cinéma à maintes reprises – White Zombie, l’excellent Vaudou de Tourneur…). Mais le terme lui-même n’apparaît pas une seule fois dans le film de Romero (et je n’en ai compté qu’une occurrence dans le roman de Russo) : le script désignait les « zombies » sous le seul nom de « flesh eaters », puis de « living dead ». L’amalgame ne se fera qu’ultérieurement, notamment avec le deuxième (et le meilleur) film de la saga, titré Dawn of the Dead outre-Atlantique, mais rebaptisé Zombie pour son exploitation européenne par son producteur et distributeur Dario Argento. Mais se pose le problème de « l’explication » du phénomène : La Nuit des morts-vivants est un film d’horreur matérialiste, et, à l’instar des épisodes ultérieurs, les « explications » mystiques, eschatologiques ou vaudoues, ne sauraient y être de mise (sauf au détour d’une punchline ironique, bien sûr : « When there’s no more room in hell, the dead shall walk the earth… »). L’idée de la contamination est reprise à Matheson (et promise à un brillant avenir…), mais reste le problème de l’origine : ici, Romero et Russo commettent sans doute une erreur, en ressentant ce besoin de justification (que les meilleurs films de zombies, par la suite, évacueront assez souvent, à moins de jouer du thème moins troublant des simples « infectés » – Romero lui-même dans The Crazies, Danny Boyle dans 28 Jours plus tard…) ; mais, pour peu convaincante que soit cette étrange histoire de radiations, évoquée rapidement en passant (là n’est pas l’essentiel, heureusement), elle ancre néanmoins La Nuit des morts-vivants davantage du côté de la science-fiction que du fantastique (le roman de Russo insiste d’ailleurs un peu plus sur cet aspect – l’anticipation y est plus franche –, et les films ultérieurs de la saga, plus « apocalyptiques » ou « post-apocalyptiques », enfonceront le clou – on n’en doute plus avec Land of the Dead…). Sur ces bases, Romero et Russo co-écrivent un scénario, d’abord très ambitieux et en trois parties, puis se resserrant sur l’essentiel (uniquement la première partie du projet initial : le film devient ainsi à peu de choses près un huis-clos – c’est toujours ça d’économisé…).
Est-il vraiment nécessaire de rappeler l’histoire de La Nuit des morts-vivants ? Probablement pas, mais bon, ainsi que le veut l’usage… Tout commence avec Barbara (Judith O’Dea) et Johnny, deux jeunes américains du Midwest, frère et sœur, qui se rendent dans un cimetière au crépuscule : Barbara tenait à honorer la tombe de leur père ; Johnny, lui, y voit une corvée, et ne cesse de se plaindre de la longueur du trajet… puis de se moquer cruellement de sa sœur : « They’re coming to get you, Barbara! » La blague ne dure pas longtemps : Johnny est attaqué par un individu mystérieux rodant dans le cimetière, et Barbara, terrorisée, s’enfuit. Elle se réfugie dans une ferme isolée, où d’autres maniaques, plus ou moins en état de décomposition avancée, l’assaillent également. Elle ne doit finalement son salut qu’à l’arrivée de Ben (Duane Jones), qui repousse les morts-vivants et entreprend de fortifier la maison dans l’attente d’hypothétiques secours, tandis que Barbara, traumatisée, sombre, après quelques crises d’hystérie, dans une catatonie dont elle ne sortira plus. Mais se sont également cachés dans la cave la famille Cooper (Harry – Karl Hardman –, Helen – Marilyn Eastman – et leur fille Karen, malade – Kyra Schon) et le jeune couple formé par Tom (Keith Wayne) et Judy (Judith Ridley). Dehors, les morts-vivants sont de plus en plus nombreux à assiéger la ferme, et il ne fait aucun doute que, le moment venu, ils sauront trouver un moyen d’y pénétrer et de massacrer les réfugiés : c’est du moins ce que prétend l’énergique Ben, qui entend bien agir – d’abord protéger la maison, trouver à s’informer, puis, si les secours ne se montrent pas, trouver un moyen de s’enfuir… Mais Harry Cooper, lâche et égoïste, soutient que la meilleure solution est de s’enfermer dans la cave en attendant les secours. Les deux hommes s’affrontent, tandis que leur sort inéluctable semble se préciser à mesure que les mangeurs de chair humaine s’amassent à l’extérieur…
Le résultat, très moderne, reste encore aujourd’hui remarquablement efficace car réfléchi et maîtrisé, en dépit des mauvaises conditions de tournage et de l’amateurisme des comédiens (cela dit, Duane Jones s’en tire plutôt bien, et Karl Hardman de même, son rôle justifiant assez son cabotinage). L’ambiance est oppressante du début à la fin, et nombre d’images marquent durablement les esprits : la mort de Johnny, la fuite vers la citerne, les bras innombrables jaillissant dans les fenêtres – désormais une séquence incontournable du genre –, le festin cannibale – idem –, le sort d’Helen (une scène qui a considérablement choqué à l’époque), et, bien sûr, cette « chute » stupéfiante, déprimante et d’une audace invraisemblable ; le générique de fin, jouant plus que jamais la carte documentaire, est d’une force rarement (jamais ?) égalée dans le cinéma d’horreur. Dans la forme comme dans le fond, La Nuit des morts-vivants est un film qui ne ressemble à rien de ce que l’on avait pu voir auparavant, et qui passe tous les codes et tous les tabous à la moulinette.
C’est que La Nuit des morts-vivants n’est pas seulement un bon film d’horreur, un huis-clos bien ficelé. Ici, je ne peux m’empêcher de citer la jaquette du DVD de The Crazies (dans l’excellente collection des « Introuvables », chez Wild Side) : « George Romero est un maître du film d’épouvante, c’est un fait « établi » par les fans du genre. Pourtant en y regardant de plus près et en occultant certaines scènes « chocs », il devient évident que Romero est avant tout un cinéaste « social » et que l’ensemble de son œuvre est hautement contestataire, anti-militariste, anti-fasciste, anti-consumériste, profondément écologiste. » Oui, moi aussi, cette formulation digne d’un tract anar et saturée de « -iste » m’a fait sourire… Mais, en y apportant quelques bémols – le « avant tout » est exagéré, et l’occultation des scènes « chocs » une erreur en ce qui me concerne –, cette description est tout à fait vraie (et son ton caricatural, avouons-le, est d’autant plus approprié que Romero, s’il a bien des choses intéressantes à nous dire, ne se montre généralement pas très subtil dans son discours : ses idées radicales, il ne les présente pas exactement avec le dos de la cuillère…). La thématique anti-capitaliste ressortira de la plupart des films ultérieurs de Romero (Zombie en tête, bien sûr), et l’anti-militarisme est central dans The Crazies et Le Jour des morts-vivants. Même Creepshow, en apparence plus léger, ne se prive certainement pas de taper là ou ça fait mal. Martin joue très adroitement des tabous religieux et sexuels. Quant au terriblement fauché Season of the Witch, si c’est un film d’horreur raté, c’est par contre un film « social » pertinent (qui n’a donc rien à voir avec les nullités pleines de vide que les alter-bobos franco-anglais nous infligent régulièrement sous cet intitulé généralement annonciateur du pire). On pourrait évoquer toute sa filmographie de la sorte (à part peut-être La Part des ténèbres, où c’est moins sensible…).
Et, quand bien même Romero a toujours prétendu le contraire, c’est déjà vrai pour ce qui est de La Nuit des morts-vivants : que le film n’ait été à l’origine qu’un projet commercial n’y change rien, c’est le traitement qui importe. Or les relations sociales – et notamment les relations de pouvoir – y sont bien cruellement disséquées. L’Amérique profonde y sombre dans un chaos qui n’a rien à voir avec la menace « extérieure » toujours évoquée jusqu’alors, et ne maquillant qu’à peine l’Union soviétique : elle est à l’intérieur même de la société américaine. Violer le sacro-saint tabou de la famille américaine et de l’innocence enfantine, c’est une chose qui n’a finalement que rarement été faite depuis. Afficher un tel matérialisme – ressortant notamment du festin cannibale (les scènes « chocs » doivent d’autant moins être occultées que ce renvoi de l’homme à sa condition la plus animale, et son assimilation à un simple tas de viande, sont au cœur du propos…) – dans un genre généralement imprégné de mystique chrétienne n’était certainement pas « innocent ». Refuser le « happy end » à ce point, c’était quasiment du jamais vu (à part peut-être, dans un tout autre genre, l’Allemagne année zéro de Rossellini précédemment évoqué), et Romero a refusé de changer la fin de son film, en dépit des demandes pressantes de distributeurs éventuellement intéressés, mais ne pouvant accepter cette conclusion éprouvante. Et, enfin, il y a la question du racisme… Romero a toujours dit que, si Duane Jones avait été engagé pour interpréter Ben, le héros du film – ou ce qui s’en rapproche le plus –, ce n’était pas parce qu’il était noir – le scénario ne prévoyait rien à cet égard –, mais tout simplement parce que c’était celui qui s’en était le mieux tiré au casting. Je veux bien le croire… mais peu importe : quelle que soit la raison qui a conduit à ce choix, La Nuit des morts-vivants n’en est pas moins un film dont le héros est noir, et n’a rien de caricatural ; ce qui, dans le cinéma américain, est peut-être bien une première, et, hélas, n’a pas eu forcément beaucoup de suites… Dans l’Amérique des années 1960, que ce choix ait été délibéré ou non, il n’en a pas moins une résonance particulière, a fortiori si l’on tient compte de la conclusion du film ; on l’a souvent rappelé, mais à juste titre : le 4 avril 1968, alors que Romero se rend à New York en quête d’un distributeur pour son film, Martin Luther King est assassiné à Memphis…
Le film sort finalement le 2 octobre 1968, et rencontre très vite un grand succès public (ce qui ne l’empêche certainement pas de se faire écharper par la critique, qui y voit une monstruosité immorale…). Tourné pour 114 000 $, La Nuit des morts-vivants a rapporté plus de 20 millions de dollars en l’espace de trente ans (et déjà entre 4 et 5 pour les seules années 1969-1970), ce qui en fait un des films les plus rentables de l’histoire du cinéma. Hélas, Romero et ses comparses d’Image Ten ne toucheront rien sur ces bénéfices, s’étant fait escroquer par leur distributeur… Quand Romero gagne son procès en 1975, il ne récupère pas la moindre somme pour autant, du fait de la banqueroute dudit margoulin. Et diverses embrouilles juridiques autoriseront la multiplication des versions bâtardes du film de Romero, remontées à la hache, « complétées » avec de « nouvelles scènes », colorisées, dotées d’une nouvelle bande-son, etc. C’est à bien des égards pour récupérer ses droits sur son film que Romero a parrainé son seul remake officiel (par ailleurs très mauvais), réalisé par Tom Savini en 1990. Aujourd’hui, le film de Romero est dans le domaine public (ce qui explique ses nombreuses éditions en DVD, de qualité très « variable »…), et on le trouve gratuitement et légalement sur le ouèbe.
Quoi qu’il en soit, La Nuit des morts-vivants est bien devenu un film culte : doublé en 17 langues, il est projeté chaque jour quelque part dans le monde depuis l’année de sa sortie (il a même été projeté au Museum of Modern Art…). Créateur d’un mythe contemporain, instaurant une nouvelle charte du cinéma d’horreur (qui allait générer les chefs-d’œuvre les plus subversifs et fascinants des années 1970), il a également inauguré les fameux « Midnight Movies », et il a démontré qu’un film indépendant et audacieux, réalisé en dehors des contraintes des studios et sans argent ou presque par une bande de débutants réfractaires aux codes, pouvait être un succès (Easy Rider, sorti la même année, a participé de ce phénomène, largement à l’origine du développement du cinéma indépendant américain – pas seulement d’horreur, loin de là – ainsi que des tentatives les plus personnelles de ce que l’on appellera bientôt le « nouvel Hollywood » – on peut penser notamment à la belle expérience d’American Zoetrope…).
Alors, oui, je maintiens : s’il n’est certainement pas exempt de défauts, La Nuit des morts-vivants est bien un des films les plus importants de l’histoire du cinéma. Du cinéma fantastique, du cinéma de science-fiction, du cinéma d’horreur, oui, mais aussi du cinéma tout court.
…
Bon, la novélisation, maintenant…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)




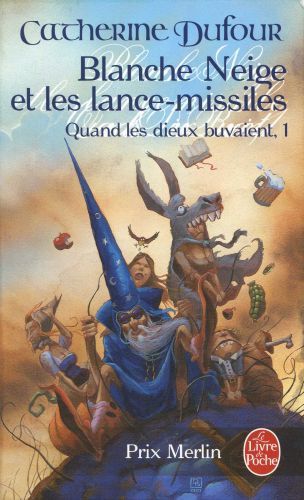





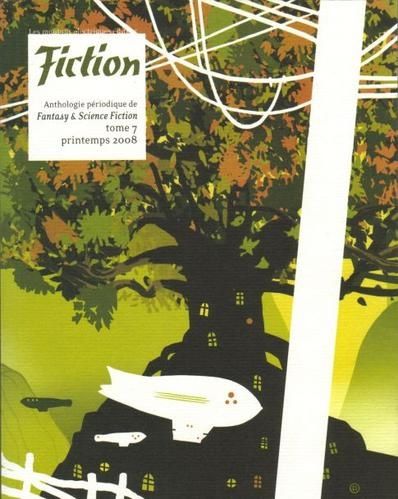



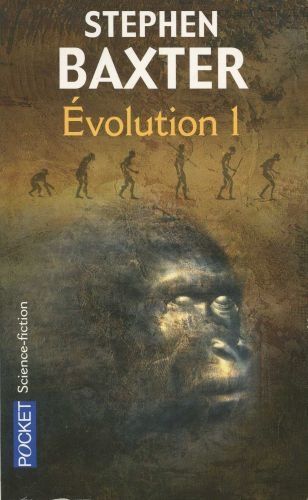
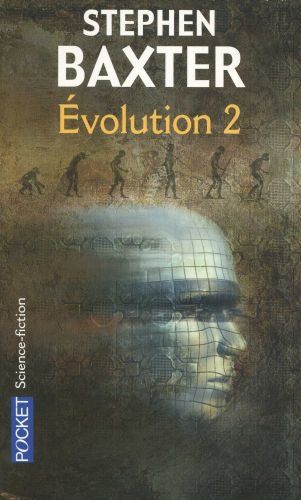

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)