"The Castle of Otranto", d'Horace Walpole

WALPOLE (Horace), The Castle of Otranto, edited with an introduction and notes by Michael Gamer, London, Penguin Books, coll. Penguin Classics, 2001, XLII + 159 p.
Bon, j’ai du retard à rattraper, moi… Allez, c’est tipar.
Un beau jour (enfin, vu mon rythme de sommeil actuel, il devait faire encore nuit), je me suis réveillé avec une idée saugrenue en tête : « Et si que je lirais des livres in english in ze text, pour voir ? hein ? hein ? » Idée saugrenue s’il en est, quand on sait que mon niveau dans la langue de Shakespeare, s’il fut correct du temps où c’que j’avais des boutons sur la gueule, a considérablement pour ne pas dire dramatiquement chuté depuis mon entrée dans le supérieur. Quelques expériences ici ou là s’étaient d’ailleurs avérées des semi-réussites, mais sans doute cela venait-il du choix des textes : Stephen King, ça passait (en gros) ; Lewis Carroll, oui et non ; Bradbury et Wells, idem. Finalement, par pure lâcheté, je n’ai guère poursuivi (si ce n’est en comics, là, OK), et c’était sans doute un tort.
D’où l’idée saugrenue que voilà. Et cette fois, histoire de ne pas reculer devant l’adversité, je me suis payé un certain nombre de bouquins en VO. Et parmi ceux-là, quelques gothiques anglais, histoire de parfaire ma culture du genre. En effet, des grands classiques de ce domaine littéraire (entendu au sens strict), je n’avais lu jusqu’à présent (et en français, œuf corse) que Le Moine, de Matthew Lewis, que j’avais bien aimé au passage (normal, vu le côté éminemment « sadien » de la chose – quoi qu’ait pu en dire le divin marquis lui-même). D’où mon envie de commencer ce cycle de lectures anglaises par le « grand-père » de la littérature gothique britannique, The Castle of Otranto d’Horace Walpole.
D’Horace Walpole ? Mais c’est que ce petit filou cachait bien son jeu ! La première édition de ce texte séminal était signée « William Marshall, translator » : il s’agissait en effet de faire croire que le texte en question était une traduction d’un original italien datant de l’époque des croisades, retrouvé dans une vieille famille catholique du nord de l’Angleterre (ce qui, dans l’Albion d’alors, n’était certes pas innocent sur les plans politique, philosophique et spirituel)… Le pire étant que la supercherie a effectivement fonctionné, et en a berné quelques-uns. Mais dès la seconde édition, la vérité a été rétablie, et l’honorable Horace Walpole (d’autant plus honorable que, bien, bien qu’imprimeur à ses heures, il ne voulait pas de la réputation d’homme de lettres…) a reconnu sa paternité sur ce petit texte unique en son genre, destiné à réconcilier « two kinds of romances », l’ancienne et la moderne. Comprendre par-là la « naïveté » et la magie des récits de chevalerie et la psychologie et le sentiment des romans modernes.
Mais ce qui surprend énormément, chez ce « grand-père » de la littérature gothique (« grand-père », oui, je me répète : le genre ne sera véritablement à la mode, avec Ann Radcliffe et compagnie, qu’une ou deux générations plus tard), c’est son goût affiché pour l’humour (voyez la préface à la seconde édition, où Voltaire s’en prend plein la gueule, ce qui n’est pas pour me déplaire, uh uh…) et le grotesque, voire, diraient les mauvaises langues – et on en a un échantillon dans les appendices, comprenant des critiques contemporaines ou légèrement postérieures –, le ridicule.
Ainsi dès les toutes premières pages. La scène se déroule au château d’Otrante, dans le sud de l’Italie, cadre quasi unique de l’action. Conrad, chétif héritier de la maison d’Otrante, doit épouser Isabella. Mais – CHPLONK ! – il est écrasé le jour même, avant ses noces, par un heaume géant qui lui tombe du ciel directement sur la gueule (si, si !), première des nombreuses manifestations surnaturelles qui parsèment le roman, et dont bon nombre se ramènent à des éléments d’armure géants (ce qui a son sens, mais chut, chut…). C’est qu’une malédiction pèse sur la maison d’Otrante, qui a usurpé son pouvoir, et le tyrannique Manfred, dont Conrad était le seul fils, en est bien conscient ; il entend tout faire pour tromper la malédiction. Et bien que marié lui-même à la loyale Hippolita, le prince d’Otrante entend épouser Isabella en lieu et place de son fils (mouhahahaha !), afin d'en obtenir une descendance mâle. Il faut encore ajouter au tableau sa fille Mathilda, un jeune et brave paysan du nom de Théodore, le prêtre de l’église locale, le père Jérôme, et enfin toute une flopée de domestiques shakespeariens en diable (ceux qui font frémir Voltaire). Voilà pour les personnages et pour le décor.
Quant à l’histoire, vous vous en doutez déjà : fantômes, passages secrets, demoiselles en détresse, quiproquos, révélations improbables, drames familiaux, retournements de situation invraisemblables… le tout à fond de train, pour tenir dans une centaine de pages, en cinq chapitres extrêmement denses, et quasiment dénués de descriptions (ce qui en rend la lecture en anglais extrêmement aisée, dois-je dire) : tout passe dans les dialogues, très finement écrits ; on ne sera pas surpris d’apprendre que The Castle of Otranto a très tôt été adapté pour la scène, tant tout y incite ou presque. On notera au passage une chose qui a choqué à l’époque, mais qui me paraît un plus intéressant : l’absence de véritable morale dans cette histoire, ou plutôt le côté désagréable et injuste de sa « morale », puisqu’il s’agit bien, avec cette histoire de malédiction, de faire peser sur des innocents la faute commise par des ancêtres…
Au final, The Castle of Otranto se révèle être aujourd’hui encore ce qu’il était déjà il y a près de 250 ans : un divertissement efficace et jubilatoire, rondement mené et brillamment exécuté.
Quelques mots pour finir sur cette édition : le fait est que c’est du beau boulot. On commence par une chronologie et une longue introduction suivie d’une bibliographie sur Horace Walpole et son œuvre, tout à fait intéressantes ; quelques notes viennent de temps en temps éclairer quelques points d’histoire ou de vocabulaire ; mais, surtout, il ne faut pas négliger les appendices, qui, comme je l’ai indiqué plus haut, contiennent de très intéressants jugements critiques sur The Castle of Otranto en particulier et/ou Horace Walpole en général (on y croise au passage quelques grands noms, comme Walter Scott). De la belle ouvrage, pour un classique de la littérature gothique, et de la littérature en général.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


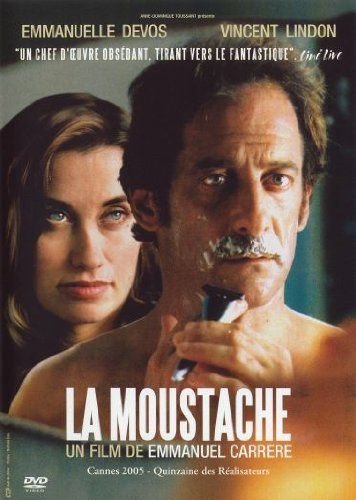
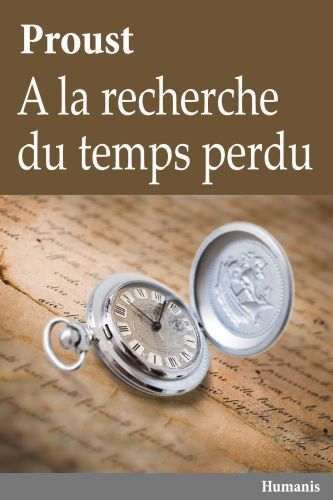
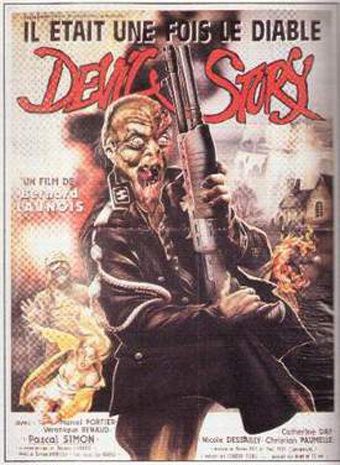






/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)