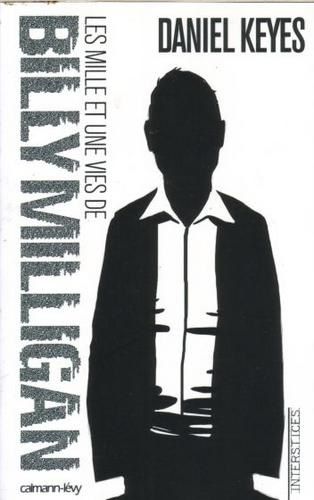
KEYES (Daniel), Les mille et une vies de Billy Milligan, traduit de [l’américain] par Jean-Pierre Carasso, Paris, Calmann-Lévy, coll. Interstices, [1981-1982] 2007, 463 p.
Daniel Keyes, né en 1927, a eu le malheur d’écrire un livre extraordinaire et à la renommée solidement établie, le très beau Des fleurs pour Algernon. L’exemple frappant d’une science-fiction humaine et juste, bien loin des « aventures dans l’espace » auxquelles les ignorants bouffés par les préjugés limitent si souvent et bêtement le genre. Si cette misérable espèce reste encore aujourd’hui tristement proliférante, nombreux, néanmoins, sont ceux qui se sont émerveillés jusqu’aux larmes à la lecture de cette touchante histoire qu’il n’est probablement pas nécessaire de rappeler ici. Des fleurs pour Algernon, qui a connu plusieurs adaptations cinématographiques et télévisuelles, est même parfois aujourd’hui enseigné dans les écoles. Mais ce succès mérité a eu un effet pervers : on y a longtemps vu le seul livre de Daniel Keyes, auteur dont on n’a plus guère entendu parler ensuite (en France en tout cas). Daniel Keyes, pourtant, a écrit bien d’autres ouvrages intéressants. La remarquable collection « Interstices » de Calmann-Lévy, consacrée à ces livres inclassables, aux frontières entre les genres et la littérature « blanche », que l’on désigne parfois du nom de « transfictions » (ce qui me permet de faire un peu de propagande, tiens : lisez, dans cette même collection, La cité des saints et des fous de Jeff VanderMeer, c’est un authentique chef-d’œuvre, un des livres les plus extraordinaires qu’il m’ait été donné de lire, toutes catégories confondues), « Interstices », donc, en témoigne aujourd’hui, en rééditant Les mille et une vies de Billy Milligan, originellement publié aux Etats-Unis en 1981 et qui, si mes souvenirs sont bons, avait déjà connu il y a bien longtemps une édition française, hélas vite épuisée et vite oubliée.
Pourquoi chez « Interstices » ? Parce que Les mille et une vies de Billy Milligan est bel et bien un livre unique et inclassable. Ce n’est pas un roman : tout ce qui y est rapporté est rigoureusement authentique, résultant d’une multitude d’entretiens et de recherches documentaires. Ce n’est pas vraiment un essai non plus ; un témoignage, peut-être. Pourtant ça se lit comme un roman (et un excellent roman, passionnant et fort). Si l’on ne peut parler de fiction, a fortiori ne peut-on parler de science-fiction ou de fantastique… Pourtant, si tout est authentique dans ce livre hors du commun, le récit n’en est pas moins si extraordinaire, si incroyable, si fascinant, que le lecteur, régulièrement, ne peut s’empêcher d’écarquiller les yeux, voire de murmurer un hésitant « non, ce n’est pas possible ! »… Tout en étant bien obligé d’y croire. Parce que c’est vrai, tout simplement… Et l’on a ainsi l’impression, à la lecture de ce témoignage, de ce « rapport », de nager en plein dans le fantastique et la science-fiction ; l’adage se vérifie une fois de plus : oui, dans Billy Milligan, la réalité dépasse bien la fiction. Daniel Keyes, cependant, ne se contente pas de nous livrer ainsi un « quasi-roman » étonnant ; son talent d’écrivain le rend également passionnant, émouvant et intelligent. Et Les mille et une vies de Billy Milligan constitue ainsi non seulement un livre unique, mais aussi une lecture indispensable.
J’arrête de tourner autour du pot, il est sans doute bien temps d’évoquer un peu le contenu de cet ouvrage (notons, au passage, et comme c’est souvent le cas chez « Interstices », que la couverture est fort jolie et très appropriée, et cette fois l’œuvre conjointe de Néjib Belhadj Kacem et Benjamin Carré). Les mille et une vies de Billy Milligan… raconte la vie de Billy Milligan. Mais qu’a-t-il donc de si spécial, ce Billy Milligan ? Eh bien, tout simplement (façon de parler…), il est le premier individu à avoir bénéficié aux Etats-Unis d’un non-lieu dans une affaire criminelle en raison d’un trouble psychique extrêmement rare : la personnalité multiple. Billy Milligan, en effet, a été arrêté à la fin des années 1970 dans l’Ohio, sous le coup d’une accusation pour trois, voire quatre viols et vols à main armée. Il a tour à tour affirmé son innocence, reconnu tous les faits, ou seulement les viols, ou seulement les vols ; et, dans un sens, il disait à chaque fois la vérité… Le syndrome de personnalité multiple, cependant, ne faisait pas l’unanimité : tous les individus au courant des faits – policiers, avocats, psychologues, psychiatres – ont commencé par voir en Billy Milligan un imposteur, souffrant probablement de troubles psychiques de type schizophrénique, sans vouloir accréditer pour autant l’idée déstabilisante de cette pathologie dont on contestait souvent l’existence même. Tous, pourtant, au fil de longs mois de procédures, d’examens, d’internements en hôpitaux psychiatriques et d’incarcérations, ont fini par y croire : Billy Milligan souffrait bien de ce mal peu commun.
On a fini par dénombrer 24 (!) personnalités différentes. Et, comme si ce n’était pas déjà assez ahurissant, on a également mis en lumière le fonctionnement de cette complexe « famille », chaque personnalité, chaque « habitant », ayant un nom, une histoire bien précise, des compétences différentes, une fonction particulière, et même une place au sein d’une complexe hiérarchie. Deux personnalités dominent en effet : en temps normal, la « personnalité majeure » est Arthur, un Anglais hautain avec un fort accent, extrêmement intelligent et rationnel ; en cas de danger, c’est la personnalité de Ragen qui prend le dessus : un Yougoslave à l’anglais hésitant, mais parlant, écrivant et lisant couramment le serbo-croate, violent et protecteur, rompu aux arts martiaux et aux armes à feu, communiste convaincu, et d’une force physique hors du commun. Ce sont ces deux « personnalités majeures » qui déterminent en principe qui peut « passer sous le projecteur » pour « prendre la conscience ». En fonction des circonstances, cela peut être Tommy, le jeune asocial doué pour l’électronique ; ou encore Allen, le beau-parleur, et le seul fumeur de la « famille » ; ou David, le petit enfant « gardien de la douleur », qui prend sur lui toute la souffrance ; Danny, celui qui a peur ; Christine, la petite fille dyslexique qui « va au coin », etc. Mais le contrôle n’est pas total, les « dix » prennent parfois la conscience contre leur volonté, et interviennent en outre à l’occasion les « indésirables », selon l’expression d’Arthur, qui viennent « prendre le temps » des autres : Philip, le petit délinquant new-yorkais ; Lee, le farceur irresponsable ; Shawn, le petit enfant sourd ; April, la garce machiavélique, etc. Tandis que le Billy « fondamental », dissocié, « dort », et que chaque personnalité est totalement inconsciente des activités des autres et parfois même de leur existence, ne pouvant obtenir d’explications qu’au travers de dialogues psychiques ou à voix haute, où Billy donne l’impression de se parler à lui-même…
Le lecteur aussi, nécessairement, est tout d’abord incrédule. Tout cela semble absolument impossible. Un homme qui est alternativement Américain, Anglais, Yougoslave, et Australien ? Âgé de 3 ans et de 26 ? Sourd ou pas ? Gaucher ou droitier ? Peintre émérite ou maladroit ? Fumeur ou non-fumeur ? Homme ou femme ? Doté d’un QI de 60 ou de 130 ? Athée ou Juif intégriste ? Communiste ou fervent capitaliste ? Capable ou non de piloter une voiture ou une moto ? Tout cela semble franchement inconcevable. Mais c’est pourtant la vérité : Billy Milligan est un personnage bien réel, et l’on s’accorde pour dire qu’il ne saurait être un simulateur – il lui faudrait pour cela être le plus brillant acteur de tous les temps, et accessoirement être très masochiste, étant donnés tous les ennuis qui ont été les siens (une page Wikipedia en anglais sur Billy Milligan).
Et Daniel Keyes, dans tout ça ? L’écrivain est un jour contacté par le docteur David Caul et son patient pour écrire son incroyable histoire. Devant cette stupéfiante affaire hautement médiatisée, les propositions dans le genre ont été abondantes, et Billy Milligan a fini par y voir quelque chose de positif, permettant de faire connaître son trouble psychique rare et de faire avancer sa thérapie en essayant de revenir sur son passé (et de gagner un peu d’argent, aussi, mais nous y reviendrons). David Caul, qui connaissait Daniel Keyes, a un jour donné à Billy un exemplaire de Des fleurs pour Algernon ; plusieurs des personnalités de Billy l’ont lu, et se sont mis d’accord pour voir en Keyes l’auteur qu’il fallait, dans la mesure où il avait déjà, dans cette occasion, montré son talent pour décrire de l’intérieur la vie d’un individu souffrant de troubles psychiques (rappelons que Keyes, avant de se tourner vers l’enseignement de l’anglais et l’écriture, avait obtenu un diplôme en psychologie ; ce n’est sans doute pas pour rien dans la réussite de son plus fameux roman, et dans la suggestion du Dr Caul…). Keyes, sceptique, accepte néanmoins de rencontrer Billy Milligan, sans s’engager pour autant. Il n’est guère convaincu, dans un premier temps ; mais il finit par se rendre à l’évidence, en rencontrant tour à tour plusieurs « habitants » (la brève phase de transition semblant particulièrement impressionnante), et se met au travail, entamant une série de plusieurs centaines d’entretiens avec cet étrange individu. Le travail n’est guère aisé, cependant, du fait de l’amnésie dont souffre Billy. Et c’est alors que survient un autre événement improbable et pourtant réel : la thérapie du docteur Caul commence à porter ses fruits, et apparaît ainsi, dans un sens, une « nouvelle » personnalité, baptisée « le Professeur », qui rassemble toutes les autres et dispose de tous leurs souvenirs (Billy n’est pas guéri pour autant, toutes les personnalités sont encore présentes, et la fusion véritable donnerait, à la différence du Professeur, « moins que la somme des parties », un individu ne possédant pas toutes les qualifications de la « famille » – ce qui rappelle d’ailleurs un peu le sort de Charlie Gordon…). Pour la première fois, Billy, sous la forme du « Professeur », peut raconter toute sa vie ; et Daniel Keyes pourra ainsi construire son livre.
La première partie du roman (« Le temps des embrouilles », pp. 13-165) décrit l’arrestation de Billy Milligan, les interrogations de ses avocats et les premières étapes de sa thérapie, plusieurs psychiatres particulièrement prestigieux abandonnant progressivement tout scepticisme pour adhérer à la thèse du syndrome de personnalité multiple et constituant un dossier en faveur de la reconnaissance de l’irresponsabilité du prévenu pour les faits qui lui sont reprochés. Si les toutes premières pages, très journalistiques, ne sont franchement guère attrayantes, l’intérêt du lecteur ne cesse cependant de grandir au fur et à mesure des découvertes stupéfiantes sur le cas Billy Milligan. Quand Daniel Keyes intervient lui même (à la troisième personne, il est « l’écrivain »), le « roman » est déjà passionnant depuis un certain temps, a fortiori si l’on s’intéresse à la psychiatrie… et aux arguties procédurales.
Mais Keyes, pour l’instant, s’est essentiellement livré à un travail de recherche documentaire, certes extrêmement intéressant, mais finalement banal pour ce qui est de la forme. Il ne révèle véritablement son talent d’écrivain qu’à partir du moment où « le Professeur » fait son apparition, et se met à raconter la vie de Billy Milligan, de sa plus petite enfance à son arrestation, ce qui constitue la deuxième partie (« De Billy au Professeur », pp. 167-371). On y retrouve cette extraordinaire faculté d’empathie dont avait su faire preuve l’auteur dans Des fleurs pour Algernon, avec ce trouble psychique si singulier vu « de l’intérieur ». Il détaille ainsi, à grands renforts d’anecdotes, l’apparition des différents « habitants », trouvant essentiellement son origine dans un horrible drame : le viol de Billy, alors qu’il était âgé de 9 ans, par son père adoptif (son père biologique s’était suicidé quelques années plus tôt ; le père adoptif, Chalmer Milligan, a toujours nié les faits, mais n’a jamais entamé de procédure judiciaire contre les allégations de Billy et le livre de Daniel Keyes). On comprend d’autant mieux, ainsi, pourquoi chaque personnalité est apparue et comment son rôle s’est progressivement défini : l’incroyable devient finalement très logique, sans le moindre didactisme poussif qui viendrait nuire à la force du propos. La plume de Keyes y est magistrale, jouant avec les émotions avec subtilité, sans jamais se contenter de bêtement presser le bouton du pathos, mais allant toujours au cœur des choses. On se prend considérablement d’attachement pour ce personnage meurtri, dont on sait pourtant « qu’il » deviendra ultérieurement – en partie, du moins, c’est tout le problème… – un criminel repoussant. Certains passages sont particulièrement saisissants, certaines phrases, parfaites dans leur simplicité, touchent au cœur avec une maestria rare. A maintes reprises, tétanisé par une phrase en apparence anodine, j’ai été amené à poser un instant le livre pour reprendre mon souffle, les yeux grand ouverts… Quant aux dialogues entre les « habitants », ils sont tout bonnement extraordinaires. Keyes était confronté à une mission impossible : non pas seulement construire un personnage crédible et attachant, mais une vingtaine en un ! Et il y arrive à merveille.
Et si la troisième et dernière partie (« Par-delà la folie », pp. 373-452), en retournant au présent, retrouve presque nécessairement le ton plus ou moins journalistique de la première, l’émotion n’en disparaît pas pour autant. Nous sommes maintenant confrontés au calvaire d’un Billy Milligan en voie de guérison, mais qui doit faire face aux rechutes, et surtout à la haine et à la peur, qui suscitent un violent délire médiatique contre « le violeur sadique », sciemment attisé par des politiciens uniquement désireux d’assurer leur réélection en jouant du discours ultra-sécuritaire… Une véritable descente aux enfers. C’est extrêmement déprimant (à la stupéfiante dernière page de cette partie, très honnêtement, j’avais les larmes aux yeux…).
Et c’est aussi révoltant ; on peut d’ailleurs noter, à cet égard, que la réédition de ce livre phénoménal intervient à point, la chancellerie de notre sinistre République venant il y a peu de déposer un projet consternant de populisme, de bêtise et de cynisme visant à supprimer les non-lieux pour troubles psychiques. Monde de merde, une fois de plus. J’aimerais croire que toutes ces ordures qui brandissent hypocritement l’argument mal compris des « droits des victimes » pour réorienter le droit pénal vers son visage le plus répugnant, celui de la pure vengeance haineuse, j’aimerais croire, donc, que tous ces abrutis puissent, à la lecture des Mille et une vies de Billy Milligan, prendre conscience des implications de leurs traficotages électoraux. Mais je suis bien conscient, hélas, que c’est là demander l’impossible, que tout est probablement déjà foutu, et que ce livre, aussi extraordinaire soit-il, ne prêchera sans doute que des convaincus… C’est triste. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour passer à côté de cette merveille unique en son genre.
PS : Billy Milligan est toujours vivant aujourd’hui, il a été relâché et se porte semble-t-il bien. Il a multiplié les actions en faveur des enfants maltraités (c’est essentiellement à cela qu’ont servi les revenus tirés du livre), et participe lui-même à la production du projet d’adaptation cinématographique de cette « biographie », véritable Arlésienne (on en parlait déjà au moment des faits…), mais qui semble se préciser un peu plus ces derniers temps (plusieurs réalisateurs s’y sont cassés les dents ; on parle à l’heure actuelle de Joel Schumacher, ce qui n’est guère rassurant, je vous l’accorde…). Billy Milligan est resté en contact avec Daniel Keyes, qui a d’ailleurs écrit une « suite », toujours pas publiée aux Etats-Unis en raison de problèmes juridiques (notons d’ailleurs que tous les noms cités dans Les mille et une vies de Billy Milligan, à quelques très rares exceptions près, de toute façon précisées, sont authentiques…) ; elle devrait sortir aux Etats-Unis dans la foulée du film. Tout cela est donc encore assez hypothétique, et il en va probablement de même pour ce qui est d’une éventuelle traduction française [EDIT : en fait, si, Les Mille et Une Guerres de Billy Milligan ont bien été publiées en français, toujours chez Interstices]…



/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





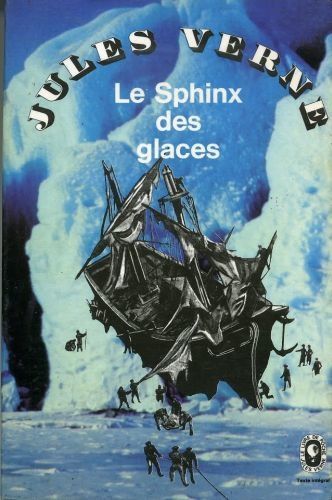




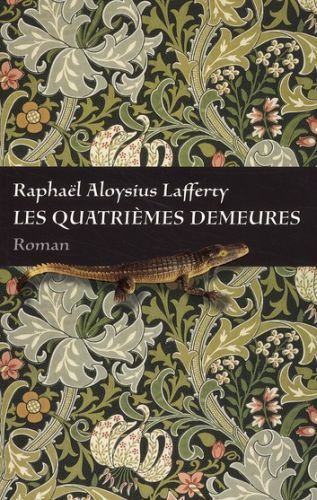


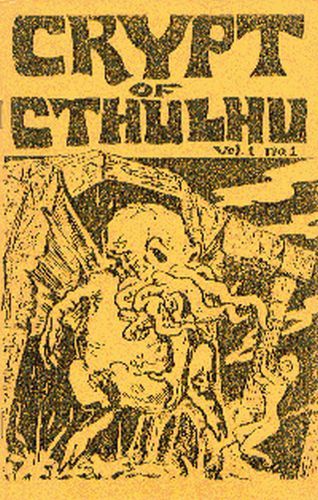
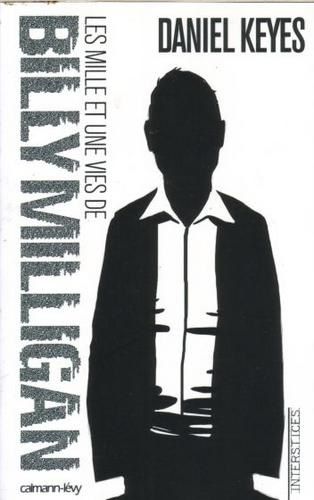



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)