Au passage, j'ai utilisé, en guise d'illustration sonore, diverses musiques dont je n'ai comme de juste pas les droits, qui demeurent à leurs propriétaires respectifs. Durant cette séance, j’ai surtout fait appel à l’album White2 de Sunn O))) (les morceaux « bassAliens » et « Decay2 [Nihil’s Maw] »), à la bande originale du jeu vidéo Darkest Dungeon, et à celle du film de Mel Gibson Apocalypto, composée par James Horner. De manière plus anecdotique, j’ai aussi fait appel aux morceaux de Lustmord « Aldebaran of the Hyades » (de l’album The Place Where the Black Stars Hang) et « Babel » (de l’album The Word as Power), ainsi qu’à « Saltarello » de Dead Can Dance (sur l’album Aion). Comme d’habitude, j’ai réservé l’immortelle bande originale de Conan le Barbare de John Milius par Basil Poledouris pour la préparation de la partie et son debrief…
Il y avait cinq joueurs, qui incarnaient Liu Jun-Mi, un Ghataï d’ascendance xi lu (Barbare 0 – Mercenaire 1 – Dresseur 1 – Gladiateur 2) ; Myrkhan, originaire de Tyrus (Gamin des rues 1 – Chasseur 2 – Forgeron 0 – Soldat archer 1) ; Narjeva, originaire d’Urceb (Esclave 0 – Courtisane 1 – Assassin 2 – Prêtresse de Nemmereth 1) ; Nepuul Qomrax, originaire de Zalut (Scribe 2 – Alchimiste 3 – Marchand 0 – Médecin 1) ; et enfin Redhart Finken, de Parsool (Docker 0 – Matelot 1 – Mercenaire 3 – Marchand 0).
I : AU CŒUR DE LA PYRAMIDE
Les héros, après s’être débarrassé des gardes, font face à la grande pyramide du sanctuaire des Mitis, où ils supposent que se trouve Dill Sendak. C’est un bâtiment impressionnant, massif, qui fait dans les quinze mètres de hauteur, et est constitué d’une sorte de pierre noire lisse pouvant évoquer une sorte de marbre.
Sur le pourtour du rez-de-chaussée, il y a des frises en marbre blanc, cette fois, qui figurent toutes une étrange et gigantesque créature reptilienne à tête de femme. L’érudit Nepuul Qomrax comprend de quoi il s’agit : une slorth – c’est-à-dire une créature monstrueuse conçue il y a bien longtemps de cela par les Rois-Sorciers ; les slorths sont des créatures toutes femelles, d’essence magique, et elles-mêmes en mesure de faire appel au Pouvoir du Néant, comme leurs maîtres d’antan.
Les héros ouvrent la grande porte de bronze à double battant au sommet de l’escalier, qui leur permet de pénétrer dans la pyramide ; pas un bruit à l’intérieur, pas une source de lumière non plus, aussi se munissent-ils de torches, et tendent-ils l’oreille – littéralement pour Redhart, qui n’en a qu’une. Ils entrent ainsi dans un petit vestibule, avec deux portes en bois ouvragé de part et d’autre ; Myrkhan croit entendre des bruits liquides – comme une goutte d’eau qui tomberait périodiquement dans un bassin, et cela vaut pour la porte de gauche comme pour celle de droite.
Derrière chacune de ces portes, de manière parfaitement symétrique, se trouve une pièce encore assez petite mais cependant deux fois plus grande que le vestibule, avec un petit bassin rempli d’une eau limpide – il faut traverser ces sortes de pédiluves pour atteindre, dans les deux cas, la porte qui se trouve au nord. Les héros méfiants prennent bien soin de vérifier que cette eau n’a rien de menaçant et que rien ne s’y tapit – ils n’ont rien à craindre ici. Nepuul, à vrai dire, fait très attention à ce qu’ils ne déclenchent pas de pièges, mais, d’une certaine manière, il doute qu’il y en ait : c’est un lieu de culte, pas une forteresse, et, à ce niveau tout du moins, les traces de passage ne manquent pas – les Mitis doivent y passer quotidiennement. Il restera prudent néanmoins… Mais les personnages mouillent donc leurs chausses, et franchissent la porte qui les mène à la pièce suivante.
Ils se retrouvent dès lors dans une salle bien plus vaste – au point où leurs torches ne leur permettent pas de tout éclairer immédiatement. Une grande terrasse borde un bassin plus profond que ceux des pièces précédentes – une poutre d’une dizaine de centimètres de large traverse ce bassin, mais impossible de voir où elle mène sans s’y engager. Vers le côté est, un escalier descend dans un sous-sol. Un peu au-dessus, sur le mur sud, se trouve une fresque avec l’inscription, dans un dialecte lémurien que les héros lisent sans peine : « Seul, avant l’union. » Liu Jun-Mi s’approche du bassin, avec sa torche… et cette fois ce n’est pas de l’eau qui se trouve au fond, mais des centaines, peut-être des milliers, de serpents – comme dans la petite pyramide, sans toutefois l’ersatz colossal qui y dormait. Myrkhan recule instinctivement… Mais Narjeva, quant à elle, s’avance sans plus attendre, et sans plus de difficultés, sur la poutre, en éclairant de sa torche – au bout de la passerelle se trouve une autre plateforme, un peu plus petite, avec une ouverture sur le côté ouest. La facilité avec laquelle la prêtresse de Nemmereth a franchi la poutre rassure un peu ses compagnons – surtout, en éclairant leur destination avec sa torche, elle leur facilite la tâche : tous les héros franchissent la poutre sans vrai problème. Ils sont maintenant libres d’emprunter le passage à l’ouest, lequel donne immédiatement sur un escalier montant à l’étage. Faut-il monter, ou descendre ? Les personnages peu ou prou unanimes décident de gagner le niveau supérieur – seul Myrkhan s’inquiétant de ce qu’on puisse les « prendre en traître » depuis le sous-sol.
Narjeva ouvre la marche. Au premier étage, il n’y a pour l’essentiel qu’une seule pièce, assez grande, plus ou moins en forme de croix. Au centre se trouve une colossale balance à plateaux métallique ; au niveau des murs ouest et est, il y a des fontaines perpétuellement alimentées d’une eau limpide – on trouve une amphore à côté de chaque bassin. En haut du mur sud, il y a une autre inscription en dialecte lémurien : « Égaux à jamais. » Pour Nepuul, à l’évidence, tout ceci renvoie à un rite matrimonial. Enfin, au coin sud-ouest se trouve une lourde porte en bois massif renforcé. Redhart la testant comprend qu’une barre de l’autre côté empêche de l’ouvrir. Il doit y avoir un mécanisme – lié à la balance. Que s’agit-il de peser ? Les époux ? Probablement pas… L’eau, sans doute – avec les amphores : il doit s’agir d’atteindre un parfait équilibre. La balance s’avère étonnamment sensible, ainsi que le constate Redhart – mais, en se coordonnant avec Nepuul sur l’autre plateau, ils parviennent à atteindre l’égalité de poids. Aussitôt, un déclic se fait entendre, en provenance de la porte au sud-ouest – laquelle donne à nouveau sur un escalier menant à un niveau supérieur.
Les héros arrivent au deuxième étage – qui est aussi le dernier. Là encore, passé un étroit vestibule, et une porte en bois ouvragé, ornée cette fois de figures érotiques voire pornographiques, il n’y a qu’une seule pièce, et en forme de croix. Au milieu de la pièce se trouvent deux blocs de marbre noir lisse qui se font face. Au nord, il y a une porte de bronze à double battant, répondant à celle du rez-de-chaussée – Narjeva croit distinguer quelques bruits de l’autre côté, sans vraiment comprendre de quoi il peut bien s’agir. Sur le mur sud, une autre inscription en dialecte lémurien proclame : « Unis à jamais. » La prêtresse de Nemmereth comprend aussitôt qu’il faut rapprocher les deux blocs de marbre noir – et Redhart jetant un œil à l’espace qui les sépare constate qu’il y a des traces de mouvement. L’ex-marin de Parsool se charge d’un des piliers, Liu Jun-Mi de l’autre, et les deux colosses constatent que leur force physique n’était pas nécessaire – les deux blocs coulissent aisément jusqu’à ne plus en former qu’un ; aussitôt, la double porte donnant sur la terrasse s’ouvre automatiquement…
II : LA SLORTH ET LES SIENS
… et, sur la terrasse, les héros découvrent une gigantesque slorth, furieuse, qui siffle en se dressant tel un cobra d’une taille inouïe ! Mais elle n’est pas seule : le couple formé par Orom et Dill Sendak, jusqu’alors en adoration devant sa divinité, perçoit l’intrusion des personnages – et si la jeune fille demeure ébahie sans trop savoir comment réagir pour l’heure, le guerrier miti, qui arbore des tatouages serpentins sur tout son corps musculeux, et dont la peau vaguement violacée trahit sa consommation de liqueur de férocine à haute dose, succombe à la fureur, et s’empare en hurlant de son épée longue ! Enfin, quatre enfants qui dormaient lovés dans les gigantesques anneaux de la femme-serpent s’éveillent peu à peu… et perçoivent aussitôt les héros comme des ennemis mortels de leur déesse et mère.
Nepuul interpelle Dill Sendak, l’enjoignant de les rejoindre : « Ces créatures sont dangereuses ! » Mais la fille semble stupéfiée par cette déclaration… Redhart ne se pose pas davantage de questions : hurlant à Liu Jun-Mi de s’emparer de la fiancée volage, le mercenaire de Parsool assène un brutal coup de hache à la slorth, en pleine face – la créature est grièvement blessée, et de toute évidence surprise par la violence de l’attaque, ses traits féminins en témoignent ; mais elle n’en est que plus enragée, elle fixe son ennemi avec son regard si étrangement intense – et le mercenaire hypnotisé se retrouve paralysé, incapable du moindre geste ! Narjeva essaye de profiter de ce que la femme-serpent est occupée avec Redhart pour la prendre à revers – elle se faufile vers le bord de la terrasse. Myrkhan décoche quant à lui une flèche empoisonnée à Orom ; il blesse le barbare au bras gauche, mais ça ne paraît pas le gêner véritablement… Liu Jun-Mi, enfin, tente sans succès de donner un coup de fouet à la slorth… Les quatre enfants, maintenant pleinement réveillés, se ruent sur les héros : ils ne sont pas en mesure de leur infliger des dégâts, mais gêneront par contre leurs déplacements et leurs attaques ; ils n’ont pas le moins du monde peur, ils sont très agressifs…
Nepuul, intimidé par la slorth, ne sait pas trop comment aider ses camarades – il porte la main à sa potion de feu alchimique, mais sait qu’il blesserait immanquablement de la sorte, non seulement leurs ennemis, mais aussi ses compagnons et les enfants…Orom attaque Liu Jun-Mi avec son épée longue, en poussant un cri de rage – et le gladiateur aurait été très sévèrement blessé, si un pas de côté à la dernière seconde n’avait pas atténué les dégâts… La slorth siffle et fait appel à sa magie pour soigner les blessures que lui avait infligées Redhart : le mercenaire, qui reprend peu à peu ses esprits, voit les plaies se refermer d’elles-mêmes, à une vitesse inouïe ! Narjeva aussi a assisté au phénomène – mais un enfant s’est jeté entre ses jambes et l’empêche d’agir… Myrkhan a choisi d’ignorer le petit qui s’en prenait à lui, mais il s’en faut de peu, au moment où il tire sur la slorth, qu’il se mette sur son passage et encaisse la flèche en lieu et place de la cible… Liu Jun-Mi, quant à lui, choisit de s’en prendre à Orom à mains nues, dans le but de le désarmer – les deux combattants sont de vraies montagnes de muscles… et pour l’heure c’est le Miti qui l’emporte sur le Ghataï.
Nepuul crie pour distraire la slorth et attirer son attention – en vain, sans surprise… Mais Redhart, libéré de sa paralysie, peut à nouveau s’en prendre à la créature des Rois-Sorciers, en choisissant lui aussi d’ignorer le gamin dans ses pattes – mais c’est une vraie plaie, et le coup du mercenaire ne porte pas. Orom est occupé avec Liu Jun-Mi – et cette fois le gladiateur prend de plein fouet l’assaut de l’ex-pilote de nef ; il est presque à l’agonie… La slorth quant à elle choisit de changer de cible : elle délaisse Redhart pour Myrkhan – et c’est cette fois l’archer de Tyrus qui est paralysé par son regard hypnotique. Narjeva de son côté choisit de bondir sur le dos de la femme-serpent – ce qui lui confèrera un avantage pour l’attaquer ultérieurement ; elle a au passage envoyé balader le petit garçon qui l’ennuyait – lequel renverse un piédestal auquel les personnages n’avaient pas vraiment eu l’occasion de faire attention jusqu’alors ; en tombe… un crâne humanoïde, dénué de toute chair, mais dont les yeux demeurent dans les orbites… et bougent… et suivent visiblement les faits et gestes des combattants ! Liu Jun-Mi, aux abois, tente le tout pour le tout : une nouvelle manœuvre de désarmement. Et, cette fois, il réussit ! Il contraint Orom à lâcher sa précieuse épée longue… Le Ghataï remarque au passage que Dill Sendak, visiblement effarée, suit d’un air désespéré l’évolution du combat : au moment où il a désarmé Orom, la jeune fille a instinctivement porté la main à la dague qu’elle a attaché à sa ceinture…
Nepuul avance, sans savoir que faire pour aider ses compagnons… Mais il voit alors le crâne qui a roulé au sol – un objet qui l’intrigue, mais il ne peut pas en déduire quoi que ce soit pour l’heure. Redhart hurle en portant un nouveau coup de hache à la slorth, mais rate sa cible – laquelle, furieuse de l’outrecuidance de Narjeva qui lui a bondi dessus, se débat violemment pour la désarçonner ; et la colossale femme-serpent y parvient enfin : elle propulse l’assassin contre un mur, un coup très rude qui la contraint à lâcher sa rapière – elle avance à quatre pattes en direction du crâne… Myrkhan, qui n’est plus paralysé, tire à nouveau sur la slorth, en visant la tête – il blesse la créature magique, qui souffre visiblement… mais pousse un sifflement assourdissant : ses plaies se referment à nouveau ! Orom s’est désengagé de l’emprise de Liu Jun-Mi pour tenter de ramasser son épée ; le gladiateur s’en doute bien, et espère en profiter, en faisant une manœuvre destinée à l’immobiliser : le Miti doit à nouveau lâcher son arme à peine ramassée, et la forte poigne du Ghataï l’étouffe !
Nepuul essaye de débarrasser Myrkhan et dans une moindre mesure Liu Jun-Mi des enfants qui les gênent, mais ces petits démons glissent comme des anguilles. Redhart, lui, s’en moque, et balance à nouveau un brutal coup de sa hache d’abordage de Parsool… qui passe à côté. Orom essaye de se libérer de l’emprise de Liu Jun-Mi, mais ce dernier, un gladiateur formé à bonne école, le domine toujours. La slorth, emportée par sa rage, n’use pas cette fois de son pouvoir de paralysie, et cherche plutôt à mordre Redhart – cependant, la créature n’est pas des plus agile, avec sa masse conséquente, et le mercenaire l’esquive sans trop de difficultés. Narjeva, toujours au sol, se détourne de la slorth : le rictus moqueur du crâne l’insupporte au plus haut point : elle s’en saisit, et en perce les yeux avec ses ongles ! Mais elle comprend aussitôt que ce geste impulsif n’était pas une très bonne idée – une sensation désagréable s’empare d’elle, avec la conviction de faire l’objet d’une malédiction pour s’en être prise ainsi à ce qu’elle comprend être le crâne d’un Roi-Sorcier… Même percés, ces yeux la fixent en ricanant ! Myrkhan, lui, s’en prend toujours à la slorth… et rate lamentablement : sa flèche perce la gorge d’un des enfants, qui meurt sur le coup ! Liu Jun-Mi, confiant en sa force, tente d’asphyxier Orom entre ses bras puissants – manœuvre audacieuse, sa proie est forte comme un bubalus… mais le gladiateur, sans étouffer totalement le Miti, le place bel et bien dans une situation très inconfortable – il lui devient plus difficile encore de se débattre pour se libérer ! Le Ghataï constate aussi que Dill Sendak s’est cette fois emparée de sa dague… et semble plutôt disposée à la retourner contre elle : il hurle à ses compagnons de s’occuper d’elle !
Nepuul agacé par les enfants cherche à en assommer un avec son bâton, mais il n’est pas suffisamment agile… Redhart ne se montre pas plus efficace de son côté contre la slorth ! Orom gonfle ses poumons, lâche un cri primal, et met tout ce qu’il a pour se libérer de l’emprise de Liu Jun-Mi : puisant dans ses dernières ressources, le Miti parvient enfin à repousser le Ghataï. La slorth furieuse vise Myrkhan, mais ses crocs n’inquiètent pas le moins du monde l’archer de Tyrus. Narjeva, du fait de la malédiction des Rois-Sorciers, se montre indécise… Myrkhan quant à lui continue de s’en prendre à la slorth – et il n’y a plus de gamin pénible pour le gêner : assurant son tir, il vise l’œil de la créature reptilienne – il touche, la femme-serpent fait une fois encore appel à ses facultés de guérison, mais il apparaît évident à tous qu’elle n’a pas des réserves infinies : elle ne pourra pas continuer ainsi très longtemps. Liu Jun-Mi repoussé par Orom lui inflige cependant un violent coup de coude au visage – le Miti chancelle : il suffirait de pas grand-chose pour l’achever…
Nepuul, en désespoir de cause, se dirige vers Dill Sendak pour la maîtriser – ce qui implique de passer à côté de la slorth ; la masse de la créature, et ses mouvements intempestifs, gênent l’alchimiste dans son déplacement. Redhart cependant parvient enfin à placer un coup dévastateur : il décapite la slorth ! La tête de la créature est propulsée hors de la terrasse dans un ultime sifflement, tandis que les anneaux du corps serpentin s’affaissent lourdement… Les enfants et Dill Sendak poussent alors un hurlement de désespoir ! Orom n’en pense visiblement pas moins… mais la férocine s’est emparée de lui, il n’est pas en mesure de faire autre chose que combattre Liu Jun-Mi, sans même chercher à ramasser son arme : il se projette en avant, tel un bolide, et Liu Jun-Mi déjà bien amoché ne parvient à l’esquiver qu’in extremis… Mais le Miti percute le mur à toute vitesse ! Narjeva, consciente des intentions suicidaires de Dill Sendak, se précipite sur la jeune fille et interrompt son geste au dernier moment, la saisissant par le bras juste avant qu’elle ne s’éventre avec sa dague ! Elle la maîtrise – ils doivent la ramener vivante… Débarrassé de la slorth, Myrkhan s’en prend désormais à Orom : une ultime flèche dans le dos abat le colosse désespéré.
Dill Sendak hurle de chagrin, mais Narjeva l’empêche de faire tout geste malavisé… Les enfants sont dans un même état d’esprit, terrifiés et affligés de ce qui s’est passé sous leurs yeux… Trop en fait pour s’en prendre aux personnages ou les gêner de quelque manière que ce soit : leur monde s’est effondré. Redhart rejoint Narjeva : ensemble, ils ligotent (et bâillonnent) la jeune noble – qui finit par se laisser faire, les yeux dans le vide, y compris quand le mercenaire de Parsool la place sur son épaule, comme un fagot ; une dose d’yzane administrée par Nepuul Qomrax se montre utile à cet effet.
Mais Liu Jun-Mi, qui s’est beaucoup dépensé dans le combat contre Orom, ressent enfin la douleur de ses nombreuses blessures : il appelle Nepuul à l’aide, le médecin faisant de son mieux pour stabiliser l’état de son patient et lui apporter un semblant de réconfort immédiat. Redhart suggère à son ami ghataï de faire dès que possible l’acquisition d’une armure et d’une bonne lame en acier… Cela dit, le gladiateur ne manquait certes pas de style : à mains nues contre un colosse armé d’une épée longue ! Impressionnant…
III : FUIR LE SANCTUAIRE
Mais les personnages ne peuvent pas s’attarder : le combat sur la terrasse, et les hurlements de Dill Sendak et des enfants, ont réveillé les prêtres mitis dans le dortoir – Narjeva et Nepuul entendent qu’il y a de l’agitation dans la partie sud du sanctuaire…
La terrasse se situe à une bonne douzaine de mètres de hauteur – et redescendre par les escaliers risquerait de prendre du temps. Cependant, la pente de la pyramide n’est pas trop brutale, et la pierre noire et lisse offre une issue tentante – Redhart aussi bien que Narjeva sont très enthousiastes à cette idée ! D’autant que les personnages se retrouveraient ainsi immédiatement face au mur nord du sanctuaire : ils n'auraient alors plus qu’à le franchir, et filer jusqu’à la nef volante d’Orom ! Nepuul et Redhart sont relativement confiants dans leur aptitude à faire décoller l’appareil.
L’alchimiste hésite à emporter le crâne du Roi-Sorcier – dont les yeux percés par les ongles de Narjeva se sont entre-temps reconstitués. Mais il y renonce finalement : le poids de la malédiction, qu’il devine, serait trop lourd à porter, dans pareille situation d’urgence ; l’alchimiste sait bien qu’il se trouverait de ses plus habiles confrères, et plus encore de puissants sorciers, pour débourser des sommes folles afin d’acquérir pareil objet… mais ce n’est vraiment pas le moment. Dans un soupir, il laisse là le crâne moqueur...
Les héros quittent donc la terrasse en glissant sur la pente de la pyramide ! Une décision grisante, dont ils se tirent bien – même si Liu Jun-Mi et Narjeva y récoltent quelques bleus au passage : rien de bien méchant dans l’absolu, mais le gladiateur était déjà bien abîmé par son combat contre Orom… C’était tout de même le meilleur moyen de regagner en vitesse le plancher des bubalus.
Les personnages se retrouvent donc en face de la muraille nord, tandis que des cris proviennent du dortoir plus au sud – et la lumière de torches se devine dans cette direction. Il faut partir au plus vite : Myrkhan lance le grappin par-dessus la muraille, qu’il leur faudra escalader rapidement. Hélas, l’affaire se montre bien vite laborieuse ! Si Redhart parvient à monter sans souci, même avec l’encombrante Dill Sendak, de même que Narjeva puis, plus difficilement, Liu Jun-Mi blessé, Nepuul et Myrkhan échouent quant à eux à plusieurs reprises, et sont toujours à l’intérieur du sanctuaire quand une première vague de cinq prêtres mitis arrivent sur les lieux…
Le Zaluti, qui échoue encore à grimper, se résout enfin à saisir sa potion de feu alchimique, prêt à en faire usage sur les arrivants ! Narjeva, sur le rempart, se munit de son arc, mais les prêtres attaquent les premiers – ils blessent l’alchimiste, mais pas l’archer de Tyrus ; ce dernier tente de riposter avec sa hache, mais n’a pas davantage de succès. Voyant comment la situation évolue, Redhart abandonne Dill Sendak ligotée et saute de la muraille à l’intérieur du sanctuaire, sa hache d’abordage de Parsool dirigée contre les assaillants de Nepuul… mais il se réceptionne mal ! L’alchimiste tente le tout pour le tout : criant à ses amis de se reculer (ce qui n’a rien d’évident pour Redhart, dans ces conditions…), il jette sa potion de feu alchimique sur les prêtres : le liquide brûlant se répand dans une gerbe de flammes, sur un rayon de trois mètres… et les Mitis n’en réchappent pas ! Problème : Nepuul lui-même ainsi que Redhart sont eux aussi blessés, et assez sévèrement…
Mais ils ont gagné du temps : ils peuvent tous retenter de grimper, avant qu’une deuxième vague de prêtres, qu’ils entendent à distance, les rejoigne. C’est laborieux, mais, en s’aidant autant que possible, tous parviennent enfin à franchir la muraille… De l’autre côté, pour l’heure, ils ne sont pas menacés. Ils courent, autant que possible (car Liu Jun-Mi, Nepuul et Redhart sont assez méchamment blessés), dans la direction du nord, pour rejoindre la clairière où Orom a posé la nef volante qu’il avait empruntée.
Une fois monté à bord de l’appareil, Nepuul gagne le poste de pilotage, dont il a compris le fonctionnement – quelques souvenirs lui reviennent, du temps où il avait vu des confrères travailler sur des plans de ces engins commandés par la cité de Satarla. Il a besoin, idéalement, de deux assistants : le passé de marin de Redhart le désigne aussitôt, mais ce dernier fait en sorte de compléter les instructions de l’alchimiste pour Liu Jun-Mi. Redhart confie l’arbalète lourde de la proue à Myrkhan, et Narjeva guette les environs, armée de son arc. Les prêtres approchent, à en croire les bruits qui viennent du sud… Mais, alors qu’ils sont encore à la limite de la clairière, Redhart vainc une pénible difficulté sur une poulie, et donne à Liu Jun-Mi les instructions qui lui permettront de faire de même : la nef décolle, et elle est bientôt hors de portée des flèches des Mitis…
IV : RETOUR À SATARLA
Une fois en sécurité dans les airs, tandis que la nuit les environne, les personnages prennent enfin le temps de respirer un peu et de se remettre de leurs blessures, une fois que Redhart, se repérant aux étoiles, a pu indiquer le sud-ouest, c’est-à-dire la direction de Satarla, à Nepuul. Ce dernier peut alors laisser temporairement le poste de pilotage à un de ses camarades, le temps de soigner les blessés – Liu Jun-Mi en tête, puis Redhart… et enfin lui-même.
Le voyage prend quelques heures : les conditions sont bien meilleures qu’à l’aller, et les personnages ne sont pas engagés dans une course-poursuite impliquant un pilotage davantage casse-cou. Nepuul et ses assistants se gardent bien de commettre la moindre imprudence.
Dill Sendak reprend peu à peu ses esprits – elle est désespérée… Bien sûr, ses ravisseurs la gardent ligotée : ils se doutent qu’elle ne manquerait pas, autrement, de se jeter par-dessus bord ! Narjeva la fait parler, cependant – en douceur, curieuse de connaître son histoire (et Redhart l’est tout autant, qui aimerait en savoir le plus possible avant de remettre la jeune fille à ses parents ou à son fiancé Tourmar Latia). Le récit de Dill est décousu, mais la prêtresse de Nemmereth en comprend les grandes lignes : elle est effondrée, le rite de mariage avec son bien-aimé Orom n’a pas pu être mené jusqu’à son terme, elle n’a pas reçu la bénédiction de la déesse S’pirr (Narjeva comprend qu’il s’agit du nom de la slorth) ; elle n’a aucune envie d’épouser cet ignoble imbécile « qui pue le bubalus » qu’est Tourmar Latia, elle hait ses parents qui l’ont vendu à ce bouseux pour se réargenter (ce qui inclut son frère Khalaman – Redhart lui annonce assez brutalement sa mort, mais elle s’en moque totalement…) ; elle hait tout autant cette bande de mercenaires sans foi ni loi qui a choisi de briser le rêve d’une vie contre monnaie sonnante et trébuchante, brutalisant au passage un peuple qui ne leur avait rien demandé…
Mais Narjeva comprend aussi, indirectement car Dill ne se montre pas explicite à ce propos, le fond de l'affaire : S’pirr était devenue folle, à l’époque de l’anéantissement des Rois-Sorciers, en prenant conscience de sa condition de slorth – une espèce purement femelle, qui ne pourrait jamais se reproduire, et ne comprendrait jamais des choses telles que le mariage. Son obsession l’a amenée à endosser un statut divin : s’insinuant dans une vieille pyramide de longue date délaissée, elle a travaillé pendant des siècles les mentalités de la tribu voisine des Mitis, jusqu’à bâtir une religion à sa gloire, qui serait centrée sur les rites du mariage et de la reproduction – d’où le cheminement spirituel marqué de la pyramide reconvertie, mais aussi l’injonction, pour tous les Mitis, de se marier au village et selon le rite du village, soit le rite de S’pirr ; la « déesse » poussait les guerriers de la tribu à chercher voire enlever des femmes issues d’autres peuples pour varier les cérémonies, d’où les origines ethniques très diverses constatées par Myrkhan quand il avait espionné le village ; mais si la slorth vivait ainsi l’amour par procuration, elle était tout autant avide d’une maternité qu’elle ne pourrait jamais connaître pour elle-même, et s’accaparait aussi tous les enfants du village jusqu’à l’âge de dix ans environ – et c’est bien pour cela que « ses » enfants étaient confinés dans le sanctuaire.
Les héros (?) arrivent enfin au « Joyau de la Lémurie », Redhart disposant un drapeau blanc à la proue pour ne pas inquiéter les autres nefs volantes. Nepuul dirige l’appareil vers la résidence des Sendak, où il se pose. Les Sendak accourent aussitôt, et c’est Redhart, bonhomme franc du collier au point parfois de la naïveté et en tout cas de l'indélicatesse, qui leur dresse un rapport sans complaisance ; leur fille « est complètement zinzin », elle veut se tuer, oh, et Khalaman Sendak est mort, aussi, etc. Les Sendak le prennent de haut, et la mort de leur fils les affecte visiblement, mais les personnages leur rendant la garde de son épée, et Nepuul ayant bien noté l’emplacement de sa tombe de fortune destinée à le protéger des charognards, les nobles ne peuvent finalement par leur reprocher grand-chose, et, s’ils ne vont pas tout à fait jusqu’à les remercier, du moins ne leur causeront-ils pas d’ennuis.
Du côté de Tourmar Latia, l’accueil est bien plus enthousiaste : le riche commerçant se moque du sort de Khalaman Sendak ou de ces sauvages dont il n’a que faire, la seule chose qui importe est qu’on lui a ramenée sa fiancée – le mariage aura bien lieu, et tant pis si cela ne sied pas à la jeune fille ! De toute façon, il ne cherchera pas à s’en faire aimer, pour lui ça n’est jamais qu’un moyen tant attendu de sortir de sa roture… Dès lors, Tourmar Latia ne reviendra pas sur sa promesse : en bon homme d’affaires, fidèle à sa parole, il fait amener une gigantesque balance, dans laquelle il installe littéralement Dill Sendak – déterminant son poids en ajoutant minutieusement pièces d’or, pierres précieuses et autres biens de valeurs dans l’autre plateau, en écho mesquin de la salle du premier étage de la pyramide… Les personnages quittent sa propriété avec une fortune impressionnante !
V : DÉPENSER LE BUTIN !
… Mais il n’en restera comme de juste à peu près rien quand ils débuteront leur prochaine aventure. C’est ainsi que font les héros qui arpentent la Lémurie : ils ne sont que rarement du genre à capitaliser… Comment dépensent-ils donc leur butin ?
Nepuul Qomrax échange l’intégralité de son salaire contre des composants alchimiques rares, qu’il achète auprès d’aventuriers parfois commissionnés par ses soins ; son laboratoire de Satarla se remplit ainsi de dizaines, de centaines d’ingrédients étranges : l’alchimiste n’a aucune idée de ce qu’il va en faire pour l’heure, mais est tout de même très satisfait de sa frénésie d’achats – il en fera forcément quelque chose un jour ou l’autre… Et il réfléchit, notamment, à faire une arme à partir de la corne d’elasmotherium qu’il a ramenée des Plaines de Klaar.
Redhart Finken rentre à Parsool, et commence par se livrer à des dépenses somptuaires ; puis il engloutit beaucoup d’argent dans des beuveries épiques, ou en dons aux membres de sa famille. L’essentiel, cependant, il l’investit dans une affaire que lui suggère un de ses six frères – le plus roué... et qui va le rouler, même si Redhart ne s’en rend pas encore compte : son frère lui fait miroiter de magnifiques opportunités de commerce, impliquant d’affréter un très dispendieux navire ; c’est chose faite… mais le bateau disparaît bien vite au large, et Redhart commence à s’étonner de ce qu’il ne revienne toujours pas, avec tous les trésors promis ; un contretemps, sans doute…
Myrkhan est retourné à Tyrus. Il entend se poser en protecteur des gamins de rues, lui qui en était encore un il n’y a pas si longtemps. Prisant maintenant la discipline, depuis son passage dans l'armée de la cité, il entend élever ces petites canailles pour en faire des soldats efficaces – mais si les enfants acceptent volontiers ses dons, ils n’ont aucune intention de satisfaire ses ambitions ; bien au contraire, la protection de Myrkhan leur paraît un gage d’impunité, et ils chapardent plus que jamais – les commerçants dépossédés sont ravis d’avoir quelqu’un à qui adresser la facture, et Myrkhan perd bien vite tout son butin… Voire un peu plus : il doit quitter précipitamment Tyrus quand il n’est plus en mesure d’honorer les dettes des gamins de la ville !
Liu Jun-Mi prend quelques vacances… puis décide de se procurer un ours : peut-être se montrera-t-il plus utile que ces satanés et capricieux yi qi !
Narjeva, enfin, ne prise pas plus que cela l’argent. Elle fait un don très conséquent au culte de Nemmereth, notamment dans sa ville natale d’Urceb – elle en attend une certaine reconnaissance en contrepartie. Elle se livre bien à quelques emplettes pour améliorer son matériel d’assassin… Mais, surtout, elle tend à ruminer ses mauvaises expériences dans les Plaines de Klaar ; dans un geste futile, elle finance une petite expédition de chasseurs pour lui ramener des peaux de crocators – elle s’en ferait bien un sac et des bottes…
Le scénario Mariage amer s’achève ici. Mais les aventures de nos héros se poursuivront dans un autre scénario, très probablement officiel, que je n'ai pas encore choisi (j'ai plusieurs pistes).
Et donc : à suivre…


/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





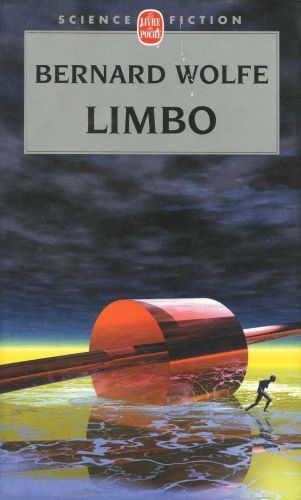








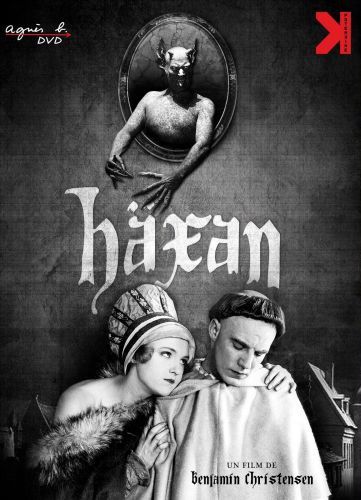
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)