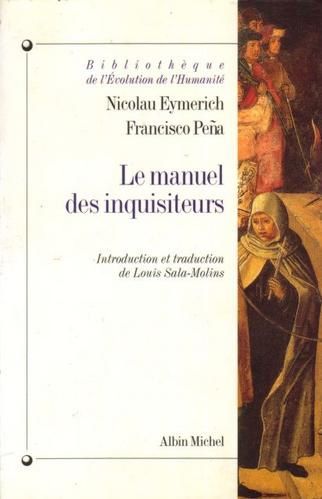
EYMERICH (Nicolau) & PEÑA (Francisco), Le manuel des inquisiteurs, introduction, traduction et notes de Louis Sala-Molins, Paris, Albin Michel, coll. Bibliothèque de l’Evolution de l’Humanité, [1973, 2001] 2002, 298 p.
… ou comment joindre l’utile à l’agréable, en l’occurrence en partant d’une fort sympathique lecture de science-fiction pour aboutir à une passionnante étude d’histoire du droit.
Nicolau (ou Nicolas, c’est bien du même qu’il s’agit) Eymerich, vous le connaissez probablement déjà ; et si ce n’est pas le cas, il vous suffit de jeter un œil à mon précédent compte rendu : en envisageant le premier volume de la fameuse saga de Valerio Evangelisti, j’avais déjà eu l’occasion de dire quelques mots du véritable Nicolas Eymerich, qui fut un des plus fameux inquisiteurs de son temps. Il a acquis la majeure partie de sa réputation en rédigeant en Avignon aux environs de 1376 ce Manuel des inquisiteurs (ou Directorium inquisitorum, en latin dans le texte) à nul autre pareil. En effet, à la différence des ouvrages du même genre qui l’ont précédé, comme la célèbre Practica officii Inquisitionis de Bernard Gui, et de la plupart de ceux qui l’ont suivi, comme le plus célèbre encore Malleus Maleficarum, ou Marteau des sorcières, de Henry Institoris et Jacques Sprenger (dont je vous reparlerai sans doute un de ces jours), le livre d’Eymerich ne se contente pas de répertorier textes, cas et anecdotes issus de la pratique inquisitoriale, mais se veut à proprement parler un manuel, un ouvrage technique et utile aux praticiens, bâti sur un solide fond théologico-juridique, et qui soit réellement précieux aux inquisiteurs, en étant en mesure de répondre à toutes les questions que ces juges d’un genre particulier peuvent être amenés à se poser dans l’exercice de leur charge. Citons l’introduction de Louis Sala-Molins (pp. 15-18) :
« Comme le notait A. Dondaine, Eymerich n’offre pas seulement comme ses prédécesseurs en droit inquisitorial des collections de textes juridiques et des récits de sentences – autant de fioritures à des descriptions longues, précises, méticuleuses, de la vie et les mœurs et les croyances de tel ou tel hérétique, des tenants de telle ou telle secte, le tout dans un certain désordre et entrelardé encore de longues dissertations apologétiques bâties sur des événements de valeur circonstancielle ; Eymerich « offre un traité systématique complètement élaboré en vue du seul exercice de la fonction ». L’œuvre d’Eymerich est plus que le manuel : c’est le directoire de l’inquisiteur. Eymerich réalise en droit inquisitorial ce que son compatriote et son frère en religion Raymond de Penyafort réalisa en droit canonique. C’est dire qu’Eymerich n’invente jamais : il lit, compare, collationne, confronte. Pas une ligne de son manuel qui ne renvoie aux textes conciliaires, bibliques, impériaux ou pontificaux. Pas une réflexion « personnelle » que n’étayent des passages de l’Ecriture ou de la patristique. Pas une astuce théologique que ne vienne justifier l’autorité de Thomas d’Aquin ou de quelque grand théologien. Et lorsque le doute est permis, Eymerich aligne, avec des scrupules de chartiste, les thèses en présence, qu’elles se contredisent ou qu’elles se complètent. Une somme, enracinée dans les textes, et dans laquelle s’enracine tout naturellement la procédure ; sa structuration parfaite fait sa parfaite clarté et son parfait mérite. Par souci d’efficacité, Eymerich disparaît derrière son texte, sauf à de rares exceptions et il ne se réfère que parcimonieusement à sa propre expérience d’inquisiteur. Si la neutralité – et l’innocence – existait en matière de compilation de textes juridiques ou théologiques, Eymerich serait un neutre – et un innocent. Et si l’institution avait une mémoire, le manuel qu’écrivait Eymerich serait cette mémoire.
« L’inquisiteur catalan part d’une constatation primaire : tout inquisiteur doit utiliser, dans l’exercice de sa charge, d’innombrables textes de diverses catégories dont personne n’a entrepris le regroupement complet. L’inquisiteur doit puiser dans les canons, dans les lois des empereurs et des rois, dans les constitutions, dans les appareils, les gloses, les encycliques, les chartes de privilèges et d’indults royaux, pontificaux, épiscopaux, dans les instructions des Inquisitions locales et dans celles des provinciaux des ordres religieux…, puiser de quoi s’éclairer. Et cela à chaque stade de l’exercice de sa fonction ; en enquêtant, en « processant », en condamnant, en torturant, en acquittant. Or, il n’existe pas de collection complète de tout ce matériel. D’où, fatalement, des risques graves d’erreur de procédure, voire d’irrégularité, et un manque flagrant d’unité dans l’exercice de la fonction inquisitoriale. Il faut donc, dit Eymerich, « regrouper en un seul livre les textes épars, et non pas au hasard, mais de telle sorte que rien n’y manque et que tout s’y ordonne harmonieusement ». Et le manuel naît, intégrant dans une seule trame « les canons, les lois, les constitutions, les appareils, les déterminations, les condamnations, les prohibitions, les approbations, les confirmations et les réponses, les lettres apostoliques, les indults, les conseils, l’analyse des erreurs des hérétiques ». A cette compilation, Eymerich ajoute encore – s’inspirant en cela de ses prédécesseurs – de nombreux formulaires, des modèles de rédaction de sentences, des formules d’abjuration et de condamnation, etc. Il regroupe enfin – citons-le mot à mot – « tout ce qui est nécessaire à l’exercice de l’Inquisition ».
« Mais la procédure n’est qu’un aspect des préoccupations de ce théologien qu’est aussi Eymerich. Il lui faut une argumentation dépassant le strict cadre juridique et construite de telle façon que tout inquisiteur puisse s’y référer pour trouver une réponse adéquate à chacune des turpitudes mentales dont pourrait être capable le plus farfelu des hérétiques : « Le manuel comporte trois parties. Il est question dans la première de la foi catholique et de son enracinement. La deuxième parle de la méchanceté hérétique qu’il s’agit de contrer. La troisième est consacrée à la pratique de l’office, qu’il faut perpétuer. » Dixit Eymerich. Le décor est ainsi planté. Explicitée aussi, dès le prologue, l’intention profonde de l’inquisiteur. Et il n’est pas trop osé de dire que l’on tient là, dans cette division tripartite et dans l’ambition de l’ensemble, le secret de la survie du Directorium inquisitorum. »
En effet, l’œuvre d’Eymerich, rationnelle, systématique, organisée, présente un caractère d’intemporalité et d’universalité auquel ne pouvaient prétendre ses prédécesseurs. Dès lors, il n’y a finalement rien d’étonnant à ce que Rome ait témoigné de son intérêt particulier pour cet ouvrage, jusqu’à en faire son guide officiel de la pratique inquisitoriale. Elle le fait imprimer dès 1503, et l’ouvrage connaîtra cinq rééditions entre 1578 et 1607, cette fois avec les commentaires de Francesco Peña, docteur en droit canon et en droit civil, destinés à le mettre au goût du jour. On voit ici toute la portée du texte eymericien…
Le manuel des inquisiteurs est ainsi un texte fondamental pour qui s’intéresse à cette institution si particulière qu’est l’Inquisition, objet de tous les phantasmes. Et il me paraît nécessaire, à cet égard, de revenir sur l’introduction et les notes de Louis Sala-Molins à cette édition abrégée (puisque ne comportant qu’une sélection de textes renvoyant essentiellement à la procédure ; les premières et deuxièmes parties du plan eymericien sont ici sabrées ; or, aucune mention de ce fait ne figure, ni sur la couverture, ni sur la page de garde, et ce n’est qu’en lisant l’introduction que le lecteur profane en est finalement instruit, ce que je ne trouve pour ma part guère honnête… et aussi un tantinet regrettable. Louis Sala-Molins ne se montre d’ailleurs guère sous son meilleur jour eu égard à cette question ; voyez cette note de la p. 69 : « A la sortie de cette édition, tel historien nous reprochait de ne point lui avoir proposé tout le Directorium. Il avait raison, le cher homme. Le cœur lui en dit-il d’y brûler à notre place quelques années de sa vie ? Libre à lui. Ceux qui voudraient en savoir davantage, nous leur en suggérons le moyen : planter là notre raccourci et chercher dans une très bonne bibliothèque la Somme d’Eymerich. Aussi simple que ça. » Ah ben c’est sympa, merci, vraiment…).
Dans son introduction comme dans ses notes – et peut-être dans sa sélection ? Je n’oserais le dire, mais ce serait alors plus gênant… –, Louis Sala-Molins se montre en effet clairement partisan, et défend une thèse contraire à celle qui est retenue par la majeure partie des historiens. En gros, l’historiographie contemporaine est revenue sur l’image de l’Inquisition que le XVIIIe et le XIXe siècles nous avaient léguée, et qui reste très répandue aujourd’hui : celle d’une institution unique en son genre, sanguinaire et odieuse, torturant et brûlant à tour de bras. Il ne s’agit pas de nier ces caractères (ce qui serait un négationnisme pour le moins puant), mais simplement de relativiser le portrait : on a fait observer que l’Inquisition n’était pas aussi arbitraire qu’on le prétendait ; que, si elle avait commis bien des atrocités, le bilan devait probablement être revu à la baisse ; qu’on lui a imputé des crimes qu’elle n’a pas commis, et qu’elle n’était peut-être pas si unique que cela (rappelons, notamment, que le « grand flamboiement » de l’Europe aux XVIe et XVIIe siècles, l’époque des bûchers de sorcières, n’avait strictement rien à voir avec l’Inquisition, et d’ailleurs que les pires massacres de ce type, et de loin, ont été commis dans l’Allemagne protestante) ; enfin, que les pires éléments à charge la concernant ne s’appliquaient pas tant à l’Inquisition dans son ensemble qu’à sa version espagnole de l’époque moderne, largement étatique et subordonnée aux Rois Catholiques, qui avaient même créé un Sénat inquisitorial destiné à la réguler. Louis Sala-Molins conteste cette vision des choses, ce qui est parfaitement légitime : pour lui, le Manuel d’Eymerich montre justement que toutes les atrocités imputées à l’Inquisition peuvent (et doivent) l’être à l’institution dans son ensemble ; et le fait que ce soit Rome qui ait ordonné l’édition du manuel au XVIe siècle avec les commentaires de Francesco Peña montre bien que la prétendue Inquisition espagnole était avant tout romaine. Ce qui se tient, et est parfaitement défendable. Je ne saurais certainement pas prétendre être un spécialiste de la question, et ne peux donc me positionner dans le débat.
Pourtant, je tiens à faire quelques remarques concernant l’argumentaire déployé par l’éditeur. Il me semble en effet que Louis Sala-Molins se montre indéniablement désireux de critiquer et de stigmatiser l’Inquisition (dans la longue citation plus haut, le passage sur la « neutralité » et « l’innocence » en témoigne déjà) : pour le citoyen, pour le philosophe, c’est parfaitement légitime, et il va de soi que je n’en ferais certainement pas l’éloge de mon côté… Mais cette attitude me paraît bien plus dommageable chez l’historien ! Et l’on peut bien regretter qu’un certain anticléricalisme, à l’occasion, vienne parasiter l’analyse, et affaiblir la démonstration.
D’autant que plusieurs points de l’argumentaire de Louis Sala-Molins me paraissent hautement contestables ; ainsi quand – dans un discours d’ailleurs passablement contradictoire – il entend montrer le caractère « unique » de l’Inquisition et critiquer le relativisme « justifiant » la dureté de l’Inquisition par la dureté de l’époque, en arguant de sa tendance à se durcir à l’époque moderne (j’y reviendrai) là où la tendance générale serait à l’adoucissement du droit pénal (p. 68). Je me demande bien où il est allé cherché ça ! Loin de s’adoucir, le droit pénal et la procédure pénale des justices royales de l’époque moderne tendent bien au contraire à devenir de plus en plus sévères, l’Inquisition n’a ici rien d’une exception (voyez l’Histoire du droit pénal et de la justice criminelle de Jean-Marie Carbasse)… Et si les deux auteurs mettent en avant la spécificité de l'hérésie pour justifier des entorses au droit commun, les juristes royaux ne font à vrai dire pas autre chose, quand ils en viennent à traiter de la lèse-majesté et de la justice retenue du roi de France.
Le caractère « unique » de l’Inquisition, et le refus d’accorder un statut particulier à l’Inquisition espagnole (pour les raisons évoquées plus haut), me paraissent de même très contestables : si c’est bien Rome qui décide de l’édition du Manuel révisé par Francesco Peña, il n’en reste pas moins que cet ouvrage est destiné avant tout à l’Inquisition espagnole (le commentateur fait plusieurs fois références au Sénat inquisitorial et à la notion propre à l’Espagne de « vieux chrétien », inexistante du temps d’Eymerich, inconnue du reste de l’Europe, et établissant dans la péninsule ibérique une distinction, en gros, entre chrétiens « de souche », si j’ose employer cette immonde et absurde expression, et chrétiens « récents », comprendre par-là les Juifs et les musulmans convertis, qui restaient suspects sur plusieurs générations, conformément, par exemple, aux tristement célèbres statuts de Tolède : la haine religieuse cède ici le pas à une sorte de haine raciale, préfigurant le racisme « moderne » en dépassant la simple xénophobie) ; d’autant que, partout ailleurs en Europe, l’Inquisition n’est plus, soit qu’elle ait été balayée par la Réforme (qui, sans surprise, a traumatisé le bon docteur Peña ! Voyez cet édifiant formulaire d’accusation « moderne », donné en guise d’exemple p. 154 : « Moi, Augustin, fiscal de la Sainte Inquisition, j’accuse devant toi, Révérend Inquisiteur, le nommé Martin Luther d’avoir abandonné la foi catholique et adhéré à l’horrible hérésie manichéenne et à telle et telle autre hérésie, alors qu’il a été baptisé dans le catholicisme et que chacun le tient pour catholique. Je l’accuse de prêcher, d’écrire, de composer et d’affirmer d’innombrables dogmes hérétiques, faux, scandaleux et très suspects de convenir aux hérésies ci-dessus nommées. »), soit que ses fonctions, entre autres du fait des troubles suscités par le Grand Schisme et la crise conciliaire, puis, justement, par la Réforme, aient été récupérées par les justices étatiques, ainsi en France, où la poursuite de l’hérésie, la lutte contre la sorcellerie, contre le blasphème, bref, contre tout ce qui constitue la lèse-majesté divine, sont de la compétence des juges royaux, qui ont empiété sur les privilèges des juges ecclésiastiques, y compris de ces juges délégués que sont les inquisiteurs : à l’époque moderne, les ambitions de théocratie pontificale issues de la réforme grégorienne, qui imprègnent encore si manifestement le texte eymericien, ne sont plus qu’un vain souvenir… La survivance de l’Inquisition en Espagne est bien un cas particulier ; l’Inquisition espagnole, sur bien des points (et notamment sa haine des Juifs, et sa défiance de tous ceux qui ne peuvent s’honorer du titre de « vieux chrétiens »), doit être distinguée de l’Inquisition du temps d’Eymerich (qui s’en prenait bien aux Juifs convertis puis relaps, certes, mais comme à tout relaps, sans prévoir de statut particulier ; fait « amusant », au passage : le devoir imposé aux inquisiteurs de poursuivre et condamner les Juifs considérés hérétiques… par rapport à la loi mosaïque !) ; et les responsabilités sont partagées : les Rois Catholiques y ont leur part, sans doute bien plus importante que celle de Rome – ils ne feraient après tout que suivre l’exemple du Roi Très-Chrétien…
Sur tous ces points, encore une fois, je ne saurais prétendre être un spécialiste ; l’éditeur est évidemment bien plus compétent que moi, je ne fais que donner mes impressions… Il est un point, ceci dit, sur lequel je ne passe pas. Dans son combat farouche (et un tantinet arrogant : le style, lourd d'invectives, est pénible…) en faveur de sa thèse, Louis Sala-Molins en vient à commettre un impair qui me paraît cette fois impardonnable : mettre tous ses ennemis dans le même panier. Qu’il s’en prenne vertement à un sinistre sectateur de l’Opus Dei qui a plagié son édition du Manuel des inquisiteurs, et l’a utilisée au mépris de la raison et de la vérité pour en dresser finalement un éloge (!) de l’Inquisition, présentée comme une institution douce et humaine (!), c’est tout à fait normal : ces abominables personnages font de la propagande révisionniste, pas de l’histoire ; ce sont des escrocs, des menteurs, de la trempe des pires défenseurs scolastiques de la tyrannie. Je n’admets pas, par contre, que Louis Sala-Molins, par des tours de passe-passe, leur assimile des historiens compétents, qui ne font que relativiser la noirceur de l’institution inquisitoriale. Pour l’éditeur, remettre en cause le caractère unique de l’Inquisition, ou la comparer à d’autres institutions, est tout simplement criminel, et il emploie à nouveau ici le terme de « révisionnisme », avec les mêmes connotations (on oublie trop souvent aujourd’hui, en se cachant derrière des insultes, que la révision est une nécessité de l’étude de l’histoire…). Halte-là ! Cette fois, c’est un historien qui fait son travail ! Et pour ma part, je n’admets pas ce caractère prétendument unique de l’Inquisition : je crois, bien au contraire, qu’il est nécessaire, pour étudier cette institution, de l’étudier dans le temps, avec ses évolutions, sous ses différentes formes, et de la comparer éventuellement avec d’autres institutions vouées, notamment, à la police politique (qui m'intéresse plus particulièrement). Faute de quoi, on sacrifierait la science sur l’autel de la dénonciation anticléricale ; autant dire que l’on tomberait à son tour dans la police de la pensée… Et quand Louis Sala-Molins s’attaque aussi violemment à ceux qu’il appelle les « comparatistes », « sérialistes », « quantitativistes », « relativistes », etc., il ne diffère finalement guère d’Eymerich s’en prenant aux cathares, aux pélagiens, aux vaudois, aux photiniens, etc. Et de même quand il les range tous sous le vocable insultant de « révisionnistes », ne se livre-t-il pas lui même à la chasse aux hérétiques ? Pour ma part, j’ai toujours adopté une optique relativiste, que ce soit en matière d’histoire, de droit, de politique, de philosophie, ou de tout ce que vous voudrez. Le relativisme et le scepticisme seuls me semblent à même de constituer une science valable, quand bien même nécessairement imparfaite. L’attitude intransigeante de Louis Sala-Molins sur ces question me paraît donc franchement déplorable…
Mais tout cela, bien entendu, ne doit pas empêcher de lire sa longue introduction, souvent intéressante, ni a fortiori dispenser de lire le traité d’Eymerich. On y trouvera en effet bien des choses passionnantes.
Les textes sélectionnés par l’éditeur renvoient tous à la partie procédurale du manuel. On commence ainsi par envisager la « juridiction de l’inquisiteur ». Il s’agit ici de définir l’hérésie, de distinguer les différents types d’hérétiques (non en fonction de leur secte, mais selon qu’ils sont manifestes ou secrets, affirmatifs ou négatifs, etc.), les hérésiarques, les blasphémateurs, bref, tous ceux qui peuvent nécessiter l’intervention de l’inquisiteur. On voit ici que son champ de compétence est extrêmement large. La question est résumée plus loin (p. 252) :
« Nous avons déjà dit qu’il [l’inquisiteur] peut procéder contre les blasphémateurs, les jeteurs de sorts, les nécromanciens, les excommuniés, les apostats, les schismatiques, les néophytes revenus à leurs erreurs antérieures, les juifs, les infidèles vivant parmi les chrétiens, les invocateurs du diable. Mais disons d’une façon générale que l’inquisiteur « procède » contre tous les suspects d’hérésie, les diffamés d’hérésie, les hérétiques, leurs fidèles, ceux qui les hébergent, les défendent ou les favorisent et contre ceux qui mettent des entraves au Saint-Office, contre tous ceux qui, directement ou indirectement, retardent son action. »
Ce qui fait déjà beaucoup de monde… Mais le commentaire de Francesco Peña est ici particulièrement édifiant (ibid.) :
« Disons, d’une formule plus courte et plus claire que l’inquisiteur peut « procéder » contre tout le monde, hormis les quelques exceptions (le pape, ses légats, les évêques) tenant à la nature même de l’autorité déléguée de l’inquisiteur. »
L’air de rien, en passant ainsi d’une liste d’exceptions à une généralité, le docteur catalan du XVIe siècle étend considérablement la portée du texte eymericien, et c’est une pratique que l’on retrouvera souvent dans l’ouvrage. Disons-le franchement : très nombreux sont les passages d’Eymerich à même d’écœurer le lecteur ; mais les commentaires sont souvent bien pires… On constate un indéniable durcissement de la pratique inquisitoriale du XIVe au XVIe siècle, comme on le voit dans la longue partie suivante. Derrière la froideur de la procédure, la répétition des formulaires d’accusation, de délation (on y fait énormément appel, et on fait tout pour l’encourager…), d’abjuration, etc., on entend régulièrement les cris des prévenus détenus dans les prisons inquisitoriales (souhaitées horribles et sévères...), torturés ou condamnés au bûcher (quand bien même la torture n’était pas systématique, et le bûcher encore moins) : en matière d’hérésie s’instaure une véritable présomption de culpabilité ; le moindre faisceau d’éléments à charge (et la rumeur publique en fait partie), qui seraient d’un poids insuffisant pour que le juge « civil » fasse quoi que ce soit, légitime ici le recours à la torture, seul moyen d’obtenir l’aveu, « reine des preuves ». Eymerich se montre le plus souvent très dur, ici, mais un fond d’humanité le rattrape à l’occasion ; Peña, généralement, se montre bien plus catégorique : quand Eymerich rappelle (pour la condamnation, non pour la torture) la règle romaine testis unus, testis nullus, c’est pour inciter à rassembler le plus de témoignages possibles (sans retarder inconsidérément la procédure, ceci dit) ; Peña, lui, se contente à peu de choses près d’une lecture a minima de l’adage, selon laquelle deux témoignages concordants suffisent à condamner au bûcher…
On en jugera d’ailleurs par la petite sélection de citations effectuée par l’éditeur en exergue de l’ouvrage (p. 7). Seule une phrase d’Eymerich est retenue : « Tout ce que l’on fait pour la conversion des hérétiques, tout est grâce. » L’inquisiteur autorise ainsi de ruser avec l’hérétique, en jouant sur le sens du mot « grâce »… Nombreux sont les passages où Eymerich témoigne de sa ruse, d'ailleurs, d’une manière que l’on retrouve directement dans les romans de Valerio Evangelisti (un passage du Manuel fournit l’évidente inspiration d’un mémorable interrogatoire des Chaînes d’Eymerich…). Mais voyons maintenant le petit florilège de Peña (ibid.) :
« La finalité des procès et de la condamnation à mort n’est pas de sauver l’âme de l’accusé, mais de maintenir le bien public et de terroriser le peuple. » On le sait (voir ma note sur l’ouvrage de Jean-Marie Carbasse) ; mais la franchise de Peña n’en est pas moins frappante… Poursuivons :
« Le rôle de l’avocat est de presser l’accusé d’avouer et de se repentir, et de solliciter une pénitence pour le crime qu’il a commis. » Une conception originale… Ajoutons que, si Eymerich se montre déjà passablement réservé sur la possibilité d’accorder un défenseur à l’hérétique, Peña, lui, s’y oppose encore plus. Précisons enfin que le défenseur d’un hérétique… pouvait lui-même être poursuivi de ce seul fait, ce qui devait être assez dissuasif ! Mais continuons :
« Que tout soit fait pour que le pénitent ne puisse se proclamer innocent afin de ne pas donner au peuple le moindre motif de croire que la condamnation est injuste. » De toute évidence, Le Prince est passé par là…
« Bien qu’il soit dur de conduire au bûcher un innocent… », Peña juge tout de même cela préférable à la possibilité de laisser un coupable en liberté ; en cela, il n’était alors pas le seul, et il a beaucoup d’adeptes aujourd’hui…
« Je loue l’habitude de torturer les accusés. » L’air du temps… Eymerich comme Peña, ceci dit, expliquent que la torture n’est qu’un dernier recours, et nécessite en principe l’autorisation de l’évêque ; mais Peña, une fois de plus, se montre bien plus généreux pour l’inquisiteur… Et nous parlons ici de torturer l’accusé (normal, quoi…) ; mais la question se pose aussi de torturer les témoins… et obtient une réponse affirmative ! Bien évidemment (bande de petits sadiques !), nombre de pages sont consacrées à la torture ; ne vous attendez pas, ceci dit, à des anecdotes racoleuses, ou des descriptions des procédés : il n’y en a pas. On ne parle ici que de droit ; c’est amplement suffisant…
On pourrait continuer longtemps ainsi, notamment avec la partie qui clôt l’ouvrage, consacrée aux « questions afférentes », où l’aspect pratique du manuel ressort particulièrement (jusque dans les aspects financiers, où Eymerich se montre bien larmoyant...).
Le Manuel des inquisiteurs démontre assez la justesse de la phrase de Valerio Evangelisti (p. 61) : « On comprend que l’expression « légende noire » est effectivement impropre. La couleur était celle-là, mais ce n’était vraiment pas une légende. » Sans doute, ceci dit, vaut-il mieux avoir quelques connaissances de base en histoire médiévale et moderne, et plus encore en histoire du droit, pour apprécier pleinement l’ouvrage. Il serait dommage, en effet, de s’arrêter à la dénonciation scandalisée, dans l’esprit plus ou moins hypocrite de la « repentance » de Jean-Paul II en mars 2000 « pour les crimes et pour les horreurs de l’Inquisition »… Ces crimes ne sauraient faire de doute ; le traité eymericien témoigne d’un projet inconcevable et odieux pour qui le regarde du XXIe siècle débutant (... disons depuis une démocratie libérale telle que la France...). Mais d’un projet unique ? Incomparable ? D’une pure « histoire ancienne » ? Non. Je soutiens, quant à moi, qu’une lecture plus reposée, plus « froide » de cet ouvrage sera bien plus utile : relativiser l’Inquisition, c’est aussi l’identifier dans ses manifestations contemporaines, parfois bien pires – les précautions procédurales d’Eymerich étant mises de côté au nom d'une raison d'Etat qui n'a rien à envier à la pureté de la foi –, mais qui n’ont pas à subir ce juste stigmate d’infamie ; c’est enfin faire honneur à la science, au meilleur de l’homme que d’envisager ses pires aspects avec la justice que les chiens de garde des fanatismes en tous genres refusent à leurs « Ennemis » indifférenciés.

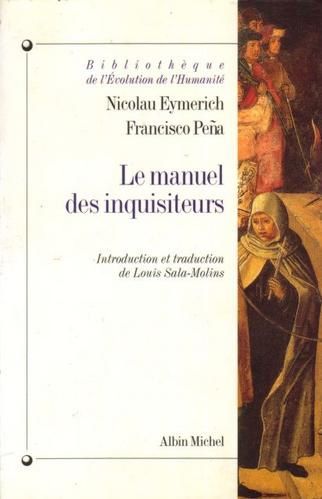

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)























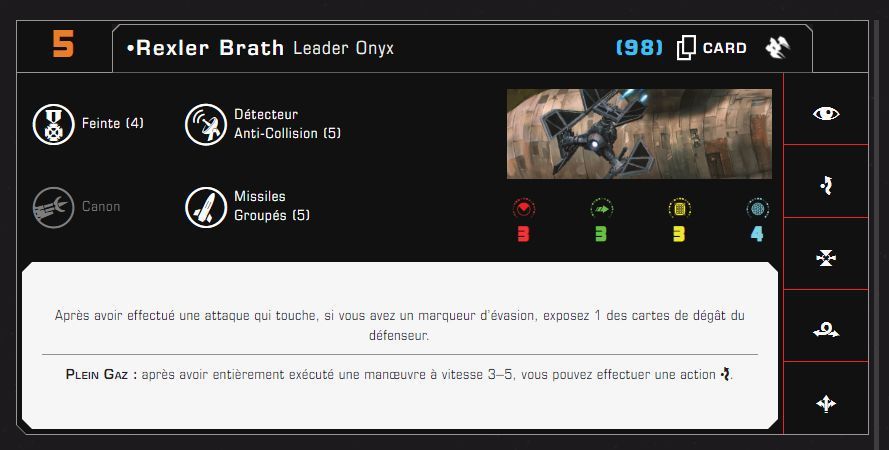



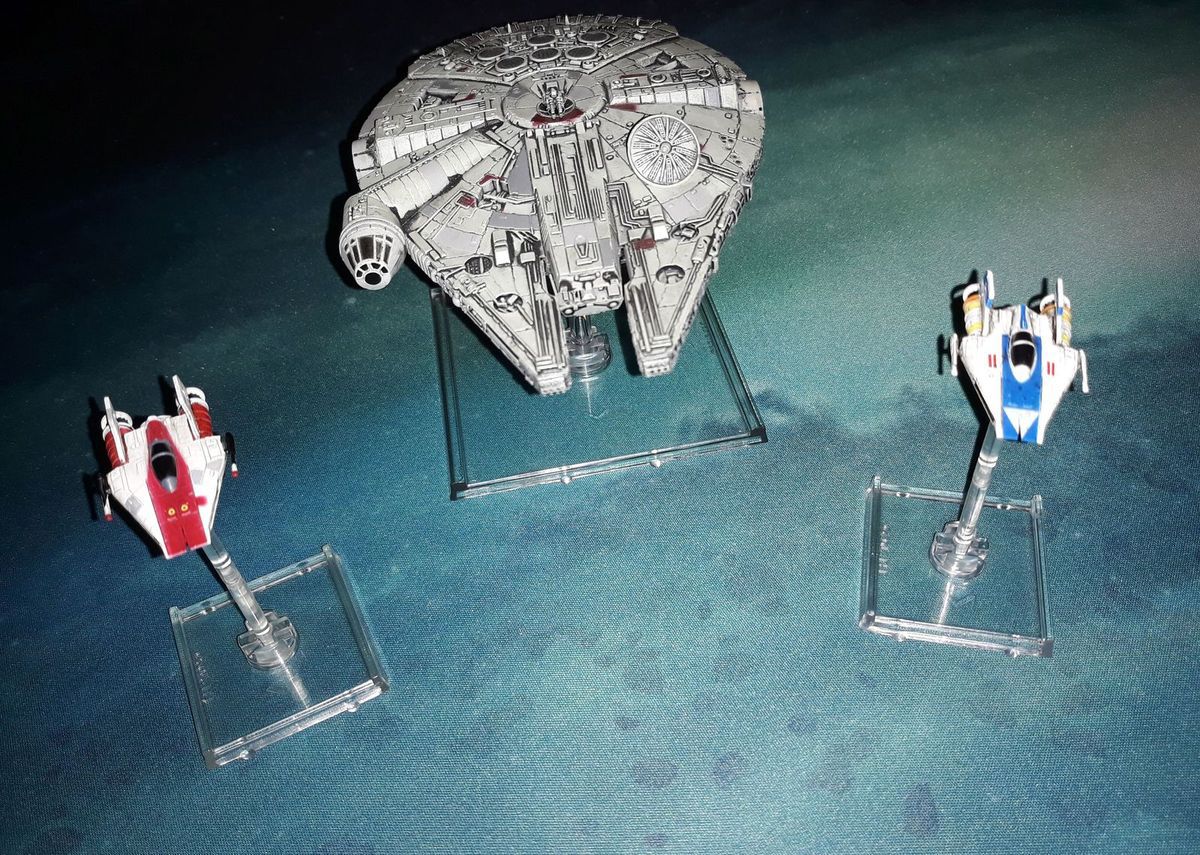





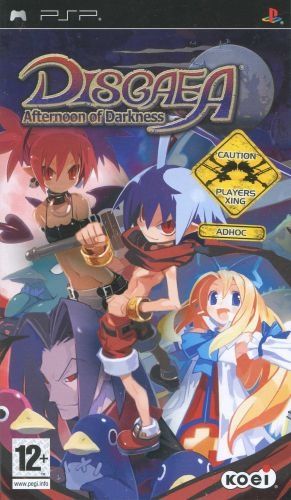

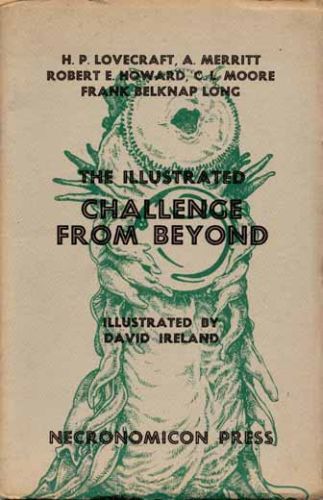

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)