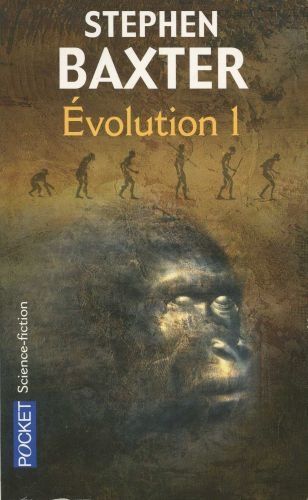
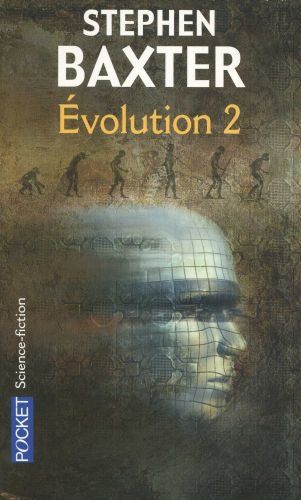
BAXTER (Stephen), Évolution, [Evolution], traduit de l’anglais par Dominique Haas et David Camus, Paris, Presses de la Cité – Pocket, coll. Science-fiction, [2003, 2005] 2008, 2 vol., 455 + 545 p.
Je commençais presque à désespérer de relire du bon Stephen Baxter. Mais c’est sans doute de ma faute, aussi : avec Les Vaisseaux du temps, puis Temps, c’est un auteur que j’ai découvert au sommet de son talent ; alors, nécessairement, le reste ne s'est pas montré pas aussi convaincant… Ces derniers temps, ainsi, j’ai quelque peu peiné sur Origine ; et j’ai trouvé Gravité (son premier roman, certes) passablement mauvais.
Mais j’avais encore Évolution qui traînait dans mon étagère de chevet. Un pavé (1000 pages en deux volumes, dans cette édition en poche ; mais il s’agit bien d’un unique roman, publié à l’origine en un volume d’environ 750 pages aux Presses de la Cité), sacrément ambitieux et intriguant : un roman se déroulant sur plusieurs centaines de millions d’années, et contant rien moins que l’évolution de l’humanité, du petit mammifère Purga survivant à grand peine au temps des dinosaures (avec déjà quelques vertigineux flash-backs…) jusqu’à la fin de la Terre dans un futur inconcevablement lointain. Un roman clairement axé hard science, très documenté et jouant incontestablement la carte de la vulgarisation scientifique (le didactisme pouvant être redouté…), mais bien un roman avant tout, profitant des nombreuses zones d’ombre de cette complexe histoire pour déployer des trésors d’imagination, une fiction qui se veut entraînante, passionnante…
Un bouquin casse-gueule, quoi. L’option est assez limitée, avec un programme pareil : si le pari est réussi, Évolution peut alors être considéré à bon droit comme un monument de la science-fiction, unique en son genre ; sinon…
À mon habitude, après avoir terminé le roman – et le bilan, en ce qui me concernait, ne faisait aucun doute –, j’ai parcouru le ouèbe à la recherche de critiques, histoire de confronter les opinions. Je n’en connaissais auparavant qu’une seule, due à la très enthousiaste et indispensable Alice Abdaloff, et qui m’avait décidé à cet achat ; et merci, merci, merci, parce que c’est effectivement un très bon bouquin, correspondant parfaitement à ce que j’attendais de meilleur chez Baxter. Mais, ici ou là, sans surprise, j’ai pu entendre un autre son de cloches… Des critiques négatives plus ou moins pertinentes (et au moins une de carrément pathétique, mais bon…), mettant l’accent tour à tour sur des invraisemblances scientifiques que je serais bien en peine de juger, et sur un certain ennui que je n’ai pour ma part pas le moins du monde ressenti, mais que je peux néanmoins concevoir…
Bah moi j’ai beaucoup aimé Évolution. Et je n’hésiterai pas à en faire le plus fascinant roman de Stephen Baxter qu’il m’a été donné de lire, ex aequo avec Les Vaisseaux du temps. M’en vais tâcher de dire pourquoi.
Inutile sans doute de tenter de résumer « l’histoire »… ce qui pourrait en outre se révéler nuisible à l’intérêt du lecteur. Je me contenterai donc de décrire brièvement la structure du roman. Celui-ci est découpé en trois parties. La première (qui occupe la quasi-totalité du premier volume) renvoie à la préhistoire ; elle débute avec Purga, petit mammifère aux allures de rongeur, mais qui n’en est pas moins un primate et l’ancêtre de l’humanité, vivant il y a 65 millions d’années, alors que les dinosaures régnaient encore sur la planète ; mais plus pour longtemps… Après un étourdissant et jubilatoire retour en arrière, Baxter reprend le fil de son récit, chaque chapitre étant séparé du précédent par plusieurs millions d’années, et se centrant chaque fois sur un personnage (souvent une femelle, d’ailleurs) issu de la descendance de Purga. Les distances temporelles s’amenuisent au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’être humain, auquel est consacré la seconde partie, qui fait donc la transition entre préhistoire et histoire (et entre les deux volumes), sur des échelles de temps de plus en plus réduites, et s’achève en 2031, avec un congrès scientifique qui servait de « fil rouge » depuis le prologue. Reste une troisième partie, consacrée aux « descendants », plus courte que les deux précédentes en termes de pagination, mais s’étendant sur une période incomparablement plus longue (environ 500 millions d’années, et même au-delà…).
Pour le reste, je ne me sens d’en parler que de manière passablement abstraite.
…
Bon, ben, autant sortir tout de suite le mot magique :
VERTIGE.
Et c’est bien pour ça que Baxter est extraordinairement doué. Une fois de plus, mais plus que jamais, l’écrivain britannique se montre d’un talent incomparable pour faire prendre conscience de la petitesse, de l’insignifiance de l’humanité, fruit miraculeux – et d’autant plus grand et admirable, par un joli retournement – du hasard et de la nécessité, égarée dans un univers dont les dimensions tant spatiales que temporelles sont tellement immenses qu’elles en deviennent tout simplement inconcevables. Il en résulte un sentiment unique, de fascination mêlée d’effroi ; cette sensation – je sais, je me répète, mais, bon – que je ne peux comparer qu’à une seule chose : le trouble qui s’emparait de moi, gamin, quand, la nuit, je m’allongeais dans l’herbe et me perdais dans la contemplation des étoiles. Un vertige, oui, angoissant et beau, et proprement métaphysique, tel que seul la science-fiction la plus habile parvient à le susciter. « Sense of wonder ». Le merveilleux scientifique résultant d’un concept fou dans son sérieux. Une littérature d’idées se muant insidieusement en littérature d’images. Et quelles images !
Oui, Baxter est ici à son sommet, parce qu’il s’en tient à ce pourquoi il est le plus doué, la science et le rêve. Aussi n’y rencontrera-t-on pas les tristes écueils d’Origine et de Gravité, avec leurs intrigues parfois laborieuses et tirant éventuellement à la ligne, leurs personnages plats sinon creux, leurs relations naïves, leur psychologie de comptoir, leurs dialogues poussifs (Évolution est largement dénué de dialogues, et pour cause…), et les maladresses stylistiques qui en découlaient parfois (aussi Évolution, bien qu’essentiellement descriptif, ou justement pour cette raison, est-il à mon sens bien « mieux écrit », plus agréable à lire et plus juste, en tout cas, que la « trilogie des univers multiples », sans parler de Gravité…). Si Baxter est un remarquable faiseur d’images, il n’est en effet habituellement guère doué pour décrire des personnages humains. Et, ici, il en tire parti (ce qu’il avait tenté, mais hélas pas totalement réussi, dans Origine, roman immédiatement antérieur, et ça se sent…) : car ses personnages, très rarement « humains » au sens où nous l’entendons habituellement (et d’ailleurs seulement dans les chapitres les moins intéressants, ce n’est pas un hasard…), ont généralement quelque chose de résolument « autre », de « non-humain », car pré-humain ou post-humain, voire plus éloigné encore… Et, sur la base de cette différence essentielle, Baxter, libéré des contingences des sociétés modernes et des subtilités de la psyché contemporaine, parvient enfin à bâtir des relations complexes, à décrire des sentiments authentiques. Paradoxe : c’est ainsi en s’éloignant de l’humain que Baxter parvient à rendre humaine son histoire « de l’humanité »… J’avais du mal à le croire moi-même, mais je vous le jure : en certains passages d’Évolution, Baxter réussit même à être… émouvant. Oui, oui. Baxter. Émouvant. La hard science d’Évolution n’est aride qu’en apparence… Et, sous ses aspects souvent dénigrés de « quasi-essai » de vulgarisation scientifique, ne lésinant éventuellement pas sur le didactisme, ce roman m’est apparu ainsi tout sauf froid, mais bien au contraire étrangement humain et juste, avec ce que cela comporte de terrible et d’admirable, de mesquin et de grandiose. En usant d’une variante science-fictive du « détour anthropologique » cher à Georges Balandier, Baxter parvient enfin à saisir l’homme et à le rendre tel qu’il est, ce qui enrichit son roman d’un contenu éthique et ontologique non négligeable.
Cela dit, quand bien même, contrairement à pas mal de monde semble-t-il, je ne me suis pas ennuyé un seul instant à la lecture de ce pavé (à la différence d’Espace et a fortiori d’Origine), je suis bien obligé d’admettre qu’il n’est pas sans défauts. Je serais bien en peine de me prononcer sur la pertinence scientifique du roman, ne disposant pas du bagage adéquat ; je me contenterai de noter que, quand bien même des erreurs ou simplifications se seraient glissées ici ou là (ce qui est plus que probable), il n’en reste pas moins que Baxter s’est à l’évidence documenté, et que la cohérence interne de son roman ne fait aucun doute : pour un béotien dans mon genre, c’est là l’essentiel. Après tout, ainsi que Baxter lui-même le rappelle en définitive, Évolution est un roman, non un essai, et encore moins une thèse… Cela dit, il est vrai que la confusion est tentante, et que le roman, parfois très didactique, pédagogique, etc., a régulièrement des allures de « docu-fiction ». Ce qui peut irriter, au point de le rendre illisible… En temps normal, cette réaction m’aurait été assez naturelle, et pourtant, j’ai adoré ; il faut croire que les atouts compensent…
Je me contenterai donc de quelques remarques, concernant essentiellement la deuxième partie, dans laquelle quelques aspects de fond m’ont un petit peu gêné (mais dans la limite du raisonnable). Sans surprise, en effet, Évolution est un roman lourd de positivisme, pour ne pas dire de scientisme. C’est tout à fait acceptable dans l’ensemble, mais cela entraîne néanmoins quelques conséquences qui m’ont paru regrettables. La première – et, là encore, cela n’a rien d’étonnant, au vu du triste monde tragique qui est le nôtre, et en particulier des délires créationnistes qui ressurgissent plus que jamais, notamment outre-Atlantique –, c’est que Stephen Baxter, en décrivant l’évolution de l’humanité, se trouve nécessairement amené à envisager la question religieuse, et le fait de manière parfois un peu caricaturale, le roman comprenant quelques (assez rares, cela dit) piques anticléricales et athées pas forcément indispensables (en contrepartie, j’ai beaucoup apprécié le chapitre astucieusement ambigu décrivant les naissances parallèles de la science et de la religion, avec l’apparition du principe de causalité ; il me semble que cette optique était plus intéressante…). Parallèlement, on y trouve encore quelques relents, quand bien même pondérés, de la valorisation du scientifique sur le quidam qui plombait Gravité, surtout dans le chapitre se déroulant en 2031… Enfin, et peut-être un peu plus gênant, si l’évolutionnisme biologique décrit par Baxter est assez convaincant, d’autant qu’il se montre complexe (nombreux sont les paramètres à être pris en compte), il y a à l’occasion quelques dérives plus contestables tendant presque à l’évolutionnisme anthropologique (même si, la plupart du temps, il faut sans doute mettre cela sur le compte des nécessaires simplifications impliquées par la construction du roman).
Pas grand chose, en définitive. Du pinaillage, essentiellement. En ce qui me concerne en tout cas : Évolution est bien un roman ambitieux et assez unique en son genre, et qui n’est certainement pas susceptible de plaire à tout le monde. À ce stade, on en est vite réduit à un lapidaire « ça passe ou ça casse ». Mais pour moi, c’est passé. Et vraiment très très bien. Me voilà réconcilié.




/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





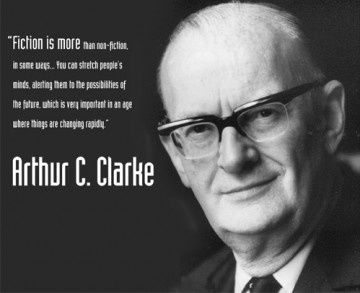
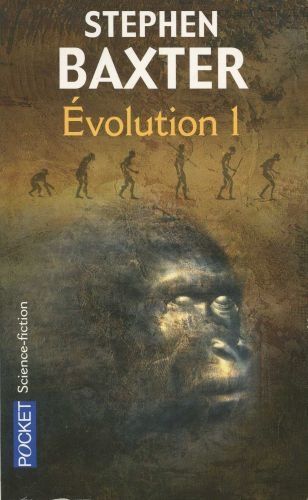
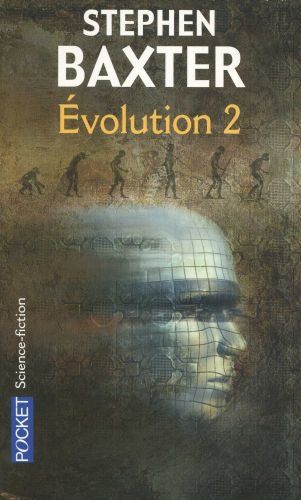



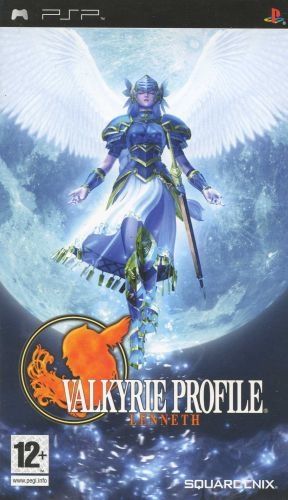
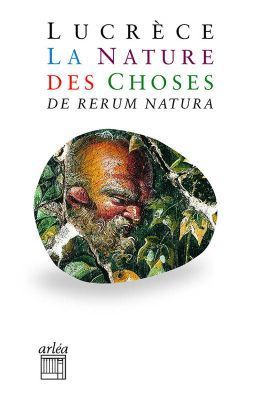
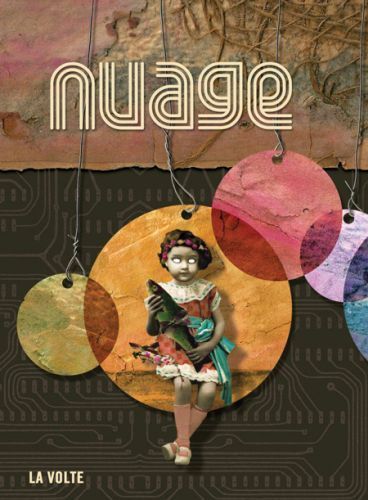
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)