
Vampire : The Eternal Struggle
À l’époque où les jeux de cartes à collectionner sont apparus et ont submergé le monde, j’avoue m’y être pas mal adonné. Le premier, bien sûr, ce fut Magic, qui m’a procuré des heures de jeu fort sympathiques. Mais celui qui m’a le plus durablement marqué et passionné, au point que je m’en suis repayé une boîte de starters il y a peu pour y initier mes petits camarades, c’est sans conteste Vampire : The Eternal Struggle (qui s’appelait Jyhad lors de sa première édition ; une mauvaise idée, sans doute…). Ce jeu, également développé par Richard Garfield et Wizards of the Coast (mais bien vite repris par White Wolf), et historiquement si je ne m’abuse le deuxième du genre, n’a certes pas eu le succès de son glorieux aîné, n’a jamais eu l’honneur d’une traduction française, et sa commercialisation a cessé il y a quelques années de cela. Et c’est bien dommage, parce que c’est indubitablement un des meilleurs jeux que je connaisse, tous genres confondus.
Je l’ai d’abord découvert, tout gamin, sous le nom de Jyhad. Déjà fasciné par le jeu de rôle Vampire : la Mascarade dont il s’inspire, je m’étais en effet risqué à en commander quelques cartes (avec une traduction française des règles et des cartes sur feuilles imprimées !) pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Sans surprise, je n’y ai absolument rien pigé pendant des années… et ai passé ma frustration sur Magic, avec des decks forcément noirs comme la nuit (ouh ouh). Mais, quelques années plus tard, quand j’ai été en mesure de comprendre au juste de quoi il retournait, je m’y suis remis en compagnie de joyeux camarades et y ai pris énormément de plaisir, même si je n’ai jamais été un joueur très efficace. Peu importe : c’est toujours l’aspect purement ludique qui me séduisait, dans ce double plaisir particulier à ces jeux consistant tant à élaborer méticuleusement des paquets variés qu’à les tester contre des adversaires nécessairement fourbes ; et du coup je n’ai jamais forcément cherché la victoire, mais simplement à passer un bon moment. Ce qui a duré des années… jusqu’à ce que mes joyeux camarades et moi-même succombions à l’appel de la compétition, expérience qui m’a paru très désagréable – je n’aime décidément pas l’esprit de compétition et ne me reconnaissais pas dans les joueurs qui l’avaient – et a fini par m’éloigner de ce jeu que j’aimais tant… Mais, comme dit plus haut, je m’en suis donc il y a peu procuré une boîte de starters (de Vampire : The Eternal Struggle, c’est-à-dire la deuxième édition, purement Camarilla) afin de constituer sept paquets tout bêtes (un par clan de la Camarilla, donc) et d’y initier quelques rôlistes de ma connaissance, et plus si affinités. Pour le pur plaisir de jouer. Et ce plaisir, après toutes ces années, est resté intact, effaçant le mauvais souvenir laissé par la période « compétition ». Et c’est pourquoi j’ai envie de vous parler de ce jeu aujourd’hui.
Même s’il en constitue un succédané et en reprend le mécanisme fondamental, Vampire est un jeu très différent de Magic (et mille fois plus intéressant à mon sens, donc, sans cracher sur les bons moments que m’a procuré le premier JCC). Notamment en ce qu’il ne prend sa pleine dimension qu’au-delà de deux joueurs (l’idéal étant quatre ou cinq), ce qui permet de déployer tout son aspect, disons, « politique ». Aussi les parties sont-elles généralement bien plus longues et complexes qu’un « simple » affrontement martial entre deux magos. Chaque joueur, ici, incarne un mathusalem, c’est-à-dire un très vieux vampire qui tire les ficelles de la société vampirique. Le joueur à gauche constitue sa proie, le joueur à droite son prédateur. Le but est donc d’éliminer sa proie, puis la suivante, etc., afin de récupérer des points de victoire… tout en évitant bien sûr de se faire tuer par son prédateur.
Pour agir, le mathusalem dispose d’une réserve de points de sang (trente normalement au départ). Ces points de sang représentent à la fois sa « vie » (comme à Magic), mais aussi – ce qui change tout – sa capacité de jeu, puisqu’il va s’agir pour lui de les investir judicieusement afin de saigner sa proie et de se défendre contre son prédateur. Et, notamment, c’est avec ces points de sang que le mathusalem va pouvoir faire entrer en jeu des vampires (cartes à dos marron) ; ces vampires, à leur tour, pourront se livrer à tout un paquet d’actions, et c’est généralement par leur biais que seront utilisées les cartes à dos vert constituant la bibliothèque.
Chaque tour de jeu (dans l’ordre des aiguilles d’une montre en principe, et donc dans l’ordre de prédation) est composé de plusieurs phases. La première est l’untap, dans laquelle on redresse les cartes engagées précédemment afin de pouvoir les utiliser à nouveau (et certains effets de jeu s’appliquent à ce moment-là). La deuxième phase est consacrée au cartes master – des cartes grises représentant dans un sens l’action directe du mathusalem sur le déroulement de la partie ; on peut en jouer une par tour. Suit la phase d’action : c’est alors que les serviteurs du mathusalem – pour l’essentiel des vampires – peuvent agir, de bien des façons différentes (j’y reviendrai en détail par la suite). Il y a ensuite la phase de transfert, au cours de laquelle le mathusalem interagit avec sa crypte, afin notamment de faire apparaître des vampires dans le jeu. Et le tour s’achève sur la phase de défausse (différence essentielle avec Magic et compagnie : il n’y a pas de phase de pioche ; en principe, dès qu’une carte est jouée, elle est immédiatement remplacée : il s’agit donc souvent de faire tourner le paquet, ce que permet en dernier recours cette ultime phase). On passe alors à la proie, et le même cycle se répète.
Mais revenons sur la phase d’action. Les minions (vampires – kindred – et alliés) agissent chacun individuellement (autre grosse différence avec Magic). Certaines de leurs actions sont représentées par des cartes, et peuvent être très diverses (comme les actions politiques, nécessitant un vote, dont l’issue dépendra des vampires en présence et des cartes jouées, ou encore s’équiper, ou aller chercher un allié ou un larbin, etc.) ; mais d’autres interviennent indépendamment. C’est le cas notamment de l’action fondamentale du jeu qu’est le bleed, c’est-à-dire le fait de « saigner » la proie pour lui faire perdre des points de sang. Mais d’autres actions sont également possibles, qui sont généralement à + 1 stealth de base (ce qui signifie que, pour pouvoir la bloquer, un vampire adverse doit avoir au moins + 1 intercept, les niveaux de ces deux notions pouvant varier du fait des cartes jouées) ; par exemple, le vampire peut partir chasser pour regagner un point de sang (sa réserve, de même que celle du mathusalem, incarnant à la fois sa « vie » et sa capacité d’action, mais aussi son « âge »). Une action engage normalement le minion… qui ne sera donc plus disponible ultérieurement pour protéger son maître contre les actions des autres mathusalems, du moins jusqu’à la prochaine phase d’untap. Notons enfin que la variété des actions offerte au vampire dépend largement de ses « disciplines », c’est-à-dire de ses capacités surnaturelles : l’Auspex, par exemple, est une forme de télépathie très utile en défense ; la Domination intervient notamment pour augmenter le bleed, ou en politique ; le Protéisme permet au vampire de se métamorphoser, ce qui lui offre par exemple souvent l’occasion de faire des dégâts aggravés, etc. Chaque discipline a deux niveaux ; si le vampire a la discipline requise au niveau inférieur, il en applique le texte en caractère romains ; s’il l’a au niveau supérieur, il peut en appliquer le texte en caractères gras.
Parlons maintenant des combats. Quand deux vampires se rencontrent – quand un vampire bloque l’action d’un autre vampire –, il y a (normalement) combat. Lequel, à son tour, se décompose en plusieurs phases : certaines cartes doivent être jouées au début du combat ; ensuite, c’est la phase de manœuvre : les vampires commencent au corps à corps, mais ils peuvent utiliser des cartes pour s’éloigner ou, du coup, se rapprocher ; vient ensuite le strike, qui débouche sur la résolution des dégâts ; se pose enfin la question de la poursuite : si un joueur joue une press, le combat se continue en revenant à la première phase, etc. Un vampire réduit à zéro points de sang est ultérieurement contraint d’aller chasser ; en dessous, ou s’il se prend des dégâts aggravés, il part en torpeur… et c’est alors éventuellement l’occasion de commettre la diablerie, quasiment le seul moyen de se débarrasser définitivement d’un vampire.
Ces mécanismes sont relativement complexes au premier coup d’œil, ce qui peut être un brin déstabilisant. Mais le jeu est fort bien conçu, et on acquiert vite les réflexes essentiels. Ce qui n’enlève rien à son incroyable complexité, au sens de richesse. On peut en effet jouer à VTES de bien des manières différentes – un nombre presque infini, à vrai dire ; d’aucuns vous diraient que c’est là une caractéristique essentielle des jeux de cartes à collectionner, mais j’aurais envie de dire que la subtilité du jeu est telle que cet infini-là est plus grand que les autres… ou du moins qu’on en prend plus frontalement conscience. Et c’est absolument fascinant et passionnant.
Cette deuxième édition se focalise uniquement sur les sept clans de la Camarilla (ceux du Sabbat et les indépendants ont été couverts par les éditions ultérieures et les diverses extensions). Je vais rapidement présenter ici ces clans, en notant que chaque vampire est unique, et peut avoir des disciplines traditionnellement rattachées à d’autres clans (ce qui accroît d’autant les possibilités de construction de deck, bien sûr, même si je n’ai créé ici, pour initier mes camarades, que des paquets « purs »). Chaque clan a en effet trois disciplines de prédilection, qui déterminent largement le style de jeu. Les Brujah (Celerity, Potence, Presence) sont des bêtes de combat, capables de frapper vite et fort, et on tend donc avec eux à jouer au casse-vampires (autrement dit, à nettoyer le terrain pour forcer le passage). Les Gangrel (Animalism, Fortitude, Proteism) sont des métamorphes souvent à même de faire des dégâts aggravés, ce qui les rend également redoutables au combat. Les Malkavian (Auspex, Dominate, Obfuscate), ces gros dingues, sont très polyvalents, et en mesure de faire passer du bleed en stealth, ce qui peut faire très mal… Les hideux Nosferatu (Animalism, Obfuscate, Potence) sont également très polyvalents, même s’ils sont avant tout les rois de la discrétion. Les Toreador (Auspex, Celerity, Presence) jouent également la carte de la polyvalence, étant aussi bons en « attaque » qu’en « défense ». Les Tremere (Auspex, Dominate, Thaumaturgy) sont surtout efficaces en défense, à mon sens ; leurs puissantes cartes de thaumaturgie ne sont cependant le plus souvent utilisables que suite à une press, ce qui peut rendre leur jeu un peu délicat. Les Ventrue (Dominate, Fortitude, Presence), enfin, sont mes chouchous : souvent politicards, ce sont en tout cas les maîtres incontestés du gros bleed dans ta gueule…
Rien qu’avec des jeux « purs » de cette seule édition, les possibilités ouvertes sont ainsi énormes, témoignage éloquent de la richesse de ce jeu d’exception. Car, au risque de me répéter, VTES est clairement le meilleur jeu de cartes à collectionner que je connaisse, et c’est avec un énorme plaisir que je m’y suis remis récemment, rien que pour le fun.
La nostalgie, camarades…


/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



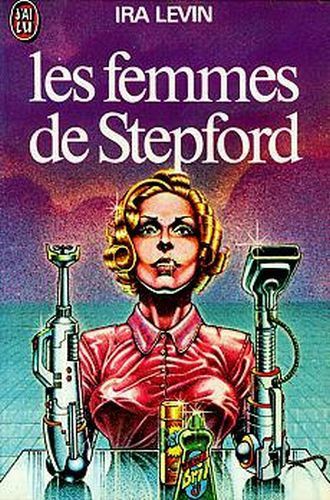




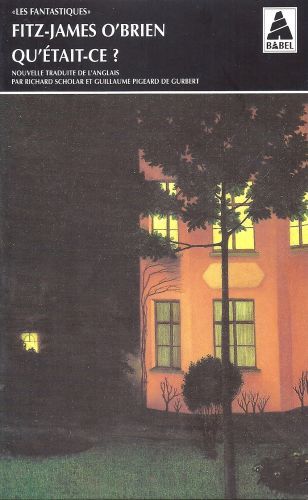





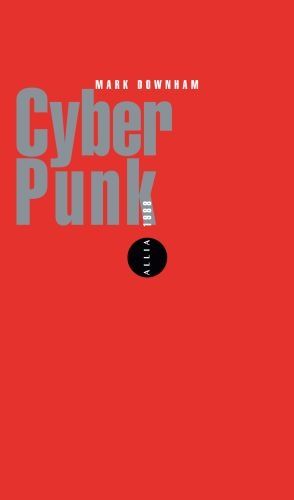



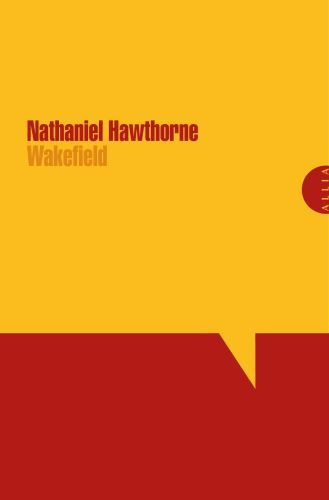

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)