DIALOGUE
Quelque temps après la parution, toute récente, de ma chronique sur Sombre, n° 2, Johan Scipion, l’auteur dudit Sombre, y a répondu ; vous pouvez par exemple voir ça sur Terres Étranges, ou sur Casus NO.
Et comme il souhaitait semble-t-il un dialogue, je suppose qu’une réponse aux réponses s’impose… Exercice pas toujours évident, mais sans doute enrichissant – je l'espère, en tout cas ; et, si je ne me retrouve par pour autant « de l’autre côté de la barrière », c’est une occasion de peser un peu plus mes propos, et de revenir sur leur pertinence ou pas…
Les réponses de Johan Scipion empruntant aux codes des forums, je vais tâcher de rendre cette dimension ainsi : en italiques, c’est le sieur Scipion qui parle ; sinon, c’est moi – mais, quand il y a des retraits, dans ce cas, c’est parce que Johan Scipion citait lui-même ces passages de ma chronique de Sombre, n° 2.
Allez, c’est parti…
Je le fais assez rarement, mais quelque chose me pousse au dialogue. Sans doute la longueur de son texte, son souci du détail et le fait qu'il y met très en avant sa sensibilité personnelle. Ou peut-être tout simplement parce qu'il soulève des points intéressants. Bref, j'ai envie d'en causer.
On peut lire ladite critique sur son blog. Il est d'ailleurs vivement conseillé de le faire avant de parcourir ce qui suit.
INSPIRATIONS ET RÉFÉRENCES
Nébal a écrit :
« Ubiquité » est présenté comme un « survival compétitif », citant Battle Royale et Cube comme ses inspirations essentielles (encore que le terme « inspirations » puisse être contestable : l’auteur nous dit qu’il n’avait pas de lui-même fait le lien avec Cube, avant les premières « playtests »…).
Je pense que Cube, un film que je kiffe bien comme il faut, est une inspi d'Ubiquité, mais inconsciente. Si je ne l'ai pas réalisé à l'écriture, c'est parce que j'étais parti sur des octogones plutôt que des carrés (il reste d'ailleurs une trace de cette idée dans le scénar). J'ai simplifié quand j'ai compris que c'était injouable car trop complexe. Mais du coup, avec les octogones toujours en tête, je n'ai pas percuté sur Cube avant mes premiers playtests. C'est con, hein ?
Ce n’est pas con du tout… Mais, à lire cette réponse, je me suis demandé s’il n’y avait pas un malentendu quant à mes intentions : je ne remettais pas en cause ta sincérité, hein…
Tu noteras au passage que je parle de « Références » et non d'« Inspirations » en ouverture de mes scénarios, l'objectif étant surtout de donner au meneur potentiel une liste de films/livres qu'il puisse regarder/lire en préparation de sa partie. Le côté cuisine créative, je le réserve plus volontiers aux premiers paragraphes de la section Feedback, en fin de scénario.
OK, pas de problème avec ça.
FESSE-MOI AVEC UNE PELLE, MAÎTRE !
« Ubiquité » n’est pas sans avoir un côté : « Oh, oui, MJ, fouette-moi, fais-moi mal ! »
Il me semble qu'une attitude un minimum volontariste est la condition sine qua non de tout jeu de rôle. Si le joueur n'a pas envie de jouer un palouf, un runner, un vampire, une tortue ninja ou une souris, et ben ça ne marche juste pas. La particularité de Sombre est qu'il demande qu'on soit volontaire pour un trip particulier : jouer un PJ-victime. Je comprends que ça désarçonne parce que ce n'est pas si courant, mais sur le fond, ce n'est en rien différent de ce que demande n'importe quel JdR : s'impliquer dans son perso.
Je suis tout à fait d’accord avec ça. Ce volontarisme chez le joueur me paraît essentiel, et, dès lors qu’il n’y a pas d’ambiguïté, j’imagine (simple question de prudence renvoyant au « contrat social », comme on dit), je suis finalement d’accord pour dire que « jouer un PJ-victime » n’est au fond pas si différent de tout autre rôle à jouer. C’est même un point qui me paraît tout spécialement important, en fait.
Mais, pour répondre à cette remarque, il faut prendre en compte la citation suivante…
Peut-être d’autant plus du fait de cet emploi de la première personne, d’ailleurs.
Ah ? Je veux bien que tu m'éclaires sur ton ressenti. En quoi est-ce que la première personne participe de ton impression qu'il faut être un peu maso pour jouer Ubiquité ?
Alors ça va être long et maladroit, hein – et éminemment subjectif.
Affirmer qu’il faut être un peu maso pour jouer « Ubiquité », lâché comme ça, ça n’a guère de sens, certes.
Même si, je suppose, la mécanique de Sombre Classic est sévère et mortifère, mais à raison, dans cette optique des PJ-victimes et de « la peur comme au cinéma ». Mais, du fait de la mécanique aussi bien, en l’espèce, que du présent scénario (mais « House of the Rising Dead », dans un genre pourtant très différent, m’avait déjà fait cet effet), les erreurs se payent éventuellement (systématiquement ?) très cher – là encore à bon droit (même si j’aurais un petit bémol, sur lequel je reviendrai bientôt).
Je suppose néanmoins que les spécificités du scénario « Ubiquité » accentuent cette dimension punitive : le chronomètre en rajoute, ça me paraît nécessaire ; l’écoulement du temps, ritualisé via les bougies soufflées, s’accompagne cependant d’autres dispositifs, et notamment celui du MJ-marionnettiste qui fait quitter la table aux joueurs absents et les dispose loin de ladite, aux emplacements appropriés pour les retrouver le moment venu… Euh, eh bien, oui, en combinant tout cela, des bases de la mécanique à l’obéissance du joueur, au doigt et à l’œil, jusque dans sa situation dans l’espace (!), je crois qu’on peut dire : « Oh, oui, fouette-moi, MJ ! » Et quand je visualise la scène, Johan Scipion (on revient temporairement à la troisième personne ici, mais justement, j'y arrive...) a un rictus sadique sur son visage de la première à la dernière minute – à côté, le Joker est un dépressif timoré.
Mais, point important : je ne dis pas que c’est mal vu, insupportable, ou que sais-je ! Si, en tant que MJ, je ne me sentirais franchement pas de mettre en jeu tous ces rituels, je suis bien certain que la chose est murement pensée et mise en œuvre, et que c’est probablement très, très amusant… Si c'est géré par quelqu'un qui sait y faire.
Or ce n’était probablement pas l’essentiel de mon propos – parce que je mettais l’accent sur le texte, le « formel », en parlant de cet emploi de la première personne (avec un « peut-être » qu’il ne faut surtout pas oublier !) ; dans cette optique, ce n’est pas tant le jeu que la lecture qui aurait cet aspect masochiste supposé (en notant éventuellement qu’à la lecture le MJ en puissance est à son tour une marionnette de l’auteur – et perçoit donc lui aussi le rictus sadique du Joker).
Mais cela vient sans doute en partie du jeu, je ne pourrais prétendre le contraire – après tout, en traitant de Sombre, n° 1, j’avais exprimé un vague scepticisme concernant la position particulière du MJ dans Sombre Classic – qui me paraît vraiment supérieure aux joueurs, mais, si ça se trouve, « paraît » donc sans l’être, c’est simplement que j’ai l’impression que les jeux que j’ai pu lire ces dernières années se montrent bien plus… « délicats » en l’espèce, ou moins « frontaux », on va dire. Ce qui n’est pas forcément un reproche, en fait…
Je voyais aussi le MJ de Sombre disposer d’une part d’arbitraire non négligeable, dans les règles le cas échéant, ou dans le scénario « House of the Rising Dead » ; et je suppose que ces éléments reviennent dans Sombre, n° 2, et donc, à ce stade, notamment dans « Ubiquité ». Je n’y reviens pas ; c’est autre chose, je pense, qui peut poser problème.
Car il faut donc ajouter à tout cela l’emploi de la première personne – mais à mon sens, et c’est vraiment d’un ressenti on ne peut plus subjectif dont je parle, même si je suppose qu’il peut être étendu. Au passage, ce n’est pas une critique en tant que telle : cet emploi de la première personne, qui me paraît assez rare en jeu de rôle (même si, côté « indépendant », j’ai lu quelques autres cas – mais justement : ils produisaient pour moi le même effet !), est une singularité de Sombre que je n’entends pas le moins du monde remettre en cause ; et qui serais-je pour faire une chose pareille ? D’autant que ça serait un peu tard.
Mais c’est donc un ressenti. Je n’ai bien sûr aucun problème, de manière générale, avec l’emploi de la première personne… En narration ou dans la conversation, c’est une évidence (merci Nébal !), et dans d’autres domaines aussi – comme, eh eh, ce genre de comptes rendus. Mais j’ai bien plus de mal avec cet emploi dans des « essais », au sens large – d’autant que c’est à cette catégorie que je suis intuitivement tenté d’accoler Sombre. Sans doute est-ce que je suis un peu trop rigide – on m’a bien trop répété qu’il fallait prohiber le « je »… Mais je (aha) crois qu’il y a en fait deux aspects de la question, distincts en apparence, mais qui se rejoignent pour susciter le même résultat (et l’amplifier du fait même de leur rencontre).
Le premier, pour employer une métaphore bien lourde et pompeuse, et pas très bien assurée, c’est le rapport à la Règle. Vive les majuscules ! C’est un ex-juriste qui parle, je suppose que ça peut expliquer bien des choses – en tout cas, j’ai toujours eu tendance à envisager les règles d’un jeu de rôle comme des règles juridiques… Ce qui n’est sans doute pas le moins du monde original, certes. Bon, bref : il y a la Loi, et il y a le Juge. La Loi se veut neutre et objective – qu’elle le soit ou pas, c’est encore une autre question ; mais elle est un monstre froid ; quand on s’y confronte, c’est avec la raison, l’émotion est hors-jeu (si j’ose dire) ; elle est sans doute contestable, mais sur le seul mode de la raison. Le Juge, c’est différent : s’il est censé n’être que « la bouche de la Loi », dans les faits, il l’incarne – mais ce seul procédé suffit déjà à introduire un biais dans le rapport que le justiciable, disons, a avec lui, et qui n’est donc pas le même que son rapport à la Loi. La loi est en principe dépassionnée, même si seulement sur le plan formel (cependant d’une importance cruciale, et ça nous renvoie directement à la question à laquelle je tente bien maladroitement de répondre…) ; à certains égards, ça ne la rend que plus redoutable… Mais, si elle peut susciter l’admiration, la révérence, l’intimidation, la crainte, c’est d’une manière abstraite. Le Juge me paraît dans une position bien différente – mais tout autant, car ce n’est en rien une dimension simplement corollaire de la question, dans une position « représentée » (aux yeux du justiciable, s’entend) elle aussi bien différente. Aussi le rapport n’est-il pas le même : les brutalités éventuelles de la Loi, peut-être parce qu’implacables, suscitent la soumission ; celles tout aussi éventuelles du Juge, qui demeure un humain sous la robe austère de la justice, peuvent par contre susciter l’agacement, voire le refus (d'obstacle), voire la révolte. Bon, je dis peut-être n’importe quoi, hein… Mais en tentant de formaliser un peu les choses, j’en arrive à ça.
Mais c’est là qu’on rejoint le deuxième aspect, un peu (nettement…) moins fumé de ma part, je suppose : il y a une confrontation d’intimités. Laquelle passe très bien dans nombre de registres, mais, dans d’autres, me hérisse un peu – et assez vite. Une règle « objective », à la troisième personne, reste sagement dans son coin. Mais quand elle s’exprime à la première personne, et, qui plus est – ça me paraît vraiment flagrant dans Sombre, pour le coup –, avec insistance (« je », « je », « je »…), il y a un risque non négligeable que je me sente envahi dans mon territoire. L’auteur décortiquant son jeu (et à bon droit, hein ! Là encore, il s’agit d’un ressenti tout personnel, pas d’un reproche, et encore moins de recommandations !), ici, dira à chaque paragraphe ou presque, « je fais », « je pense », « j'ai constaté », etc. Plein de « je », plein, partout, à tous les niveaux – et plus il y en a, plus je me sens repoussé dans mes retranchements ; au point, parfois, où j’ai envie de hurler : « STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP !!! » Parce que, pour dire les choses, j’ai le sentiment d’être… agressé, en fait.
D’autant qu’il y a un stade où le « je » systématique peut insidieusement se muer, pas forcément dans les faits d’ailleurs mais avant tout dans le ressenti, encore une fois, en « moi, je » ; et il n’y a pas beaucoup de choses aussi agaçantes que le « moi, je », dans semblable contexte…
En combinant tous ces aspects (pas seulement les derniers paragraphes, mais aussi ce que je disais avant en termes de ressenti plus ludique que formel), on aboutit donc (enfin, moi, en tout cas) à une représentation de l’auteur/MJ. Et j’insiste : c’est une représentation. Elle n’a pas à être fondée en réalité. Donc, précautions, le sinistre personnage que je vais tenter de décrire là tout de suite, et donc... à la troisième personne, n’est pas Johan Scipion (que j’ai croisé, à peine, et lu, tout juste, mais que je ne connais pas). Il est une représentation – ce qui est pratique pour charger la barque, eh !
Bref : quand je lis Sombre, au-delà de l’intérêt que j’y trouve, de la pertinence de la chose, du sérieux et de la finition de l’entreprise – traits dominants qui figurent bien l’essentiel de mes comptes rendus, je ne vais donc pas y revenir –, je suscite éventuellement malgré moi une image de l’auteur/MJ. Car c’est bien d’un auteur/MJ qu’il s’agit, déjà : Sombre, bien plus qu’à peu près tous les autres jeux que j’ai lus, met cette dimension « auteur/MJ » en avant, et l’emploi de la première personne y participe forcément. Mais il ne se contente pas, via cette image, d’être mis en avant : à la lecture, j’ai le sentiment qu’il est aussi clairement au-dessus de moi ; et il n’est pas seulement au-dessus de moi – ce qui est déjà une position utile pour me surveiller, comme dans un panoptique des « playtests », et presque par voie de conséquence me « juger » (tiens, on y revient) : il est aussi penché sur moi – figure paternelle qui conseille le gniard, éventuellement au point de la condescendance ; tyran qui sait, et qu’on ne contredira pas, parce que « he is the Law » ; démiurge qui, du fait de son immense expérience (que je ne nie certainement pas !), unique en tant que telle, dispose de clefs qu’il veut bien me confier, mais en ne marquant que davantage, au moment même de la transmission, et même sans le vocaliser, combien c’est là chose admirable de sa part, et qui, bien entendu, ne le dépare pas de ses atours de créateur, et m’autorise encore moins à m’en vêtir à mon tour (oui, je sais que c'est une vision totalement erronée, et que le jeu incite bien au contraire aux retours d'expériences comme à la création de settings, ou autres apports d'autres auteurs ; je ne parle bien ici que d'une représentation instinctive, s'en tenant au seul texte, et évacuant tout ce qui l'entoure).
Et, si on y rajoute la dimension du marionnettiste au rictus sadique envisagé en causant des spécificités d’ « Ubiquité », c’est là qu’on en arrive véritablement (ouf !) au : « Fouette-moi, MJ ! »
Noter cependant… que l’on peut aimer ça – n’est-ce pas justement le propos, en fait de masochisme ?
Mais le sentiment demeure.
Bon, je ne sais pas si j’ai su m’expliquer… Mais passons à autre chose : le format court, à partir des deux scénarios figurant dans Sombre, n° 2.
LE FORMAT COURT
Je reste un peu perplexe sur l’idée d’une partie d’une heure maximum, de manière générale.
À l'usage, c'est un format très intéressant. Court, mais pas trop. Il incite au dynamisme narratif (ce que j'apprécie, jouer dans une certaine urgence vivifie mon expérience de jeu) tout en laissant le temps pour de vraies modulations de rythme, qui donnent du relief à la partie. Je l'apprécie vraiment, même si aujourd'hui, je ne le pratique plus en Classic. En Zéro par contre, je m'y adonne très régulièrement.
Certes, je ne peux pas vraiment me targuer de nombre d’expériences en la matière – mais les quelques-unes que j’ai pu avoir m’ont bien renforcé dans mes préjugés (et ce n'était pas des parties aussi courtes, d'ailleurs, mais j'y arrive). Il faudra peut-être y revenir un jour ; mais pour l’heure, eh bien, je crains de ne pas en avoir... envie.
Jouer n’importe où, sans véritablement de matériel, et sur un format très court, même uniquement en un quart d’heure, si ça se trouve…
Mais oui, carrément ! Quinze minutes (de jeu), c'est le format d'Overlord.
C’était bien le propos.
Et là je dois dire que j’ai vraiment du mal à en voir l’intérêt – c’est tellement aux antipodes de mes conceptions du jeu de rôle (oui, au pluriel, même si je suis très « traditionnel » globalement, j’apprécie quelques alternatives) que ça me dépasse complètement…
Ça fait ça à plein de gens. Mais attends de lire Sombre 3, tu vas mieux comprendre où je veux en venir. Ne juge pas la variante sur son scénario de rodage (Overlord), ce serait un peu court (pun intended). Tu verras, Deep space gore, c'est pas le même braquet.
Le problème est que j’ai lu Sombre, n° 3 (je vais essayer d’en causer bientôt), et « Deep Space Gore » ne m’a franchement pas plus emballé que ça… Certes, j’y vois au moins de l’intérêt ludique – même vague ; pour moi, « Overlord » en était peu ou prou dépourvu. Mais… Non, décidément, je crains que ce ne soit vraiment pas ma came. Mais sans doute sont-ce mes préjugés qui s’expriment, et à vrai dire je serais tout à fait ravi qu’on me démontre que l’intérêt ludique est là !
En fait, peut-être ici faudrait-il forcer le trait, en définitive, en renforçant la parenté avec un jeu de plateau ?
Fait. Camlann, dans Sombre 6, est livré avec un mini plateau de jeu, qui participe de son accessibilité aux enfants de 7 ans.
C’est un peu hâtif de dire ça sans avoir lu la chose, mais sur le principe ça me paraît une très bonne idée. Peut-être contaminerai-je mes neveux, tiens…
DE LA BASTON ! ET DE L’HISTOIRE
[...] après une très, très brève mise en contexte, les PJ se battent, et c’est tout. Ça m’a fait l’effet d’un très triste gâchis. En l’état, je ne peux pas qualifier « Overlord » de scénario : c’est une baston ; et une baston n’est pas un scénario, pour mon moi rigide.
C'est bourrin, hein ? Mon avis :
+ Overlord est archi efficace. C'est le scénario que je mène le plus en convention. Plus de la moitié de mes démos, c'est te dire. Je dois approcher les 500 parties. Il fonctionne avec presque tout le monde et produit de bonnes parties dans 99 % des cas. Après DSG, je l'avais un peu laissé de côté. Je l'ai redécouvert avec bonheur par la suite.
+ Sûr et certain que c'est un scénario. Je développe plus bas.
Sur l’efficacité, ça me paraît probable. Et le fait de le jouer en convention, pour faire découvrir, de même, rien à y redire.
Mais – et ça me renvoie à ces quelques mauvaises expériences en parties (relativement) courtes – arrive vite un point où je ne veux plus « tester », ou « découvrir » : je veux jouer...
En fait, de manière générale, la baston tend à me faire chier, en jeu de rôle.
Je pense que tu passes à côté de quelque chose. Pas que je veuille te convaincre de quoi que ce soit, hein. Vu que tu exprimes un ressenti, tu ne peux pas te tromper : c'est un point de vue perso. Mais le mien est tout autre.
À mon avis que j'ai, la baston est un truc fun parmi la tonne de trucs fun qu'on peut faire en jeu de rôle. Et c'est un truc fun qui a l'avantage d'être facile à mettre en place. Y'en a tellement d'autres qui sont hyper difficiles à amener en jeu que ce serait bien dommage de s'en priver.
Tu as tout à fait raison.
Au format d’une chronique (pourtant déjà bien longue ! Et peut-être bien trop, le cas échéant…), je ne me suis pas étendu sur la question et ai fait dans le lapidaire : ça vaut pour le « la baston tend à me faire chier », ici, et pour le « j’aime les histoires » juste après.
Le fait est que mon rapport à la baston en jeu de rôle, et à la notion d’histoire ou de scénario, est en fait plus complexe que ça.
Sans doute vaut-il mieux que j’envisage les deux aspects ensemble, après une citation de plus.
J’aime les histoires.
Mon vécu perso est qu'il ne faut pas se donner beaucoup de mal pour qu'une baston raconte une (bonne) histoire. Envoyer des mandales et en recevoir produit de la fiction, qui peut être de fort bonne qualité. Mieux encore, elle produit de l'émotion. Gros enjeux ludiques et dramatiques, rebondissements, dynamisme, soutien massif des règles, y'a tout pour faire monter la mayonnaise.
Je vois souvent des trucs excellents à ma table lorsque je mène Overlord, alors même que les persos sont fins comme des feuilles de papier à cigarette. Ça m'a vachement fait cogiter.
En préalable : il faut remettre ces citations dans leur contexte. Sombre, n°2, et plus particulièrement le scénario « Overlord » pour Sombre Zéro, m’a fourni l’occasion de ces développements, mais ceux-ci avaient un champ bien plus large – renvoyant le cas échéant à d’autres jeux, testés, ou à des notions plus ou moins vagues me venant en tête à l’occasion de telle ou telle lecture rôlistique. Ici, je ne parle donc que très marginalement d’ « Overlord » ou même de Sombre…
Et donc, la baston.
Je disais qu’elle tendait à me faire chier, mais c’est effectivement très contestable, et il y a plusieurs paramètres à prendre en compte.
En fait, je peux prendre du plaisir à une bonne baston rôlistique, surtout en tant que PJ – et même avec des systèmes pas forcément très indiqués pour rendre cette dimension du jeu, par exemple L’Appel de Cthulhu.
C’est plutôt en tant que MJ que ça coince… En fait, pour dire les choses, j’ai l’impression de ne pas être « câblé pour » ; je sature vite avec des règles d’action trop détaillées, et j’ai du mal à rendre « vivant » le combat, à le « filmer » et à exprimer cette dimension narrative ; enfin, je tombe très facilement dans le très fâcheux travers du « à toi, à moi », comme on dit dans Brigandyne… et il n’y a rien de pire pour plomber un combat.
(À part les règles de Shadowrun, bien sûr.)
Peut-être n’est-ce cependant qu’une impression – à vrai dire, ça fait tellement longtemps que je n’ai pas mis l’accent sur cette dimension dans une partie que je maîtrisais… Mais j’ai justement le désir de tenter des choses – et notamment dans ce goût-là. Cela fait quelque temps que j’envisage, après ma chronique d’Imperium, et si une table adéquate peut être constituée, de jouer quelque chose plus orienté « action », même si pas seulement – genre de la (grosse ?) fantasy (je songeais à L’Anneau Unique, ou peut-être Chroniques Oubliées Fantasy ; et j’ai succombé à la hype autour de Barbarians of Lemuria, que je lis bientôt…) ou, pourquoi pas, du super-héroïque (j’avais envie de jouer enfin à La Brigade Chimérique...). Avec de la chance, si ça se fait, je pourrai revenir sur ce préjugé…
Qu’une baston puisse dynamiser un scénario, je n’en doute pas. C’est le moment où on agite les dés, après tout – il y en a même pour souffler dessus. Blague à part, il y a là une dimension ludique sans doute essentielle – et mettre ainsi en danger le personnage produit un effet émotionnel que peu d’autres procédés ludiques peuvent atteindre, j’imagine (même s’il y en a, et, bien entendu, je ne prétends pas par-là que le combat est la seule occasion de mettre en danger les personnages, bien sûr que non…).
Et, oui, c’est un outil qui en vaut bien un autre ; que je me pince éventuellement le nez par principe n’y change rien, au fond – c’est bien le plaisir de jeu (de l'ensemble de la table) qui doit dominer.
Certes, je suis toujours un peu perplexe devant la tendance du jeu de rôle (parce que orienté aventure notamment…) à développer autant le combat comme peu ou prou seul mode de résolution des conflits – et je suis curieux de lire des choses un peu différentes, ou tant qu’à faire d’y jouer. Hors jeux « narratifs » (avec tous les guillemets que vous voudrez – certains m’ont convaincu, comme Inflorenza, d’autres vraiment pas, comme Monostatos, d’autres pas plus que ça, comme Prosopopée, etc.), j’avais été particulièrement enthousiasmé à cet égard à la lecture de Dying Earth, mettant en avant les joutes oratoires au motif que, dans ce monde-là, le combat au sens martial était (sera) vulgaire…
Mais je m’accommode fort bien d’une bonne scène de baston. D’autant que mon opposition, « baston » d’une part, et « j’aime les histoires » de l’autre, ne tient pas vraiment la route – et encore moins dans ce contexte, puisque j’entendais opposer « Overlord » et « Ubiquité », et justement en relevant que ce dernier, pour être très centré sur la baston, constituait justement une bonne histoire ! Oui, le combat produit de la fiction et de l’émotion, s’il est bien géré. Et « Ubiquité » y incite d’autant plus que les joueurs ne sont pas là pour convertir du gobo en XP, ils sont impliqués d’une manière bien plus frontale et intime…
En fait, ma lassitude à l’égard de la baston est sans doute plus justement une lassitude à l’égard du schéma dont je parlais dans la chronique : un peu de social pour faire bonne mesure (quitte à partir sur un « vous êtes dans une auberge quand… »), un chouia d’exploration peut-être, et hop ! Baston. Une baston sans âme le plus souvent, et sans guère d’enjeux – pour moi, du moins, déjà frustré des occasions où j’aurais pu jouer mon perso, son rôle (eh) ; le voilà qui distribue des mandales, et c’est bientôt fini. Ça m’ennuie horriblement…
Tester est nécessaire. Les auteurs se le doivent (et tu es irréprochable à cet égard, c’est peu dire et ça se sent et c'est admirable), et je ne suis pas le dernier, après une lecture enthousiasmante, à avoir envie de tenter de la mettre en pratique (ce que je ne fais cependant jamais ou presque, pour tout un tas de raisons...). Mais, quand je débarque dans un truc pareil, j’ai envie de jouer. J’ai eu quelques mauvaises expériences où, au nom du test, on faisait l’impasse sur l’histoire – quantité négligeable. Le combat était loin d’être le seul responsable, à vrai dire…
Et, pour le coup, c’est l’impression que me fait « Overlord », scénario d’ « initiation » et/ou de « rodage ». C’est parfaitement légitime, et tout à fait bienvenu pour toi – quand tu en fais un bel outil de découverte (et de promotion), je suis convaincu que tu as tout à fait raison.
Et, bien sûr, circonstance qui change tout, on parle ici de quelque chose de joué en un quart d’heure… Je ne peux certainement pas prétendre que c’est alors « perdre son temps », là où c’était bien mon sentiment dans les one-shots de, disons, trois heures, dont je parlais juste avant.
Mais où est l’envie de jouer ? À titre personnel, la chose en l’état ne me tente pas du tout. C’est bien pour du test, oui, mais il faut aller au-delà, me concernant ; d’autant qu’en l’espèce le cadre est joliment amené – c’est bien pour cela que j’y voyais un gâchis… Pas dramatique, certes – et trop bref pour ça.
Ceci étant, la durée du jeu revient bel et bien en rapport avec cette notion d’histoire. Comme dit dans la chronique, je ne suis pas forcément un adepte acharné des romans fleuves (même si j’aime les campagnes touffues, le cas échéant) ; j’aime, cependant, disposer d’un minimum de temps, pour incarner véritablement les personnages, et approfondir l’univers.
Je ne doute pas qu’un bon joueur, à « Overlord », puisse trouver à incarner un personnage en dépit de sa « fiche » rikiki, de sa quasi totale absence de background, et en plus du format « flash ». C’est très possible – même si je doute d’en être moi-même capable.
Je n’en ai simplement… pas envie, sur un format pareil. Je ne sens pas l’enthousiasme, l’investissement me dépasse.
Et, donc, « Deep Space Gore » ne m’a pas beaucoup plus convaincu… si ce n’est de ce que cette approche n’était décidément pas pour moi. « Double Feature » ou pas.
Et on passe au « dark world » intitulé « Extinction ».
EXTINCTION (BIS)
Je suis plus sceptique concernant le rôle de Nyarlathotep, qui, comme souvent, me paraît mal s’intégrer dans ce schéma
C'est une concession ludique, dont je m'explique p. 58. Si j'ai ressenti le besoin de justifier sa présence, et même son omniprésence, c'est que je suis bien conscient qu'il s'agit d'un parachutage rôliste. Il est raccord avec l'apocalypse, pas trop avec l'horreur marine. Mais de mon point de vue de game designer, la jouabilité prime toute considération esthétique ou thématique. Au diable l'élégance, c'est l'efficacité qui compte.
Tu as sans doute raison. Mais ma remarque dépassait largement le seul cadre d’ « Extinction ». Je suis sans doute un peu trop rigide en matière de lovecrafteries (la faute à S.T. Joshi, sans doute !), et, si j’essaye de me sortir de ce piège, et y parviens à l'occasion, j’y retombe parfois, paf ! bêtement. Un accident – le coup est parti tout seul…
Or, ces derniers jours, je réfléchissais justement un peu au cas de Nyarlathotep, dans l’œuvre même de Lovecraft. Et je me disais que c’était décidément le « Grand Ancien » le plus problématique. En tant que trickster, et tout méphistophélique, il s’insère mal, voire pas du tout, dans le schéma lovecraftien censément orthodoxe, où le « Mythe de Cthulhu » est essentiellement d’obédience science-fictive, et non fantastique, et où les « dieux » (qui n’en sont donc pas) du pseudo-panthéon cthulien sont censément caractérisés par leur indifférence concernant l’homme (en fait, ce schéma est déjà sacrément contestable avec le Yog-Sothoth de « L’Abomination de Dunwich »…).
Dans le cadre science-fictif d’ « Extinction », Nyarlathotep me paraît donc d’autant plus figurer quelque cheveu sur la soupe. C’est peut-être efficace, mais, oui, ça m’a laissé perplexe.
Mais qu’en faire ? À s’en tenir à ces considérations générales, pas grand-chose…
Ce texte est le cadre général de ce qui devait être un supplément de plusieurs centaines de pages. Je l'ai publié dans le zine pour des raisons purement éditoriales (une affaire un peu beaucoup pénible).
Ce que tu as lu est l'équivalent des textes introductifs de Delta Green signés Tynes : un cadre global dans lequel viennent ensuite s'insérer d'autres textes, plus directement jouables. Dans DG, il s'agit de différentes organisations. Dans XT, j'ai opté pour sept settings.
OK, merci pour cette précision. M’aurait vach’ment intéressé, ce supplément…
[…] ce cadre de jeu trop flou […]
Il n'est pas flou, il est général. Plus de précisions nous auraient bloqués dans le développement des settings. Par « nous », j'entends les auteurs et les meneurs d'XT, invités à y créer leur propre setting à leur mesure. Mon cadre devait leur laisser autant d'espace créatif que possible : poser des jalons clairs pour donner de la personnalité à l'univers sans les gêner. Une structure, quoi.
Ça se tient, certes.
Pour le coup, le goût de trop peu demeure, éventuellement : chacun de ces « settings » ne tient après tout qu’en une seule colonne…
Ce sont des résumés. Chacun d'entre eux devait occuper plusieurs de pages, des dizaines pour les plus costauds.
Et là ça m’aurait vraiment passionné – même si en l’état c’est déjà tout à fait intéressant.
On passe à l’article « Peur ».
TU AURAS PEUR
[…] pas bien original ceci dit, et d’une utilité directe en jeu éventuellement douteuse – peut-être parce que, prépondérance du jeu d’aventure ou pas, l’acquéreur de Sombre a sans doute dès le départ sa petite idée de ce qu’est « la peur comme au cinéma ».
Certains oui, d'autres pas du tout.
Pour un hardcore rôliste, dix, vingt, trente, cent casual gamers, dont la culture horrifique commence et s'arrête à Shining. J'en croise plein en convention, dans les salons et les festivals surtout (le public y est souvent plus mélangé que dans les convs). Ils ne sont pas plus branchés que ça par le cinoche d'horreur, mais Sombre les accroche par sa simplicité et son efficacité.
Cela dit, ce n'est pas pour eux que j'ai écrit cet article, en tout cas pas plus pour eux que pour n'importe qui d'autre. Le point n'est pas d'initier les gens au cinéma ou au jeu de rôle d'horreur. Il y aurait tant à dire, ce n'est pas dans un petit article que j'y parviendrais. L'objectif est de préciser la manière dont, *moi*, je les comprends. En particulier, j'ai besoin de définir certains termes dont je vais ensuite, tu le constateras en poursuivant la lecture de la revue, faire un usage abondant : « horreur », « fantastique », « peur », « aventure », etc.
Cet article n'est pas du tout une aide de jeu. Il ne prétend à aucune utilité directe autour d'une table, raison pour laquelle je l'ai voulu aussi court que possible. Il s'agit de mon lexique de base, fondation essentielle de tous mes futurs articles. C'est pour cette raison que je l'ai publié en premier : il n'y avait pas d'article dans S1 et le premier qu'on lit dans S2, c'est « Peur ». Pas du tout un hasard.
Quand tu construis une maison, tu commences par couler une dalle de béton. Ça ne paye pas mine, ça ne te sert à rien directement (ça ne te met pas un toit sur la tête, je veux dire), mais si tu ne le fais pas, ta baraque se casse la gueule. « Peur », c'est ma dalle de béton, mon socle théorique.
Je ne suis pas un théoricien du jeu de rôle, pas même du jeu de rôle d'horreur, mais j'en écris un. Or le game design tel que je le conçois ne saurait faire l'économie d'un cadre théorique minimum. Parce que Sombre, tout générique qu'il soit, est une production d'auteur, c'est-à-dire qu'il déploie une vision personnelle du genre horrifique. Mon avis est que pour être suffisamment robuste, j'entends par là efficace à ma table et à celle d'autres meneurs, cette vision ne peut pas s'appuyer sur du rien. Il lui faut un soubassement théorique, aussi modeste soit-il (et le mien est minimal, six pages dans S2).
Mais je suis bien convaincu de tout ça, en fait…
Notons cependant comment l’épouvante, ou le gothique, sont remisés de côté – effectivement, à vue de nez, ils ne sont pas le propos de Sombre… et ce malgré la présence de ce brave Igor dans l’article suivant.
J'ai trois scénars d'horreur gothique sur le feu, dont deux en cours de finalisation. Je vais en publier un tout bientôt, dans Sombre 7. L'horreur gothique est l'un de mes sous-genres préférés. Chuis un die hard fan de la Hammer et de Chill première édition.
De manière générale, tous les sous-genres horrifiques sont le propos de Sombre. Il s'agit d'un jeu d'horreur générique, qualité que je m'emploie à démontrer numéro après numéro. Faut juste me laisser le temps d'aller au bout de ma démarche. À raison d'une sortie par an, ça avance lentement. Mais ça avance. Y'a maintenant pas mal de diversité dans le matos officiel.
OK, merci pour ces précisions.
Je ne suis à vrai dire pas moi-même un über-fan de la Hammer et ce genre de choses, même si j’aime bien, mais je suis curieux de voir ça.
UTILISER SOMBRE, N° 2
Je ne garantis, pas du coup, que je me servirai un jour de Sombre, n° 2.
Hé mais tu l'as déjà fait ! Pour preuve :
[…] un rapport assez complexe, en fait… et qui, dans le cadre de ce deuxième numéro, m’a amené à questionner mes envies, et mes limites.
[…] (je m’en doutais, mais l’Adrénaline ne sert que pour les jets de Corps, pas ceux d’Esprit)
[…] mettre en lumière des dimensions évidentes de la mécanique, mais qui m’avaient pourtant échappé (plus le niveau de Corps diminue, plus les dégâts variables diminuent – ça tombe sous le sens, mais je n’y avais pas fait gaffe, con de moi…) […]
C’est pas faux. Peut-être un peu spécieux quand même, mais c’est pas faux.
Comme je l'écris dans son édito, S2 est une manière de Master's companion, dont la fonction essentielle est d'aider le meneur à passer de la lecture au jeu, de la revue à la table. C'est pour cela que je recommande toujours S1 + S2 pour débuter, plutôt que S1 tout seul. Car dans S2, on trouve :
+ Des propositions ludiques diverses et variées pour inciter les gens à se demander ce qu'ils veulent faire avec Sombre. Parce que c'est la question fondamentale que posent tous les systèmes génériques : vu qu'on peut tout faire (à Sombre, dans le cadre précis du cinéma d'horreur, mon jeu est générique horrifique), quoi qu'on fait exactement ? Tous les jeux de rôle posent bien sûr cette question à un degré ou un autre, mais la généricité lui donne une importance particulière.
+ Une variante et des scénarios (beaucoup) plus courts pour essayer Sombre sans avoir besoin de recruter pour une séance longue.
+ Des articles pour bien intégrer les concepts fondamentaux du jeu et réviser le système avant de l'utiliser. Chaque mot des règles de Sombre compte, donc ça vaut la peine de s'assurer que tout a été compris jusque dans les moindres détails. C'est important dans la perspective de la maîtrise des scénarios officiels. Playtest intensif oblige, ils sont finement équilibrés pour les règles officielles.
Globalement, je suis d’accord – demeure cependant mon scepticisme concernant Sombre Zéro ; mais accoler les deux premiers numéros est révélateur des possibilités variées du jeu, c'est certain.
…
Mazette, avec ces « réponses aux réponses », je livre un deuxième article deux fois plus long que la chronique originale… N’importe nawak…
(Je ne ferai pas ça tous les jours, honnêtement ; mais je ne vais certainement pas me plaindre de ce genre de retours, en même temps.)
(Et bientôt Sombre, n° 3…)


/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


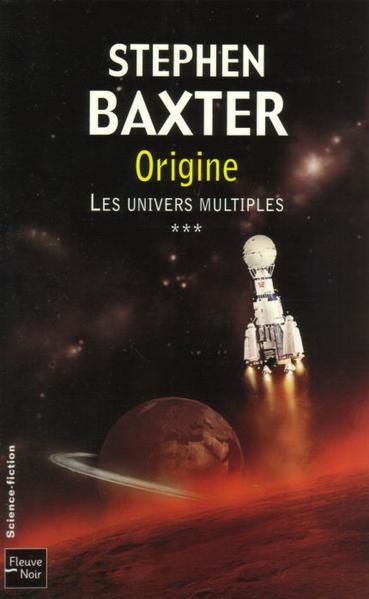



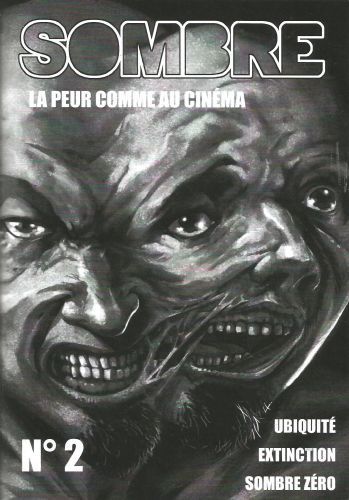
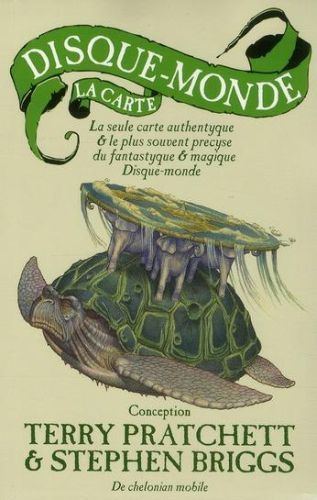


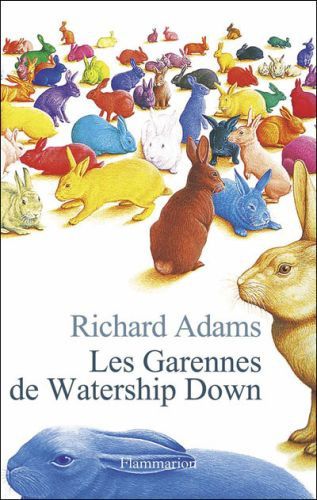

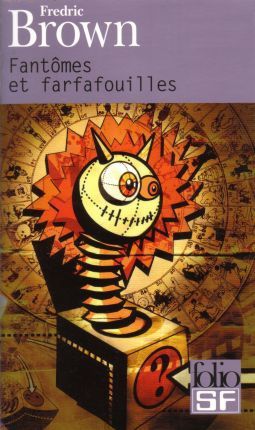





/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)