LE RETOUR DE KHLIT LE COSAQUE
Joie ! Les Éditions Callidor nous reviennent, avec trois nouveaux titres dans leur belle collection « L’Âge d’or de la fantasy », dont celui-ci, Le Khan Blanc, deuxième tome des « Lames cosaques », soit les aventures de Khlit, que ses ennemis appellent le Loup, aventures entamées dans le remarquable volume qu’était Le Loup des steppes. L’occasion de retrouver, au-delà du rusé vieil homme qui est le héros de ces aventures, la maestria de son auteur, Harold Lamb, figure des pulps (et plus particulièrement d’Adventure) qui devait avoir une influence déterminante sur un certain nombre de collègues et successeurs, au premier rang desquels Robert E. Howard, grand fan devant l’éternel, et qui saurait, le moment venu, tirer les enseignements de ses lectures de jeunesse dans ses propres récits d’aventures historiques et orientales, mais aussi dans sa fantasy, Conan en tête (quant aux successeurs de Howard, ils pourraient à nouveau s’en inspirer – je ne suis pas exactement un fan de David Gemmell, mais je ne serais pas surpris que ses récits de « Drenai », tels que Légende et ses divers avatars, doivent également à Harold Lamb, d’autant que le prisme mongol y est particulièrement marqué ; je ne me prononcerai pas pour George R.R. Martin et ses Dothraki dans « A Song of Ice and Fire », mais bien d’autres noms pourraient sans doute être avancés).
C’est tout de même un point à souligner : si « Les Lames cosaques », ainsi que la série est ici intitulée, a eu une influence colossale sur la sword and sorcery américaine ultérieure, en dépit du titre de la collection, elle ne relève pas à proprement parler de la fantasy ; les aventures se déroulent dans notre monde, aux environs du XVIe siècle, et, si l’auteur prend des libertés avec l’histoire, c’est en veillant à rester dans un cadre suffisamment mal connu pour se permettre quelques audaces bienvenues.
Par ailleurs, le surnaturel n’est pas vraiment de la partie : on croise bien des sorciers ou chamans ici ou là, mais, s’ils prétendent disposer de pouvoirs magiques, rien ne l’implique dans les faits ; tout au plus la première des trois novellas ici compilées, et d’une certaine manière la troisième, contiennent-elles des « prophéties » qui s’accomplissent, mais c’est là un ressort narratif classique en dehors de la fantasy – tandis que l’ersatz très réduit de « civilisation perdue » de la deuxième novella n’a pas l’ampleur coutumière des variations sur ce thème chez un Robert E. Howard (par exemple dans El Borak, pour rester dans un cadre proche), et joue certes de vieux mythes, mais dans une perspective qui pourrait très bien être considérée comme « réaliste ». Dans les trois nouvelles, au fond, ce qui pourrait en apparence relever de la magie s’avère plutôt tenir de la chance – un facteur extérieur crucial, même dans les meilleures aventures, les plus serrées…
Outre ces trois novellas publiées initialement dans Adventure entre décembre 1918 et avril 1919, et d’une petite centaine de pages chacune, il faut noter que, comme Le Loup des steppes (et à vrai dire les autres titres publiés par Callidor, de manière générale), Le Khan Blanc dispose d’un paratexte limité mais bienvenu, en dépit d’une traduction (par l’éditeur) peut-être un peu limite : une préface de S.M. Stirling, sans plus, surtout des éléments publiés par l’auteur et son rédacteur en chef dans le courrier des lecteurs d’Adventure. Et, comme les autres volumes, Le Khan Blanc est également illustré, assez abondamment – le travail de Ronan Marret ne m’avait vraiment pas convaincu dans le premier tome, mais il y a de nets progrès dans ce deuxième tome, sans que ce soit renversant non plus.
LE SANG DE GENGIS KHAN
Les aventures de Khlit le Cosaque, d’abord un peu dispersées et de formats très divers dans Le Loup des steppes, se mettent de plus en plus à constituer une saga : les trois novellas recueillies dans le présent volume se suivent et font intervenir des personnages récurrents au-delà du seul Khlit. Par ailleurs, elles usent d’un cadre qu’on ne dira peut-être pas « unique », néanmoins bien plus cohérent que dans le premier tome, où l’on voyageait énormément, de l’Ukraine à l’Irak puis à la Mongolie ; en fait, il s’agit de poursuivre les ultimes errances de Khlit dans cette dernière destination, à la recherche du tombeau de Gengis Khan, en en faisant à son tour un khan, à la tête des clans tatars – ce qui unit les trois récits du Khan Blanc. Les deux premières nouvelles se situent ainsi aux confins de l’Asie, entre le lac Baïkal et la Grande Muraille de Chine, et, si la troisième revient davantage vers l’Ouest, à la lisière du désert du Taklamakan puis à Kachgar, nous restons tout de même bien loin de l’Ukraine natale du Cosaque.
Ce qui n’est en rien un problème – au contraire, même : Harold Lamb, à qui son éditeur avait donné carte blanche du fait de la popularité de ses récits, en profite pour mettre en scène sa passion pour les peuples mongols « au sens très large » (je ne me sens vraiment pas d’entrer dans les détails de cette histoire très compliquée à tous points de vue), se fixant ici sur les Tatars. Comme le Cosaque (et il semblerait qu’historiquement les Mongols aient usé des Tatars comme les Russes useraient des Cosaques à l’époque de Khlit), les Tatars ici mis en scène sont présentés comme autant de descendants des redoutables conquérants mongols – Gengis Khan en tête, qui fascinait Lamb, lequel lui avait d’ailleurs consacré une biographie (il en a rédigé plusieurs, portant surtout sur des grands conquérants, comme par exemple Alexandre le Grand, un autre moyen pertinent de traverser l’Asie pour en faire un pont entre l’Orient et l’Occident). Dans Le Loup des steppes, le sang mongol de Khlit l’avait amené à partir en quête du mythique tombeau de Gengis Khan, jusqu’à brandir son étendard devant les troupes chinoises ; et, bien sûr, il y a son fameux sabre incurvé, que l’on dit avoir été celui du plus grand conquérant de l’histoire…
Un héritage difficile à porter, en ce XVIe siècle (approximatif) où, passé les gloires de Gengis Khan, de Kubilai Khan et de Tamerlan, l’histoire des peuples des steppes est moins bien connue (ou en tout cas l’était quand Lamb avait écrit ses récits, à l’aube du XXe siècle, je suppose que cela a pu changer depuis) ; on suppose du moins l’époque et la région anarchiques, avec une complexe mosaïque de peuples qui s’affrontent sans cesse, tout en subissant à l’ouest la pression russe (notamment via les Cosaques, d’ailleurs), et à l’est la pression chinoise ; ceci, en outre, dans un contexte culturel et notamment religieux flou et fluctuant, les trois novellas y reviennent régulièrement, qui mettent en scène des personnages tantôt tournés vers le chamanisme, le bouddhisme ou l’islam, tandis que le christianisme, présent, ne concerne qu’une minorité de personnages seulement – incluant cependant notre héros, qui doit dissimuler cette foi aux yeux de ses hommes.
Reste que cet ancrage historique et culturel vibre de la passion de l’auteur, sensible, tout en lui fournissant un cadre idéal pour des aventures épiques, où les combats et la ruse sont autant d’armes à prendre en compte, dans des luttes politiques extrêmement complexes. Soit tout ce qu’il faut pour faire une bonne aventure de Khlit, exotique, héroïque, futée et riche de bien cruels dilemmes autant que de révoltantes trahisons.
LA RUSE DU VIEUX LOUP
Khlit a bien quelque chose d’un précurseur de Kull et de Conan (sans même parler d’El Borak), mais sous un angle bien particulier, et éventuellement avec certaines limites. Tout d’abord, bon combattant, excellent cavalier, ce n’est toutefois pas un héros d’essence « physique » avant tout. Sa ruse est au moins aussi importante que son aptitude au combat, et probablement davantage – et il lui en faut, de l’astuce, dans ces complexes affaires où il est contraint de choisir entre des maux tous aussi redoutables les uns que les autres. C’est une dimension qui me le rend beaucoup plus sympathique que les héros howardiens, dont les performances martiales tendent, à un moment ou à un autre, à me fatiguer (et j'imagine que cela explique pour partie pourquoi Bran Mak Morn est mon préféré). Les combats sont bien présents chez Lamb, moins scrupuleusement détaillés, plus resserrés, pas moins habilement chorégraphiés ; mais la ruse de Khlit offre l’occasion de belles joutes d’un autre ordre, et qui me parlent bien davantage.
Les Kull et Conan qu’il anticipe sont en fait surtout les rois vieillissants et qui regrettent le temps de l’aventure solitaire. Il y a bien de ça chez Khlit, mais avec peut-être davantage de conscience qu’il ne peut plus vraiment se permettre, à mesure que ses cheveux grisonnent, de prendre le large ainsi qu’il l’avait toujours fait, pour parcourir l’Europe et l’Asie sans attaches. Toutefois, ce statut passablement tardif de « roi » lui préserve tout de même bien plus d’opportunités d’aventures et de voyages que pour Kull et Conan ; la nostalgie demeure, oui, mais elle n’a dès lors pas les mêmes connotations que pour les héros de Howard dans leurs avatars de vieux souverains. L’âge est probablement une composante plus importante du personnage.
Il y a cependant un autre aspect qui permet de faire le lien, peut-être de manière plus pertinente, et c’est son statut d’étranger. Kull et Conan sont essentiellement des étrangers – c’est en cela qu’ils sont des barbares. Tous deux, chez Howard du moins (pour avoir relu récemment quelques vieilles BD Marvel, j’ai constaté que les épigones et adaptateurs n’avaient pas toujours eu cette lucidité), ont quitté leur terre natale (l’Atlantide pour Kull, la Cimmérie pour Conan), et définitivement : ils n’y retourneront jamais. En lieu et place, au terme de longues aventures, ils sont devenus les maîtres de royaumes civilisés (la Valusie pour Kull, l’Aquilonie pour Conan), mais leur statut d’ « extérieurs » demeure, qui leur vaut bien des ennuis. Il y a de cela chez Khlit, mais sur un mode un peu renversé… et peut-être un peu plus banal ? Pas dit, car il y a quelques nuances d’importance. En tout cas, l’Ukraine natale de Khlit est bien lointaine, et, si le sang de Gengis Khan qui coule dans ses veines l’associe aux Tatars sur lesquels il est amené à régner, il n’en demeure pas moins un étranger en leur sein, surtout pour les chamans et sorciers, ses pires adversaires, qui n’apprécient pas son extraction culturelle différente – et encore moins son christianisme, quand vient le temps des révélations. Cependant, les Tatars dont Khlit est fait khan ne sont pas les civilisés Valusiens et Aquiloniens – la rupture avec le passé est donc moins brutale concernant notre héros cosaque que concernant les créations de Robert E. Howard. Il y a enfin l’idée d’un chef occidental à un peuple barbare oriental, mais Khlit étant lui-même une forme de barbare, en tant que « Khan blanc » (titre à ne peut-être pas trop prendre au pied de la lettre), il n’est pas non plus tout à fait équivalent à El Borak… ou à son modèle, pour partie, qu’était Lawrence d’Arabie, quand bien même les exploits de ce dernier étaient tout récents et très médiatisés quand Lamb écrivait ses aventures cosaques.
Tous ces aspects font la saveur de ce beau personnage. Reste à l’impliquer dans de belles aventures, et Harold Lamb sait y faire…
TROIS AVENTURES ORIENTALES
Le Khan Blanc
Quelques mots, rapidement, sur les trois novellas figurant dans ce deuxième volume. La première s’intitule « Le Khan Blanc », et Khlit y gagne ce titre… non sans mal. Les Tatars sont partagés quant au vieux Cosaque – et, à vrai dire, ceux qui se posent en alliés ne servent visiblement que leurs propres intérêts politiques, ce dont le Loup a bien conscience. Cependant, les Tatars davantage hostiles ne peuvent dissimuler que le Cosaque les a impressionnés, à manier ainsi l’étendard de son ancêtre Gengis Khan devant les troupes chinoises…
Et les Chinois ne l’ont pas oublié non plus – ils le font même savoir à Khlit et aux Tatars ! Un général du nom de Li Jusong, connu pour être impitoyable, est en route pour le punir… et Khlit décide de partir incognito pour lui faire face – seul ! Pourtant, un Tatar du nom de Chagan le suit, bien malgré lui, et c’est à deux qu’ils se rendent à Shankiang, alors même que la ville est sous la menace d’un assaut du général chinois. Or ce dernier est accompagné d’un vieux sage aveugle, Li Chan Ko, dont les prophéties pourraient bien concerner Khlit…
Une nouvelle très variée et pourtant cohérente. La politique tendue des scènes chez les Tatars laisse bientôt la place à un survival urbain puissant autant que nerveux, tandis que notre héros se retrouve isolé dans Shankiang assaillie par les troupes de Li Jusong. Ses talents martiaux lui sont utiles, mais bien davantage sa ruse – ne serait-ce que pour s’infiltrer dans la ville – et, cela n’est pas un paradoxe, sa sincérité. L’ensemble baigne en même temps dans les symboles et les prophéties, qui confèrent à l’aventure un parfum plus mystique, inattendu mais efficace. Le résultat est palpitant, angoissant, épique, malin, tout à la fois – et, bien sûr, l’exotisme y a sa part, très bien employé par l’auteur, qui n’en fait pas trop mais dépayse assurément, y compris en opposant la steppe des Tatars et la ville de bonne taille, civilisée mais en proie aux assauts de civilisés ; je ne doute pas un seul instant que Robert E. Howard a adoré. Et moi aussi.
Changa Nor
La deuxième novella s’intitule « Changa Nor ». Khlit est donc devenu le kha-khan des Tatars – encore faut-il qu’il trouve à les occuper… La pression des Kallmarks, à l’ouest, est inquiétante ; mais un vieux mythe intrigue les Tatars, qui porte sur une forteresse antique au milieu d’un lac, et dont on dit qu’elle abrite des trésors considérables ; peut-être de quoi s’accommoder les Kallmarks ? Khlit est lui aussi curieux, aussi se rendent-ils sur place – et la forteresse existe bel et bien, qui bénéficie de protections si surprenantes qu’elles ne manquent pas d’évoquer quelque démoniaque magie… Après tout, on dit l’endroit gardé par un sorcier qui communique avec les animaux, et chevauche un renne !
Ici, SPOILERS, jusqu’à la fin de cette section… Car le secret de Changa Nor nous est enfin révélé : cette forteresse minuscule correspond en fait à l’ultime reliquat du royaume du Prêtre Jean, cette contrée mythique de l’Asie dont les Européens croyaient qu’elle était dirigée par un souverain chrétien. Elle abrite bien des trésors, oui – mais peut-être plus spirituels que matériels ?
Cependant, c’est pour cette même raison un piège redoutable, concernant Khlit. Depuis qu’il est devenu kha-khan, ses ennemis les plus acharnés au sein de la horde tatare sont incontestablement les chamans, le rusé Lhon Otai en tête, qui suspectait bien que Khlit était chrétien… Ce qu’il est bel et bien, mais qu’il avait dissimulé, sachant que les Tatars le rejetteraient s’ils venaient à l’apprendre. Forcément, ici, ils l’apprennent…
L’occasion, donc, de bien cruels dilemmes pour Khlit, qui a promis à ses hommes les trésors de Changa Nor, et qui doit faire face aux manœuvres cyniques des chamans. Et, progressivement, un nouveau suvival se met en place, mais cette fois en huis-clos – tandis que Khlit et quelques-uns seulement de ses hommes, même portés à le rejeter pour sa foi quand ils avaient été ses soutiens les plus fidèles, se retrouvent piégés par l’ambitieux Lhon Otai…
La nouvelle fonctionne très bien. Elle recycle un vieux mythe de manière surprenante mais pertinente, tout en en profitant pour injecter de la « bizarrerie » presque surnaturelle dans le récit – avec l’étonnant personnage du gardien de Changa Nor, Gurd, mais aussi les autres résidents, l’ultime Prêtre Jean et une variation étonnante sur Jeanne d’Arc ! Mais, au-delà, les dilemmes et les ruses, davantage dans l’esprit des précédentes aventures de Khlit, sont joliment mis en avant, pour un résultat imparable.
Le Toit du Monde
La troisième nouvelle, « Le Toit du Monde », qui se situe davantage à l’ouest, est peut-être la plus déconcertante, car elle paraît tout d’abord passablement décousue. Pourtant, dans sa structure complexe, elle contient assurément de beaux moments – mais c’est tout de même une architecture un peu bancale à mes yeux.
La religion y a toujours sa part : Khlit le chrétien, à la tête d’une horde tatare dont la foi semble guère doctrinale et largement chamanique, doit composer avec une nouvelle prophétie, émise cette fois par le dalaï-lama, et que ses hommes prennent au sérieux, comme un grand seigneur voire un grand magicien ; en même temps, l’aventure amènera Khlit à côtoyer des personnages musulmans, à la foi pas forcément si intransigeante non plus, certes.
Pourtant, c’est sans doute une fausse piste ? Ou, plus exactement, derrière la religion, il y a comme de juste la politique, qui importe bien davantage… En fait, le dalaï-lama, via son machiavélique envoyé Dongkor Gelong, entend mettre de l’huile sur le feu dans les relations très tendues entre les Tatars de Khlit et un autre peuple cavalier, les Kirghizes ; l’objectif étant de les amener à s’entretuer, pour régner sur leurs cadavres !
Khlit n’est pas bête : il sait très bien ce qu’il en est, et ses hommes aussi, sans doute. Il n’aime pas être manipulé… mais le contexte le contraint à obéir. Et tout d’abord à cette étrange injonction, qui conduit Khlit à se rendre (avec, et une fois de plus contre son gré, l’indispensable Chagan) dans les ruines d’une vieille cité abandonnée au fond du désert du Taklamakan – puis de se rendre dans la ville de Kachgar, effervescente fourmilière où se nouera l’avenir des relations entre les Tatars et les Kirghizes, autant dire de l’Asie centrale.
Mais, dans le désert, Khlit rencontre… le véritable personnage central de cette histoire : une femme des plus arrogante, du nom de Sheillil – une danseuse au passé ambigu, liée aux Kirghizes, et qui n’aime pas, elle non plus, être manipulée, et a fortiori considérée comme un objet ; fine politique, elle sait cependant jouer de son statut guère enviable pour manipuler les autres ! Sheillil est un bon personnage, et, dans son rôle à la Salomé, elle impressionne sans doute davantage que la guerrière en armure de Changa Nor. À vrai dire, oui, elle prend le premier rôle – d’autant que Khlit, pour survivre à cette complexe histoire, est contraint de jouer à l’imbécile pris de panique ; nous savons forcément qu’il ne s’agit là que d’une façade, mais le récit en est tout de même affecté.
L’intrigue est passablement tordue, cependant. Peut-être un peu trop ? Elle manque assez clairement d’unité : là où le contraste de la première nouvelle, du camp de yourtes à la ville assaillie, fonctionnait superbement, ici, l’opposition plus marquée encore entre les ruines du Taklamakan et Kachgar débordant de richesses convainc moins – alors même que la portée symbolique de cette opposition est plus considérable encore. Les « passages » entre les différents tableaux sont plus ou moins convaincants, il faut dire, ce qui n’arrange rien à l’affaire – ainsi avec le rôle trouble du marchand Chu’n Yuen.
Mais il y a tout de même de beaux moments – de belles images, aussi : sables mouvants du Taklamakan à la lisière d’une ville fantôme, ou chasse « à l’amour », quand la belle et arrogante Sheillil constitue le lot d’un affrontement à mort entre seigneurs cavaliers, tandis qu'en fond se joue l’avenir des Tatars et des Kirghizes.
Au final, la nouvelle est donc bonne, mais convainc probablement un petit peu moins que les deux précédentes, davantage resserrées – à mes yeux, du moins.
UN MODÈLE D’AVENTURE
Cette très relative fausse note mise à part, Le Khan Blanc est un beau volume et un modèle de récits d’aventure. L’impact, me concernant, a peut-être été un peu moindre qu’avec Le Loup des steppes, mais je suppose que la joie de la découverte y est pour beaucoup, et ce deuxième tome en est un digne successeur.
Harold Lamb, oui, est décidément un maître de l’aventure. Il a un don pour l’exotisme qui n’en fait pas trop, sans doute parce que ces textes vibrent de sa passion pour les peuples cavaliers et l’Asie centrale et orientale – la carte blanche qui lui avait été donnée par son éditeur en la matière s’avère un atout de choix. Et, bien sûr, il sait, sur cette base, construire des histoires fortes, débordant de ruses tordues mais pertinentes, et riches de dilemmes insurmontables.
Pour ce faire, il joue bien sûr de ce très bon personnage qu’est son héros, Khlit, bien plus complexe et subtil qu’il n’en a l’air. Si les camarades tatars du Khan Blanc (le dévoué Chagan, le fougueux Chepé Buga, l’enthousiaste Berang) relèvent sans doute davantage de stéréotypes, c’est à bon droit – et cela se marie bien avec quelques beaux personnages d’enflures, en face, comme Lhon Otai ou Dongkor Gelong, tandis que d’autres antagonistes sont plus ambigus, tel Li Jusong, un adversaire véritablement à la hauteur de Khlit. Enfin, il faut compter avec les personnages les plus singuliers propres à chaque aventure, comme le charismatique archer Arslan dans « Le Khan Blanc », les résidents de Changa Nor (Gurd en tête), ou, surtout à vrai dire, l’insupportable et pourtant admirable et subtile Sheillil du « Toit du Monde ».
En définitive, même si cela peut paraître un peu mesquin, je ne peux qu’en revenir à ce même jugement émis suite à la lecture du Loup des Steppes : dans le registre de la fantasy (même si, à proprement parler, les aventures de Khlit n’en relèvent donc pas le moins du monde), l’influence de Harold Lamb sur certains auteurs ultérieurs, et au premier chef Robert E. Howard, saute aux yeux, mais fait bien plus que cela : elle s’affiche aussi comme un modèle indépassé sinon indépassable – en ce qui me concerne, les aventures de Khlit sont globalement bien meilleures que celles de Conan et compagnie, à quelques exceptions près ; et, à en juger par ces deux volumes, il ne fait aucun doute, objectivement, que la qualité est bien davantage constante.
Harold Lamb a écrit bien d’autres aventures de Khlit le cosaque, cela dit – encore onze, semble-t-il. Je ne puis qu’espérer, dès lors, que les éditions Callidor continueront sur cette voie, et nous livreront la suite un de ces jours. J’ai hâte !

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)




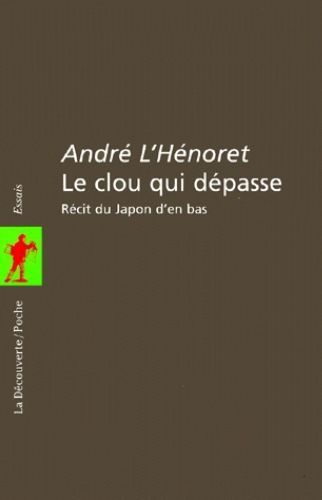





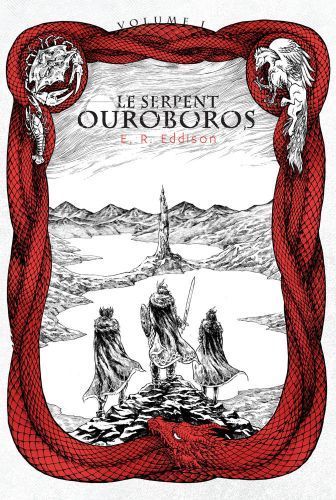


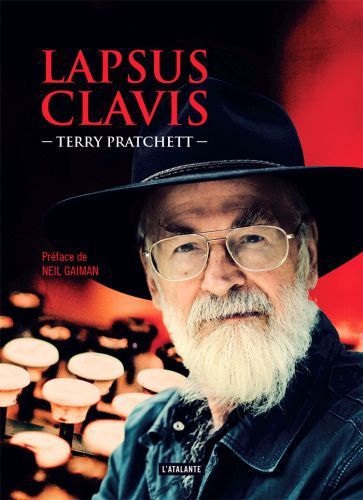
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)