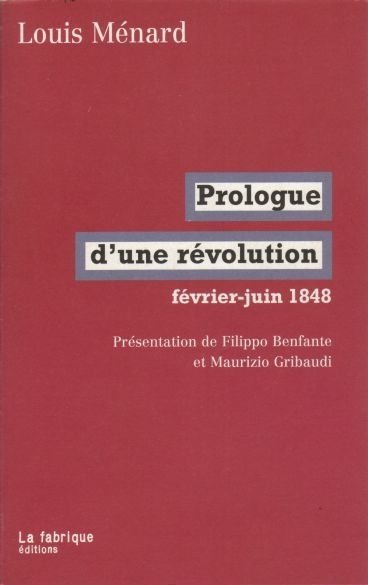
MÉNARD (Louis), Prologue d’une révolution. Février-juin 1848, présentation de Filippo Benfante et Maurizio Gribaudi, Paris, La Fabrique, coll. Utopie et liberté, [1849] 2007, 299 p.
Mon Dieu ! Horreur ! Un livre de gauchiss’ ! Le titre, la couleur, l’édition et la collection ne laissent guère de doutes là-dessus. L’auteur est sans doute moins connu : Louis Ménard fut en son temps un pouète plus ou moins talentueux, un chimiste relativement doué, un helléniste maniaque obsédé par « l’âge d’or » de l’Antiquité et la religion païenne. Il eut l’occasion de fréquenter du très beau monde, cela dit : Baudelaire, notamment, avec lequel il s’est brouillé après une critique un peu sèche ; puis des gens aussi divers que Leconte de Lisle, Renan ou Berthelot, puis Barrès… Ah, et, en exil sous la IIe République, il rencontra Marx en Belgique.
Le Prologue d’une révolution (tout un programme…) semble bien loin de la plupart des préoccupations habituelles de ce petit bourgeois confortable familier de la bohème. Il est pourtant un de ses ouvrages majeurs, et un témoignage remarquable sur les premiers mois de la IIe République. Et si Ménard n’a pas le prestige d’un Marx, d’un Tocqueville, d’un Proudhon ou d’un Lamartine, pour citer quelques autres auteurs ayant traité à la même époque de ce sujet, son ouvrage, très engagé, n’en est pas moins riche d’informations et d’analyses pertinentes, et constitue sans doute la meilleure histoire écrite « sur le vif » des Journées de Juin. Et cela, d’ailleurs, fut très vite notoire : Proudhon, qui s’était fait très discret et plus empêtré que jamais dans ses contradictions lors des événements, se racheta quelque peu en accueillant la publication de Ménard, début 1849 (soit en gros six mois après les événements ; on peut bien parler ici « d’histoire immédiate »), dans les pages d’un de ses éphémères journaux quarante-huitards harcelés par les autorités, en l’occurrence Le Peuple. Et Ménard a livré des Journées de Juin un tableau bien différent de celui qui était véhiculé jusqu’alors par les républicains modérés de la tendance du National (rappelons que, des Journées de Juin à l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République le 10 décembre, Cavaignac est chef de l’exécutif et Armand Marrast président de l’Assemblée) et les conservateurs de tout poil, essentiellement les anciens légitimistes et orléanistes qui formeront bientôt le Parti de l’Ordre. Ménard dénonce en effet à longueur de pages les atrocités commises par les forces de Cavaignac à l’encontre des insurgés. On l’accuse de mensonge, de diffamation : il produit ses sources. Menacé de prison, il prend bientôt la route de l’exil… et ne rentrera en France qu’après l’amnistie de 1852.
Mais qu’on ne s’y trompe pas : le Prologue d’une révolution, s’il a tout d’un pamphlet, n’est pas un bête concentré d’anecdotes horribles et plus ou moins racoleuses, et ne traite pas que des Journées de Juin, envisagées de manière purement prosaïque. Au-delà, il fait preuve d’une analyse assez lucide des événements ayant conduit à ce drame scellant le sort de la jeune République. Et, à vrai dire, il est souvent plus pertinent que bien des commentateurs plus fameux, Marx en tête…
La réédition de cet ouvrage chez les gauchiss’ de la Fabrique est donc tout à fait appréciable pour qui s’intéresse à cette complexe période qu’est la IIe République, si mal connue, pour ne pas dire négligée, quand bien même elle est à mon sens fondamentale. On peut donc bien remercier Filippo Benfante et Maurizio Gribaudi pour cette belle édition, dotée d’une riche présentation remarquablement documentée, émaillée de cartes et de gravures, régulièrement annotée, et complétée par des annexes non négligeables concernant les poursuites intentées contre Ménard (et notamment une longue lettre contenant des pièces justificatives). J’exprimerai néanmoins un regret, sans doute un peu naïf : sans surprise, cet ouvrage militant publié dans une collection militante ne fait pas vraiment l’objet d’une analyse critique, que la distance des événements et la multiplicité des travaux sérieux conduits sur les Journées de Juin (notamment) aurait pourtant autorisé… On avouera même que les éditeurs tendent à idéaliser quelque peu Ménard, et à gommer ses aspects les moins sympathiques (voyez, dans la présentation, les considérations un peu embarrassées sur l’antisémitisme de ce futur antidreyfusard et proche de Maurice Barrès ; cela dit, je ne saurais m’étendre pour ma part sur ce sujet, et le Prologue d’une révolution n’en témoigne guère – tout juste une allusion discrète concernant Crémieux ; on est bien loin de l'antisémitisme virulent d'un Proudhon ou, paradoxalement, d'un Marx), tout en adoptant une position assez unilatérale concernant les événements, fort légitime chez le contemporain et témoin – mais non participant – Louis Ménard, mais plus dommageable chez l’historien.
Dans le Prologue d’une révolution, Louis Ménard décrit les événements depuis la Révolution de Février jusqu’aux Journées de Juin, sous l’angle du « Peuple » (toujours avec une majuscule…) spolié de ses attentes légitimes par les conservateurs. Si le récit des journées révolutionnaires ne constitue certainement pas le sommet de son ouvrage, il n’en contient pas moins nombre d’éléments intéressants. On remarquera notamment comment Ménard, très vite, relève les contradictions au sein du Gouvernement provisoire, en distinguant pour sa part trois partis : les républicains modérés de la tendance du National, les démocrates de La Réforme et (plus ou moins rattachables à ces derniers) les socialistes, à savoir Louis Blanc et Albert. Il livre par ailleurs, tout au long de son ouvrage, quelques portraits fort intéressants et souvent lucides des protagonistes de ces événements. Ainsi, il relève très tôt le jeu ambigu de Lamartine – en se montrant peut-être excessivement sévère à l’occasion – et je note aussi son bel éloge de Louis Blanc, personnalité qui m’est très sympathique et que l’on a un peu trop oublié à mon goût, notamment en raison du mensonge éhonté, très tôt répandu, lui attribuant l’expérience désastreuse des Ateliers nationaux : Ménard sait bien, lui, que ces « Ateliers de charité » n’avaient rien à voir avec l’Organisation du travail prônée par Louis Blanc, mais étaient une invention de Marie, anti-socialiste notoire ; il montre par contre très bien l’importance des travaux de la Commission du Luxembourg présidée par Louis Blanc – sans se faire d’illusions sur les circonstances de sa création et sur son inefficacité à court terme… – et rapporte fidèlement son attitude conciliatrice et diplomate, tout en réfutant adroitement les calomnies portées à son encontre lors des événements du 15 Mai et des Journées de Juin.
Je ne reviendrai pas ici sur le détail des événements rapportés par Ménard. Notons juste qu’il est sans doute celui qui livre le compte rendu le plus documenté des émeutes de Rouen lors des élections à la Constituante, ce « premier sang » hautement révélateur de la tournure des choses (c’est par ailleurs la seule véritable excursion provinciale de son ouvrage : Ménard est Parisien jusqu’au bout des ongles, ne cesse de stigmatiser avec un profond mépris la province nécessairement conservatrice, et s’en tient autrement au récit des seuls événements parisiens).
Mais avant de passer aux Journées de Juin, le point d’orgue du Prologue d’une révolution, il me paraît utile de rapporter plus en détail son évocation de l’attentat du 15 Mai, date cruciale et hélas méconnue ; or Ménard se montre très documenté et complet à ce sujet (à vrai dire, il est peut-être une des « sources » les plus riches à cet égard ; je n’ai pour ma part rencontré de récit plus complet que dans le passionnant mais très orienté ouvrage d’Henri Guillemin La Première résurrection de la République) ; et comme c’est un événement qui me paraît fondamental et que j’ai eu l’occasion d’étudier (pour plus de détails, vous pouvez zyeuter mon mémoire de Master 2, et j’y reviendrai nécessairement pour ma thèse), hop, un petit topo.
(Et une digression sur l’attentat du 15 Mai, une !)
L’Assemblée constituante vient tout juste d’être élue. Si tous les représentants affichent leur républicanisme, la composition de l’Assemblée issue du suffrage universel ne surprend guère les éléments les plus avancés : les « rouges », ceux que l’on appellera bientôt les démocrates-socialistes, sont très minoritaires ; les « bleus », républicains modérés de la tendance du National, dominent, secondés qu’ils se trouvent par une masse plus ou moins floue de « républicains du lendemain », conservateurs « blancs » qui comptent bien accaparer la République, et formeront bientôt le Parti de l’Ordre. Parmi les démocrates les plus radicaux, nombreux étaient conscients de ce fait, ainsi Blanqui, qui multiplia les manifestations tendant à repousser la date des élections jusqu’à ce que « l’éducation du peuple » lui permette de voter intelligemment, ou encore le ministre de l’Intérieur Ledru-Rollin, qui s’est empressé de favoriser cette « éducation » par le biais de ses très critiqués commissaires du Gouvernement, ou sa propagande républicaine empruntant régulièrement la plume de George Sand. Mais rien n'y fait : voyez, par exemple, les fameuses et pertinentes évocations des circonstances de leur élection par Tocqueville et Rémusat, tout deux libéraux issus de la gauche dynastique de la Monarchie de Juillet... Et l’Assemblée affiche très tôt sa volonté de rupture : elle proclame solennellement la République, adresse des remerciements polis au Gouvernement provisoire, mais s’empresse de le remplacer par une Commision exécutive ne comprenant que cinq membres ; les socialistes Louis Blanc et Albert en sont bien évidemment exclus, et Ledru-Rollin lui-même n’intègre finalement ce nouveau Gouvernement que sur la pression de Lamartine, élu dans dix départements, et qui sentait bien venir la mainmise du National sur la politique française.
Les clubs parisiens entendent réagir, et c’est la question polonaise qui leur en fournira l’occasion. 1848, rappelons-le, est « le printemps des peuples ». Dans la foulée de la Révolution parisienne, les républicains se soulèvent un peu partout en Europe, notamment en Italie, en Prusse et en Pologne. Les têtes couronnées européennes craignent cet embrasement, dans lequel ils voient une résurrection des événements de la décennie 1790. Lamartine, ministre des Affaires étrangères, s’empresse de les rassurrer : la France républicaine ne veut pas de la guerre. Mais, a fortiori depuis la Monarchie de Juillet et sa politique étrangère timorée, les républicains français se sont attachés à la cause de la Pologne opprimée par la Prusse et par la Russie. Or l’insurrection polonaise menace d’être réprimée dans un bain de sang. Les clubs, et notamment ceux de Raspail et de Blanqui, annoncent une manifestation en faveur de l’intervention française en Pologne pour le 15 mai.
Mais, le jour fatidique, les très nombreux manifestants, s'ils ne défilent pas en armes, ne se contentent pas d’arpenter les rues parisiennes ; dans une atmosphère qui rappelle à tous les témoins le mauvais souvenir des « journées révolutionnaires » de la Convention, la foule pénètre dans l’Assemblée, le commandant de la Garde nationale Courtais n’osant pas (ou ne voulant pas ?) s’y opposer. C’est là une violation manifeste : l’Assemblée s’était empressée d’émettre un règlement acceptant de recevoir les pétitions, mais seulement si elles lui étaient remises par une délégation restreinte. Désireux de calmer le jeu, des représentants du peuple parmi les plus avancés et les plus appréciés de la foule parisienne, et notamment Barbès et Louis Blanc, acceptent de jouer un rôle d’intermédiaires. Les demandes concernant la Pologne sont lues, mais le peuple refuse de quitter l’Assemblée tant que les élus ne se sont pas prononcés sur cette question, en dépit de pressions diverses. Barbès reprend la parole pour rassurrer les manifestants... et en profite en outre pour développer tout un programme de réformes radicales, reposant notamment sur un « impôt sur les riches » qui ne manque pas de susciter le trouble dans les rangs des députés (bientôt, on colportera jusque dans les colonnes du Moniteur une rumeur faisant état de manifestants réclamant à Barbès « deux heures de pillage », mensonge flagrant – tous les témoins, de droite comme de gauche, l’affirment – bien représentatif de la manipulation des esprits reposant sur la psychose des « nouveaux barbares »). Et les discours s’enchaînent, y compris ceux de manifestants n’ayant pas été élus, et notamment Blanqui, qui haïssait son ancien camarade de prison Barbès et ne manque pas de renchérir sur les propositions du « Bayard de la démocratie ». La foule, cependant, refuse toujours de quitter les lieux : elle veut une réponse immédiate, un vote par acclamations, par exemple. La tension monte ; on entend battre le rappel, et on craint l’intervention de la Garde nationale, qui avait fait preuve tout récemment de son hostilité aux « communistes » lors d’une manifestation qui s’était soldée par un fiasco, et où des personnalités telles que Cabet ou Louis Blanc avaient été menacées de mort… C’est à nouveau Louis Blanc qui vient calmer les esprits ; bien contre son gré, il est porté en triomphe par la foule… et finit par rentrer chez lui, un peu trop vite sans doute.
C’est que les événements vont bientôt s’accélérer, du fait de l’intervention inopinée d’Huber. Un personnage ambigu, aux nombreuses zones d’ombre, et dont le rôle exact lors des événements du 15 Mai divise encore aujourd’hui. Pour certains, en effet (et notamment Henri Guillemin dans l'ouvrage précité), Huber était un indicateur de police, un élément provocateur infiltré dans les clubs… Toute paranoïa mise à part, on sait que la pratique était effectivement courante ; mais on avouera aussi que les autorités n’hésitaient pas à propager elles-mêmes ce genre de rumeurs pour discréditer certains républicains (très peu de temps avant l’attentat, Blanqui en avait fait les frais ; c’était l’affaire dite du « document Taschereau », qui a considérablement nui au prestige de « l’Enfermé »). Ménard, quant à lui, ne semble pas douter de la sincérité des convictions d’Huber… C’est bien le problème : aujourd’hui encore, on ne sait pas exactement ce qui s’est passé le 15 Mai, et qui tirait les ficelles, ni même s’il y avait des ficelles de tirées… ce qui ne semble cependant guère faire de doute : à en croire George Sand, grande amie de Barbès (et qui, dans sa correspondance avec ce dernier, ne mâchait pas ses mots sur son comportement dans cette affaire…), le jour du 15 mai, il y avait bien quatre ou cinq complots contradictoires…
Quoi qu’il en soit, Huber, qui s’était fait très discret jusqu’alors (selon Ménard, il avait succombé à un « évanouissement »…), prend à son tour la parole : « Puisque l’Assemblée ne veut pas prendre un parti et que le peuple est trompé par ses représentants, je déclare que l’Assemblée nationale est dissoute ! » Et c’est cela qui constitue à proprement parler l’attentat du 15 Mai… Tumulte dans l’Assemblée ; les représentants de tous bords s’insurgent contre ces paroles enflammées qui soulèvent l’enthousiasme du peuple. Mais bientôt, la « dissolution » de l’Assemblée semble un fait accompli, et on commence à dresser des listes pour former un nouveau « gouvernement provisoire », sans forcément demander leur opinion aux intéressés (Louis Blanc, absent, y figure souvent – et cela lui sera reproché par la suite –, mais aussi Lamartine, qui avait encore tout son prestige, et Ledru-Rollin). Barbès, un temps perplexe, joue bientôt le jeu, et s’auto-proclame plus ou moins chef de ce nouveau « gouvernement provisoire ». Comme cela avait été le cas quelques mois plus tôt à peine, les « insurgés », avec Barbès et Albert à leur tête, se rendent à l’Hôtel de ville, et s’empressent d’élaborer des décrets radicaux (dont un concernant l’intervention française en Pologne : il ne faut pas voir là un simple « prétexte », les sentiments pro-polonais des manifestants étaient indéniablement sincères). Du coup, le peuple quitte enfin l’Assemblée… et les représentants s’empressent de reprendre les choses en mains. Lamartine et Ledru-Rollin, bien conscients du tort que pouvaient leur jouer les événements, prennent la tête de la Garde nationale et marchent sur l’Hôtel de ville. Il n’y a pas de combats (les manifestants étaient de toutes façons désarmés, et s’étaient déjà plus ou moins dispersés) : Barbès et Albert, entre autres, sont bien vite arrêtés et conduits à Vincennes (Blanqui ne sera arrêté que quelques jours plus tard ; Huber disparaîtra dans la nature, et ne refera son apparition que lors du procès de Bourges, début 1849 ; lui-même ne sera jugé que lors du procès de Versailles contre les responsables de « l’attentat » du 13 juin 1849, mais, à Bourges, Barbès, Blanqui, Raspail, etc., seront condamnés pour attentat – non-précédé de complot –, ainsi que Louis Blanc et Caussidière, par contumace – j’y viens).
Les débats ne peuvent guère reprendre à l’Assemblée, où certains représentants, jusqu’alors fort timides, s’empressent de blâmer les manifestants absents et de réclamer des remerciements officiels à la Garde nationale, mais le fait est là : au soir du 15 mai 1848, il y a de nouveau des détenus politiques, et l’extrême gauche est décapitée (on comprend d’autant mieux pourquoi les insurgés de Juin, à peine un peu plus d’un mois plus tard, ont manqué de meneurs…). Très vite, l’Assemblée en profite pour préparer une législation plus sévère en matière de presse et de réunions, et ne manque pas de dissoudre d’office les clubs dits « Raspail » et « Blanqui » (qui ne portaient bien entendu pas ces noms, mais c’est ainsi qu’ils sont désignés dans les décrets ; Raspail et Blanqui figurant parmi les principaux accusé, ce n’est certainement pas innocent…) ; et l’on réclame la constitution d’une commission destinée à faire la lumière sur les événements, et notamment sur le rôle des représentants (que l’on pouvait supposer en principe inviolables…) Louis Blanc et Caussidière, pourtant à l'évidence intégralement innocents dans cette affaire… C’est le premier signe flagrant de la réaction entamée par l’Assemblée constituante, et « l’attentat » sera le prétexte sempiternellement évoqué par la suite pour justifier les retours en arrière et les mesures de répression. La prochaine étape, ce sera les Journées de Juin…
(C’est fini pour aujourd’hui.)
Les Journées de Juin, on connaît (et c’est bien pour cela que je ne vais pas m’étendre autant sur ce sujet, qui constitue bien le cœur de l’ouvrage). Ou on croit connaître… Et le récit qu’en livre Ménard est clairement le plus détaillé et le plus solide que j’ai lu. Il permet de combattre utilement certains amalgames trop répandus : notamment, Ménard sait bien que cette insurrection n’est pas le fait des ouvriers des Ateliers nationaux (la suppression annoncée des Ateliers, et plus exactement les conditions dans lesquelles elle s’opère, est bien l’élément déclencheur, mais ces ouvriers, embrigadés « militairement », étaient très minoritaires parmi les insurgés) ; et, à l’encontre notamment de Marx pliant l’histoire à sa conception de la lutte des classes (or c’est cette vision qui a longtemps prévalu…), il sait que la Garde mobile n’a pas été recrutée dans le sous-prolétariat, mais essentiellement parmi de très jeunes ouvriers peu ou pas politisés. Il sait très bien, de même, que Louis Blanc, Cabet, etc., en dépit des accusations portées à leur encontre, n’avaient rien à voir avec le soulèvement de l’Est parisien.
Son récit très complet peut sans doute être critiqué par endroits : si les exécutions sommaires, nombreuses, ne font aucun doute, il n’est pas impossible que Ménard ait grossi le trait à l’occasion ; en sens inverse, si c’est à bon droit qu’il dénonce les calomnies les plus surréalistes accablant les insurgés et les décrivant comme des « nouveaux barbares » assoiffés de sang, de viol et de pillage, il en fait parfois un peu trop dans la description romantique (fort quarante-huitarde, certes) et quasi bisounoursesque des mœurs des émeutiers… Il est partial, en somme (voyez notamment son récit de la fameuse affaire du général Bréa : Ménard ne nie pas l’assassinat du général, mais multiplie les « circonstances atténuantes »… De même, à l’en croire, il ne saurait y avoir de doute sur les responsables de la mort de l’archevêque de Paris, Mgr Affre, fauché par une balle perdue quand il s’était avancé en médiateur sur une barricade. Enfin, il ne manque pas de dénoncer le rôle joué par des agents provocateurs au service de la réaction...). Mais son honnêteté ne saurait faire de doute (il n'hésite d’ailleurs pas à saluer, parmi ses « opposants » politiques, ceux qui ont eu le comportement le plus noble, en s’opposant à la tournure des événements et aux massacres, ainsi, bien sûr, La Rochejaquelein, ou même, plus étrangement, Armand Marrast), non plus que son travail de documentation : ses pièces justificatives en témoignent. Aussi les longues pages consacrées par Ménard à l’Insurrection de Juin sont-elles bien indispensables à quiconque s’intéresse à cet événement fondamental, d’une grande importance dans l’histoire des luttes sociales et politiques, en France et au-delà.
L’ouvrage dans son ensemble est ainsi un document indéniablement enrichissant, et l’on ne peut que se féliciter de cette réédition.



/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)














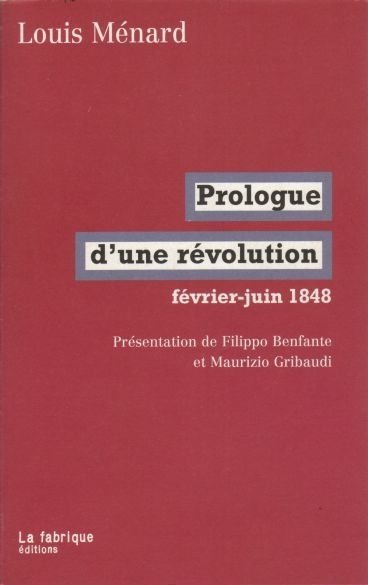

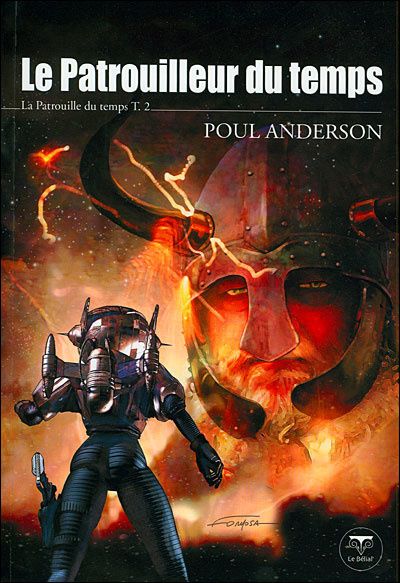

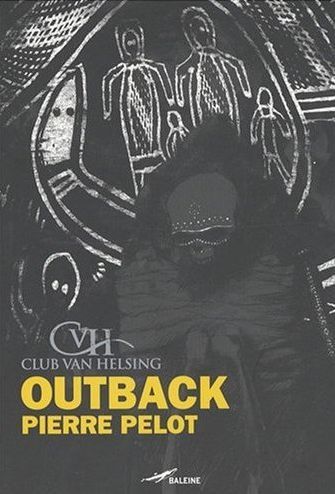

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)