"Bifrost", n° 49. "Spécial Robert Silverberg"

Bifrost, n° 49. Spécial Robert Silverberg, Saint Mammès, Le Bélial’, janvier 2008, 191 p.
J’ai longtemps hésité avant de rendre compte de mes lectures de Bifrost sur ce blog miteux, et je me suis abstenu pour plusieurs numéros. Et ce pour plusieurs raisons : déjà, invariablement, je les lis à la bourre (et cette fois ne déroge pas à la règle, désolé…) ; ensuite… eh bien, c’est une revue. Fiction aussi, me direz-vous, et pourtant j’en ai déjà causé à deux reprises… Oui, certes. Mais Fiction, comme c’est qu’y disent, c’est une anthologie périodique : on y trouve essentiellement des nouvelles, et quelques articles ; peu de rubriques à proprement parler. Une bonne partie de Bifrost, au contraire, est consacrée à la critique des parutions les plus récentes. Et là, que pourrais-je bien dire ? Mais il y a le reste : deux ou trois nouvelles, les articles de Fred Jaccaud et Roland Lehoucq, le dossier… Après tout, si je rédige des petites notes sur de minuscules ouvrages promotionnels comme les cadeaux du libraire pour Bragelonne (ici, ou là) ou Points-Fantasy (hop), je peux bien me fendre de quelques remarques sur Bifrost, non ?
Et c’est d’autant plus vrai en ce qui concerne ce n° 49, puisqu’il s’agit d’un numéro « spécial Robert Silverberg ». Robert Silverberg, le dernier des géants comme on dit parfois ; un auteur incontournable… que j’ai pourtant contourné jusqu’à présent. Ce Bobby-là est sans conteste ma plus grosse lacune science-fictionnelle. J’ai déjà eu l’occasion de m’expliquer sur ce bête blocage dans un compte rendu qui n’avait rien à voir ; depuis, je n’ai toujours pas lu le moindre roman de Robert Silverberg… Cela dit, les choses se sont sans doute un peu améliorées, puisque L’Oreille interne ainsi que son Livre d’or de la science-fiction ont entre-temps intégré mon étagère de chevet. Et ce numéro spécial de Bifrost, que j’ai donc lu en parfait béotien, m’a incité à franchir enfin le pas : cela a en effet été l’occasion de noter quelques titres, sur lesquels il faudra bien que je me jette un jour ou l’autre…
On doit à Robert Silverberg lui-même quatre textes au sommaire de ce numéro spécial, deux nouvelles et deux articles (pas d’entretien, cette fois-ci). La première nouvelle, « Apprenti en sorcellerie » (pp. 6-28) prend place dans l’univers du « cycle de Majipoor », mais se lit très bien indépendamment ; c’est néanmoins un récit de fantasy banal au possible, à peu près dénué de tout intérêt… Pas le meilleur moyen de convaincre du talent de l’auteur, donc. La deuxième nouvelle est déjà plus intéressante, sans être transcendante pour autant : « L’Eglise à Monte Saturno » (pp. 46-75) est un récit fantastique correct, sans plus ; c’est téléphoné, mais il y a une atmosphère… Bon… A la limite, dans la partie fictionnelle, c’est encore Lucas Moreno qui s’en sort le mieux avec son « PV » (pp. 30-45) pourtant assez moyen… ce qui, quelque part, la fout un peu mal, quand même.
Heureusement, les articles de Robert Silverberg m’ont semblé bien plus intéressants. Et tout d’abord le surprenant et réjouissant « Ma carrière de pornographe » (pp. 119-126), dans lequel le prolifique écrivain, bien connu pour avoir fait régulièrement dans l’alimentaire, raconte comment, de 1959 à 1964, il a écrit 150 (150 !!!) romans « pornographiques » (selon les critères vraiment très très chastes de l’époque, hein…) pour gagner sa vie. Un article passionnant, assez drôle, mais aussi instructif, que ce soit sous l’angle du métier d’écrivain, ou sous celui de la censure… Moins surprenant mais fort sympathique tout de même, « La genèse de Majipoor » (pp. 162-170) revient sur l’élaboration du monde de Majipoor qui a fourni un cadre idéal pour bon nombre des œuvres les plus récentes de Robert Silverberg, et probablement celles qui ont connu le plus de succès (commercial en tout cas ; la critique a semble-t-il été moins généreuse passés les premiers volumes…). J’ai lu cet article un peu « dans le vide », n’ayant jamais lu le cycle en question ; mais j’y ai trouvé néanmoins un beau modèle de construction d’univers, complexe et cohérent, et ma foi fort alléchant.
Outre un volumineux guide de lecture (« Petit guide touristique en terres de Silverberg », pp. 134-161) concocté par plein de gens dont quelques cafards et sur lequel je ne saurais guère revenir (si ce n’est pour noter qu’Ugo Bellagamba en profite pour glisser une note intéressante et plus approfondie que les autres critiques sur les nouvelles et novellae de Silverberg – pp. 157-161 – ; boah, allez, je peux bien citer tout de même quelques titres qui, du coup, me paraissent particulièrement tentants : Les déportés du Cambrien, Les monades urbaines – mais celui-là me bottait depuis un certain temps déjà –, et Roma Æterna, notamment), le dossier comprend également un article de Rachel Tanner sur L’Homme dans le labyrinthe (« L’Homme dans le labyrinthe. Mythe et space opera », pp. 127-133) ; n’ayant pas lu ledit bouquin, je ne saurais dire si cet article développant le parallèle entre le roman de science-fiction de Silverberg et le Philoctète de Sophocle est vraiment pertinent (ça m’en a tout l’air, cela dit) ni s’il apporte vraiment quelque chose (ça, c’est moins sûr, pour ce que j’en ai lu ici ou là…). Reste que c’est très intéressant, ma bonne dame, et qu’il va falloir que j’y jette un œil un de ces jours (à L’Homme dans le labyrinthe, hein, pas à Sophocle ; ça, c’est déjà fait… mais ça pourrait être une bonne idée d’y revenir, en fait…).
Et... c’est tout. C’est un peu court, peut-être, maintenant que j’y pense… Ou pas. Bon. Pas grave.
Quelques mots sur le reste. Pas question, bien entendu, de revenir ici sur le cahier critique (« Objectif runes », pp. 78-109), et sur les chroniques s’y rattachant de Thomas Day (« Le coin des revues », pp. 110-112) et de Pierre Stolze (« A la chandelle de Maître Doc Stolze. Un inédit indigeste et deux rééditions jubilatoires », pp. 113-116). Ah, si, juste une chose en passant : je tiens à préciser à Me Stolze que, bon, ça va pour cette fois, mais que, quand je deviendrai Empereur-Dieu de la galaxie, qualifier New York 1997 de John Carpenter de « nanar cinématographique » (p. 113 ; non mais ça va pas, la tête ?) sera passible de la peine de mort par lapidation à coups de figues molles. Il est prévenu.
Quelques mots, par contre, sur l’article de Roland Lehoucq (« Le Soleil dans l’œil », pp. 172-178). Le physicien démolit cette fois à raison le très décevant Sunshine de Danny Boyle : comme d’habitude, c’est à la fois passionnant et à peu près incompréhensible en ce qui me concerne. Seul petit regret : je m’attendais à quelque chose de plus saignant (je me souviens du papier sur Fusion – The Core…). Très bonne rubrique, cela dit (faut que je vous cause de SF : la science mène l’enquête un de ces jours…). Pas « d’Anticipateurs » de Fred Jaccaud pour ce numéro.
Mais reste une rubrique qui mérite bien qu’on en dise quelques mots : les Razzies, le prix du pire. Aaaaaaaaaah, les razzies… Beaucoup de gens estiment qu’il est nécessaire d’en dire du mal, de ce prix bête, méchant et de mauvaise foi (… et qui s’assume, ne l’oublions pas). Chaque année, ça suscite sa petite polémique, il y a des nominés qui le prennent très mal, et, au-delà, des pseudo-Bisounours slurpeux plus ou moins sincères et souvent eux-mêmes fort pédants qui s’empressent de stigmatiser cette évidente bêtise destinée uniquement aux jeunes connards prétentieux et élitistes (c’est ce qu’ils disent, hein ; y’a souvent des contradictions dans les termes, notez bien). Mais moi, j’aime bien, les razzies. En fait, dans la multitude des prix littéraires SF, c’est sans doute celui que je préfère ; parce que c’est le seul qui assume jusqu’au bout sa bêtise et sa mauvaise foi (on peut bien dire que les autres le valent sous cet angle, non ?) ; parce qu’il pointe à l’occasion des pratiques vraiment pas glorieuses, ce qui peut lui conférer une certaine utilité ; et parce que c’est drôle, enfin. Mais je plaide coupable : je suis un jeune connard, bête et (parfois) méchant, et à l’occasion élitiste.
Petit bilan sur le palmarès de cette année ? Allez. Je sais, j’ai comme qui dirait du retard, mais bon… Remuons le couteau dans la plaie. Une déception, tout d’abord : je l’ai trouvé un peu mou du genou, le bilan, cette fois… Dommage. Mais restent quelques jolies têtes de vainqueurs. Alain Damasio a gagné le prix de la pire nouvelle francophone pour « So phare away ». Pas lu, peux pas dire ; mais j’ai apprécié de voir parmi les nominés Daniel Walther pour sa bouse dans le précédent Bifrost… La pire nouvelle étrangère est censée avoir été choisie au pif dans les numéros de Lunatique de l’année écoulée ; pourquoi pas, après tout… Pour le pire roman français, Céline Minard a gagné avec Le Dernier monde ; je n’ose imaginer l’abomination que cela doit être, pour avoir battu Tous ne sont pas des monstres de Maud Tabachnik et Léviatown de Philip Le Roy (mes chouchous persos, dont je vous avais déjà vanté les indiscutables mérites ; Cold Gotha de Guillaume Lebeau, s'il n'est pas bon, n'est quand même pas aussi pathétique...). Pas grand chose à dire sur le pire roman étranger, si ce n’est que faire figurer dans la liste Rainbows End de Vernor Vinge, c’était quand même un peu pousser mémé dans les orties… mais bon, c’est le jeu. Ou alors, à ce compte-là, j'y aurais bien glissé La Théorie des cordes de José Carlos Somoza, ne serait-ce que pour faire suer Patrick Imbert (c'est à cause de lui, si j'ai acheté cette daube ; maudit, maudit !)... Pour la pire traduction, Sylvain Berthet a gagné : ça doit être du costaud, pour avoir enfoncé Karim Chergui (ainsi que Bernadette Emerich pour Le vieil homme et la guerre)… Pour la pire couverture, bien évidemment, c’est l’inénarrable Jackie Paternoster qui a gagné, pour ses abominations de Terremer et Rainbows End (j’y aurais bien rajouté ses immondices pour « le quatuor de Jérusalem », et plus particulièrement Le codex du Sinaï et surtout Ombres sur le nil, bel et bien paru cette année…) ; certes, quelques horreurs n’étaient pas de son fait (ainsi, nominé également, Gilles Francescano pour Quatre chemins de pardon), mais Miss Jackie a toujours une longueur d’avance : son indicible attentat au bon goût pour Unica me paraît déjà bien placé pour le prochain prix (idem pour Pavane, d’ailleurs…). On saluera également la nomination de Patrick Imbert pour son légendaire anus de robot, mais bon, moi je vous dis qu’il est bien, ah mais. Le prix de la pire non-fiction a été remporté par Lunatique (décidément…) ; je ne peux pas me prononcer… mais j’avais un autre chouchou, personnellement. Le « prix de l’incompétence éditorial » (sic) a été attribué aux Moutons électriques pour leurs innombrables coquilles ; y’a du vrai (même si Terre de Brume, notamment, est au moins aussi doué ; les deux publient des très chouettes bouquins, cela dit, hein…), mais en ce qui me concerne, l’abondance desdites coquilles dans chaque numéro de Bifrost, la bourde mentionnée à l’instant, et, dans ce même numéro, la jolie référence aux « Pensées de Montaigne » (re-sic, p. 92), désignaient un tout autre champion ; pour l’année prochaine peut-être ? Mais là, reconnaissons que Mnénémomos avait avait fait très fort fort, aussi. Le prix putassier, c’est mon préféré, personnellement : Pygmalion a très logiquement gagné pour ses pratiques de saucissonnage ; peu de concurrence, cette année, dommage (ou bien… ?). Enfin, le Grand Master Award a été remis au Divin Gérard Klein, pour plein de choses : là, les razzies ont été égaux à eux-mêmes, c’est-à-dire particulièrement bêtes et méchants ; et du coup, ça m’a bien fait rire… Quant aux prix des lecteurs de Bifrost, ce fut un vrai raz-de-marée pour taper sur l’équipe de Galaxies, avec visiblement beaucoup de raisons ; mais n’ayant jamais lu ladite revue (« et pour cause ! »), je ne vais pas tirer sur l’ambulance.
N’empêche que : les razzies, une fois par an, ça défoule. Ne serait-ce que pour ça, merci Bifrost.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)









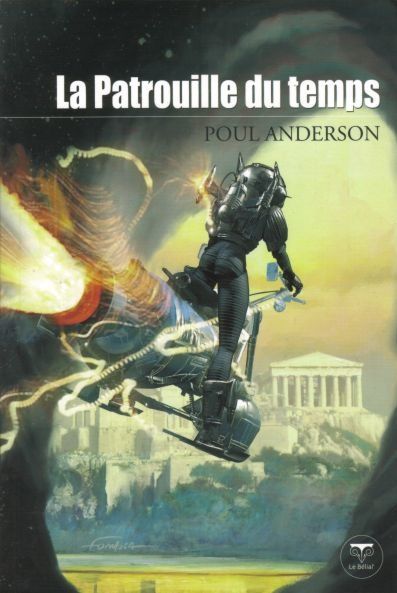



 Un sixième de Michelle Bigot, Claude Mamier, Gudule, Lucie Chenu, et un demi Sébastien Bermès.
Un sixième de Michelle Bigot, Claude Mamier, Gudule, Lucie Chenu, et un demi Sébastien Bermès.
 Sébastien Bermès ; au premier plan à gauche, Claude Mamier.
Sébastien Bermès ; au premier plan à gauche, Claude Mamier. M'âme Martin.
M'âme Martin. M'âme Martin et Jeanne-A Debats.
M'âme Martin et Jeanne-A Debats. Christophe Sivet ; on entrevoit derrière Jeanne-A Debats (debout) et Michelle Bigot (assise).
Christophe Sivet ; on entrevoit derrière Jeanne-A Debats (debout) et Michelle Bigot (assise). Un bout de la tête de Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, la main de Gudule qui signe, Lucie Chenu, Sébastien Bermès et Nicolas Bally ; debout, Michelle Charrier.
Un bout de la tête de Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, la main de Gudule qui signe, Lucie Chenu, Sébastien Bermès et Nicolas Bally ; debout, Michelle Charrier. Gudule.
Gudule. Gudule et Lucie Chenu.
Gudule et Lucie Chenu. Au fond, un demi Claude Mamier, Gudule, Lucie Chenu et un tiers de Sébastien Bermès ; premier plan, Sire Cédric et Nicolas Bally.
Au fond, un demi Claude Mamier, Gudule, Lucie Chenu et un tiers de Sébastien Bermès ; premier plan, Sire Cédric et Nicolas Bally. Jeanne-A Debats, Christophe Sivet et Michelle Bigot.
Jeanne-A Debats, Christophe Sivet et Michelle Bigot. Une demie Nicole Hibert, Jeanne-A Debats et Michelle Bigot.
Une demie Nicole Hibert, Jeanne-A Debats et Michelle Bigot. Jean-Daniel Brèque.
Jean-Daniel Brèque. Debout, devant la table, Michelle Charrier, et au fond, Jean-Daniel Brèque ; pour le reste, on ne distingue vraiment que Claude Mamier et Lucie Chenu...
Debout, devant la table, Michelle Charrier, et au fond, Jean-Daniel Brèque ; pour le reste, on ne distingue vraiment que Claude Mamier et Lucie Chenu... Au fond, debout, un demi Jean-Daniel Brèque ; assis, Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, Gudule, une demie Lucie Chenu, et au premier plan Sébastien Bermès.
Au fond, debout, un demi Jean-Daniel Brèque ; assis, Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, Gudule, une demie Lucie Chenu, et au premier plan Sébastien Bermès. Jean-Daniel Brèque... heu... ensuite, je savions pas qui... puis Nicole Hibert et Jeanne-A Debats.
Jean-Daniel Brèque... heu... ensuite, je savions pas qui... puis Nicole Hibert et Jeanne-A Debats. Jean-Daniel Brèque, Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, pas du tout Gudule mais bel et bien Michelle Charrier, et Lucie Chenu ; à droite, une petite partie du fan club de Sire Cédric empêche de le voir, ainsi que Nicolas Bally et Sébastien Bermès (debout, de dos, je suppose qu'il s'agit de David Duquenoy).
Jean-Daniel Brèque, Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, pas du tout Gudule mais bel et bien Michelle Charrier, et Lucie Chenu ; à droite, une petite partie du fan club de Sire Cédric empêche de le voir, ainsi que Nicolas Bally et Sébastien Bermès (debout, de dos, je suppose qu'il s'agit de David Duquenoy). Michelle Bigot, Claude Mamier, Michelle Charrier, Gudule et un demi Sébastien Bermès.
Michelle Bigot, Claude Mamier, Michelle Charrier, Gudule et un demi Sébastien Bermès. Nicolas Bally, Lucie Chenu et Lise N.
Nicolas Bally, Lucie Chenu et Lise N. Nicolas Bally et Sire Cédric.
Nicolas Bally et Sire Cédric. La même chose, le monsieur à droite je savions pô (... ?), puis un demi Jean-Daniel Brèque.
La même chose, le monsieur à droite je savions pô (... ?), puis un demi Jean-Daniel Brèque. Sébastien Bermès.
Sébastien Bermès. Le rayon mangas / comics où avait lieu la dédicace (les auteurs et illustrateurs étaient entassés dans le fond).
Le rayon mangas / comics où avait lieu la dédicace (les auteurs et illustrateurs étaient entassés dans le fond). On passe au resto, le soir, et... je sais pas qui c'est. Mais j'ai cru comprendre que la dame avait dirigé le Fleuve Noir fut un temps (EDIT : ah ben maintenant je sais, donc : Nicole Hibert et Laurent Delpit).
On passe au resto, le soir, et... je sais pas qui c'est. Mais j'ai cru comprendre que la dame avait dirigé le Fleuve Noir fut un temps (EDIT : ah ben maintenant je sais, donc : Nicole Hibert et Laurent Delpit). David Duquenoy, M'âme Martin, et... heu... je sais pô.
David Duquenoy, M'âme Martin, et... heu... je sais pô. Lucie Chenu et... heu... je sais pas non plus (EDIT : mais si, voyons ! Nienna et Deedlot).
Lucie Chenu et... heu... je sais pas non plus (EDIT : mais si, voyons ! Nienna et Deedlot). Je sais pas pour les jeunes filles à gauche (EDIT : mais si, donc ! Un tiers de Nienna et Deedlot), mais sinon Sébastien Bermès et Jeanne-A Debats.
Je sais pas pour les jeunes filles à gauche (EDIT : mais si, donc ! Un tiers de Nienna et Deedlot), mais sinon Sébastien Bermès et Jeanne-A Debats. 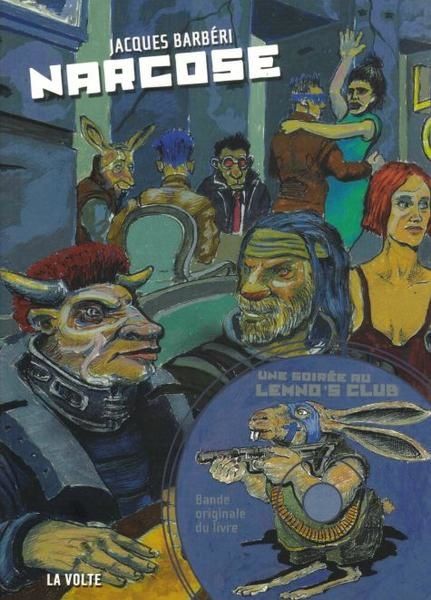




/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)