Neuvième séance de la campagne de L’Appel de Cthulhu maîtrisée par Cervooo. Vous trouverez les premiers comptes rendus ici, et la séance précédente là.
Le joueur incarnant le bootlegger Clive était absent. Étaient donc présents l’homme de main Johnny « La Brique », la flingueuse Moira, le perceur de coffres Patrick, et ma « Classy » Tess, maître-chanteuse.
Fran et moi avons intercepté Patrick et l’avons empêché de jeter le mannequin dans la grande cuve de sang au centre de la pièce, non loin de la grue où pendent des chaines – un moteur agite des pales au fond, destinées à réduire en bouillie la chair ; le bac contenant le liquide vert phosphorescent, de l’autre côté, a des sortes de « flotteurs », et répand ainsi automatiquement de son liquide quand le contenu de la cuve atteint un certain niveau. Fran est très nerveuse, elle se mordille instinctivement l’index droit, et guette les réactions des autres prisonniers. Je dis à Patrick qu’il ne doit pas jeter ainsi le mannequin dans la cuve, que nous n’en connaissons pas les conséquences et que cela pourrait être dangereux ; Patrick se calme et s’excuse. Je me tourne alors vers Fran, lui demandant ce qu’elle voulait dire (notamment pour « le sans-tête »), mais ça la secoue trop, elle dit que ce n’est pas le moment d’en discuter, qu’il nous faut fuir cet enfer. Je lui dis cependant que, plus elle nous en dira, et plus nous aurons de chances de nous en tirer – ensemble, j’insiste toujours sur ce mot. Elle nous désigne vaguement les endroits où Templesmith « travaillait » ; pour elle, c’est un sadique, aucune autre raison ne pourrait expliquer ce qu’il fait ; d’ailleurs, il lui demandait régulièrement de lui faire signe quand elle n’en pourrait plus – alors, il la lobotomiserait… Par ailleurs, il lui avait fait comprendre qu’il trouverait toujours un moyen de la « ranimer » si elle tentait de se suicider… Elle est visiblement à bout, je fais de mon mieux pour la calmer et l’assurer qu’on va s’en sortir.
Patrick tire alors le mannequin, et le dépose sur une table de menuiserie, avant d’explorer la grande pièce qui se trouve au sud-est : c’est un atelier, débordant de matériel chirurgical ou chimique ; sur le côté se trouve un bureau d’études, avec de nombreux papiers, et Patrick va y voir de plus près. Il s’y trouve des documents importants, dont un vieux parchemin en vélin, roulé, un manuscrit en anglais, des notes associées évoquant les symboles et courbes « runiques » que nous avons croisés à plusieurs reprises (c’est clairement une écriture, soignée et sophistiquée, les arabesques remplissent de nombreux feuillets). Fran est plus que jamais nerveuse, à voir Patrick traîner ainsi dans le coin, elle succombe à un surplus d’émotions ; je lui parle doucement pour la calmer, lui adresse des « chut… chut… » compatissants et même tendres ; je tente aussi de lui passer délicatement une main dans le dos, mais ça la fait sursauter : il est trop tôt. Je la conduis cependant vers Patrick, en insistant encore sur le fait que nous resterons ensemble et nous en sortirons ensemble, ce qui la rassure. Patrick prend cependant un peu de temps pour étudier le livre en anglais (américain) ; c’est une sorte de grand carnet de notes, rempli aux trois quarts, et signé Charles Reis. Il n’en retire cependant pas grand-chose d’autre, et Fran lui dit que ce n’est vraiment pas le moment, qu’il est taré de s’en occuper de suite : « Il peut revenir ! » Je suis plutôt d’accord, et dis à Patrick de prendre le livre, que nous étudierons plus tard, au calme. Patrick prend aussi le parchemin. Fran nous explique que Templesmith, quand il venait, empruntait toujours le couloir à l’ouest – celui par lequel nous sommes également arrivés…
Sur l’astéroïde, Moira reprend conscience après que Johnny l’a lâchée, pris de folie furieuse. Peut-être s’est-elle évanouie ainsi en raison de ses deux téléportations successives en un court laps de temps ? Toujours est-il que le hurlement de rage de Johnny la réveille. Elle prend vaguement conscience d’être sur une sorte d’astéroïde – bien loin de New York où elle se trouvait juste avant… alors qu’elle était à Arkham quelques minutes plus tôt. Elle voit la Lune toute proche, distingue l’étoile mouvante qui éclaire la scène… Elle entrevoit aussi la silhouette de Johnny brandissant une hache, qui fracasse la serre et donne de violents coups à l’intérieur pour trancher une chose qu’elle ne voit pas… Elle aperçoit cependant, confusément, le nuage de pollen qui s’en échappe. Johnny a massacré les branches supérieures – il obtient confirmation qu’un corps humain, en dessous, sert d’engrais ou de nourriture à la plante qu’il assaille. Un liquide crémeux goutte des tiges tranchées, et le pollen se dissipe autour de lui, après avoir pénétré dans sa bouche et ses narines. Il ne peut dès lors retenir un sourire qui reste figé sur son visage, mais pleure à chaudes larmes en même temps… Cette drogue inconnue lui remet en mémoire de vieux souvenirs – en fait, toutes les (nombreuses) fois où il a délibérément fait du mal à quelqu’un… Il a déjà dévasté un quart de la serre.
Clive, plus loin, est effrayé par l’état de Johnny. Mais il se tourne dans une autre direction, en entendant les gamins qui sortent de la grande bâtisse. Ceux-ci ont l’air encore à moitié endormis : « C’est qui, eux ? Pourquoi ils cassent la serre à ʺXixisʺ ? » Certains semblent repartir en arrière pour réveiller d’autres de leurs camarades. Moira les voit elle aussi ; Clive et elle repèrent parmi eux des enfants qu’ils avaient déjà croisé à Arkham. Un des gamins interpelle Moira. Elle s’approche gentiment, demande s’ils savent où ils sont… Ils reculent, sauf leur « leader » (qu’on apprendra s’appeler Vladimir), qui arbore lui un rictus de mépris, et se tourne vers les autres : « C’est pas des alliés de ʺXixisʺ ou de Tina ! C’est une épreuve ! Faut qu’on les bute ! » Moira lui demande de qui il parle, et dit qu’elle ne leur veut aucun mal… Déclaration qui ne suscite aucun écho. Une gamine, en fait, tente de s’approcher discrètement de Moira pour passer dans son dos et l’attaquer par surprise, mais Moira s’en rend compte et l’arrête : « Mais enfin ! Ta maman ne t’a pas appris… » La gamine ne lui laisse pas le temps d’achever et lui mord le doigt avec un sourire ravi… Moira la repousse : « Mais ça va pas ? » Les autres gamins se mettent à taper du pied en rythme : « Sacrifice ! Sacrifice ! Sacrifice ! » Moira cherche ses armes à feu par réflexe… mais réalise qu’elles ont été remplacées par deux dagues (celle de gauche étant un peu plus légère que l’autre), plus ou moins « orientales », courbées et assez larges. Elle met sa main sur la garde de la dague de droite et recule… Mais Moira, très perturbée par cet environnement inconnu, ne peut pas surveiller les enfants au mieux ; des gamins en profitent pour essayer de lui jeter des pierres – elle les évite cependant, ce qui ramène son attention sur ses agresseurs. Clive s’approche à son tour, en levant son cimeterre et en insultant les gamins – il cherche visiblement à les intimider, voire à les effrayer. Moira essaye à son tour, à sa manière : « Si vos parents n’ont pas su vous éduquer, je vais le faire, moi ! » Ce qui les fait rire : « On va te montrer… » Ils sortent eux aussi des armes blanches, très diverses (parfois des simples fourchettes et couteaux de table)…
Johnny s’amuse de ses souvenirs sadiques, et en retire du mépris pour tout vie, y compris la sienne ; il est secoué par de grands rires nerveux tandis qu’il continue de balancer des coups de hache dans la serre (sans faire attention au corps humain en dessous de la plante, qu’il tranche comme le reste). Il y a un bruit spongieux, une nette odeur de décomposition… La serre, bien fragilisée, commence à s’écrouler sur Johnny ; il s’en rend compte quand il essaye de dégager la pique à l’arrière de sa hache, qui s’est enfoncée dans une paroi. Il sort donc de la serre… et voit Moira et Clive qui essayent de tenir à distance des gamins avec leurs lames. Johnny, sourire vissé aux lèvres, des larmes ruisselant sans interruption sur ses joues, s’avance dans leur direction. Et, cette fois, ça perturbe un peu les gamins, qui se taisent… Moira lui dit de ne pas avancer davantage, et de ne pas leur parler… Mais Johnny ne saisit pas tout – et continue de toute façon d’avancer, souriant, en trainant sa hache…
Clive balance aux enfants des insultes irlandaises. Moira et lui se rendent alors compte que Bridget fait partie du petit groupe, qui les désigne du doigt, et dit aux autres enfants qu’elle les reconnaît. Ceux-ci doutent visiblement, sont sans doute angoissés, mais leurs intentions sont clairement violentes. Clive demande : « Est-ce qu’on va vraiment le faire ? » Moira dit qu’elle ne comprend pas… puis dit que non, c’est totalement exclu ! Johnny continue d’avancer… Bridget dit à ses camarades dit qu’ils doivent se montrer dignes de « Xixis », en lui apportant les dépouilles des intrus… Clive s’approche de Moira : « Tu crois vraiment qu’il y a une autre solution ? » Moira cherche désespérément une autre issue… et demande même aux gamins ! Ils sont pour le moins perplexes… Et l’un d’entre eux commence même à dire : « On pense que… », mais Bridget lui donne une tape à l’arrière du crâne avant qu’il en dise davantage… Moira crie : « Bridget ! Et ta maman ? » Ce qui énerve la petite… Elle dit aux autres enfants : « Si vous en êtes pas capables, moi je m’en charge ! » Elle prend alors une grosse paire de cisailles dans les mains d’un gamin plus indécis, et commence à s’approcher de Moira ; celle-ci dégaine sa dague la plus longue, et dit à Bridget qu’elle va la ramener chez elle… Mais Vladimir réagit : « Vous voyez, ils ne savent rien ! On va à la cabane, on s’arme et on les fume ! » Et il se dirige vers la cabane de jardin. Mais Johnny est sur son chemin… Le gamin s’arrête, mais il n’a pas peur, c’est juste un calcul réfléchi ; il se tourne vers les autres gamins et leur chuchote quelque chose que Johnny ne comprend pas… Bridget continue d’avancer vers Moira, qui recule à chacun de ses pas : « Tu ne devrais pas faire ça… » Mais elle se rend compte que, en reculant, elle donne en fait du courage aux autres gosses ! Clive hésite, regarde souvent Johnny – qui pousse enfin un hurlement et charge Vladimir (et cette fois, le petit éprouve une peur instinctive) ; le « leader » essaye cependant de contourner Johnny pour atteindre la cabane de jardin, mais se rend bien vite compte que ce n’est pas suffisant, et se jette de côté pour éviter le coup de hache que lui assène « La Brique ». Certains des enfants reculent devant cet assaut, mais d’autres arborent un sourire semblable en fait à celui de Johnny… Ils sont à l’évidence tout aussi drogués. Bridget, de son côté, est maintenant épaulée par quatre autres enfants, armés. Elle se jette sur Moira, tentant de lui cisailler les jambes… Moira essaye de la désarmer, mais ne s’en expose que davantage, et Bridget la blesse à la jambe. Les gamins autour d’elle s’enflamment maintenant que le premier sang est versé, et hurlent un cri de guerre : « Xixis ! »
Dans le souterrain, Fran nous intime de nous en aller. Patrick approuve, mais veut d’abord jeter un œil à la dernière pièce, et je l’approuve – en maintenant qu’on allait rester tous ensemble. Mais Patrick constate que Fran, de temps à autre, se mordille la phalange de l’index gauche… On passe à côté de générateurs « faits maison », et Patrick ouvre la porte de la dernière pièce : c’est une armurerie, où l’on trouve notamment une mitraillette Thompson flambant neuve, une table surchargée d’outils d’entretien pour armes sur laquelle se trouve également un calibre 38, des caisses de munitions, et des râteliers avec notamment un fusil. Fran se dirige instinctivement vers la Thompson, et Patrick l’intercepte – ce qui effraie Fran : Patrick serait-il un de ses ennemis ? Mais ce dernier lui demande si elle saurait s’en servir. Fran dit qu’elle n’en a jamais utilisé, non, mais qu’elle sait se servir d’armes de poing, c’est simple… Patrick lui explique que non, ce n’est pas si simple ; il l’invite plutôt à prendre le calibre 38, et dit qu’il va se charger lui-même de la mitraillette (il n’a guère d’expérience avec cette arme, mais néanmoins plus que tout autre ici du fait de son passé dans l’IRA – il me demande cependant si je saurais m’en servir, à tout hasard, et je lui réponds que ce n’est clairement pas le cas… Je n’ai pas davantage d’expérience avec les fusils, à vrai dire, mais m’empare quand même de celui qui est accroché à un râtelier, à tout hasard). Fran admet que Patrick a raison, et sa tension redescend tandis qu’elle s’empare du calibre 38 (effectivement, d’après ses gestes quand elle s’empare de l’arme, et notamment les vérifications auxquelles elle se livre, nous supposons qu’elle a bel et bien de l’expérience avec ce genre d’armes de poing). Patrick ouvre les caisses : on y trouve énormément de munitions – dont des chargeurs « camemberts » pour la Thompson, des munitions de .38, des cartouches pour le fusil… Nous prenons chacun des munitions adéquates pour nos armes. Fran, en voulant glisser ses chargeurs dans la veste que je lui avais prêtée, trouve dans la poche un des mystérieux bonbons que j’avais trouvés dans l’entrepôt du Corail d’ébène ; elle commence à le déballer, prête à l’avaler, mais je lui dis qu’il ne faut pas, que nous ne savons pas exactement de quoi il s’agit, mais que c’est au mieux suspect – et qu’il vaudra mieux se pencher sur la question plus tard, quand nous serons en sécurité… Fran m’écoute – notamment pour ce dernier argument. Patrick s’équipe de chargeurs pour la mitraillette – des holsters sont suspendus au mur, mais on y trouve aussi des sacs à cet effet, pouvant contenir chacun trois « camemberts », et il en prend un. J’entends des bruits de chaînes en provenance des cellules – sans doute les être mutilés qui s’y agitent…
Nous nous dirigeons vers le tunnel de gauche – celui par lequel nous étions arrivés. Fran s’interrompt cependant avant qu’on ne s’y engage : « On ne peut pas les laisser comme ça… », dit-elle en désignant les victimes de Templesmith. Mais je lui dis que nous ne pouvons rien faire, nous n’en avons ni le temps, ni les moyens, et ce serait beaucoup trop dangereux, nous ne devons pas nous attarder. Fran semble comprendre, mais se tourne vers Patrick – qui confirme que nous ne pouvons pas rester, nous risquerions trop de nous attirer des ennuis. J’abonde : c’est un choix qu’on ne peut pas se permettre. Patrick ajoute : « Ils sont déjà morts… » Fran crache une insulte dans sa barbe (quelque chose de slave, peut-être ? Son physique, ses manières, nous font supposer qu’elle est polonaise…), mais se résigne. Nous retournons là où nous étions arrivés – en tombant. Du coup, moi qui éclairais le chemin, je lève ma lampe vers le plafond : Patrick distingue, à deux mètres environ, une porte horizontale (perpendiculaire par rapport à nous) ; elle a une poignée en forme de boule, avec en dessous un logement pour une petite boîte cubique. Patrick nous montre tout cela – mais il n’a plus sa boîte, qui a été « consommée » quand il l’avait utilisée chez Templesmith, et les deux boîtes du mannequin sont hors d’usage. Mais qu’importe : Patrick essaye de s’accrocher à la poignée… et nous tombons tous les trois inconscients après avoir ressenti un léger choc frontal – à peine avons-nous eu le temps de sentir une odeur de vieux bois…
Sur l’astéroïde, un groupe de gamins emmené par Bridget se précipite sur Moira et Clive, tandis que d’autres, parmi lesquels Vladimir, contournent Johnny pour se rendre à la cabane de jardin. Moira essaye d’attaquer Bridget, qui s’abaisse et esquive. Johnny, quant à lui, donne sans l’ombre d’une hésitation de grands coups de hache aux enfants à portée – il entend faire un exemple… et y parvient on ne peut mieux : il en éventre un, et, dans son élan, tranche la tête d’un second ! Clive se jette lui aussi dans la mêlée, aux côtés de Moira, en brandissant son cimeterre ; il pare un vicieux coup de fourche, et se découvre, sous le coup de l’adrénaline, un vrai talent d’épéiste : il empale un gamin en plein cœur… et son arme ressortant dans le dos de sa première victime blesse aussi un autre enfant à la gorge ! Vladimir, de son côté, atteint cependant la cabane de jardin. Parmi les enfants qui le suivaient, certains sont maintenant clairement effrayés, mais d’autres sont plus que jamais forcenés (ils ont les mêmes traits sadiques que Johnny, témoignant de leur état drogué, et le sang les excite). Deux d’entre eux se jettent sur Johnny – armés, l’un d’une fourchette, l’autre d’un couteau de table… mais ils semblent être en mesure de s’en servir au mieux, pour toucher des points précis. Pas assez bien cependant : ils ratent Johnny, l’effleurant à peine. Deux autres s’en prennent à Moira – avec des armes similaires… Mais le premier n’arrive à rien, et est contraint de s’arrêter ; celui qui le suivait trébuche et, du fait d’un faux mouvement, se retrouve avec son propre couteau dans l’œil ! Bridget essaye de s’en prendre à Clive tant que l’arme de ce dernier est coincée, mais elle l’effleure à peine. Moira en profite pour l’assaillir, une arme dans chaque main – elle lui assène des coups terribles, et la tue. Moira se repositionne alors, dos à Clive, et fait ainsi face à deux autres gosses. De l’autre côté, Johnny enragé s’en prend à ceux qui l’ont vainement attaqué, et leur assène un gros coup de hache – avec toujours autant de réussite : il en tue un sur le coup, et tranche le bras droit de l’autre ! Clive dégage son arme et essaye de toucher l’adversaire le plus proche, mais celui-ci fait un petit saut en arrière et esquive sa botte. Il en reste un dans le dos de Johnny, qui pousse un véritable cri de guerre et lui grimpe dessus, en essayant de le mordre – ceci, toutefois, il n’y arrive pas. Il en reste deux contre Moira, et deux contre Clive, mais tous ratent leurs assauts (l’un d’entre eux trébuche même sur les cadavres et les agonisants). Moira et Johnny entendent alors un bruit étrange en provenance de la cabane de jardin – qui leur évoque l’automate chez Templesmith… mais peut-être aussi Mortimer ?
Patrick, Fran et moi reprenons conscience – et c’est comme si notre corps reprenait le contrôle au fur et à mesure. Nous sentons nos différents organes « reprendre place » – nous avons craint un moment qu’ils ne soient plus là ! Mais ce n’est pas le cas. Nous sommes confinés dans un espace étroit – et je relève une odeur qui m’évoque les « vieux richards » chez qui j’étais femme de ménage autrefois (un mélange de pommades, de parfums, de bouquets, du bois verni, de la laque pour cheveux…). Nous réalisons que nous sommes dans une vaste penderie ; les vêtements (masculins) suspendus aux cintres semblent de très bonne qualité – du velours, ce genre de choses. Fran, quand elle reprend conscience, est sur le point de hurler… mais je m’en rends compte, lui plaque la main sur la bouche, et lui chuchote de se taire : nous ne savons pas où nous sommes… Elle obtempère, mais reste crispée sur ma main, elle a besoin de la serrer. Ma lampe est hors d’usage, mais une lumière très légère filtre à l’intérieur du placard (la lumière du jour ?). Patrick ressent des picotements à l’œil droit – là où il avait pris la pulvérisation en trafiquant la serrure de l’armoire, dans la chambre de Templesmith ; il cligne des yeux, tout vire à la lumière rouge et il ressent outre une virulente douleur interne – comme si ses côtes étaient prises dans un étau… Fran fouine parmi les vêtements sur les cintres, et profite de l’obscurité pour se changer – elle me rend ma veste, que je remets, après quoi j’ouvre doucement la porte…
Le décor évoque une vieille famille WASP fortunée – c’est luxueux, mais aussi très vieux jeu (un peu style colonial), avec çà et là des signes religieux. Nous sommes dans une chambre – plus précisément une chambre d’amis, supposons-nous : n’y figurent pas de traits personnalisés, des photos par exemple. Mais la chambre est très bien équipée. Fran se précipite sur la fenêtre, qu’elle ouvre en grand : le soleil est resplendissant, elle prend de grandes respirations avec un soulagement éloquent. Je perçois une légère odeur de thé… mais surtout des bruits de pas, en dessous – évoquant des talons bas ou talonnettes. Je vais jeter un coup d’œil à la fenêtre : nous sommes au deuxième étage d’une sorte de manoir, un vaste jardin sépare la demeure d’un mur de trois mètres de haut environ, avec des tessons au sommet ; au-delà, je distingue des rues – qui ne m’évoquent en rien Arkham, mais probablement une ville plus grande. Patrick sort douloureusement du placard. Je demande à Fran si elle sait où nous sommes, et elle me répond que nous sommes à Boston – chez les parents Templesmith : Fran précise que c’est le dernier endroit où elle est allée, avec son père… Je signale les bruits de talonnettes à Patrick – qui dit qu’il s’expliquerait volontiers avec les Templesmith, en brandissant sa mitraillette… Je suis partagée, me demande si les parents Templesmith sont aussi coupables que leur fils… Que faut-il en penser ? Patrick le demande à Fran, mais elle ne nous écoute pas vraiment, toute à son soulagement… Puis elle répond, avec un temps de retard : pour elle, les parents Templesmith sont avant tout de parfaits pigeons… Elle nous explique que son père et elle étaient des escrocs et des faussaires, et qu’ils avaient tenté de profiter du vieil âge des Templesmith, qui ne sont rien d’autres que des vieux cons de WASP pleins aux as… Mais Hippolyte Templesmith, lui, avait flairé l’arnaque – d’où la suite des événements… L’évocation de ses activités criminelles amène Fran à nous questionner à ce sujet : elle a deviné que nous travaillions pour O’Bannion, à Arkham, et suppose que nous ne connaissons pas Boston… Je lui demande si elle connaît la maison et saurait comment en sortir discrètement, mais ce n’est pas le cas : elle n’est venue que deux fois, et ne connaît rien d’autre que le rez-de-chaussée. Patrick lui demande si les Templesmith ont une voiture : oui, plusieurs, et des chauffeurs aussi ! Nous n’avons pas le choix, il nous faut y aller – j’insiste cependant sur la discrétion, et qu’il faut éviter de faire des bêtises… Or Fran veut se venger. Mais Patrick concède que la priorité est de retourner à Arkham, où nous reprendrons des forces, ce qui nous permettra d’agir au mieux. Fran retient difficilement une insulte… Elle dit que, pour elle, c’est une question d’honneur – mais je lui fais entendre que ce n’est pas là son vocabulaire, et qu’il vaut mieux agir avec méthode et efficacité. Patrick aussi essaye de la raisonner, lui disant que nous ne sommes pas dans la bonne position. « Tu comprends ? » Il répète cette question, assez durement… Fran est bougonne, à la manière d’une adolescente contrariée voire exaspérée, mais dit qu’elle est d’accord – c’est surtout qu’elle se souvient que nous l’avons sauvée, et qu’elle nous en doit une… L’autorité, cependant et de manière générale, lui pèse sur les nerfs, à l’évidence.
Patrick entrouvre la porte de la chambre, qui donne sur un couloir richement décoré, donnant sur plusieurs portes fermées ; au bout du couloir, un escalier descend. Nous nous y rendons discrètement, moi en tête – et je guette les bruits de pas. Nous arrivons au premier étage ; un couloir à droite donne sur plusieurs portes, dont un bureau et un salon que nous pouvons entrapercevoir. Des titres honoraires, très divers, sont affichés un peu partout, ainsi que des photos de famille, avec Hippolyte Templesmith et ses parents ; je remarque un meuble sur lequel se trouvent plusieurs de ces photos, et me rends compte que bon nombre de celles-ci masquent Howard Templesmith pour mettre en évidence, à sa place, son fils Hippolyte. Nous nous dirigeons vers l’autre escalier et descendons prudemment…
Sur l’astéroïde, Moira essaye de frapper les gosses à sa portée, mais échoue. Johnny, pour sa part, se rue vers la cabane de jardin – il a toujours un gamin accroché sur le dos… Il essaye, en pleine course, de le dégager en lui donnant un coup de la pique au dos de sa hache : il y parvient, et même le tue, mais se blesse un peu lui-même au passage, et le cadavre du gosse reste accroché sur lui… Peu importe : il arrive devant la porte de la cabane et l’ouvre ; Vladimir attendait à l’intérieur, sur le côté, et donne instinctivement un grand coup de binette, mais Johnny s’y attendait et esquive sans souci. Clive n’a pas plus de succès que Moira de son côté – mais leurs assaillants reculent un peu. Johnny est rentré dans la cabane, où un gamin psalmodie – il cherche visiblement à lui jeter un sort…Johnny lève son bras droit pour le frapper – mais il hurle subitement tandis que sa hache tombe au sol : il n’a plus d’os dans le bras droit ! Il reste quatre gamins du côté de Moira et Clive – qui ont entendu Johnny hurler –, mais ces agresseurs changent de tactique et se précipitent à leur tour vers la cabane.
Moira, suivie de Clive, profite de cette accalmie pour jeter un œil à une autre cabane, sur la droite, au-delà d’une sorte d’aire de piquenique : c’est une sorte de salle de jeu, dont les murs sont cependant couverts de dessins ignobles, comme ceux de Bridget ; on y trouve aussi des « étendoirs » portant des écorchés, comme dans le tunnel souterrain, avec non loin des râteliers surchargés d’outils chirurgicaux et autres lames. Parmi les dessins, certains semblent clairement avoir pour but d’apprendre aux enfants comment écorcher un corps, en indiquant en outre les points les plus douloureux…
Johnny fou furieux fonce vers le gamin dans la cabane, l’empoigne de son bras gauche, et le plaque violemment contre le mur – dans l’idée de le défoncer ! Le mur craque effectivement, malgré ses deux couches de planches, et le gamin pisse le sang : des éclats de bois se sont fichés dans son crâne… Johnny sort de la cabane par cette nouvelle issue tandis que, de l’autre côté, les gamins restants y pénètrent par la porte. Johnny court alors vers le bâtiment abritant les cages, par où il était arrivé avec Clive et Moira, en hurlant : « Radzak, le dîner est servi ! » Il ne voit cependant pas le chat… mais, par contre, un navire d’ébène approche des quais. Les enfants se rendent compte que « La Brique » a quitté la cabane et veulent en sortir à leur tour… mais les deux premiers s’accrochent aux planches détruites et bouchent le passage aux autres.
Moira, avec Clive, revient vers la cabane de jardin, afin d’attaquer les gamins qui s’y trouvent (Clive a tiqué en entendant Johnny appeler Radzak, mais pas Moira, qui était inconsciente lors de leur discussion avec le chat). Moira blesse un des enfants assez méchamment, mais le deuxième qu’elle assaillait a pu faire un pas de côté et s’en tire avec une simple estafilade à l’épaule gauche ; Clive essaye de toucher ce dernier et rate. Johnny continue de courir vers les cages – mais son bras droit se tord du fait de ses mouvements instinctifs de balancier, ce qui est très douloureux et le ralentit… Un gamin essaye de toucher Clive, qui esquive cependant – les autres s’en prenaient à Moira, sans plus de succès, mais elle ne parvient pas non plus à riposter efficacement… Un des petits, cependant, se met à chialer : il a perdu toute combattivité, et pleure en appelant désespérément sa maman… Clive en blesse un autre, maintenant à l’agonie. Moira sort de la cabane, en disant à Clive de la suivre…
(Les joueurs incarnant Johnny et Moira s’en sont tenus là pour la soirée ; le joueur incarnant Patrick et moi-même étant encore disponibles et ayant une longue scène à gérer de notre côté, sans nécessité pour les autres d’intervenir, nous avons poursuivi.)
Patrick, Fran et moi n’entendons rien en descendant. Au rez-de-chaussée, nous voyons qu’une grande cuisine se trouve à notre droite, tandis qu’il y a plusieurs autres pièces inconnues dont les portes sont fermées ; on aperçoit enfin, au bout d’un hall sur la gauche, la porte d’entrée. Je m’avance instinctivement dans cette direction, mais Fran me dit que je suis folle de vouloir sortir par devant. Je lui demande si elle connaît une meilleure sortie, ce n’est pas le cas, mais Patrick suggère de jeter un œil à la cuisine. Nous y retournons donc : il n’y a pas de porte donnant sur l’extérieur, mais nous devrions pouvoir sortir par la grande fenêtre au-dessus de l’évier. Patrick l’ouvre délicatement : elle ne donne pas sur l’arrière du jardin, mais sur un côté du manoir. Nous entendons la porte d’entrée s’ouvrir au moment même où Fran, la première, se glisse dehors par la fenêtre. Je la suis, puis Patrick, qui arme à tout hasard sa Thompson… Nous tentons de rester discrets, mais sans grand succès : en traversant, je touche avec mes jambes une pile d’assiettes, et Patrick de même un peu plus tard – d’autant que ses douleurs internes le reprennent en pleine action ! Nous entendons une voix féminine : « Il y a quelqu’un ? Herbert ? »
Tandis que Patrick oriente sa mitraillette en direction de la porte de la cuisine, Fran et moi repérons l’extérieur : c’est pour l’essentiel un jardin à l’anglaise, courant sur soixante mètres avant de laisser la place à un mur d’environ trois mètres de haut et surmonté de tessons. Vers l’avant, à distance, il y a une sorte de cour, avec un kiosque et des bancs, où nous repérons un petit groupe – nous comprenons par la suite que s’y trouve notamment Jacqueline Templesmith, tandis que son mari Howard est couché sur une table à l’intérieur de ce que nous saurons alors être un poumon d’acier (un dispositif censé soigner les maladies respiratoires ; à l’évidence, il n’est pas donné à tout le monde d’en avoir un…). Nous tentons alors de contourner la maison par la droite, vers l’arrière. Je parviens à l’angle sans un bruit, Fran de même, mais Patrick, alors qu’il accélère un brin, est de nouveau pris d’une terrible douleur au ventre qui le fait s’interrompre… et lâcher par réflexe une interjection. Les pas à l’intérieur s’accélèrent, et Patrick voit bientôt un visage féminin (avec un col d’uniforme de domestique) se pencher par la fenêtre. Elle ouvre grands ses yeux en apercevant Patrick – lequel pose son doigt sur sa bouche pour lui signifier de se taire, geste qu’il accompagne d’un grand sourire et d’un clin d’œil complice… tout en brandissant sa Thompson. Elle rentre la tête à l’intérieur, et nous l’entendons crier : « Mon Dieu ! »
Il nous faut presser le pas. Derrière, le jardin est plus ou moins entretenu, et il s’y trouve une cabane à outils. J’envisage brièvement de grimper, mais sais que Patrick en sera incapable ; Fran dit cependant qu’il faut y aller, que nous n’avons pas le choix… Patrick tente quand même de nous rejoindre. Je demande à Fran si elle sait où se trouve le garage : oui, c’était le bâtiment à l’avant de la priorité, au-delà du petit groupe que nous avions aperçu… Patrick dit qu’il va falloir y aller les armes à la main – ce qui m’inquiète, mais il précise qu’il ne s’agit pas forcément de tirer sur qui que ce soit… Nous devons donc repasser devant la fenêtre de la cuisine ; la femme de ménage ne s’y trouve pas, mais Patrick l’entend, affolée, se débattre avec le téléphone… Nous devons continuer – en essayant de nous faufiler discrètement par les haies. Mais nous entendons alors une voix féminine qui hurle : « Madame Jacqueline ! Des intrus ! Ils sont armés ! » Jacqueline Templesmith se lève, ahurie, se penche dans notre direction, mais ne nous aperçoit pas ; la femme de ménage, par contre, a rejoint la porte d’entrée principale, tandis que le garde de la guérite située à côté du portail se précipite vers son employeuse…
Patrick sort alors de l’abri de la haie et met en joue le garde avec sa mitraillette : « Lâche ton arme ! » Mais la distance les séparant est trop grande pour que la menace soit efficace, le garde en est bien conscient et a le temps de se planquer derrière une autre haie sans que Patrick ait pu faire quoi que ce soit… Jacqueline, pour sa part, panique et s’enfuit en direction du mur. Je m’avance de l’autre côté, en restant abritée derrière la haie – j’ai le temps de voir que Howard, dans son poumon d’acier, est incapable de bouger, et qu’il a des guêpes sur le visage. Je fais de mon mieux… mais le garde me voit – plus précisément, il ne sait pas avec exactitude où je me trouve, mais sait que Patrick n’est pas le seul intrus dans la propriété… Il essaye de nous raisonner, nous invitant à nous rendre… Patrick n’en tient pas compte : il continue à avancer, même à découvert, et tire enfin au jugé – il ne touche pas sa cible, mais le recul réveille ses douleurs internes… J’entends un cri étouffé de Jacqueline, mais ne la vois pas – et je ne vois pas davantage Fran. Je contourne la haie et interpelle le garde tourné vers Patrick, en lui disant de lâcher son arme ; le garde comprend qu’il est en fâcheuse posture, mais me dit qu’il ne se rendra pas tant que mon collègue menacera de lui tirer dessus, bien sûr… Je crie : « John ! Tire pas ! » Mais le garde a d’autres exigences : il veut s’assurer que Jacqueline Templesmith va bien. Patrick crie : « Tess ! Appelle Fran ! » Mais nous entendons immédiatement après trois détonations, suivies d’insultes dans une langue slave… Le garde, désemparé, est prêt à se rendre… Mais il nous demande de lui tirer une balle dans le bras pour le couvrir. Patrick dit qu’il va s’en charger, l’assurant même qu’il veillera à ce que la balle ne fracture pas l’os… Le garde pose son arme, Patrick s’exécute avec son automatique – sa cible crache une injure, mais se montre satisfaite : d’une certaine manière, le garde semble même nous estimer, et hoche la tête. Fran surgit alors de derrière la haie, braque le garde, mais Patrick lui dit de ramasser son arme et que nous nous en tiendrons là.
Puis nous nous rendons au garage. Nous y trouvons deux véhicules : une grosse voiture familiale, et une autre plus sportive – sans doute celle de Hippolyte Templesmith, et nous la prenons. Patrick doit bricoler pour la démarrer, et y parvient sans souci, tandis que Fran et moi nous occupons de la grille. Je m’installe derrière le volant, avec Fran à mes côtés et Patrick armé à l’arrière. Je demande à Fran de me guider dans cette ville que je ne connais pas, mais elle est obsédée par ses idées de vengeance, comme en transe, et ne se montre d’aucune aide. Or nous entendons des sirènes derrière nous… Patrick, sur le siège arrière, s’accroche d’une main à la banquette – mais il est pris d’une soudaine migraine qui lui fait cligner des yeux : machinalement, il ferme l’œil droit, et voit des sortes de « cristaux », formant une tache rouge de plus en plus grande qui emplit son champ de vision… Puis il perçoit une image différente, avec la sensation de voir à travers les yeux d’un autre : une main avec une montre en or très onéreuse amène une flute de champagne à ses lèvres… tandis que l’autre main est ensanglantée, appuyée sur une table à côté d’un scalpel ; ce point de vue extérieur « clignote » puis disparaît, et Patrick retrouve sa vision normale. Quant à moi, emportée par mon élan, je tamponne la voiture d’un petit vieux qui roulait très lentement – le conducteur mange son volant et bouge la tête douloureusement. C’est alors que Fran sort enfin de sa transe, et je lui répète qu’elle doit me guider, tandis que je me dégage de la voiture du vieillard, puis la contourne. Fran réagit, cette fois, et son aide s’avère précieuse ; elle finit par nous amener à une route de terre en périphérie, à l’arrière d’un centre commercial. Une sirène de police nous dépasse, mais Fran est confiante : effectivement, la voiture poursuit sa route, et la sirène s’éloigne. Nous sommes pour le moment en sécurité.
Il est un peu plus de 13h. Fran demande une cigarette, et je lui en donne une – qu’elle savoure avec une sensation de plaisir extrême. Je lui dis qu’il nous faut abandonner cette voiture, trouver où nous planquer dans Boston, et enfin retourner à Arkham. Mais Fran continue de fumer, sans un mot, totalement détachée… J’en profite, et Patrick de même, pour reprendre mon souffle et me calmer. Je vérifie au passage si j’ai sur moi tout ce que j’avais pris dans la demeure d’Hippolyte Templesmith puis dans le tunnel souterrain, et c’est bien le cas. Patrick ne se sent visiblement pas très en forme, et je demande à Fran si elle pourrait trouver quelqu’un pour l’ausculter. Elle acquiesce, mais nous demande d’abord nos noms, et nous les lui donnons ; après quoi elle nous demande si O’Bannion aurait du travail pour elle – jusqu’à présent, elle travaillait seulement avec son père –, et je lui dis que c’est bien possible. Elle apprécie visiblement, et se montre enfin plus active. Il nous faut abandonner la voiture – et rejoindre un garage de sa connaissance. Mais elle entend d’abord se défouler sur le véhicule rutilant d’Hippolyte Templesmith… et se met à déchirer les fauteuils avec sa lame. Patrick lui montre comment abîmer le moteur et la batterie ; mais pour ma part, je ne me mêle pas de ça…
Après quoi Fran nous entraîne, par des ruelles piétonnes très discrètes, jusqu’à un quartier plus populaire, habité essentiellement par des immigrés (dont des Irlandais) ; nous pénétrons dans un garage un peu délabré, au nom de la rue où il se trouve : « East End ». Apparaît un garagiste avec de l’embonpoint, pas très propre sur lui, qui reconnaît Fran et se précipite sur elle, la serrant dans ses bras (je remarque qu’il affiche un air surpris en nous voyant…). Le garagiste demande à Fran comment va son père ; elle retient un sanglot, et demande à lui parler en privé – en prenant tout de même le temps de dire que Patrick et moi sommes « OK ».
Le garagiste et Fran s’éloignent dans une pièce adjacente – mais il nous tend d’abord un journal, avec en guise de gros titre : « CAMBRIOLAGE À ARKHAM CHEZ HIPPOLYTE TEMPLESMITH » Il y a en dessous une grande photo sur laquelle Patrick et moi nous reconnaissons parfaitement, ainsi que Clive et Moira (Johnny était cagoulé). Par ailleurs, l’article cite nos noms… Templesmith a placé une prime de 2000 $ sur chacun d’entre nous ; le maire d’Arkham, scandalisé, a affirmé que les odieux criminels devaient être arrêtés à tout prix, et l’enquête a été confiée à l’inspecteur Harrigan. Je parcours le reste du journal : le deuxième article principal parle d’un cadavre retrouvé avec une carte d’as (mais de trèfle, cette fois) en main, et le journal évoque une guerre des gangs. Un troisième article attire mon attention : il y a eu un braquage dans une grande banque d’Arkham, et les coupables sont deux jeunes Noirs, en fuite (l’article en rajoutant bien sûr tant dans le racisme que dans la déploration du comportement des jeunes d’aujourd’hui en général)…
Je cherche à me procurer de quoi me maquiller, ainsi qu’une perruque, et fais de même en sorte que Patrick soit moins reconnaissable (ceci étant, depuis la photo, il a perdu tous ses cheveux et ses sourcils, ce qui change déjà considérablement la donne…). Fran est revenue auprès de nous, et nous dit qu’il n’y aura pas de souci pour avoir une voiture discrète afin de retourner à Arkham ; elle suggère cependant de ne pas faire le moindre mouvement avant la nuit, et de partir un peu avant l’aube. De toute façon, nous avons tous bien besoin de nous reposer, et le garagiste, qu’elle présente comme étant son oncle, peut nous héberger en attendant… Il nous confie une chambre avec un grand lit. Patrick va prendre une douche – quand il en sort et reprend la direction de la chambre, le garagiste l’interpelle et lui fait signe d’approcher pour discuter ; il se désigne comme étant Otto, et Patrick se présente ; le garagiste lui sert la main avec respect : il a appris, de la bouche de Fran, que nous l’avons sauvée… Il aimerait qu’elle reste avec lui à Boston, mais elle n’a semble-t-il qu’une idée en tête : aller avec nous à Arkham. « Je peux compter sur vous pour que la gamine s’en sorte bien ? » Patrick le lui certifie : « On l’a aidée, et elle nous a aidés aussi, on n’oublie jamais une chose pareille. » Otto demande à Patrick de le suivre jusqu’à une planque, où il dissimule une belle bouteille de whisky irlandais (qu’il devait boire avec le père de Fran, Archibald, après la réussite du coup chez les Templesmith) : il veut en boire un verre ou deux avec Patrick, et aussi « la rouquine ». Il parle un peu de Fran, dit qu’elle est « parfois un peu chiante », c’est son caractère, mais qu’elle en vaut la peine.
Nous dormons – à peine réveillés à un moment de la nuit par Fran qui braille des choses que nous ne comprenons pas. Puis, un peu avant l’aube, elle nous réveille vraiment ; elle a cette fois de vrais vêtements (dont un pantalon), mais d’allure assez passe-partout – et elle me donne un chapeau. Elle nous emmène alors devant une voiture familiale, d’apparence tout à fait banale, mais dont les vitres sont un peu opaques – et qui en a dans le ventre, ainsi que je m’en rends compte très vite en m’installant derrière le volant. Otto est également là, qui nous explique qu’il y a une cache à l’arrière du siège passager avant. Fran lui fait visiblement un peu la gueule, mais il la prend dans les bras, elle rouspète pour la forme, puis se laisse faire. Fran monte à l’avant, à côté de moi, et Patrick reste à l’arrière. Fran ouvre un paquet de cigarettes et m’en offre une, que j’accepte bien volontiers. Nous partons pour Arkham…
À suivre…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)
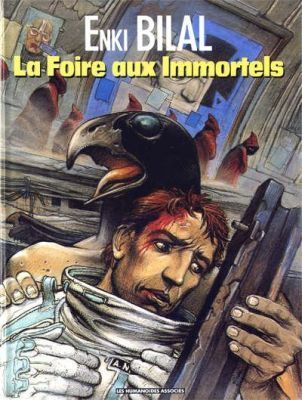
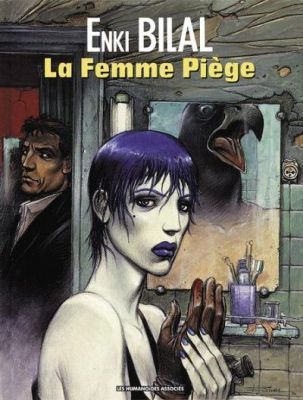
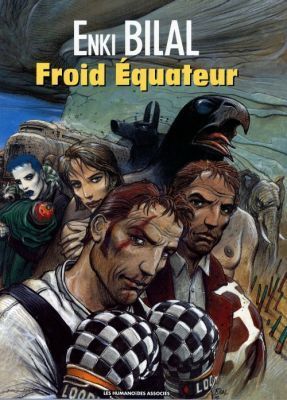



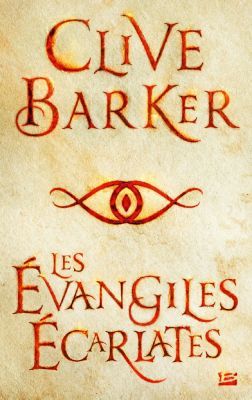
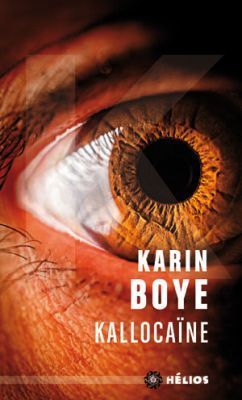






/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)