PRIEST (Christopher), Notre Île sombre, [Fugue for a Darkening Island (revised)], traduit de l’anglais par Michel Charrier, Paris, Denoël, coll. Lunes d’encre, [1972, 1976, 2011] 2014, 202 p.
Notre Île sombre, s’il est paru en France l’an dernier, n’est pas pour autant un roman « récent » de Christopher Priest. Enfin, pas tout à fait. Il s’agit en effet d’une version révisée d’une des premières œuvres de l’auteur, un roman publié originellement en 1972, et qui avait été traduit en 1976 sous le titre Le Rat blanc. Ce texte de jeunesse s’inscrivait dans la tradition très britannique de la SF-catastrophe, teintée alors d’expérimentations à la New Worlds (on pourra trouver d’autant plus étonnant – ou révélateur ? – que l’auteur, dans son avant-propos, s’en tienne à l’évocation de classiques produits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sans mentionner une seule fois J.G. Ballard). Il y avait donc un côté « exercice de style » très assumé dans Fugue for a Darkening Island.
Mais quarante ans ont passé, la stature de Christopher Priest n’est plus exactement la même aujourd’hui, et il a eu envie de « réviser » ce roman (sans changer son contexte temporel, nous sommes toujours dans des années 1970 imaginaires, un passé qui n’a pas eu lieu ; choix discutable sans doute, mais pas inintéressant) : d’une part pour des raisons tenant, disons, au métier d’écrivain (question de personnages, notamment, davantage creusés et plus subtils) ; d’autre part, pour des raisons (plus gênantes à mon sens) d’ordre « politique » : avec le temps, l’auteur a en effet dû subir des critiques très variées de cette œuvre ancienne, certains y voyant un roman généreux, une critique humanitaire bienvenue et, mieux que fréquentable, recommandable, là où d’autres… dénonçaient le brûlot d’extrême droite. Ce qui est absurde si l’on veut bien creuser un tout petit peu et témoigne d’une lecture à courte vue, mais c’est un rélexe assez répandu, hélas…
Mais cela peut en même temps se comprendre, dans la mesure où la « catastrophe » illustrée par Priest dans Notre Île sombre, sociétale, consiste… en l’afflux massif d’immigrés africains en Angleterre ; thème sensible, ouvrant la porte à tous les fantasmes, et susceptible par nature de bien des lectures politiques, quoi qu’en dise l’auteur, intéressé avant tout par ses personnages et en premier lieu son narrateur. À vrai dire, la quatrième de couverture de cette édition française me paraît bien témoigner de l’échec de Christopher Priest sous cet angle, dans la mesure où on y parle d’une « critique de l’arrogance des pays du Nord vis-à-vis de ceux du Sud », ce qui ne me paraît au fond pas plus pertinent, après lecture, que le portrait de Priest en nazillon (en tout cas, je n’ai pas vu cette critique pour ma part ; bon, je suis peut-être aveugle, hein…).
Cela dit, je n’avais pas lu Le Rat blanc, et étais curieux de voir comment un jeune Priest, qui était encore bien loin d’avoir écrit des chefs-d’œuvre tels que Le Prestige ou La Séparation, se dépatouillait avec ce thème quand même passablement provocateur. Il était donc bien temps de lire Notre Île sombre (mentionnons au passage que la couverture d’Aurélien Police est plus que jamais superbe et fait envie).
« J’ai la peau blanche. Les cheveux châtains. Les yeux bleus. Je suis grand. Je m’habille en principe de manière classique : veste sport, pantalon de velours, cravate en tricot. Je porte des lunettes pour lire, par affectation plus que par nécessité. Il m’arrive de fumer une cigarette. De boire un verre. Je ne suis pas croyant ; je ne vais pas à l’église ; ça ne me dérange pas que d’autres y aillent. Quand je me suis marié, j’étais amoureux de ma femme. J’adore ma fille, Sally. Je n’ai aucune ambition politique. Je m’appelle Alan Whitman.
« Je suis sale. J’ai les cheveux desséchés, pleins de sel, des démangeaisons au cuir chevelu. J’ai les yeux bleus. Je suis grand. Je porte les vêtements que je portais il y a six mois et je pue. J’ai perdu mes lunettes et appris à vivre sans. Je ne fume pas, en règle générale, mais si j’ai des cigarettes sous la main, je les enchaîne sans interruption. Je me saoule une fois par mois, quelque chose comme ça. Je ne suis pas croyant ; je ne vais pas à l’église. La dernière fois que j’ai vu ma femme, je l’ai envoyée au diable, mais j’ai fini par le regretter. J’adore ma fille, Sally. Il ne me semble pas avoir d’ambitions politiques. Je m’appelle Alan Whitman. »
C’est ainsi que s’ouvre Notre Île sombre, et je trouve que ça claque quand même pas mal. Le roman – coquetterie de jeune écrivain lecteur de New Worlds ? – alterne les époques de manière plus ou moins chaotique, jusqu’à ce que la narration devienne linéaire dans les dernières pages. On passe ainsi sans cesse d’un Alan Whitman à l’autre (ce qui peut paraître gratuit et déconcertant au début, mais s’avère assez vite plutôt convaincant et en tout cas parfaitement lisible, on peut saluer la maîtrise de l’auteur dans la structuration de son roman), confronté (le plus souvent : il y a aussi quelques flashbacks sentimentaux qui ont sans doute pour but de donner de l’épaisseur au narrateur, mais m’ont semblé un peu superflus malgré tout) à une bien étrange catastrophe, effet secondaire d’une catastrophe d’une tout autre ampleur.
Les guerres en Afrique noire ont dégénéré, salement – oui, certes, « proprement », c’est difficilement envisageable –, comme si famines et épidémies ne suffisaient pas. Le continent est à vrai dire devenu invivable, et les survivants se sont lancés, contraints et forcés, dans un exode massif. Bon nombre de pays constituent des destinations de choix pour ces migrants miséreux ; mais il y en a même qui arrivent en Angleterre (sans doute pas le choix le plus évident, et même, disons-le, crédible, mais cela joue bien sur les fantasmes des nationalistes, aussi cons là-bas qu’ici), et pas qu’un peu : deux millions, peut-être ? Difficile à dire. Ce qui est certain, c’est que l’Angleterre n’était pas prête à accueillir ce flot massif de réfugiés. Oh, certes, à l’instar des autres pays « développés », elle a très vaguement – mais pas suffisamment – mis la main à la patte humanitaire pour intervenir en Afrique même, mais c’était vain. Et quand les bateaux bondés arrivent sur les côtes de la perfide Albion – on ne peut s’empêcher de penser aux navires à destination de la Grèce ou plus encore de l’Italie, de nos jours –, elle ne sait tout simplement pas quoi faire… Pour ma part, je trouve que Priest se montre d’ailleurs ici – et longtemps dans la suite – relativement optimiste, dans un roman-catastrophe par essence pessimiste : je ne sais pas si cela procède de la réécriture (auquel cas ce serait probablement une bêtise…), mais, plus encore qu’à cet exode massif en Angleterre (en Angleterre ?!), je crois que j’ai vraiment eu du mal à croire aux réactions généreuses des Anglais, majoritairement prêts à accueillir à bras ouverts les immigrants, le nationalisme, la xénophobie et le racisme restant longtemps très discrets… Bon. On va dire de toute façon que la crédibilité n’est sans doute pas l’aspect essentiel de cette anticipation devenue par la force des choses rétrofuturiste…
Alan, professeur/ouvrier du textile/errant désemparé, fait en tout cas partie de ceux qui observent, avec une curiosité un peu perverse, l’arrivée des réfugiés sans en peser tout de suite les inévitables conséquences politiques. La politique ne l’intéresse pas vraiment, il est vrai, il doit être gentiment de gauche, pour la forme... Non, notre narrateur, passablement chaud de la bite, s’intéresse longtemps avant tout à ses maîtresses, qui lui permettent de trouver ce que sa femme frigide Isobel lui refuse. Mais il ne pourra pas fermer les yeux éternellement. La situation devient en effet rapidement tendue avec ces « Afrims », et une spirale infernale se déclenche, l’élection du conservateur (qui se dit réformiste, la bonne blague...) très, très nationaliste Tregarth aggravant radicalement les choses ; à vrai dire, si le portrait de ce salopard borné et de ses soutiens haineux est juste et nécessaire, la tendance du roman à faire reposer sur ce camp essentiellement, et pas sur les Afrims, largement exemptés, la responsabilité de la guerre civile qui enflamme bientôt l’Angleterre, m’a paru un brin naïve, quand même (j’espère là encore qu’elle n’est pas la résultante d’une révision – je vais employer un gros mot que je déteste – « politiquement correcte »)…
Alan ne peut plus ignorer tout cela quand les barricades se mettent à pousser dans les rues, et a fortiori quand des Afrims s’emparent de sa maison (qu’il avait fuie) : sans foyer, Alan, Isobel et leur fille Sally ne savent plus où aller, à leur tour… Les institutions sont défaillantes, l’aide internationale de même, tout voyage est un péril majeur. Trois camps s’affrontent bientôt les armes à la mains : les Afrims – qui s'organisent –, les nationalistes de Tregarth (avec état d’exception, peines de mort et camps de concentration), et les « royalistes sécessionnistes », autrement plus généreux (et c’est d’eux qu’Alan se sent le plus proche, sans s’engager pour autant). La petite famille erre sans but, et se déchire en prime : Alan et Isobel en viennent à se séparer dans le chaos ambiant. Ils se retrouveront, cependant, quand ils intègreront chacun de leur côté la petite bande de vagabonds menés par Rafiq, amas de réfugiés qui ne veulent pas et sans doute ne peuvent pas choisir un camp. Et tout cela, bien sûr, finira mal…
On l’aura compris à ce très bref résumé – auquel j’ai donné par nécessité une forme linéaire, mais le roman joue donc, et astucieusement, sur l’enchevêtrement permanent des époques –, Notre Île sombre ne brille pas par sa crédibilité ; le choix de laisser ce roman se dérouler dans des années 1970 fantasmées et d’ores et déjà obsolètes se justifie peut-être d’autant plus. Si le roman compte nombre de scènes fortes, et suscite à l’occasion des tableaux éprouvants, j’avoue l’avoir trouvé bien « timide » dans l’ensemble (la fin inévitable exceptée, mais bon, elle allait de soi) : c’est comme si, en dehors des ordures à la Tregarth, les Anglais de base – et pas seulement Alan –, même s’ils sont élu ladite ordure, par définition, confrontés à ce bouleversement majeur et à ses conséquences dramatiques, restaient majoritairement gentils, mignons, ouverts, d’une gauche tellement « bon teint » qu’elle en devient absurdement caricaturale (les Afrims, eux, sont de toute façon hors-champ…). Le camp « royaliste sécessionniste » m’a laissé perplexe… Je n’arrive pas à croire à tout cela – mais il est vrai que je n’ai aucune espèce de confiance à l’égard de mes semblables… ou vis-à-vis de moi-même, d’ailleurs. L’intérêt de Notre Île sombre n’est donc clairement pas, à mes yeux en tout cas, d’ordre politique, ou même plus largement sociétal ; et sous cet angle, je ne peux m’empêcher de le trouver un peu raté…
Restent deux choses qui jouent en sa faveur : la structure impeccable, certes déconcertante voire agaçante au premier abord, mais qui se révèle rapidement tout à fait pertinente, outre qu’elle ne nuit en rien au confort de lecture (on sait toujours en quelques lignes où l’on en est exactement dans cette navigation qui n’a que l’apparence du chaos), secondée par un style aussi simple en apparence qu’éloquent ; la personnalité d’Alan, aussi, dont les émotions à fleur de peau, le désespoir et la peur ne manquent pas de toucher le lecteur. Et c’est sans doute là que réside l’intérêt de Notre Île sombre : pas dans une quelconque catastrophe sociétale et politique, qui ne fait que servir de cadre, mais dans le portrait d’un homme un peu lâche, confronté à une situation qui le dépasse et qu’il n’aurait jamais pu concevoir. Alan n’est pas forcément très sympathique. Son égoïsme plus ou moins assumé, son rapport utilitaire aux femmes – et en premier lieu à Isobel –, son je-m’en-foutisme vaguement bobo de professeur à qui il ne peut rien arriver (eh eh !), tout cela ne joue guère en sa faveur. Pourtant, le récit à la première personne de ses avanies se montre véritablement émouvant – avant d’être effrayant ou révoltant –, et c’est là la réussite essentielle de Notre Île sombre.
Et je ne peux m’empêcher, du coup, d’établir un parallèle avec un autre roman lu il y a peu : Soumission de Michel Houellebecq. Si le propos central n’est sans doute pas le même, et si la conclusion est radicalement différente, je n’ai pu m’empêcher de relever quelques points communs, et de trouver notamment qu’il y a quelque chose de François en Alan (ou l’inverse), ces types qui vivaient dans un vague confort en principe inatteignable, surtout occupés de ce qu’ils fourraient (pour la forme, ou pour l’hygiène), et se retrouvent subitement plongés dans un monde qu’ils comprennent moins que jamais – un monde, dans les deux cas, résultant d’un fantasme politique de nationalistes paranoïaques et dont la crédibilité n’est sans doute pas la fonction première. C’est en effet la trajectoire d’un homme qui est véritablement au cœur du récit dans les deux cas… même si là s’arrête la comparaison : François, en se soumettant, ne fait que renforcer son confort utilitaire dans une utopie réactionnaire, là où Alan sombre dans un chaos toujours plus terrible qui ne peut que le conduire sur le terrain de la haine. Dans les deux cas, cependant, on a donc inévitablement eu des critiques « politiques » s’acharnant au mépris du bon sens (même si j’aime pas le bon sens) sur le racisme supposé du livre, et passant ainsi à côté de l’essentiel (à tout prendre, au passage, ce serait le roman de Priest qui, dans son pitch, me paraîtrait de loin le plus sulfureux ; mais il a tenté un peu maladroitement de gommer cet aspect… et j’espère vraiment, donc, que ce n’est pas une reculade face à une critique obtuse – je suis curieux, ici, de voir quelles sont au juste les différences avec Le Rat blanc…). Triste monde tragique.
Roman bancal, Notre Île sombre se lit bien – l’horrible expression – mais sans pleinement convaincre. Il ne manque pas d’intérêt, cependant – un intérêt tenant essentiellement à la forme, à la structure et à l’émotion. Le fond, faiblard dans l’aspect global, est néanmoins pertinent dès qu’il se resserre sur l’individu. J’imagine que c’est assez priestien, d’ailleurs… mais on est bien loin des plus grandes réussites de l’auteur. À ce stade, cette révision tient donc un peu de la curiosité… un peu décevante, pour le coup.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)
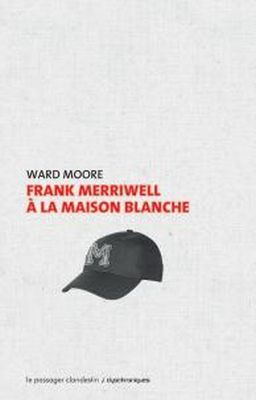



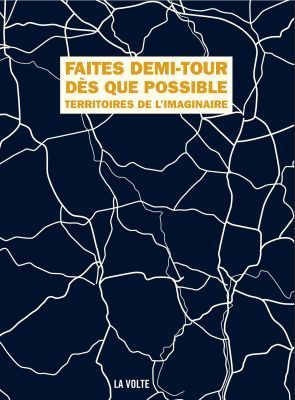



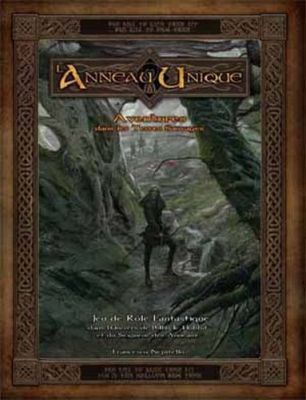



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)