Gunnm, t. 9 : La Conquête de Zalem (édition originale), de Yukito Kishiro
KISHIRO Yukito, Gunnm, t. 9 : La Conquête de Zalem (édition originale), [Gannmu 銃夢], traduction depuis le japonais [par] David Deleule, Grenoble, Glénat, coll. Manga Seinen, [1990-1995, 2013] 2018, 252 p.
Eh bien, nous y arrivons… La fin de Gunnm ! Ou du moins de la série originelle, car il y a eu depuis des prolongements, d’abord Gunnm Last Order, à la réputation pas top semble-t-il, ensuite Gunnm Mars Chronicle, dont je ne sais absolument rien, si ce n’est que la publication française en avait été entreprise parallèlement à cette reprise de Gunnm-tout-court en « édition originale » (et dont la traduction, notamment, me laisse parfois sceptique, ç’a été vrai tout du long). Mais Gunnm-tout-court s’arrête donc là – et il y a une vraie fin, même si avec suffisamment de portes ouvertes pour broder séquelles et préquelles.
À vrai dire, c’est un peu la ruée, dans ce neuvième tome très dense, qui doit rassembler pas mal de ficelles pour aboutir à une conclusion. Et, du coup, cela peut être un tantinet indigeste, je suppose… En fait, j’avais lu cet ultime tome il y a quelque chose comme deux semaines de cela, sans avoir le temps de le chroniquer dans la foulée ou disons dans les jours qui suivaient – pour faire mariner un peu. Mon ressenti… était un peu perplexe, disons. Mais, histoire d’en livrer une chronique pas trop totalement à l’ouest (dans l’idée, mais je suppose qu’elle le sera quand même), j’ai préféré relire ce neuvième tome avant de vous en causer – et bien m’en a pris, je crois, parce que c’est beaucoup mieux passé ; il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien à mes yeux, toujours, mais globalement ça se tient, et, oui, c’est une vraie fin, et probablement une bonne fin ; ce qui n’était vraiment pas gagné.
Nous avions laissé Gally seule contre tous ou presque, et quasiment en morceaux, atteindre enfin sa némésis Desty Nova, avec l’assistance du fiston chelou dudit savant dingue et flanophile, Kaos. Gally, qui s’est endurcie avec toutes ces années passées dans les Badlands, n’a pas exactement envie de faire dans la demi-mesure, et compte bien massacrer Desty Nova sans faire de manières, et tant pis pour ses connards d'employeurs sur Zalem. Mais une chose la ronge : quel est donc le secret des Zalémiens, justement ? Ce qui a rendu fou Ido, au point où il s’est réfugié dans une autre vie bienheureusement amnésique ? Je mets la balise SPOILER au cas où, mais cette « révélation » apparaît à la page 14, hein… Adonc, ni une, ni deux, Desty Nova découpe son crâne et exhibe la micropuce qui a remplacé son cerveau – car tel est le sort de tous les citoyens de Zalem quand ils atteignent l’âge de 19 ans, et c’est la condition de leur citoyenneté…
Bon. La découverte de ce secret, systématiquement, rend tous les Zalémiens dingues, et je suppose que, dans leur position, cela peut se comprendre, aussi les scènes illustrant leur folie, qu’elle tienne de la catatonie ou de l’automutilation précédant le geste authentiquement suicidaire, fonctionnent ma foi plutôt bien. Le rapport de Lou à cette révélation s’avère d’ailleurs plus subtil et convaincant que ce à quoi nous avait habitué le personnage, et c’est tant mieux – elle y gagne enfin de la chair et de l’âme, même stockée dans une micropuce. Reste que, de mon point de vue de lecteur bien éloigné de tout ça, ce terrible secret est de suite beaucoup moins terrifiant et scandaleux… On avance d’ailleurs (Desty Nova sauf erreur) que, cerveau cybernétique et corps organique, ou l’inverse comme pour Gally, ça n’est jamais qu’une question d’assemblage… C’est l’approche du savant fou, elle n’est donc probablement pas canonique, mais, après tout, la perspective transhumaniste de la série depuis ses tout premiers épisodes constituait à mes yeux un de ses atouts majeurs, et je tends donc à lui donner raison. Mais bon. D’une certaine manière, je conçois bien que ce « secret » soit constitutif d’une fin correcte pour la série, qui tient ses promesses ; c’est vraiment à titre très personnel que cet aspect de l’histoire me laisse passablement froid – de même à vrai dire pour les autres institutions de Zalem ici décrites, quand on y met enfin les pieds, et qui orientent absolument sans surprise la techno-utopie vers quelque chose qui tient bien davantage de la dystopie (chambres de suicide et expérience grandeur nature sur un mode typique de la thématique des arches stellaires, et, donc, disons auto-mutilation volontaire, qui est en même temps un auto-aveuglement) ; sans parler de la « justification » du nom même de la cité des nuages, mf…
Cela fonctionne donc, sans être forcément très enthousiasmant en ce qui me concerne. Mais, à mon sens, ce tome de conclusion contient suffisamment de bons moments ailleurs pour que l’ensemble en bénéficie, dont ces moments en rapport avec Zalem et ses secrets – notamment dans la manière de l’affrontement entre Gally et Desty Nova. Notez, il n’est pas dénué de trucs un peu lourds, le retour d’Eli au premier chef, dont on se serait très bien passé – tandis que le grand finale de Den vaut essentiellement pour le rôle ambigu de la petite Koyomi dans tout ça ; les errances plus ou moins psychiques de Kaos y sont forcément liées, et parlent plus ou moins. Non, ce qui est vraiment bon à mes yeux, et en même temps pas vraiment surprenant dans l’absolu, c’est que le combat se déroule dans le crâne même de Gally – que Desty Nova soumet à des rêves et cauchemars, tour à tour poignants et terribles, teintés de regrets aussi ; une ou des vies alternatives, parfois heureuses – insupportablement heureuses ; moyen de questionner la prédestination martiale de Gally. Dans ces scènes tantôt horribles, tantôt plus calmes et sereines que d’usage, le dessin toujours très bon de Kishiro Yukito brille tout particulièrement, sur un mode parfois sensible qui renvoie aux premiers tomes de la BD – les époques d’Ido et de Yugo… Un autre aspect intéressant de ces passages réside dans l’amorce d’une réévaluation du personnage de Desty Nova – dingue et dangereux sans doute, mais bien plus que cela en même temps ; s’il a commis suffisamment d’horreurs pour que l’on souhaite y mettre un terme, et si ce trifouillage de la mémoire et des sensations de Gally/Alita en fait d’ailleurs partie, il est quelques moments pourtant où, dans le rôle du tonton excentrique, il se révèle étrangement humain – et pas si éloigné d’un Ido, jusque dans leur désir partagé et un peu perturbant de « jouer à la poupée » avec Gally/Alita ; peut-être était-ce aussi le désir secret de Kishiro Yukito – voire, horreur glauque, des lecteurs de Gunnm ? Gally parviendra certes à fuir ce rêve – mais pour réaliser qu’elle n’en a absolument aucun, ce qui est plutôt douloureux…
Mais je disais donc que cet ultime tome était très dense – et il reste encore deux aspects à mentionner, plus rapidement, mais liés. Le plus intéressant à mon sens est ce flashback dans lequel Gally découvre enfin la Yôko qu’elle était – une militaire martienne impitoyable, à l’époque d’un conflit entre Mars et la Terre, pardon, Röte et Blau ; Gally est horrifié par ce dont elle se souvient enfin, mais l’épisode a aussi pour fonction de justifier… eh bien, le point de départ même de la BD : comment ce cerveau organique dans un corps hétéroclite en lambeaux a pu finir dans la Décharge, où Ido le trouvera, toujours en état de marche, quelques siècles plus tard… Noter que la BD prend soin de ménager un grand flou sur une durée de 200 ans au moins, laissant de la marge pour des épisodes ultérieurs – en tant que tel, le procédé, bien employé, n’est pas frustrant, mais vraiment intrigant.
Enfin, les destins de Gally et de Zalem doivent s’unir. Les fantasmes de Den et de la Décharge s’associent également aux illusions aveugles des Zalémiens – tandis que Desty Nova s’engage plus avant, même follement, sur la voie d’un semblant de rédemption. Sans vraie surprise, Gally nous offre donc un finale christique, non sans une certaine grâce cela dit – une manière de boucler la boucle, ou, plus exactement, de relier les mondes. La forme même de ce sacrifice donne tout d’abord une vague impression d’improvisation (notamment les rôles de Desty Nova et aussi de Lou dans tout ça, avec des équivalents gadgétoïdes de deus ex machina), mais, là encore, en définitive, cela fonctionne ; et, comme de juste, un épilogue ouvre à nouveau quelques portes pour raconter d’autres histoires…
Arrivé au terme de cette BD, quel est mon ressenti global ? Positif – largement, je crois. En commençant par une évidence : le dessin de Kishiro Yukito est vraiment très bon, et progresse même de tome en tome. Le personnage de Gally est très réussi. Quelques autres personnages de même – Ido dès le départ, plus tard Kaos même s’il a ses moments pénibles, et finalement Desty Nova ; d’autres noms pourraient sans doute être avancés. Il y a eu des hauts et des bas, sans doute ; comme je l’ai dit dans tous mes comptes rendus depuis le troisième volume, le principal bas de la série est clairement, en ce qui me concerne, le pénible arc du motorball. Le tournant madmaxien à partir du tome 6 m’a bien plu, par contre. Il y a des choses qui fonctionnent très bien du début à la fin, cela dit – et notamment cette veine plus ou moins transhumaniste, sur un socle cyberpunk, qui autorise une sorte de gore très improbable mais d’autant plus enthousiasmant. Et des choses qui fonctionnent beaucoup moins bien dès les premières occurrences, pour compenser – le catalogue de coups spéciaux et d’armes de destruction massive, avec des notes de bas de case régulièrement crétines à la manière d’un Shirow Masamune dans The Beurk in the Shell… Mais les qualités l’emportent clairement sur les défauts : Gunnm est un bon manga de SF, et un bon manga d’action ; peut-être pas tout à fait à la hauteur de son culte, même si j’y ai participé non sans une certaine nostalgie adolescente – néanmoins bien au-dessus du lot, pas l'ombre d'un doute à ce sujet.
Ce que confirme en définitive cet ultime tome, très dense : tout ne se montre pas totalement convaincant, mais les bons moments rachètent sans peine les moins bons, et c’est une conclusion appréciable à une série de qualité.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





























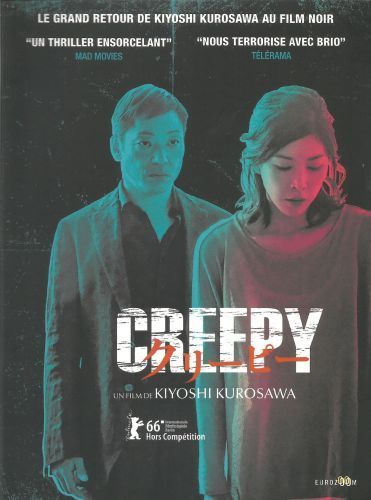





/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)