"Une course d'enfer", de Clive Barker

BARKER (Clive), Une course d’enfer, [Books Of Blood, Volume 2], traduit de l’anglais par Dominique Dill, Paris, J’ai lu, coll. Science-fiction – Fantastique, [1984, 1988] 1994, 251 p.
Deuxième des six « Livres de sang », Une course d’enfer comprend cinq nouvelles d’horreur, nouveaux témoignages des morts sur les atrocités de la vie.
Le recueil s’ouvre sur « Terreur », récit dans lequel un « philosophe » obsédé par la peur, et y voyant la clef de tout, entend bien convaincre ses jeunes comparses de la justesse de son point de vue. La nouvelle séduit par son nihilisme quasi adolescent et son délicieux sadisme, mais est quelque peu convenue, et la fin est largement prévisible. Ambiance très correcte, toutefois.
On passe ensuite à « Une course d’enfer » : ladite course, épreuve de demi-fond dans les rues de Londres, oppose des humains inconscients de l’importance de l’événement à des démons désireux d’anéantir la démocratie et de faire rejaillir l’enfer sur Terre. Quelques jolies scènes d’horreur, à partir de ce postulat pour le moins saugrenu, et un beau suspense.
Cela dit, on sait que Clive Barker est capable de faire bien mieux, ce qu’il va montrer avec un brio tout particulier dans les deux nouvelles qui suivent, clairement au-dessus du lot.
Commençons donc par « Le Testament de Jacqueline Ess », ou l’histoire d’une femme qui, après une tentative de suicide, se découvre le pouvoir de manipuler la chair, la sienne et celle des autres, par la pensée. Un beau portrait de femme, des scènes de gore éprouvantes, et une tragique histoire d’amour au dénouement superbe. Vraiment une excellente nouvelle.
Excellente nouvelle également, « Les Démons du désert » prend place en Arizona, aux environs du bled paumé de Welcome (allons bon !), où d’étranges créatures – garantes de descriptions surréalistes de la plus belle eau – rôdent dans le désert. Ces « démons » se retrouvent confrontés à la bêtise et la beauferie humaines, ce qui donne au récit une tournure fortement misanthrope (et surtout misandre). La construction est audacieuse, les personnages bien campés, la douleur palpable, le fond comme la forme brillants (à l’exception peut-être d’un paragraphe explicatif probablement superflu) : j’ai beaucoup aimé.
Je serais plus réservé en ce qui concerne « Nouveaux Assassinats dans la rue Morgue », nouvelle qui conclut le recueil et qui, comme son titre (mensonger, d’ailleurs) l’indique assez, est un hommage à Edgar Allan Poe. Un descendant du fameux détective Dupin enquête à Paris sur un meurtre dont est accusé un de ses proches, et qui n’est pas sans évoquer la célèbre affaire de la rue Morgue (qui serait donc authentique). La nouvelle met tout de même un peu de temps à démarrer, et est parasitée par quelques clichés un brin pénibles. Toutefois, l’atmosphère qui s’en dégage progressivement, la bestialité perverse sous-jacente et le ton très dépressif de l’ensemble sauvent le texte, qui se révèle assez correct, même si, là encore, on a eu la preuve que Clive Barker était capable de tout autre chose.
Un bon recueil, donc, comprenant deux excellents textes et trois autres un peu moins bons mais très recommandables tout de même. Globalement inférieur à Livre de sang en ce qui me concerne, mais très appréciable néanmoins.
Suite avec Confessions d’un linceul.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


















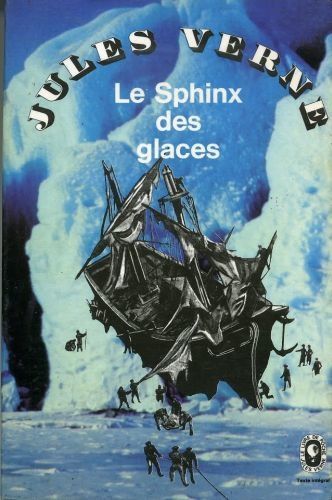

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)