HAMILL (Shaun), Une cosmologie de monstres, [A Cosmology of Monsters], traduit de l’anglais (États-Unis) par Benoît Domis, Paris, Albin Michel, coll. Imaginaire, 2019, 404 p.
Parfois, pour quelque raison indicible, les étoiles s’alignent et un premier roman devient un événement avant même sa (putain de) sortie : tel est bien le cas pour Une cosmologie de monstres, signé Shaun Hamill, bouquin dont le projet d’adaptation en série TV est antérieur à sa date de publication. Et, à propos de celle-ci, il faut relever que la présente traduction française, due à Benoît Domis, est sortie « officiellement » quelque chose comme deux semaines seulement après la version originale.
Cerise sur le gâteau, le Maître Stephen King himself adoube le jeune auteur et son roman dans un blurb plus qu’élogieux (et on notera au passage que la quatrième de couverture s’en tient à ce blurb – il n’y a pas le moindre résumé du roman, et ça n’est pas plus mal, au fond). Bon, maintenant, avec toute l’estime que j’ai pour le grand Stéphane Roi, je me méfie un peu de ses blurbs… Non que je doute forcément de leur sincérité, hein ! C’est plutôt qu’il me fait l’effet d’avoir l’enthousiasme un peu expansif, parfois, et du coup plus ou moins lucide (qui suis-je pour le lui reprocher…) – un peu comme son confrère Neil Gaiman, disons, dont le nom figure, durant la bonne saison, sur trois bandeaux rouges sur cinq. En fait, à cet égard, j’ai sans doute abordé la lecture d’Une cosmologie de monstres avec un biais un tantinet fâcheux, hérité de, par exemple, Les Mortes-Eaux d’Andrew Michael Hurley (même si j’avais oublié, et le nom du bouquin, et le nom de l’auteur, bordel, et c’est en soi éloquent) : soit la crainte d’un soufflé qui retombe vite… Un roman certes pas mauvais, globalement, mais pas génial non plus, et qui ne restera pas.
Bien sûr, il y a ici une accroche supplémentaire : la référence à Lovecraft. Il est partout, hein ? Pour autant, Une cosmologie de monstres ne relève probablement pas de la lovecrafterie à proprement parler. Aussi la (très belle) couverture d’Aurélien Police (l'excellent Aurélien Police) a-t-elle pour cette raison suscité quelques haussements de sourcils… De fait, les tentacules de la couverture sont grosso merdo absents du roman – comme ils le sont de la majeure partie de l’œuvre de Lovecraft, à vrai dire… Mais qu’on associe pavloviennement Lovecraft et tentacules en dit peut-être plus sur les lecteurs que sur l’auteur, et si l’illustrateur et l’éditeur en jouent, ma foi… Pourquoi pas ? C’est de la référence en biais, dans un livre assurément très référentiel, et ça se tient – on n’est pas obligé d’y voir de la putasserie (et je la vois pourtant volontiers, de manière générale). Je l’aime bien, moi, cette couv… Et, thématiquement, je la trouve en fait appropriée. Mais je reviendrai sur le contenu lovecraftien (ou pas) du roman un peu plus tard.
Commençons en présentant un chouia l’histoire – sans aller trop loin non plus, encore que je ne pense pas qu’Une cosmologie de monstres soit un roman « à spoilers ». C’est l’histoire d’une famille, sur cinq décennies environ – au Texas ; et rappelez-vous que seuls les fourmis et les Texans survivront à l’hiver nucléaire ! Mais je m’égare…
Nan, notre histoire commence en 1968 environ, et nous parle tout d’abord d’amûûûr. Margaret, une jeune fille issue de la petite bourgeoisie WASP par essence coincée du cul, choque ses géniteurs en même temps que son milieu social en convolant, plutôt qu’avec le quarterback bon chrétien et héritier de la fortune de papa de service, avec l’excentrique Harry, geek jusqu’au bout des pulps et des comics plastifiés, et véhicule idéal à la projection du lecteur de SFFF mâle (dit-il d'expérience). Le couple Turner s’installe dans sa petite banlieue médiocre (on voit très bien les palissades blanches et le gazon impeccable), et pond des gosses, parce que c’est comme ça qu'il faut faire – chronologiquement, deux filles, Sydney la danseuse sarcastique qui a comme un petit souci de complexe d’Électre, Eunice la nerd tourmentée, et plus tard Noah, le mini-Harry qui nous raconte tout ça. Las, Papa a des soucis, puis ses filles, et tout ceci dégénère mollement au fur et à mesure que les années passent. Ce qui pourrait être le tableau parfaitement banal d’une petite famille américaine parfaitement banale.
À ceci près que.
Tout d’abord, Harry… est un fan de Lovecraft, et plus généralement d’horreur, qu’il cultive et savoure dans les pulps comme dans les salles de cinéma de quartier. Ses goûts vont de La Famille Addams à Yog-Sothoth en passant par Les Contes de la Crypte et Rosemary’s Baby, ce qui couvre un large spectre (si j’ose dire). Il aime probablement aussi les citrouilles d’Halloween, et se découvre en définitive une vocation : il bâtira dans son jardin une maison des horreurs, une sorte de train fantôme sédentaire, où les banlieusards du coin, pour une modique somme, viendront éprouver quelques frissons amusants. En fait, la passion pour l’horreur qui caractérise Harry dévie de sa voie la famille entière, jusqu’à constituer pour elle une norme dont il faudra bien s’accommoder – ce dont le roman se fait nécessairement l’écho.
Mais ensuite… Eh bien, rien que de très naturel, au fond : le petit Noah a un copain imaginaire – c’est le cas de nombre d’enfants, paraît-il, et de la totalité des croyants, alors bon.
…
Il est forcément imaginaire, hein ?
Mais ce qui ne l’est pas, ce qui pèse de tout son poids sur la famille maudite des Turner, c’est la réalité affreusement concrète de la mort et de la souffrance. Oh, oui.
Sur ces bases… Eh bien, on ne s’étonnera pas vraiment que Stephen King ait aimé. Les Turner pourraient aussi bien vivre à Castle Rock, Maine, et Shaun Hamill consacre l’essentiel de son roman à nous narrer par le menu la destinée de cette famille. Ce qu’il fait globalement très bien, je suppose – encore que je doive aussitôt préciser qu’à titre tout personnel, le thème de la famille, ben, de manière générale, je m’en bats copieusement les glaouis… Et l’amûûûr… Bon. Mais, oui, ça fonctionne, indéniablement – et la plume fluide y est pour beaucoup.
En fait, à certains égards, le sort des Turner pourrait relever avant tout d’une sorte de soap opera deluxe, un peu tordu certes, le fantastique n'en constituant qu’un soubassement (même si comme tel fondamental) ; pendant une bonne partie du roman, le fantastique et a fortiori l’horreur relèvent plus de la citation que de l’expérience authentiquement vécue ; puis le surnaturel s’immisce dans le récit – en même temps qu’une horreur très humaine s’insinue çà et là, qui à vue de nez tiendrait plus du thriller que du fantastique : l’horreur surnaturelle, ce sera pour les dernières pages du roman seulement. Du coup, j’ai lu quelques retours sceptiques à cet égard – éventuellement liés d’ailleurs aux critiques adressées à la couverture tentaculaire : Une cosmologie de monstres ne serait pas très horrifique, etc. Peut-être… En même temps, paradoxe du jour, et de tous les jours qui ont précédé, l’horreur littéraire ne me paraît que rarement très horrifique… Pour frissonner à la lecture d’un bouquin, j’ai besoin du talent des meilleurs : Lovecraft ou King, oui, ou Dan Simmons, ou Clive Barker… Au-delà, le fantastique n’a pas à se montrer nécessairement horrifique, et l’horreur me paraît souvent opérer au mieux quand elle est ponctuelle – en conclusion d’un récit, mettons. Ce en quoi Une cosmologie de monstres me paraît remplir son contrat, et à vrai dire d’une manière assez… banale. Le King lui-même a souvent procédé de la sorte – assez récemment encore dans le plutôt lovecraftien également Revival, par exemple.
Mais justement : et Lovecraft, dans tout ça ? Eh bien, à s’en tenir à cette brève présentation du roman, il est très, très, trèèèèèès loin de tout ça. Je veux dire… Bordel : les gens, les sentiments, la famille ?! On ne fera pas plus anti-lovecraftien – le gentleman de Providence aurait trouvé tout cela parfaitement répugnant. Et à bon droit, bien sûr. Alors que les tentacules non-euclidiens, ça va. Et ça va avec tout. Ceci dit, il n’y en a guère ici – et pourtant il y a bien Lovecraft.
Mais il y est, durant la majeure partie du roman, essentiellement sous forme de citations. Souvent explicites, d’ailleurs : les titres des différentes parties du roman renvoient tous à des nouvelles de Lovecraft – « L’Image dans la maison déserte », « La Tombe », « Le Monstre sur le seuil », « Celui qui chuchotait dans le noir », « La Cité sans nom », « La Maison maudite », « Celui qui hantait les ténèbres » enfin. Shaun Hamill balaye (devant sa porte) un large spectre (toujours) : il évoque de la sorte aussi bien la première nouvelle « adulte » de Lovecraft, soit « La Tombe », que la dernière, « Celui qui hantait les ténèbres » ; entre les deux, on a du « conte macabre » aussi bien que du « Mythe de Cthulhu ». Ces titres sont globalement pertinents, même s’ils m’ont régulièrement fait l’effet d’être un peu trop forcés. Mais la citation explicite ressort également de passages commentés des œuvres de Lovecraft – plutôt critiques, d’ailleurs, comme il se doit : je ne vous détaille pas le blabla « mal écrit », « personnages ineptes », etc., vous le trouverez dans 95,2 % des romans et nouvelles de la « nouvelle littérature critique lovecraftienne ». Avec pertinence le plus souvent, mais disons que ça se répète. En cela aussi le roman de Shaun Hamill est somme toute banal.
Y a-t-il du Lovecraft au-delà, dans Une cosmologie de monstres ? Au-delà notamment de ce titre pour le moins connoté, d'ailleurs, veux-je dire ? Probablement – mais de manière un peu plus subtile cette fois : dans les procédés, et dans les thèmes. Encore qu’en fait de subtilité… Car le premier procédé à évoquer est probablement celui de l’attaque en force. Une cosmologie de monstres, passé l’exergue associant Bradbury à Lovecraft (eh, Weird Tales bro), s’ouvre sur une sentence pour le moins perturbante : « Je me suis mis à collectionner les lettres de suicide de ma sœur Eunice à l’âge de sept ans. » Difficile ici de ne pas penser à la fameuse ouverture du « Monstre sur le seuil », j’ai logé tout un chargeur dans la trogne à mon pote mais je vais vous expliquer qu’en fait je ne l’ai pas tué… C’est assez grotesque, bien sûr – et plus ou moins honnête ; mais de manière pertinente, le cas échéant, car, comme dans la nouvelle de Lovecraft, cette entrée en matière tient du gros panneau rouge clignotant affichant « LE NARRATEUR DE CETTE HISTOIRE N’EST PAS FORCÉMENT TRÈS TRÈS FIABLE ». D’autres techniques de ce genre ponctuent le roman, même s’il est parfois plus difficile de faire le tri entre ce qui relève de la référence lovecraftienne consciente… et de la mécanique passablement aseptisée du thriller pondu en atelier d’écriture (on y reviendra). À moins que cela ne fasse justement partie du jeu ?
Cela dit, en définitive, je tends à croire que, au-delà de la citation et des procédés techniques, c’est du côté des thématiques que le roman de Shaun Hamill affiche bel et bien une certaine parenté, si j’ose dire, avec Lovecraft. Car si le gentleman de Providence ne prisait guère les sentiments humains en littérature, il pouvait certes lui arriver, et assez régulièrement, de traiter pourtant de la famille – mais sous l’angle perverti de la généalogie morbide, de l’ascendance maudite et qui marque nécessairement de son empreinte funeste les générations suivantes, en guise d’héritage imposé sans bénéfice d’inventaire (ce qui est plutôt approprié, ici, pour le rapport de Noah à son père Harry). Si Une cosmologie de monstres, pour l’essentiel, ne fait pas vraiment dans le « Mythe de Cthulhu », et s’en tamponne en tout cas le coquillard des divinités extraterrestres indicibles et des cultes impies et non-euclidiens qui les révèrent, en revanche, dans son approche de la famille, il suscite de nombreux échos lovecraftiens – des textes comme, parmi ceux qui ont fourni les titres des parties du roman, « Le Monstre sur le seuil » (bis – en fait, le titre de cette nouvelle est sans doute le plus pertinent à l’égard du roman dans son ensemble ; oui, on gratouille à votre fenêtre en ce moment même, à défaut d’émettre des borborygmes aqueux) ou « La Maison maudite » (qui souligne l’ambiguïté fondamentale des murs dans lesquels demeurent et travaillent les Turner), mais aussi, en vrac, L’Affaire Charles Dexter Ward, « Les Rats dans les murs », « Le Festival », « Le Cauchemar d’Innsmouth », « Faits concernant feu Arthur Jermyn », « La Peur qui rôde »… C’est en fait un thème extrêmement fréquent, chez Lovecraft – et qui, oui, a éventuellement ses connotations génético-racistes, pour le coup absentes (eh) du roman de Shaun Hamill. Et ça, yep, c’est très bien fait, et ça fonctionne très bien – c’est là, pour moi, l’âme de cette histoire, et ce qui rend la référence lovecraftienne pertinente en définitive. Sans le supplément de tentacules – on s’en passe très bien.
Car il y a bien aussi, en dernier ressort, cette histoire d’un monde derrière le voile, qui permet enfin à l’horreur véritable et véritablement surnaturelle de s’immiscer dans le récit, mais ça me paraît à ce stade secondaire. Cela suscite certes quelques images plutôt fortes, mais probablement pas autant que la conclusion de Revival (donc) de Stephen King, dans un registre très proche – je relève au passage que cette dimension du roman de Shaun Hamill m’a beaucoup, beaucoup fait penser à la nouvelle « Waller », de Donald Tyson (dans l’anthologie lovecraftienne Black Wings III, éditée par S.T. Joshi), même si celle-ci joue à donf de la carte du grotesque en flirtant ouvertement avec le ridicule, là où Une cosmologie de monstres se veut à ce stade parfaitement sérieux, et joue davantage du pathos.
Reste à causer rapidement de la forme – et c’est lié, car l’émotion est au premier plan : dans l’ensemble, ouais, ça marche bien, très bien même, et on ressent véritablement les personnages des Turner, leurs sentiments, etc. Ils sont humains, authentiques, on est régulièrement amené à s’y identifier, bref, ils sont parfaitement pas lovecraftiens du tout, donc. On n’est pas à l’abri, cependant, de l’excès de pathos occasionnel – et, lors de certaines séquences, j’avais au fond du crâne ces putains de violons sirupeux, ou ces pas moins putains de ballades folk fades, que l’industrie cinématographico-télévisuelle américaine se sent obligée de nous balancer à la moindre « séquence émotion », ce que j’ai toujours trouvé excessivement pénible (oui, c’est de toi que je parle, calamiteux dernier épisode de The Haunting of Hill House – entre autres – beaucoup trop d’autres).
Mais, dans l’ensemble, oui, tout cela se lit très bien – c’est fluide, on tourne les pages sans y penser, on se rend compte un peu tard qu’on a prolongé le séjour chez les Turner jusqu’à une heure indécente et qu’il serait bien temps d’éteindre la lumière, ce genre de choses. Shaun Hamill écrit plutôt bien, son traducteur Benoît Domis aussi, en tout cas ça coule tout seul.
Maintenant, ici, Une cosmologie de monstres a peut-être les défauts de ses qualités… Il y a cette critique qui revient de temps en temps, et qui, de tel ou tel texte, consistera à dire : « C’est un pur produit formaté des ateliers d’écriture à l’américaine. » Et cette critique me laisse plus qu’à mon tour perplexe. Mais là… Ouais. Là, ouais. Grave. De fait, Shaun Hamill a bien travaillé son roman en atelier, et s’étend copieusement à ce sujet dans les remerciements d’usage en fin d’ouvrage. Et, pour le coup, ça se sent. Ça fonctionne, oui, c’est très pro pour un premier roman, mais, justement, ça l’est peut-être un peu trop. Parce que, du coup, ça a quelque chose d’un peu mécanique parfois, d’un peu fade trop souvent, car finalement assez convenu… Lovecraft, si décrié pour son adjectivite et compagnie, avait néanmoins un style qui lui était propre, comme le relevait très justement Le Terrible Michou.
Cela dit, en faisant la part des choses, oui, Une cosmologie de monstres est un bon roman, et se lit très bien. Vraiment très bien. C’est bien fait, c’est réfléchi, ça touche, bref, ça fonctionne. Ça n’est pas un chef-d’œuvre. Ça ne mérite probablement pas tout ce battage événementiel. Mais c’est bien – au-dessus du lot à n’en pas douter. Une lecture recommandable, donc, à condition de ne pas trop en attendre non plus : Shaun Hamill n’est pas le messie, avec ou sans tentacules.
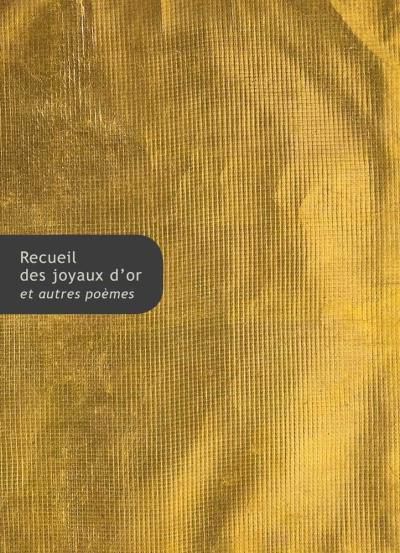

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)






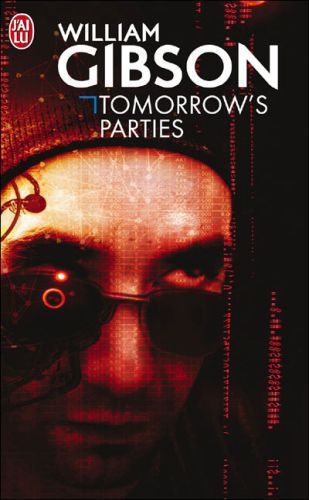





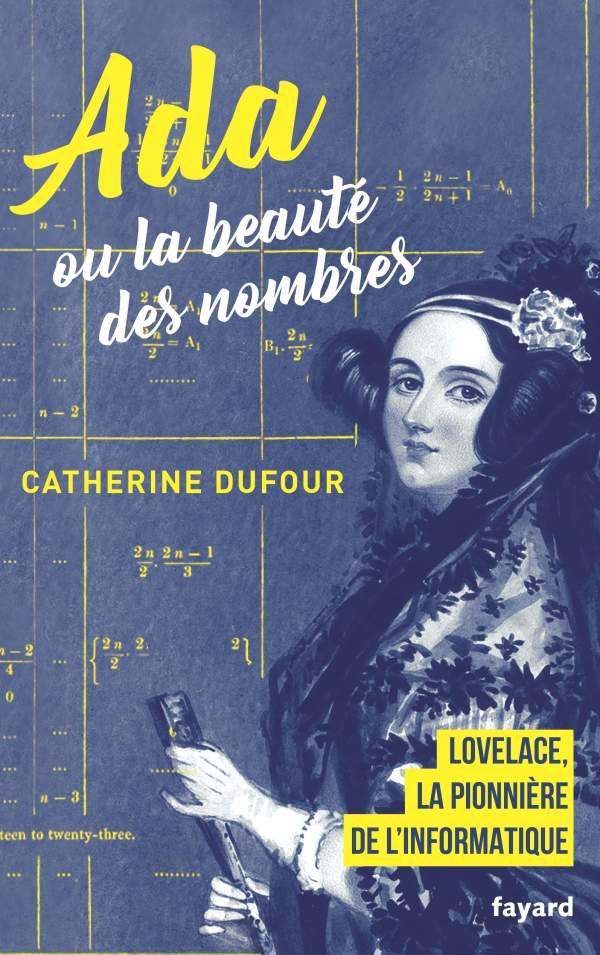
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)