Anthologie de la poésie japonaise classique
Anthologie de la poésie japonaise classique, traduction, préface et commentaires de G. Renondeau, Paris, Gallimard, coll. Poésie – UNESCO, coll. UNESCO d’œuvres représentatives, série japonaise, [1971, 1978] 2016, 256 p.
POUÈTES POUÈTES
Cela a longtemps fait partie des running gags débiles de ce blog : ma détestation de la polésie et des pouètes. Comme de juste, je forçais le trait, par provocation idiote… J’imagine que ça ne trompait personne, d’autant qu’il me fallait bien confesser, de temps à autre, que j’avais lu et apprécié Rimbaud et Baudelaire ado (comme un ado, quoi), et qu’un Totor Hugo par-ci, un Totor Hugo par-là, eh bien, ma foi…
Depuis ? Ah, ça se complique – mais j’imagine que c’est ma méconnaissance, alors, qui prime : le fait est que je ne connais rien à la poésie contemporaine, en français ou dans d’autres langues – enfin, avec tout de même une exception pour Ian Monk, hop et hop. Oui, il y avait de la pose, dans tout ça – mais, si je ne méprise pas le registre autant que j’ai pu le prétendre, le fait demeure que je n’y suis globalement guère sensible, outre que je suis ignare.
Ces derniers temps, avec mon engouement nippon et la reprise des études, la question a pris un tour plus sérieux : il me fallait en apprendre au moins un minimum concernant la poésie japonaise. Une perspective qui ne m’enchantait pas forcément, à la base – surtout parce que mon expérience de lecteur de haïkus s’était vite avérée désastreuse : je n’y comprenais absolument rien… Mais j’ai bien fini par tenter le coup – et je me suis découvert un attrait inattendu pour la poésie japonaise classique ; mais disons « vraiment classique », celle des époques Nara et Heian surtout. J’en avais eu quelques aperçus dans des œuvres essentiellement poétiques, notamment les Contes d’Ise et Le Dit de Heichû, mais aussi dans d’autres œuvres citant occasionnellement de la poésie – par exemple, certains « journaux » (nikki) lus dans la brillante anthologie Mille Ans de littérature japonaise, éditée par Nakamura Ryôji et René de Ceccatty (et qui comprend certes des moments purement poétiques), et il me faudra creuser tout cela, c’est prévu. Autre exemple, dans les chroniques du « cycle épique des Taira et des Minamoto », et au premier chef dans Le Dit des Heiké ; voire, en remontant bien plus haut, dans le Kojiki même… Parallèlement, d’autres œuvres ont pu raviver mon intérêt plus que limité pour la poésie japonaise des ères prémodernes ultérieures – par exemple, Insectes, de Lafcadio Hearn…
Je me disais donc qu’il pourrait s’avérer utile de revenir sur la question, et de lire bien davantage de poésie japonaise classique. Autant dire que cette anthologie me tendait les bras : composée par Gaston Renondeau (dont j’avais apprécié le rendu sobrement élégant de sa traduction des Contes d’Ise, justement – un bien curieux personnage que ce général Renondeau…), elle envisage quelque chose comme, disons, douze siècles de poésie japonaise, du Man.yôshû à la Rénovation de Meiji, selon une périodisation classique (peut-être critiquable çà et là, mais c’est du pinaillage). Chaque période, ici, a ses spécificités – et c’est là que j’émettrais peut-être une très timide critique, car la sélection opérée par l’anthologiste appuie sans doute un peu trop sur des changements de forme drastiques – j’aurai l’occasion d’y revenir, et à plusieurs reprises. Par contre, le rendu très « simple » (faussement ?) de cette traduction me paraît donc un atout – c’est peut-être moins élégant que, disons, les circonvolutions archaïsantes dont est coutumier un René Sieffert, par exemple, mais cela parle bien plus intuitivement, et je suppose que c’est tant mieux, dans le contexte de la poésie japonaise classique.
Mais, pose de détestation de la polésie ou pas, le fait demeure : je ne me sens clairement pas armé pour livrer une critique pertinente en matière de poésie – encore moins que pour tout autre registre. Du coup, cette chronique va prendre une forme peut-être un peu inhabituelle, parce que je vais faire beaucoup de citations ; j’aurai bien quelques commentaires à émettre de temps en temps, ne serait-ce qu’au regard du contexte historique, mais l’essentiel résidera bien dans les extraits des œuvres traduites par Gaston Renondeau. Vous l’échappez belle, hein ? Le drame, c’est qu’il me faudra lire toute cette poésie pour la version YouTube de la chronique, ce qui promet d’être sportif…
Autre conséquence notable : cet article est pour l’essentiel une sélection dans ce qui était déjà une sélection – et je ne prétends certainement pas en avoir extrait « le meilleur », c’est même assez improbable : simplement ce qui m’a le plus parlé à titre personnel – moi, je, me, myself, I.
Allez, c’est parti.
LA PÉRIODE ARCHAÏQUE ET LA PÉRIODE DE NARA : LE MAN.YÔSHÛ, DONT QUELQUES POÈMES LONGS
Présentation
La première période envisagée par Gaston Renondeau est fort longue, puisqu’elle va « des premiers siècles de notre ère à la fin du VIIIe siècle ». Il rassemble donc plusieurs ères classiques en une seule. Cette mention des « premiers siècles de notre ère », toutefois, me paraît un peu douteuse, et il me paraît certain en tout cas qu’on ne peut pas remonter, au mieux (vraiment au mieux), au-delà de l’ère Kofun (250-538) ; plus probablement faut-il y voir l’ère Asuka, autrement pertinente ici, qui s'étend de 538 à 710, moment où débute l’ère Nara, avec l’installation dans la nouvelle capitale impériale – l’ère Nara s’achevant quant à elle en 794.
La question est compliquée, notamment parce que l’on rattache clairement Kofun à la protohistoire japonaise, et éventuellement Asuka aussi, mais pour partie seulement – car le rapport à l’écriture est alors problématique au Japon, et, à cette époque justement, les choses évoluent radicalement. Le japonais a longtemps été une langue purement orale – d’où cette longue protohistoire. C’est le modèle offert par le puissant voisin qui va s’avérer déterminant : la littérature japonaise originelle est en fait largement une littérature chinoise. Si une littérature proprement japonaise devait avoir une origine, ce serait, dit-on, avec le Kojiki, remis à l’impératrice Genmei en 712 – nous sommes déjà presque à la toute fin de notre période, à ce compte-là… Mais c’est de toute façon une œuvre hybride entre le japonais et le chinois, d'une lecture au mieux compliquée. En fait, la question se prolongerait encore quelques siècles, puisque la mise en forme d’une langue japonaise écrite distincte de la langue chinoise écrite (rappelons que les deux langues sont on ne peut plus différentes aux plans aussi bien de la grammaire ou de la syntaxe que des intonations, etc.) prendrait encore du temps, avec l’introduction des kana, etc.
Cependant, même avec cette ambiguïté fondamentale, une littérature japonaise se développe progressivement, dès l’époque « archaïque », mais surtout au VIIIe siècle (donc à l’époque de Nara pour l’essentiel) – et c’est une littérature qui est au premier chef poésie, selon des formes empruntées à la Chine mais bientôt adaptées, où le caractère syllabique prononcé de la langue japonaise s’accommode bien de procédés de composition poétique s’attachant au nombre de syllabes (ou de mores, plus exactement), et non à quelque autre aspect tel que la rime. On trouve assez tôt l’alternance classique entre vers de cinq et de sept syllabes, sur des formats plus ou moins longs, plus ou moins rigides. Ces poèmes proprement japonais sont appelés collectivement waka, mais se subdivisent en plusieurs sous-genres, dont les plus importants sont les poèmes courts, ou tanka (ceux qui connaîtront la plus longue prospérité, au point que le mot waka en viendra à terme à désigner les seuls tanka), et les poèmes longs, ou chôka.
En témoigne ce qui constitue probablement le premier vrai monument littéraire japonais, à l’époque de Nara, aux environs de 760 plus précisément (le cas du Kojiki, antérieur, étant donc très particulier – il ne serait véritablement lu que bien plus tard, dans le courant des « études nationales »). Je veux parler du Man.yôshû, ou « Recueil des dix-mille feuilles », qui constitue d’une certaine manière (et en dépit de certaines difficultés, notamment l’emploi selon les cas des caractères chinois pour leur valeur signifiante ou pour leur valeur phonétique), l’acte fondateur de la poésie japonaise classique, en compilant un très grand nombre de poèmes de l’époque archaïque et de celle de Nara – des poèmes par ailleurs très divers, qui pouvaient tenir aussi bien de l’épopée que de l’intime, célébrer l’édification d’un château ou une partie de chasse satisfaisante, aussi bien que déplorer la fin d’une idylle ou la mort d’un enfant, etc. Le Man.yôshû demeurera une référence de base, dûment complétée au fil des siècles par d’autres anthologies présentant un même caractère « officiel » (on parle d’ « anthologies impériales » ; il y avait bien sûr aussi des compilations « privées », et parfois du plus grand intérêt), et notamment, lors de la période suivante, le Kokinshû, qui constitue l’autre modèle éternel du poème classique nippon – peut-être insurpassable ; mais ça, ce sera plus tard, donc…
Pour l’heure, tenons-nous-en au Man.yôshû – car tous les poèmes cités par Gaston Renondeau pour cette première période en proviennent. Et, d’emblée, mon compte rendu comportera un certain biais… En effet, les poèmes longs, ou chôka (constitués d’un nombre variable, car indéterminé, de vers alternant en principe cinq et sept syllabes, pour finir sur deux vers de sept syllabes), sont assez rares dans l’ensemble de cette anthologie – et probablement, en fait, dans l’ensemble de la poésie japonaise ? On en compte quand même quelques-uns, et tout particulièrement aux sources de la pratique poétique nippone. Le Man.yôshû en figure donc un certain nombre, même si les poèmes courts, ou tanka, sont bien plus nombreux (4207 contre 265, je crois que c’est clair… Mentionnons pour mémoire qu’il y avait d’autres types de poèmes dans cette compilation, dont certains en chinois, mais bien plus minoritaires encore de manière générale ; celui qui s'en tire le mieux est le format du sedôka, avec ses six vers, 5-7-7-5-7-7, ce qui le rapproche donc du tanka en termes de longueur, mais il n’y en a que 62 exemples dans tout le Man.yôshû). Les poèmes longs ont dès lors quelque chose d’exceptionnel dans cette anthologie, qui privilégiera ensuite systématiquement les poèmes courts, tanka d’abord, plus loin haïkus (avec l’exception hors-concours des pièces de nô de l’époque Muromachi) – en fait, les chôka « meurent » pendant l’ère Heian… Cependant, dans le contexte particulier de la compilation originelle, ce sont souvent les poèmes qui m’ont le plus parlé, même si à des titres divers. Noter aussi qu’ils datent tous du VIIIe siècle – et tant pis pour la « période archaïque », dont la pertinence ici est décidément un brin douteuse.
Morceaux choisis
Commençons par le « dialogue de deux pauvres » de Yamanoue no Okura (660-733), un diplomate qui s’était rendu en Chine et en avait été fortement imprégnée de pensée confucéenne ; mais il était aussi connu, semble-t-il, pour ses poèmes sur les miséreux et les enfants – en témoigne sans doute le présent poème, qui, au-delà du poignant tableau de la pauvreté, a aussi, j’imagine, quelque chose d’une réflexion éthique (pp. 49-51) :
[Le premier pauvre]
Dans la nuit où la pluie tombe
Mêlée au vent,
Dans la nuit où la neige tombe
Mêlée à la pluie,
Il fait un froid
Contre lequel on ne peut rien.
Je mâche à petits coups
Un morceau de sel dur
Je bois à petites gorgées
De la lie de saké dans l’eau tiède.
Tout en soufflant
Et reniflant
Je caresse une barbe
Rare.
Je puis bien me vanter
Qu’en dehors de moi
Il n’est homme qui vaille…
Mais il fait si froid
Que je tire sur ma tête
Ma couverture de chanvre.
J’y ajoute
Autant que j’en possède
Mes vêtements de toile sans manches.
Mais la nuit est vraiment froide…
De ceux plus pauvres encore
Que je ne suis
Le père et la mère
Sans doute ont faim et se gèlent.
La femme et les enfants
Sans doute gémissent d’une faible voix.
En pareille circonstance
Comment t’y prends-tu
Pour mener ta vie ?
[Le second pauvre]
Le ciel et la terre
Sont vastes, dit-on
Mais pour moi
Comme ils sont étroits !
Le soleil et la lune
Brillent, à ce qu’on assure,
Mais pour moi
Ils ne luisent guère.
En est-il pour tous de même
Ou pour moi seulement ?
Par fortune
Je me trouve homme.
Comme tous les autres hommes
Je suis fait.
Ma veste de toile
Non doublée
Pend en lambeaux
Comme du varech.
Ce ne sont que haillons
Jetés sur mes épaules
Dans ma cabane
Qui penche, croulante,
Le sol nu
Est jonché de la paille tirée d’une botte.
Mon père et ma mère
Dorment près de mon chevet.
Ma femme et mes enfants
À mes pieds
M’entourent
En geignant.
Du foyer
Aucune fumée ne s’élève
Dans la marmite
Les araignées ont tissé leurs toiles.
On a oublié
Comment on fait cuire un repas.
Nous sommes là gémissants
Comme l’oiseau nue
Quand le chef du village
Porteur de sa canne
Jusque dans notre chambre
Vient nous appeler
Pour raccourcir,
Comme on dit,
Un bâton déjà
Trop court.
Est-elle donc à tel point
Sans remède
La vie de ce monde ?
Deux petites précisions, concernant les propos du second pauvre : quand il se dit « homme », il faut entendre par-là le genre humain, pas le sexe masculin, mais avec également une connotation bouddhique liée au cycle des réincarnations – cette condition, supérieure à celle des animaux, se mérite, elle est un privilège. Quant au chef du village qui vient « raccourcir un bâton déjà trop court », il faut entendre par-là qu’il prélève des taxes sur un ménage au revenu déjà insuffisant.
Certains des poèmes longs repris dans cette anthologie ont un contenu mythologique, et éventuellement épique, qui me les a rendus plus appréciables encore dans leur dimension de récits – cela sera parfois toujours le cas dans la poésie ultérieure, mais dans un registre davantage allusif, format court oblige, où par ailleurs l’affectation aura régulièrement sa part (combien de variations sur le Bouvier et la Fileuse ! Mais, là encore, le cas des pièces de nô de l’époque Muromachi est à part). Dans ce registre, j’avoue avoir été séduit notamment par cette évocation anonyme (on sait seulement que l’auteur a vécu au VIIIe siècle) de « la légende d’Urashima » (pp. 69-71) :
Un jour de printemps
Couvert de brume,
À Suminoe
Me promenant sur le rivage
Je regardais les barques de pêche
Qui se balancent sur les flots.
Alors j’ai pensé
À une histoire de jadis.
Le jeune Urashima
De Mizunoe
Était fier de sa pêche
Au thon et à la dorade,
De sept jours
Il ne rentra pas à la maison.
La limite de la mer
Il avait franchie dans sa barque.
Soudain,
Ramant vers lui, vint
La fille
Du dieu de la mer.
Ils s’entretinrent
Et s’éprirent l’un de l’autre.
Ils échangèrent des serments
Et se rendirent au pays de la vie éternelle,
La main dans la main
Ils entrèrent tous les deux
Dans une demeure
Splendide de l’enceinte
Du palais du dieu
De la mer
Sans vieillir
Ni mourir
Un long temps
Il passa,
Mais l’insensé
Étant fils de ce monde
Parla ainsi
À son épouse :
Quelques moments je voudrais
Retourner à la maison,
Prendre des nouvelles
De mon père et de ma mère.
Je reviendrai,
Disons… demain.
Quand il eut parlé
Sa femme dit :
Si dans ce monde de vie éternelle
Tu veux revenir
Et comme maintenant
Vivre avec moi
N’ouvre jamais
Le coffret de toilette que voici.
Il en fit le serment
Et le répéta.
À Suminoe
Revenu
Il chercha sa maison :
Il ne vit plus de maison,
Il chercha son village :
Il ne vit plus de village.
Perplexe,
Il restait là, pensif.
Depuis trois ans seulement
Qu’il avait quitté la maison
Se pouvait-il que jusqu’à la clôture
Elle eût disparu ?
Si, pour voir, j’ouvrais
Ce coffret,
Comme autrefois
La maison ne serait-elle pas là ?
Il entrouvrit
Le précieux coffret de toilette et alors
Un nuage blanc
S’échappa de la boîte
Et se répandit
Jusqu’au pays de la vie éternelle.
Bondissant sur ses pieds
Il cria, agitant ses manches,
Trépigna,
Se roula à terre.
Soudain
Son esprit s’affaiblit,
Sa peau qui était si jeune
Se couvrit de rides,
Ses cheveux qui étaient noirs
Devinrent blancs.
Bientôt
Le souffle lui manqua
Et finalement
La vie le quitta.
Du jeune Urashima
De Mizunoe,
Je vois le lieu de la demeure.
Dans un genre relativement proche, encore que le principe mythologique s’y montre autrement discret, ou en tout cas différemment connoté, j’ai trouvé très poignant cet autre poème anonyme du VIIIe siècle, intitulé ici « En regardant le tombeau de la jeune fille d’Unai » (pp. 72-74) :
Depuis son âge non encore fait
D’enfant de huit ans
Jusqu’au moment où ses cheveux
Furent noués en un flot lâche
La jeune fille d’Unai
À Ashinoya
Resta invisible
Aux gens du voisinage,
Car elle était enfermée
Comme une chrysalide en son cocon.
« Nous voulons la voir ! »
Disaient, irrités,
Ceux qui venus la courtiser
Assiégeaient la maison.
Un garçon de Chinu,
Un autre d’Unai,
Dans une compétition ardente
Comme une hutte en feu
Se lançaient tour à tour
Des défis d’une voix forte.
Mettant la main sur la poignée
De leurs sabres bien affilés,
Portant à l’épaule un arc d’un bois neigeux
Et un carquois
Ils juraient de sauter dans l’eau
Et même dans le feu.
Ils dressaient l’un contre l’autre
Leur rivalité.
Alors la jeune fille
Parla ainsi à sa mère :
Lorsque pour ma personne
Insignifiante comme un méchant bracelet de pierres
Je vois des hommes vaillants
Se disputer,
Même si je vis
Peut-on parler pour moi d’union ?
Je les attendrai
Au pays de la mort, dit-elle
Et soupirant
Dans l’ombre
Ainsi qu’un étang perdu dans la lande
Elle s’en fut de ce monde.
L’homme de Chinu
La vit cette nuit-là en songe
Il la poursuivit
Et la rejoignit dans la mort.
Resté seul,
L’homme d’Unai
Leva les yeux au ciel,
Gémit, rugit,
Il se jeta à terre
Grinçant des dents, poussant des cris
« Par un de mes semblables
Je ne serai jamais vaincu ! »
Et ceignant son poignard
Qu’on accroche à la hanche
Il partit sur les traces de son rival
Comme on cherche l’igname sauvage.
Les familles
Se réunirent
Et voulant laisser un témoignage
Qui durât de longues générations
Pour qu’en des âges lointains
On se transmît cette histoire,
La tombe de la jeune fille
Elles édifièrent au milieu,
Les tombes des deux hommes,
Elles édifièrent
De part et d’autre.
Écoutant cette histoire
Quoique je n’aie point connu ce temps
Comme pour une mort récente
Oh ! Combien j’ai pleuré !
J’apprécie tout particulièrement cette idée du témoignage pour les générations ultérieures : le poète avait-il conscience que son poème remplirait à son tour ce rôle ? On peut en douter… Mais, si lui pleurait devant les trois tombes, nous pouvons quant à nous être émus par son évocation. C’est peut-être ironique – ou plus probablement grandiose : d’une certaine manière, la substance d’une poésie demeurant en dépit de l’impermanence du monde – comme un rempart, peut-être.
Un dernier exemple, un peu plus court (néanmoins toujours un chôka), où un anonyme du VIIIe siècle, à nouveau, œuvre dans un registre plus abstrait d’une certaine manière, en décrivant le cadavre d’un homme noyé (pp. 82-83) :
Dans la mer où l’on entend
Les cris des oiseaux
À distance
Des hautes montagnes,
Ayant pris pour oreiller
Les algues du large,
Sans porter fût-ce un vêtement
Fin comme des ailes de mouche luisante,
Sur la grève marine
Où l’on prend le poisson,
Cet homme a passé la nuit là,
Sans conscience.
N’était-il pas un enfant chéri
Par sa mère et par son père ?
N’avait-il pas une femme
Tendre comme une jeune herbe ?
Transmettrai-je pour vous
Des paroles d’affection ?
Mais on a beau lui demander sa maison
Il ne dit pas sa maison.
On a beau lui demander son nom
Il ne dit même pas son nom.
Tel le petit enfant geignard
Il ne sait prononcer une parole.
Quoi que l’on en pense
Il y a de lamentables choses
En ce monde.
Oui, moi aussi, la conclusion me laisse sans doute un peu perplexe… Je préfère en retenir ce qui précède, et qui, à tort ou à raison, m’a évoqué quelque lointain ancêtre du « Dormeur du val », peut-être, avec son oreiller d’algues…
LA PÉRIODE DE HEIAN : L’ÂGE D’OR DU TANKA ET LE KOKINSHÛ
Présentation
On en arrive alors à la période Heian, soit de la fin du VIIIe siècle à la fin du XIIe siècle – une période que l’on présente souvent, mais peut-être un peu trop hâtivement (car il y a un sous-texte plus ou moins conscient à ce discours), comme constituant « l’âge d’or » du Japon : sa propre incarnation de l’Antiquité. Un Japon complexe, certes, où le modèle chinois et les aspirations qu’il serait sans doute encore trop tôt pour qualifier de « nationales » cohabitent dans un creuset culturel propice au développement de la littérature jusque dans ses formes les plus sophistiquées.
En tout cas, dans le cadre de cette Anthologie de la poésie japonaise classique, en changeant de période, on change de format – et peut-être de manière un peu artificielle ? Globalement, en histoire, les époques de Nara et de Heian peuvent être envisagées comme formant un tout, que le seul changement de capitale, finalement, n’affecte guère. Ce passage d’une ère à l’autre, si l’on y tient, a-t-il eu un impact réel sur la poésie ? En dehors du fait que l’on passe en même temps du Man.yôshû originel à, pour l’essentiel, une deuxième compilation de grand renom, le Kokinshû (dont sont extraits la quasi-totalité des poèmes que je vais maintenant citer), on est en droit de se poser la question… Même si une évolution notable paraît pouvoir être observée de manière objective : l’abandon, assez vite, du chôka, pour privilégier le seul tanka.
La sélection de Gaston Renondeau l’affiche nettement : en effet, tous les poèmes que je vais citer ici (et donc la plupart, sinon tous, des très nombreux poèmes compilés pour cette période) sont à vue de nez des tanka ; comme tels, ils adoptent la structure classique, concernant l’alternance du nombre de syllabes, 5-7-5-7-7 – et les autres formes de poésie, chôka en tête, semblent dès lors reléguées au passé ; et même au passé le plus lointain.
Morceaux choisis
Ceci étant, ces tanka, dont c’est « l’âge d’or », sont très divers. Je commence avec cet anonyme de l’époque Heian (p. 111) :
Plus encore
Que sur l’eau qui court
Écrire des chiffres,
Chose vaine est d’aimer
Celle qui ne vous aime.
La littérature de Heian était souvent l’affaire de femmes – Murasaki Shikibu (c. 973-c. 1014 ou 1025) est sans doute la plus célèbre, avec son monumental roman qu’est Le Dit du Genji, mais elle a aussi écrit de la poésie (nous en avons quelques exemples dans cette anthologie même) ; d’autres s’y sont appliquées, éventuellement dans le cadre de leurs « journaux » (j’y reviens de suite), comme Izumi Shikibu (née vers 970) ou encore Sei Shônagon (c. 965- ap. 1013), et on pourrait sans doute en citer bien d’autres, de bien des manières ; mais dame Ise (875-938), qui bénéficie en outre de l'antériorité, est peut-être considérée comme la plus importante dans l’art spécifiquement poétique. En voici une pièce (p. 136) :
Pas même en rêve
Je ne veux être vue de lui.
Car chaque matin
En regardant mon visage flétri
J’ai honte de moi-même.
Une autre célébrité, maintenant – un homme cette fois : Ki no Tsurayuki (c. 872-c. 945). Un personnage assez fascinant… Outre de très nombreux poèmes comme celui qui va suivre, on lui doit notamment une préface au Kokinshû, dont il fut le principal compilateur (et où l’on trouve donc ce poème), préface qui, fait semble-t-il jusqu’alors inédit, constituait un essai de théorie poétique remarquable, aussi sensible que pointu. Mais je note qu’il fut aussi l’auteur du Journal de Tosa, lu dans Mille Ans de littérature japonaise, excellente anthologie : le genre du journal (nikki) était alors naissant – en fait, le Journal de Tosa en est le plus vieil exemple dont on dispose. Pourtant, il semblerait qu’à l’époque, déjà, il ait été considéré comme une pratique réservée aux femmes, surtout parce qu’on y associait l’usage des kana encore très récents (les hommes lettrés se devaient d’écrire en kanbun, le « chinois littéraire » qu’ils prisaient par-dessus tout) – aussi l’avait-il écrit en tant que femme, et en se figurant lui-même, en tant qu'homme, comme un personnage extérieur, désigné à la troisième personne… Ce qui contribuait au passage à flouter les frontières entre ce genre et la fiction, mais aussi, donc, à orienter la littérature japonaise postérieure dans une voie lui permettant de s’émanciper de l’étouffant modèle chinois. C’était un texte étonnamment émouvant, par ailleurs… Mais voici donc un échantillon de sa poésie (p. 143) :
Fleurs de cerisier
Qui ne connaissez le printemps
Que depuis cette année,
Puissiez-vous ne jamais apprendre
Qu’un jour vous devrez tomber.
Bien sûr, les grands artistes ont leur disciples – qui rivalisent avec eux, le cas échéant. Mibu no Tadamine (c. 860-c. 920), bien qu’un peu plus âgé, fut un disciple de Ki no Tsurayuki, et participa avec lui à la compilation du Kokinshû. On y trouve les trois poèmes qui suivent (p. 145) :
Les herbes flottantes
Sans racines ne peuvent s’arrêter
Dans les remous d’une cascade.
De même mon cœur flotte
Sans trouver à se fixer.
***
Depuis notre séparation
Où elle me montra un visage
Froid comme la lune à l’aube,
Rien ne me semble aussi triste
Que le petit matin.
***
Le vent d’automne
Vibre comme une harpe
Dont le seul écho
Sans raison avive
Ma passion pour l’aimée.
Maintenant, un poème de Kiyohara no Fukayabu (dates inconnues, première moitié du Xe siècle), par ailleurs l’arrière-grand-père de Sei Shônagon (p. 148) :
Qui donc à l’amour
A pu donner
Son nom ?
Il aurait dû l’appeler
Tout simplement mourir.
Oui, ils sont nombreux, ces tristes poèmes amoureux… Même s’il ne faut sans doute pas s’y méprendre : déjà, il y a bien d’autres thèmes que l’amour dans les poèmes rassemblés par Gaston Renondeau pour la période – ensuite, quand c’est bien de l’amour qu’il s’agit, il n’est pas systématiquement si triste, et le badinage peut aussi être de la partie. En fait, ce sont là des aspects que j’avais pu mentionner à la hâte (et avec plus ou moins de compétence, oui…) quand j’avais lu les Contes d’Ise (traduits également par notre général Renondeau – le nom d’Ise, ici, ne renvoie pas à la poétesse : on attribue l’essentiel de ces poèmes à un homme, son « héros » en fait, Ariwara no Narihira, 825-880, dont des œuvres sont bien sûr citées ici), ou encore Le Dit de Heichû, de manière peut-être plus explicite, car le ton y est d’emblée plus cocasse. Une fois de plus, cet article est une sélection au sein d’une sélection… Et il faut croire que ces amours tristes me parlent plus que tant d’odes à l’automne, figurant coucous et lespédèzes – c’est tout, on ne peut rien en conclure d’autre. Notez, nos poètes mouillent plus qu’à leur tour leurs manches dans la plupart des cas…
Mais, pour le coup, je vais conclure cette section avec trois poèmes passablement dépressifs, en dehors de tout contexte amoureux explicite – histoire de ! Commençons dans la joie avec Minamoto no Muneyuki, mort en 983 (p. 149) :
Dans le village de montagne
La solitude de l’hiver
Semble encore plus triste
Quand on songe que se sont évanouies, fanées,
Les figures humaines comme les plantes.
Continuons dans la joie avec « l’archevêque » Gyôson (1055-1135), qui aperçoit ici un arbre alors qu’il effectue une retraite ; notons au passage que nous délaissons enfin le Kokinshû, que nous avons longuement suivi – le présent poème est extrait d’une autre compilation, postérieure et moins renommée (p. 168) :
Ô, cerisier de montagne
Prenons-nous en pitié
L’un l’autre,
En dehors de tes fleurs
Je ne connais personne.
Et concluons (la période) dans la joie avec Fujiwara no Atsuyori, le moine Dôin (1090-c. 1182)
Mes pensées sont tristes,
A la vérité
Ma vie se prolonge
Mais je ne supporte pas ses misères
Et mes pleurs coulent.
LA PÉRIODE DE KAMAKURA : LA DÉCADENCE DE LA POÉSIE ?
Présentation
La période suivante est celle de Kamakura, qui s’étend de la fin du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle. Si les deux périodes antérieures ont été abondamment traitées, fourmillant de nombreux extraits, au point d’occuper les deux tiers du recueil environ, ce foisonnement n’est plus du tout de mise pour toutes les périodes qui suivent, quelles qu’en soient les raisons.
Précisons tout de même qu’il faut ici se méfier de ses préconçus (et je vous renvoie notamment à l’Histoire du Japon médiéval : le monde à l’envers, de Pierre-François Souyri) : le « Moyen Âge » japonais (et en cela est-il si différent de l’européen ?) n’est pas la « période sombre » que l’on a longtemps voulu, par artifice intéressé, opposer à la supposée gloire antique de Heian et à son éventuelle « Renaissance » ultérieure lors de l’époque Edo – simplement, il a une culture qui lui est propre, celle des bushi, qui génère des formes nouvelles tandis que, peut-être, la poésie, sur un modèle très conservateur, tend pour un temps du moins à devenir le loisir un peu badin d’une aristocratie impériale plus guère à la page et qui se contente de répéter inlassablement les mêmes codes…
En fait, la période suivante témoignera avec éclat de ces formes nouvelles associées au Moyen Âge japonais, avec le nô de Zeami ; mais, pour la période qui nous intéresse ici, les grandes œuvres ne manquent pas non plus – au-delà des seules chroniques historico-guerrières telles que Le Dit des Heiké, pensez par exemple aux fabuleuses Notes de ma cabane de moine de Kamo no Chômei (également poète, et cité ici dans ce registre).
Mais le regard porté sur la poésie de Kamakura demeure assez peu enthousiaste, ici. On a l’impression, vraie ou fausse, d’une certaine « décadence » de l’art poétique, en dépit de réussites marquées occasionnelles. Impression renforcée par le nombre plus que limité des textes cités… Mais ce processus remontait sans doute déjà à Heian, et il est complexe à appréhender. Je suppose qu’un exemple l’éclaircira un tant soit peu, dès le premier poème de cette période que je citerai.
Mais nous pouvons donc constater que nous n’avons, dans cette Anthologie de la poésie japonaise classique, qu’un très, très bref aperçu de la poésie de Kamakura, et je suppose qu’il y a là comme un biais, donc – alors même que, au regard des dates de vie et de mort de nos auteurs, la scission avec l’époque Heian n’est peut-être pas si franche en matière d’arts et lettres qu’elle l’a été sur le plan politique.
Citons-en tout de même quelques exemples…
Morceaux choisis
Je commence avec Fujiwara no Ariie (1155-1216), dont je vais citer deux tanka ; le premier (p. 182) est titré ici « Hiver », et certes le jeu d’évocation des saisons est une pratique courante de la poésie japonaise (de manière plus marquée encore dans les haïkus, où cela deviendra un procédé de composition en tant que tel, autant qu’un thème – mais nous n’en sommes pas encore là) :
Regrettant l’année qui passe,
Les pêcheurs d’Ojima
À l’eau qui trempe leurs vêtements
Ajoutent les larmes
Qui tombent sur leurs manches.
Ce poème me plait bien, sans quoi il ne serait pas ici, mais je suppose qu’il est l’occasion de faire une remarque d’ordre plus global, éclairant peut-être mes propos introductifs de cette section. En effet, il y a ici un jeu de mots sur le nom de l’île, Ojima ou Oshima (shima signifie « île »), et le verbe oshimu, qui signifie « regretter » – le genre de jeu de mots que l’on retrouve très, très souvent dans ces poèmes classiques. En fait, ce jeu de mots précisément se retrouve dans d’autres poèmes, plus loin dans l’anthologie, et je ne suis vraiment pas certain que Fujiwara no Ariie ait été le premier à en faire usage… La valeur poétique demeure, dans le cas présent – mais tous ceux qui usent de ce même jeu de mots ne brillent pas autant.
Et là, pour le coup, c’est probablement le signe, effectivement, d’une certaine « décadence » du genre poétique, dont les prémices remontent peut-être à Heian, et liée à l’affectation des poètes de cour – tout particulièrement de ceux que nous appellerions des « poètes du dimanche », et ils sont nombreux : certains d’entre eux reprennent sans cesse, comme par automatisme, les mêmes jeux de mots mille fois employés, ou, dans un registre assez proche, des épithètes poétiques (on serait tenté de dire « homériques ») devenues elles aussi autant de clichés, mais qui suffisent à occuper un ou deux vers – dans des tanka (ou, pire encore, des haïkus, plus tard – les générations ultérieures ne seront pas forcément épargnées par ce travers…), cela peut occuper jusqu’à deux vers, n’en laissant plus que trois pour que notre poète se montre un peu plus « inventif », voire « personnel »… Toujours ça de gagné, hein ? Mais, dans le cas du présent tanka, cela me paraît fonctionner – la répétition ultérieure du même procédé produira un effet tout autre…
Citons un deuxième poème de notre auteur – où l’amour triste a des accents de dépit voire de colère (p. 182 également) :
Je ne t’oublierai pas !
M’avait-elle assuré
En me disant adieu, pourtant
Depuis cette nuit-là, seule la lune,
Suivant son cours, est revenue.
Je passe maintenant à Minamoto no Sanetomo (1192-1219), qui ne fut pas que poète, mais aussi le troisième shôgun de Kamakura. Il est mort jeune, comme vous pouvez le constater – assassiné… En fait, politiquement, il n’a de toute façon guère brillé : titulaire de la charge du bakufu, il n’a guère été qu’une marionnette, notamment vis-à-vis des régents Hôjô complotant dans l’ombre… Mais il a par contre brillé en tant que poète, et a été très tôt reconnu à cet égard. J’en citerai deux œuvres, dont la première n’évoque certes pas le gouvernement militaire qu’il était censé exercer (p. 184) :
Quelle pitié !
À sa vue les larmes
Roulent sans fin :
Cet enfant qui n’a plus de parents
Cherchant en vain sa mère…
Je suppose que ce deuxième poème a un caractère allégorique (pp. 184-185) :
Oh ! Ces vagues mugissantes
Qui du large déferlent
Sur la grève
Dans un tumulte de déchirures, de cassures,
Et d’éclaboussures !
Mais on considère généralement que le plus grand poète de cette ère turbulente fut Fujiwara no Sadaie, plus connu sous le nom de Teika (1162-1241). Il avait d’ailleurs lui aussi œuvré en tant que compilateur, comme certains de ses illustres prédécesseurs. En voici deux échantillons, dont le premier développe le jeu sur les saisons précédemment mentionné (p. 191) :
Je promène mes regards :
Les fleurs, les feuilles rouges aussi,
Ont disparu.
C’est un soir d’automne
Dans ma hutte du bord de mer.
Deuxième poème, et retour à l’amour triste (p. 191 également) :
Même si tu prends un autre oreiller
Pour reposer ta tête
Garde-toi bien d’oublier
Le souvenir du clair de lune
Qui tombait sur cette manche trempée de nos larmes.
Ah, ces manches trempées ! Tiens, ça sonnerait presque comme une épithète poétique, ça… Non ? Bon, qu’importe. Nous en avons déjà fini avec Kamakura…
LA PÉRIODE DE MUROMACHI : LA GLOIRE DU NÔ DE ZEAMI
Présentation
Et nous en arrivons donc à la période de Muromachi, de la fin du XIVe siècle à la fin du XVIe siècle – du moins est-ce ainsi que la délimite Gaston Renondeau ; en fait, la périodisation est ici un peu confuse, car on distingue souvent la fin de cette période, particulièrement agitée, sous d’autres noms, comme Sengoku, qui appuie sur le chaos de la guerre civile, ou Azuchi Momoyama, qui met l’accent sur les chefs de guerre Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi, et avec des dates limites plus ou moins indécises… jusqu’à ce que Tokugawa Ieyasu vienne trancher cette indécision, bien sûr.
Mais, surtout, dans le cadre de cette anthologie de la poésie japonaise classique, on change radicalement de format – et cette fois de manière franchement artificielle, je suppose. En effet, pour l’ensemble de la période, Gaston Renondeau n’a pas sélectionné des poèmes à proprement parler, mais a puisé, et uniquement, dans le pan de la littérature où cette ère a particulièrement brillé : le théâtre nô, et tout spécialement les pièces de Zeami (1363-1443), le grand maître du genre – au point en fait où sa parfaite maîtrise a quelque peu étouffé toute tentative de création, sans même parler d’innovation, dans ce registre après lui… Les pièces de nô comprenaient des passages en prose et d’autres versifiés, destinés à être chantés – comme, plus tard, le jôruri où brillera Chikamatsu Monzaemon (1653-1725), voyez par exemple mon retour sur le premier tome de ses Tragédies bourgeoises. Et c’est dans ces passages en vers que l’anthologiste (connu pour avoir été un grand amateur et traducteur de nô) a puisé ses exemples de la poésie de Muromachi (ce qu’il ne fera pas pour Chikamatsu lors de l’époque Edo…) – et uniquement dans ces pièces : nous ne sommes donc pas en présence de poèmes présentés comme tels. Et la mainmise étouffante de Zeami est ici manifeste : des sept pièces dont Gaston Renondeau cite des extraits, cinq sont assurément de sa plume, et très probablement une autre encore !
Forcément, le rapport au contexte n’est pas du tout le même que dans mes citations précédentes : il y a une histoire à rappeler au préalable… L’anthologiste livre donc des explications en tête de ces extraits, que je vais synthétiser à mon tour, avant de citer des passages versifiés.
Morceaux choisis
Je vais retenir ici deux nôs, tous deux signés par le maître Zeami. Outre leur auteur, ces deux pièces ont aussi en commun de faire référence à des événements historiques, figurant notamment dans Le Dit des Heiké ; c’est loin d’être systématiquement le cas, mais pour le coup ce sont ces extraits qui m’ont le plus parlé à titre personnel ; d’autant peut-être que les connotations religieuses, couramment associées au nô et notamment aux passages, peu ou prou obligés pour ce que je crois en savoir, où des fantômes font leur apparition, ces connotations donc sont peut-être un peu moins appuyées ? En fait, probablement pas, dans le second extrait du moins… Tant pis !
Nous commencerons par Kagekiyo ; avec un double extrait, en fait – et la bascule entre les deux moments n’est sans doute pas pour rien dans mon ressenti… Kagekiyo était un guerrier du clan des Taira (ou Heiké), vaincu par les Minamoto (ou Genji) dans la grande guerre qui, à la fin du XIIe siècle, a provoqué le changement d’ère et assuré la domination du pays aux bushi – événements narrés dans le « cycle épique des Taira et des Minamoto », dont le point culminant est donc Le Dit des Heiké. Suite à la défaite de son camps, Kagekiyo est exilé en Kyûshû, où il se mue en un pauvre vieillard aveugle et débile… Une fille qu’il avait eue d’une courtisane, et de longue date oubliée, se rend auprès de lui. Honteux de sa situation, le vieux guerrier accepte enfin de faire le récit de ses exploits à la bataille de Yashima (même si les Taira y ont été défaits), à la condition toutefois que la jeune femme partira ensuite pour le laisser seul dans sa lamentable et dégradante misère.
Dans ce premier extrait, Kagekiyo revient donc sur le grand guerrier qu’il était, au sommet de sa gloire (pp. 207-208) :
Dans les barques du clan
Épaule contre épaule, genou contre genou,
Se pressent [les guerriers]. Rayonnant de gloire
Kagekiyo, plus qu’aucun autre,
Dans la barque impériale, est indispensable.
Au-dessous de lui les guerriers
Sont nombreux et fameux.
Mais grande est sa renommée, que la barque en voguant porte au loin.
De son maître la faveur est constante,
Par tous il est envié…
En apercevant ses ennemis, il s’écrie :
« Quels présomptueux ! » et aux rayons du soleil couchant
Il brandit son sabre.
Dès qu’il se met à tailler, sans pouvoir résister,
Ses adversaires devant sa lame
S’enfuient de tous côtés.
« Ils ne m’échapperont pas ! »
« Quels lâches vous êtes tous !
Aux yeux des Taira comme des Minamoto, quelle honte ! »
En arrêter un est chose aisée, pense-t-il,
Et mettant son sabre sous son bras :
« Je suis Kagekiyo Shichibyôe le Mauvais,
Samurai des Taira ! » Ainsi se nomme-t-il
Et il s’élance pour en saisir un.
Mihonoya était venu :
Kagekiyo veut prendre le couvre-nuque de son casque,
Qui glisse, glisse de ses doigts.
Deux ou trois fois Mihonoya s’enfuit ; pourtant,
Puisque c’est l’adversaire qu’il a choisi, il ne le laissera pas échapper.
Il bondit, empoigne le casque :
Eiya ! Et comme il le tire [à lui],
Le couvre-nuque se déchire et reste dans sa main.
Son possesseur s’est enfui plus loin,
Il prend de la distance, puis se retournant :
« Tout de même, elle est terrible,
La force de tes bras ! » s’écrie-t-il.
À quoi Kagekiyo : « Ce sont les os de ton cou
Mihonoya, qui sont durs ! »
Et en riant ils s’éloignent l’un de l’autre.
Plus loin dans la pièce, quand il s’agit de la conclure en fait, le père et la fille se font leurs adieux – à jamais ; épisode horriblement poignant (pp. 208-209) :
Cette histoire évoque mon passé.
[Le corps] en décrépitude, l’esprit lui-même
Obscurci, quelle honte !
Ce monde après tout ne me causera plus longtemps
Ses souffrances : ma fin est proche.
Hâte-toi de t’en retourner. Quand je n’y serai plus
Pour mon âme donne ta prière afin que l’aveugle
Dans les ténèbres soit guidé par sa lumière,
Et dans les chemins difficiles trouve un secours.
« Adieu, je reste » dit-il, et elle : « Je pars. »
Ces seuls mots dits d’une seule voix,
Tel est le dernier souvenir que le père et la fille se sont laissé.
Je passe maintenant à une autre pièce de nô de Zeami, intitulée Kiyotsune. Nous retournons aux derniers temps de la guerre entre les Taira et les Minamoto, quand un des chefs Taira, Kiyotsune, conscient que la bataille est perdue et qu’il n’échappera pas à ses ennemis, fait le choix de se suicider (il n’est certes pas le seul dans ce cas, je vous renvoie, outre les chroniques du « cycle épique des Taira et des Minamoto » en elles-mêmes, à ce qu’a pu en dire Maurice Pinguet dans La Mort volontaire au Japon) – en conséquence, il est précipité dans cet enfer où les guerriers sont condamnés à livrer combat inlassablement, mais sa foi en le bouddha Amida, croit-il, l’en sortira un jour… Seulement, d’ici-là, Kiyotsune laisse derrière lui une épouse dévastée, et qui déduit du geste de son mari la fausseté de ses protestations d’amour, puisqu’il l’a tant fait souffrir de par son choix égoïste… Une nuit, l’esprit du défunt la visite en rêve – et l’apparition tourne bientôt à la querelle domestique (pp. 210-211) :
Ô surprise ! Celui qui m’apparaît pendant que je me suis assoupie
Est bien Kiyotsune…
Mais puisqu’il est certain qu’il s’est noyé
Comment pourrais-je le voir si je ne rêvais pas ?
Même si je rêve puisque vous daignez
M’apparaître, soyez remercié.
Pourtant, puisque sans attendre le terme naturel de votre vie
Vous vous êtes noyé, m’abandonnant,
Vos serments de jadis étaient des mensonges !
Aussi n’ai-je pour vous que de la haine !
Plus tard, l’échange s’apaise, cependant, et, à la demande de sa veuve, le fantôme de Kiyotsune lui fait le récit désolant de ses derniers instants (pp. 211-212) :
Or donc
Le buddha, les dieux, les trois Joyaux
Nous abandonnent, pensé-je le cœur serré.
Chez tous les hommes du clan
L’esprit est en déroute, le courage abattu,
Les forces évanouies, la volonté brisée.
Ils accompagnent ainsi Sa Majesté qui s’en retourne.
Spectacle pitoyable.
C’est dans un tel moment
Que j’appris que l’ennemi se portait sur le Nagato.
Alors, prenant une barque, je m’éloignais de la rive, sans but,
Le cœur plein d’une grande tristesse.
Il est vrai que les vicissitudes de ce monde
Ne sont que rêves après rêves.
Comme les fleurs du printemps de Hôgen, les feuilles rouges des érables de l’automne de Juei
Se sont dispersées et flottent sur la mer.
La barque solitaire
Par le vent d’automne qui souffle du Rivage des Saules
Est poussée vers le large
Comme par l’ennemi vainqueur.
Ce rassemblement des hérons dans les pins…
Ne seraient-ce pas les étendards des innombrables Minamoto qui ondulent au vent ?
À cette pensée mon courage m’abandonne.
Oh ! Misère !
Après tout, ce corps éphémère comme la rosée doit disparaître,
Figure passagère emportée par les vagues comme une herbe flottante
Ou dérivant à l’aventure dans une barque.
Pour ne plus souffrir d’une détresse au terme inconnu
Je décide d’en finir en me jetant dans la mer.
Sans rien dire – « Il y a des pins à Iwashiro… » – je montai sur l’avant
Et sortis de ma ceinture une flûte.
Je jouai un air pur, je chantai un imayô, composai un rôei.
Passé, avenir, apparurent à mes yeux ; tôt ou tard il faudrait finir sous la vague légère
Le passé ne revient pas. Point ne s’arrête le temps ; ma volonté est brisée.
Je ne veux voir dans cette vie qu’un voyage
Qui ne doit pas laisser un regret.
Aux yeux du monde, j’aurai été un dément, diront les uns ;
Les autres resteront indifférents.
Je regardai la lune qui dans la nuit descendait vers l’Ouest, Allons ! Je l’accompagnerai !
Adoration au buddha Amida ! Ô Tathâgata Amida !
Daigne venir à ma rencontre !
Et sur cette dernière imploration,
De la barque je me jetai dans le flot qui se retirait.
Ô tristesse !
Mon corps misérable s’enfonça parmi les épaves du fond de la mer.
Notes explicatives : « Hôgen » désigne une ère, ou plus exactement le coup d’État qui la singularise, et qui a précipité la lutte armée entre les Taira et les Minamoto, affaire narrée dans Le Dit de Hôgen. « Juei » désigne également une très brève ère (1182-1184), celle où se déroule l’action et qui augure du pire pour les Taira. L’incise mentionnant Iwashiro comprend un jeu de mots un peu gratuit (voir plus haut) sur matsu, qui signifie à la fois « pin » et « attendre » ; qu’il s’agisse d’une vraie béquille ou d’ironie, maintenant… Quant à imayô et rôei, ces deux termes désignent des sortes de poèmes chantés, mais les uns de style japonais et les autres de style chinois – l’occasion, peut-être, de noter que tout un pan de la poésie japonaise n’est pas évoqué ici, et Gaston Renondeau lui-même l’admet : les productions les plus populaires, sous forme de chansons le cas échant.
Quoi qu’il en soit, nous en avons fini avec Muromachi – ne reste plus qu’une ère, couramment appelée Edo, mais que Gaston Renondeau préfère appeler ici « période des Tokugawa ».
LA PÉRIODE DES TOKUGAWA : LE RÈGNE DU HAÏKU
Présentation
C’est l’ultime période « classique » (ou « prémoderne ») ; elle débute en 1603, avec l’établissement du nouveau shôgunat par Tokugawa Ieyasu, et s’achèvera avec la Rénovation de Meiji, en 1868.
Une fois de plus, Gaston Renondeau opère un changement de format drastique : si la période Muromachi, avec les nôs de Zeami, nous avait ramenés à des textes relativement longs, nous revenons maintenant à des textes courts, et même plus courts que jamais, puisque l’intégralité, sauf erreur, des poèmes cités pour cette période sont des haïkus – généralement ce que l’on met en avant dans la poésie japonaise, comme étant son expression la plus singulière et la plus pure.
Les haïkus (ou hokku, ou haikai) sont des poèmes composés de trois vers faisant cinq, sept et cinq syllabes. Ils sont en fait dérivés des poèmes courts classiques, les tanka, dont ils constituent la première partie, les trois premiers vers, donc – en reste deux (de sept syllabes chacun), que, dans le cadre du renga, jeu poétique collectif, un poète pouvait être amené à composer dans un souci d’enchaînement des haïkus à proprement parler ; mais le haïku a ensuite gagné son autonomie.
Cependant, au-delà de cet aspect purement formel, le haïku se distingue aussi par ses thèmes (même si l’on retrouve des grands classiques de la poésie nippone, et tout particulièrement l’évocation des saisons, souvent avec des « mots-clefs », ou encore l’idée de l’éphémère, très à propos dans ces œuvres si brèves) et peut-être plus encore par son ton – qui, originellement du moins, se veut léger, voire humoristique, et, le cas échéant, vulgaire. Il y a bien cet aspect d’ « illumination » que l’on associe un peu facilement au haïku, plus ou moins bien compris, en Occident, cette confrontation de l’instant et de l’infini notamment, mais aussi beaucoup d’autres choses ; c'est fou ce qu'il peut y avoir dans ces toutes petites choses, en fait.
Dit-on.
Car, ne nous voilons pas la face : je ne suis certes pas le mieux placé pour en parler... En fait, disons-le, cette anthologie, qui m’avait beaucoup séduit jusqu’ici, m’a nettement moins parlé dès lors qu’elle s’est consacrée au haïku. C’est que je n’y comprends pas grand-chose, et même probablement rien… Et que cela ne touche pas davantage ma sensibilité, ce qui est probablement plus gênant encore. L’intérêt du haïku, trop souvent, me dépasse – sa candeur affichée, notamment, me laisse perplexe. Je n’en sais pas la raison – peut-être les deux vers manquants du tanka me donnent-ils une impression de manque… Je ne sais pas.
J’y travaille – j’ai accompagné l’achat de la présente Anthologie de la poésie japonaise classique d’un autre recueil, dans la même collection, Haïku : anthologie du poème court japonais, ainsi que d’un volume comprenant l’intégralité des haïkus du « seigneur » Bashô (en bilingue, la bonne idée) – on verra si, à force, mon goût se développe…
En fait, ça n’est pas exclu : je suppose que le haïku, comme beaucoup de choses finalement, demande à être apprivoisé. Si j’osais la métaphore, mais pourquoi pas après tout, je dirais que j’envisage la question un peu à la manière des strips de Peanuts, la génialissime BD de Charles M. Schulz – un format proche, si ça se trouve… Pendant des années, je n’ai rien compris à ce qui faisait l’intérêt des mésaventures de Charlie Brown, Snoopy et compagnie – et puis, à force de tentatives, le satori est venu ! Aujourd’hui, je me régale à la lecture de ce monument… Ce que je ne comprends plus, c’est comment j’ai pu y être aussi hermétique pendant si longtemps ! Alors, les haïkus… Peut-être. Un jour. Beau.
De toute façon, dans le cadre de cet article, il va quand même me falloir en citer – quelques-uns… Ceux, çà et là, qui m’ont vaguement évoqué quelque chose, en dépit de mon absence totale ou presque de goût pour le procédé, ce qui ne me facilite certes pas le tri… Notez, je n’étais sans doute guère plus compétent jusqu’alors. Mais là, à ce stade…
Morceaux choisis
À tout seigneur, tout honneur, commençons donc avec ce satané Bashô (1644-1694), considéré comme le grand maître du haïku – et comme la figure centrale de la poésie d’Edo, le grand poète de ce temps, quand son grand romancier était Saikaku (1642-1693 – il avait été haïkiste, par ailleurs, et prolifique, avant de révolutionner la fiction), et son grand dramaturge Chikamatsu (1653-1725). Bashô… Je m’y suis frotté à plusieurs reprises – par exemple à travers le recueil à son nom Cent Onze Haiku, ou encore dans l’excellente anthologie composée par Nakamura Ryôji et René de Ceccatty, Mille Ans de littérature japonaise (qui l’abordait toutefois de manière relativement indirecte). Mais sans succès… Il faudra bien, pourtant ! Et je vais à terme creuser la question, avec cette intégrale que je viens d’évoquer. D’ici-là, voici sept haïkus de Bashô, parmi les nombreux à être cités dans ce recueil, qui ne m’ont pas laissé totalement indifférent, quoi (pp. 220-224) :
Elles vont bientôt mourir
Les cigales ; on ne s’en douterait pas
Lorsqu’on les écoute.
***
À ma lampe,
Plus d’huile, je me suis couché. Dans la nuit
La lune entre par la fenêtre.
***
Détesté d’ordinaire,
Que le corbeau lui-même
Est beau les matins de neige !
***
Il mange les serpents,
M’a-t-on dit du faisan. Terrible
Me paraît maintenant son cri.
***
Si réjouissant au départ
Comme il est bientôt triste
Le bateau aux cormorans !
Ici, j’imagine qu’une petite explication s’impose : les pêcheurs font plonger les cormorans, et ce sont les oiseaux qui attrapent les poissons ; mais, systématiquement, les hommes soustraient leurs proies aux cormorans. Le spectacle ravit d’abord le poète, par son pittoresque peut-être, mais la prise de conscience, progressive, de ce qui se produit réellement, l’amène enfin à envisager la scène avec mélancolie sinon écœurement…
Encore deux !
De temps en temps les nuages
Nous reposent
De tant regarder la lune.
***
Tombé malade en voyage
Mes rêves errent
Sur une plaine dénudée.
Bashô, dans l’optique de cette anthologie, est vraiment le maître du haïku ; nul autre n’est autant cité. Bien d’autres poètes sans doute sont envisagés, et pas des moindres « objectivement », j’imagine (par exemple, Buson, 1716-1783, ou Issa, 1763-1828), mais ils ne produisent pas le même effet – sur moi en tout cas : à tout prendre, ils m’ont encore moins parlé que Bashô…
Je vais quand même citer trois autres haïkus, dus à trois auteurs différents. Tout d’abord, ceci, signé Enomoto Kikaku (1661-1707 ; p. 230) :
Sur mon chapeau
La neige me paraît légère
Car elle est mienne.
Ensuite, ceci, par Morikawa Kyoroku (1656-1715 ; p. 237) :
Dans la chambre d’un daimyô
J’ai dormi, mais là aussi
Il faisait froid.
Sauf erreur, les deux précédents poètes faisaient partie du cercle de Bashô. Ce n’est pas le cas pour le dernier que je vais citer, plus tardif : le moine Ryôkan (1758-1831). Un dernier pour la route, oui… et peut-être, de tous ces haïkus, celui qui m’évoque le plus quelque chose, même vaguement ; et sans doute le connaissais-je déjà, vous aussi probablement (p. 253) :
Le voleur
M’a tout emporté, sauf
La lune qui était à ma fenêtre.
C’est l’ultime poème cité par Gaston Renondeau dans cette anthologie, et je me dis que ce n’est peut-être pas un hasard.
POUÈTES POUÈTES !
Cette incompréhension radicale du haïku mise à part, j’ai pris beaucoup de plaisir à lire cette Anthologie de la poésie japonaise classique – le genre d’ouvrage que l’on a envie de partager, d'où ces abondantes citations… Je suppose pourtant que ça n'était pas gagné. Mais, intéressé tout de même à la base par la poésie de Nara et de Heian, qui a ici comblé mes attentes, j’ai également apprécié d’avoir d’autres aperçus de l’art poétique japonais, ainsi (ce n'était pas du tout prévu) que du nô : les extraits de La Margelle du puits, de Zeami, dans Mille Ans de littérature japonaise, m’avaient fait un peu peur, mais ce que l’on trouve ici me parle bien davantage, et il me faudra peut-être fouiller un peu dans tout ça...
Une expérience à prolonger, donc – y compris avec ces satanés haïkus ! Avec de la chance, cela finira par m’évoquer quelque chose… Après tout, c’est ce qui s’est produit pour un certain nombre de tanka et de chôka des ères antérieures. Alors, pourquoi pas ?
La polésie…
Je parle de polésie…
Tout est foutu.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)
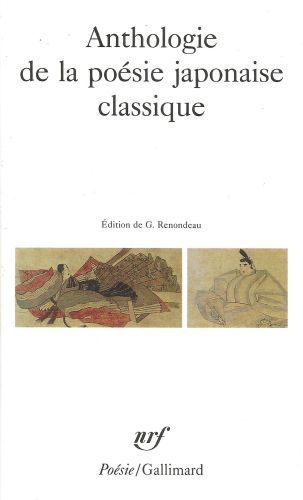








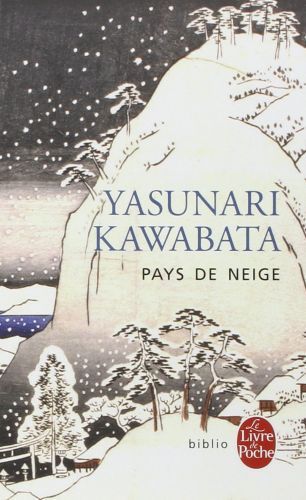




/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)