La première nouvelle, signée Caitlín R. Kiernan, est « Pïckman’s Other Model (1929) »… et je l’avais déjà lue, dans New Cthulhu : The Recent Weird, même si je l’avais totalement oubliée… Elle est sans doute mieux passée cette fois : je n’en avais pas vraiment saisi l’intérêt alors, mais ai bien davantage apprécié ce texte à la relecture. Comme le titre l’indique assez, il s’agit d’une suite à la nouvelle de Lovecraft « Pickman’s Model », sans doute parmi les plus célèbres hors « Mythe » (on trouvera ultérieurement, comme mentionné plus haut, deux autres « suites »). Le narrateur en est un ami de Thurber, qui était quant à lui le narrateur de « Pickman’s Model », mais s’était suicidé après coup, non sans avoir tenu auparavant un discours délirant à son ami, sur les sources de la peinture macabre du génial Richard Upton Pickman. Bien évidemment, l’idée demeure la même – la révélation que Pickman peint d’après nature n’en est pas une pour quiconque a lu Lovecraft, et le pastiche de Kiernan en joue forcément. Si la conclusion est peut-être un peu terne de ce fait (mais ça se discute, il y a quand même un apport personnel non négligeable), la nouvelle fonctionne bien : son jeu assumé sur le narrateur « non fiable » (d’un à-propos essentiel, et qu’on retrouvera plus tard, à sa manière, dans la variation de Brian Stableford sur le même sujet), son évocation du cinéma hollywoodien de « l’âge d’or » du muet via la mystérieuse starlette Vera Endecott, impliquée dans un scandale à la Roscoe « Fatty » Arbuckle, mais forcément lourd de connotations encore plus sinistres dans un cadre pareil, enfin la vulgarité associée en définitive à ladite actrice, que ce soit au travers d’un déconcertant et répugnant métrage pornographique ou plus frontalement dans son langage à mille lieues de la préciosité affectée du narrateur, sont autant d’éléments bien vus qui tirent cette nouvelle vers le haut.
[A la re-relecture, c'est encore mieux passé. Cette nouvelle est très futée, très bien conçue, et son ambiance est remarquable ; c'est une des meilleures nouvelles de l'anthologie, je crois, vraiment un pastiche de qualité.]
Après quoi Donald R. Burleson, que je connais décidément plus en tant que critique qu’en tant qu’auteur de fictions (même s’il me laisse souvent sur le bas-côté, avec sa déconstruction-truc…), livre « Desert Dreams », nouvelle dans laquelle un homme résidant à Providence, et même à Benefit Street tant qu’à faire, est assailli de rêves récurrents (ou plutôt d’un unique rêve se déployant et poursuivant au fil de nouveaux épisodes) le transportant dans un désert qu’il connaît à la perfection (alors qu’il n’a jamais mis les pieds dans quelque désert que ce soit), où il découvre auprès d’étonnants Indiens ce qui ressemble fort à un culte secret d’un dieu méconnu et ô combien inquiétant – et tout ceci s’avère bien sûr absolument vrai… L’idée n’est pas inintéressante, et le pastiche fonctionne en gros, à ceci près que la fin est probablement beaucoup trop ouverte : arrivé au bout, on est plus frustré qu’autre chose… Ceci étant, cette nouvelle est bien meilleure que celle que l’auteur livrera plus tard dans Black Wings III.
[Mais ça n'a vraiment rien d'extraordinaire ; c'est même décidément très médiocre, pas désagréable, mais sans vrai intérêt.]
Mais « Engravings », de Joseph S. Pulver, Sr., est moins convaincante [bah, classer les deux n'a pas de sens...] – et exactement ou presque pour les mêmes raisons qui m’avaient fait trouver sa contribution à Black Wings III peu ou prou insupportable… Nous y voyons une petite frappe effectuer une « livraison » pour un inquiétant personnage entouré de chats ; bon… Dans le fond, la nouvelle joue de la généalogie morbide, avec quelque chose qui n’a pas été sans m’évoquer Angel Heart ; mais le problème est que, dans la forme, elle appuie lourdement sur la confusion mentale du délinquant – au point où c’est plus indigeste que véritablement pertinent, à mes yeux en tout cas… Il y a vraiment une affectation dans le style, comme un désir de se compliquer la vie autant que celle du lecteur, pour sonner arty ; hélas…
[En fait, ça sonne d'autant plus faux que l'histoire est indigente et caricaturale ; on est à la limite du ridicule, en définitive, et je ne sais pas quelle était au juste la part de la volonté de l'auteur dans ce résultat...]
On passe à quelque chose d’autrement intéressant à mon sens avec « Copping Squid », de Michael Shea. Ricky Deuce, dans l’épicerie de nuit où il travaille à San Francisco, a maille à partir avec un jeune Noir au comportement étrange, un certain Andre, qui l’agresse au couteau. Normal, quoi… Mais il s’avère bien vite que le bonhomme a des motivations bien plus étonnantes qu’une simple pulsion d’agression pour gagner quelques billets… Quand Ricky l’entaille au bras avec son propre couteau, il se montre étonnamment satisfait, même s’il a encore des choses à demander au vendeur ; celui-ci, intrigué par la tournure incompréhensible des événements, en vient même à abandonner son poste pour accompagner le jeune homme en voiture… qui finit par lâcher que, ce dont il a vraiment besoin maintenant, c’est d’un témoin. Et Ricky sera ainsi amené à vivre cette expérience terrible, de voir « des choses » (« some shit » dans le texte, ça revient tout le temps), sans même être bourré (il n’a pas bu une goutte d’alcool depuis trois ans)… Au premier abord, je n’étais pas tout à fait certain de ce que je pensais au juste de cette nouvelle. Mais, en définitive, je l’ai plutôt appréciée [et même plus que ça], même si ça coince [vaguement] à l’occasion (les motivations de Ricky, notamment, sont tout de même un brin problématiques – mais peut-être faut-il y voir la personnification du lecteur curieux de récits « weird » ?). J’ai cependant trouvé nombre de choses bien vues – notamment l’atmosphère ultra-prolo-sordide [et communautaire], qui, dans les premières pages du moins, a sans doute quelque chose d’humoristique (à vrai dire, la nouvelle, par bien d’autres aspects, a des traits parodiques), mais qui me paraît acquérir, au fur et à mesure, des traits plus essentiels et profonds, et inquiétants ; on passe ainsi du T-shirt illisible d’Andre (qu’on comprend, bien avant Ricky comme de juste, arborer « Cthulhu Rules » ; on pense forcément à des logos tordus de groupes de black metal, ce genre de choses… [C'est par ailleurs le seul moment de l'anthologie où apparaît le nom du Grand Ancien, et à vrai dire de n'importe quel Grand Ancien]), à une tirade illuminée au milieu d’un cercle d’adorateurs, qui évoque peut-être davantage, mais à bon droit, les prêches enflammés de pasteurs américains fondamentalistes plutôt que les traditionnels délires cultistes (l’idée étant bien sûr de questionner la différence supposée entre les deux) ; si la « vision » en elle-même ne m’a pas transcendé, ses implications ultérieures – mêlant doute et fascination – sont assez intéressantes, le culte prenant des atours de virus n’affectant que des « initiés », pleinement volontaires ou pas (Ricky ne manque pas de se poser la question de son implication dans tout ça) ; la conclusion appuie d’ailleurs à nouveau sur la dimension ultra-prolo-sordide, et probablement raciale aussi (difficile de ne pas penser cela, d’emblée, avec le personnage d’Andre, et peut-être plus encore avec sa gouaille évoquant quelque ersatz contemporain de Zadok Allen transmuté par des clichés gangsta rap), qui fournit un contrepoint moderne intéressant aux obsessions de Lovecraft.
[Cette nouvelle est très bien passée à la relecture, j'ai vraiment apprécié son humour, son ambiance, et ce qui se terre derrière la légèreté de façade...]
Puis nous avons « Passing Spirits », de Sam Gafford, qui m’a vraiment plu. Nous y suivons un homme en phase terminale de son cancer, qui est hanté par le spectre de H.P. Lovecraft (à moins qu’il ne s’agisse que de sa conscience ?), puis, de plus en plus, par ses personnages – à mesure que le narrateur, conscient de sa mort prochaine, rêve plus profondément, intégrant pour sa part les récits du gentleman de Providence, vécus sur le moment. En résulte une nouvelle saturée de références – ce qui, au début, peut effrayer un peu –, mais finalement à bon et même très bon escient, et permettant d’envisager beaucoup de choses d’une manière très « fan », que ce soit, presque prosaïquement, dans le rapport du lecteur à son idole et à ses textes (avec de l’analyse critique en prime, notamment des liens avec Dunsany ou Hodgson, l’auteur étant un spécialiste de ce dernier), ou, plus globalement, dans l’échappatoire bienheureuse du fantastique et de l’horreur : les monstres et fantômes devraient être plus terrifiants que des maladies, dans l’idéal… La nouvelle est sans doute semée d’allusions un peu « gags » (par exemple quand le narrateur s’entretient avec Lovecraft des biographies respectives de Lyon Sprague de Camp et de S.T. Joshi), ce qui lui permet de ne pas sombrer dans un pathos pourtant difficile à éviter avec pareil sujet (la nouvelle s’ouvre sur le narrateur au chevet de Lovecraft à l’agonie – situation qui s’inverse bien sûr plus tard) ; et, au milieu de ce thème global par essence morbide, elle conserve ainsi quelque chose d’étonnamment lumineux, en fait – jusqu’à une très jolie conclusion. Oui, ce texte a quelque chose de « fan », mais avec subtilité, et sans user de l’inévitable quincaillerie des pastiches ; c’est vraiment très bon.
[Même avis après relecture.]
Une grosse déception ensuite, avec Laird Barron et « The Broadsword », une longue nouvelle que d’aucuns (Joshi inclus) considèrent comme un authentique chef-d’œuvre (en fouinant sur les critiques de l’anthologie, c’est presque systématiquement le récit qui est mis en avant et loué par-dessus tout)… mais je suis largement passé à côté, et ça me travaille. Je reconnais qu’il y a sans doute quelque chose dans le style, soigné et témoignant d’une voix toute particulière, mais le propos m’a laissé parfaitement froid. La dimension lovecraftienne s’affiche par moments (si elle est dénuée de renvois clairs au lexique lovecraftien, comme la plupart du temps ici), et renvoie sans doute – pour ce que j’ai cru en comprendre – à certains aspects de « The Shadow over Innsmouth », mettons, mais, au-delà des revendications d’ordre cosmique, la nouvelle, pour employer la troisième personne, me paraît en fait insister sur la dimension psychologique – le point de vue est clairement biaisé, d’une manière évoquant un narrateur non fiable. Le personnage point de vue est un homme vieillissant, vivant seul – il a une compagne, mais ils ont chacun leur logis – dans une résidence, vieillissante elle aussi, mystérieusement appelée « The Broadsword » ; Laird Barron prend soin de poser longuement l’ambiance, avec une certaine réussite sans doute dans un premier temps : le vieux bâtiment décrépit, la vague de chaleur qui touche la ville d’Olympia, dans l’État de Washington, où se déroule l’histoire, le personnage rongé par le remord et obsédé par la mort de son épouse et peut-être plus encore d’un collègue qui s’était égaré lors d’une opération en forêt, sa relation avec un cercle de petits vieux toujours battants dans son genre… Puis on commence progressivement à évoquer un comportement étrange de sa part, des visites impromptues d’une inconnue dans son appartement, des coups de fil déstabilisants, et il entend bientôt des voix… clairement menaçantes. Tout donne l’image d’un homme en train de perdre la raison, et – horreur suprême à certains égards – qui s’en rend plus ou moins compte ; le balancement avec l’idée qu’il soit en fait un être à part, amené à intégrer les us et coutumes d’une espèce ancestrale cachée au milieu de l’humanité (violemment maléfique, à mes yeux – le sadisme des voix me paraît aller dans ce sens, si le comportement de base peut conserver une dimension d’indifférentisme cosmique), espèce dont il ferait partie, ne m’a toutefois pas convaincu et, globalement, je n’ai pas tardé à m’ennuyer jusqu’à la fin… Mais c’est sans doute moi : je suis passé à côté. D’aucuns, nombreux, ont loué ce texte entre autres pour son originalité, par ailleurs, et là je dois dire que ça me dépasse tout particulièrement… Déception. Incompréhensible.
[Même constat après relecture : je ne vois tout simplement pas ce que ce texte a de si brillant. Il n'est pas mauvais, mais je le trouve tout de même bien banal ; à vrai dire, son caractère lovecraftien ne coule pas forcément de source, de toute façon. Pourquoi ce texte est-il si unanimement loué ? Je n'en sais rien, il faut donc croire que je passe toujours à côté...]
Passons à William Browning Spencer et « Usurped ». Un homme qui entretient une relation fusionnelle avec son épouse affligée d’un cancer est soudain attaqué par une nuée de guêpes alors qu’il roule dans quelque coin paumé du sud-ouest américain. Il survit à l’accident qui en résulte, encore qu’en sale état, et sa femme aussi, peu ou prou indemne pour sa part… voire mieux que ça... mais il ne la « ressent » plus. Le sentiment que l’accident ne s’est pas produit comme il aurait dû se produire assaille Brad – et un ex-universitaire [ou juste un tocard] passablement excentrique lui raconte bientôt des inepties à propos des conditions du drame, qui ne serait pas le seul à s’être produit sur ce coin précis de route… Brad, déphasé, se retrouve bientôt entraîné dans un piège cosmique – révélant ce qu’est le monde et ce qu’est sa destinée. Plutôt une bonne nouvelle, où les divers éléments – psychologiques, cosmiques – se marient bien. Le texte garde un certain côté « pulp », sans se montrer naïf pour autant.
[Il y a surtout un côté conspi à la X-Files vraiment sympa, et de l'étrangeté qui fait plaisir. Un bon texte.]
David J. Schow, dans « Denker’s Book », une nouvelle assez brève, évoque un scientifique de génie, lauréat du Prix Nobel, qui a la mauvaise idée de « tricher » dans ses recherches sur l’espace, le temps et les dimensions, en ayant recours à un livre anonyme et protéiforme (pour le moins évocateur du Necronomicon), qui a le pouvoir de changer la réalité – le « sorcier », en conséquence, est déchu de ses prestigieuses récompenses… Toutefois, son orgueil n’est sans doute pas le seul à en souffrir, le livre maudit pointant une nature de la réalité que la science ne peut concevoir, et qu’il ne vaut mieux pas mettre en évidence, d’une manière ou d’une autre… L’idée est bonne, mais l’écriture un peu terne, et je ne suis pas certain que l’auteur en fasse vraiment quelque chose en définitive – il y avait là de la matière, pourtant…
[Je serai plus sévère à la relecture : cette nouvelle est ratée, vraiment ratée. La bonne idée de base est bâclée, le texte ressemblant en définitive, bien plus qu'à une fiction, à rien d'autre qu'un très mauvais et très ridicule pamphlet occulto-mes-couilles dégoté sur Internet, le genre de merdouille obscurantiste qui réjouit les amateurs de conspirations anti-scientifiques, antivax, platistes, intelligent design et (navrante) compagnie. C'est peut-être volontaire de la part de l'auteur, mais ça n'en sonne pas moins aussi bêtasse, au point de l'extrême lassitude. Impossible d'apprécier l'idée de la sorte. C'est d'autant plus ennuyeux que les implications apocalyptiques de la fin de la nouvelle auraient pu être vraiment très intéressantes.]
« Inhabitants of Wraithwood », de W.H. Pugmire, est cité par S.T. Joshi comme étant une des trois nouvelles tournant autour de « Pickman’s Model » figurant dans l’anthologie, mais c’est d’une manière très particulière, très personnelle, et revendiquant haut et fort sa singularité. Nous y suivons un criminel en cavale, dont l’expression commune si ce n’est vulgaire ne doit cependant pas nous tromper : le bonhomme, pour être une petite frappe, n’est pas sans culture en matière d’art et de littérature (merci Maman). Le sort l’amène à se réfugier dans un endroit pour le moins « weird », fréquenté par d’étranges individus plus « weird » encore – en fait, d’une certaine manière, des œuvres d’art vivantes, dans la lignée des terribles sujets représentés d’après nature par feu Richard Upton Pickman. La nouvelle tient du cauchemar (la plupart des sections s’ouvrant sur un réveil du narrateur, qu’on est parfois tenté de remettre en cause), et en même temps de la farce macabre, portée par un humour étrange et hautement déconcertant. Un bon texte avec une belle ambiance – même si j’ai trouvé qu’il s’éternisait peut-être un peu trop.
[Sentiment plus mitigé à la relecture. C'est correct, mais ça ne m'a pas passionné, loin de là.]
Mollie L. Burleson livre quant à elle « The Dome », une nouvelle très courte, très banale, très vide, à l’instar de celle qui figurait dans Black Wings III, et qui m’avait fait supposer un copinage éhonté, tant le niveau était drastiquement inférieur à tout le reste de l’anthologie ou presque – et c’est exactement la conclusion à laquelle j’aboutis ici… Avec peut-être un peu moins de sévérité, admettons.
[Il y a pire dans la présente anthologie, mais c'est quand même un texte totalement inutile, sans le moindre intérêt, et assez puéril, en définitive.]
Après quoi « Rotterdam », de Nicholas Royle, m’a laissé au mieux perplexe. Il faut dire que j’en attendais sans doute beaucoup, une fois de plus (de l’auteur, je n’avais sauf erreur lu qu’une seule nouvelle, dans Le Visage Vert, mais qui m’avait vraiment séduit, et donné envie d’en lire davantage – l’occasion ne s’était toutefois pas présentée…), ce qui peut expliquer au bout du compte une certaine frustration, et la conviction d’être passé à côté du truc… Nous y suivons deux hommes, travaillant sur une éventuelle adaptation cinématographique de « The Hound », de Lovecraft, faire du repérage à Rotterdam (cadre de la nouvelle, même si cela n’a en fait aucune espèce d’importance chez Lovecraft). Le personnage point de vue est intéressant (un écrivain déprimé et parfois colérique qui aimerait bien que le producteur achète les droits de son roman pour en faire un film), et l’arrivée de son comparse, qui entretient un jeu ambigu avec lui (érotique, notamment, c'est assez clair), bénéficie à l’ambiance travaillée du récit (qui tournait jusqu’alors sur l’absence d’âme de la ville, détruite pendant la guerre et reconstruite après coup, perturbée cependant par des installations artistiques incongrues ; quant à la référence à la nouvelle de Lovecraft, elle pose sans doute des questions d’ordre esthétique autant que pratique, sur la signification du décor, la liberté de transposition, etc.). Et puis… on passe à tout autre chose, et ça ne m’a plus parlé du tout. Sans doute suis-je passé à côté, oui – ça ne serait pas la première fois, hein… Impression de gâchis, quand même.
[Oui. Il y a une bascule dans la banalité qui me laisse très perplexe. Sentiment vigoureux d'être passé à côté de quelque chose... Mais, du coup, non, je n'ai pas aimé ; toujours pas. Et c'est bien une déception, à titre personnel au moins aussi frustrante que celle concernant « The Broadsword »...]
Au rang des textes loués mais qui ne m’ont pas convaincu pour une raison ou une autre, il faut maintenant mentionner « Tempting Providence », novelette de Jonathan Thomas, qui traite d’un artiste exposant ses œuvres, dans les pires conditions, à Providence – et qui découvre, dès le lieu même de l’exposition, combien la ville a (horriblement) changé depuis le temps de Lovecraft ; impression confirmée, bien sûr, quand le fantôme de Lovecraft entre dans la partie. Eh bien… j’ai trouvé ça très chiant ; mais sans doute est-ce que je suis passé à côté, encore une fois… Quoi qu’il en soit, j’ai trouvé le texte bavard au point d’en être vraiment ennuyeux, tandis que son canevas me laissait pour l’essentiel parfaitement froid : le fantôme de Lovecraft est ici nettement moins intéressant que celui que l’on avait croisé, plus haut, dans « Passing Spirits », de Sam Gafford, nouvelle qui m’avait vraiment botté, tandis que le discours décadence-blah-blah-c’était-mieux-avant-blah-blah-ils-ne-respectent-donc-rien-blah-blah, même tempéré avec un soupçon d’humour (plus ou moins drôle à vrai dire), m’a tenu éloigné du texte. Plutôt loué par ailleurs, j’ai donc l’impression, mais certes pas par moi…
[Sentiment plus sévère à la relecture. Là aussi, le côté pamphlet, mais dans un esprit très réac, m'a vite lourdé, et la répétition des mêmes récriminations sur le mode navrant du « c'était mieux avant » m'a même carrément agacé ; la puérilité du narrateur aussi. Quelle est la part de volonté dans tout ça ? Je ne m'avancerai pas à ce propos, mais c'était vraiment très pénible...]
J’ai bien davantage apprécié « Howling in the Dark », de Darrell Schweitzer, nouvelle autrement courte et concentrée, d’une extrême noirceur lourde de « cosmicisme » – et peut-être au sens le plus lovecraftien du terme, dans la mesure où le texte tourne autour de la vaine quête de sens à laquelle succombent si souvent les humains, dans un monde qui s’en fout, mais surtout joue de l’injonction terrible de « laisser les choses derrières soi », de « continuer à avancer », pour en exprimer toute l’horreur et l’impossibilité. Le tout dans un cadre familial oppressant, qui en suscitera presque nécessairement un autre, sous la houlette d’une sombre figure, une sorte de variation sur « l’ami imaginaire » qu’ont souvent les gosses, variation qui, cependant, procède sans doute bien différemment du mini-lutin-Dieu habituel, en confrontant les gniards puis les adultes à leurs fautes et à leurs regrets. Très noir, et très bien vu en ce qui me concerne.
[L'ambiance est remarquable, horriblement pesante ; ça fonctionne vraiment très bien.]
On en arrive à Brian Stableford, avec « The Truth About Pickman » (la troisième et dernière nouvelle de l’anthologie à prolonger « Pickman’s Model » de Lovecraft), un récit qui ne se contente pas d’être palpitant (en dépit d’une fin un petit peu terne, peut-être), mais est aussi bien plus rusé qu’il n’en a l’air, sans doute. L’ambiance est joliment travaillée – le cadre improbable d’une maison paumée dans quelque endroit infréquentable de l’île de Wight a beau être contemporain, la manière évoque bien davantage, mais délibérément, quelque chose de typique de l’horreur littéraire des années 1920 ou 1930, dimension cependant pondérée par l’accent qui y est mis sur la science la plus récente (en l’espèce, Stableford fait mumuse avec la génétique). Cette simple conversation entre deux érudits que tout oppose est lourde de non-dits, voire de menaces… L’astuce, ici, consistant pour une bonne part à jouer sur le procédé (affectant à sa manière « Pickman’s Model ») du « narrateur non fiable », mais d’une manière très bienvenue. C’est habile et ça fonctionne parfaitement.
[Oui, c'est vraiment bien. Le jeu sur le narrateur non fiable est particulièrement astucieux, en manipulant les préventions du lecteur, et l'investigation scientifique du texte est étonnamment palpitante. Une réussite marquée, dans un registre finalement inattendu, car transformant un « conte macabre » très poesque en un étonnant thriller SF, en même temps imprégné de policier feutré, peut-être à la Agatha Christie. J'ai vraiment beaucoup aimé.]
« Tunnels », de Philip Haldeman, est tout aussi efficace, si moins rusé – voire banal. L’ambiance est très chouette (c’est d’autant plus appréciable qu’elle se fonde sur un présupposé cthonien qui aurait pu évoquer le sinistre Brian Lumley…), avec ce gamin de narrateur qui fait des sales rêves, et, tout autour de lui, une bande disparate de petits vieux… qui ont la bougeotte. Sans doute à bon droit – même si cela peut aussi évoquer une sorte de délire sectaire, vu de loin ; mais le lecteur sait bien, lui, que la menace est là et bien là… En fait de Brian Lumley, du coup, j’ai trouvé à cette nouvelle un côté un peu Stephen King – et c’est de suite tout autre chose, hein…
[Cette fois, ça m'a bien moins parlé à la relecture. Le côté « secte » est très intéressant, tout autant cette fatalité qui plonge une famille dans la terreur, et donc forcément l'ambiguïté entre ces deux manières d'envisager ce qui se produit, mais... Je ne sais pas, il manque quelque chose pour que ça fonctionne vraiment. Je suppose que ça demeure correct, mais je suis visiblement bien moins enthousiaste.]
Une grosse surprise ensuite, avec « The Correspondence of Cameron Thaddeus Nash », qui, bien sûr, n’est pas une nouvelle écrite par Ramsey Campbell – simplement la divulgation de documents qu’il annote çà et là (et à peine, encore)… Surprise, parce que c’est un texte largement humoristique, et que j’ai en tout cas trouvé hilarant (le terme n’est pas trop fort, non) – je n’attendais vraiment pas l’auteur sur ce terrain, mais il est vrai que je ne le connais pas plus que ça… Il s’agit donc d’une correspondance jamais publiée, et dont nous n’avons ici que les envois du mystérieux Cameron Thaddeus Nash, un « rêveur » anglais – nous n'avons pas les réponses de son « idole » Lovecraft. Sauf que le fan transi des premières missives – s’il dérape déjà çà et là, de manière amusante d’ailleurs (Houdini !) – se transforme bientôt en un infect personnage, de plus en plus désagréable au fur et à mesure que les missives s’accumulent ; d’une arrogance invraisemblable, il abuse (comme tant d’autres l’ont fait ?) de la gentillesse du gentleman de Providence, jamais avare d’encouragements et de conseils à ses jeunes correspondants désireux de devenir écrivains… Nash lui soumet donc ses propres textes, mais certainement pas pour qu’il les retouche – pour qui se prend-il ?! Par contre, Nash accepte volontiers l’offre de Lovecraft – ou plutôt la force-t-il… – de faire circuler ces textes tels quels pour en assurer la publication – à fins d’édification de la racaille des pulps. Dont Lovecraft lui-même, bien vite – n’a-t-il pas eu le culot de « l’oublier » dans sa liste des auteurs contemporains admirables dans son essai sur la littérature d’imaginaire ? Inadmissible ! Ce qu’il produit est pourtant au-dessus de tout ! Voilà ce qu’un authentique rêveur peut écrire, à mille lieues des sinistres et ineptes pulperies dont Lovecraft et ses dégénérés de fans aux ridicules prétentions littéraires sont coutumiers, et dont le monde gagnerait assurément à se passer… La psychose devient de plus en plus flagrante, et, si la nouvelle demeure avant tout drôle (en étant par ailleurs saturée de gags biographiques et autres allusions en rien cryptiques pour qui s’intéresse au sujet), elle parvient pourtant à véhiculer, au fil des pages, une certaine gêne, vaguement inquiétante… et peut-être même, à terme, une forme de révolte futile à l’encontre d’un troll avant l’heure, qui, en tant que tel, ne mérite pourtant certainement pas qu’on lui réponde (voyez ce que cet abject connard écrit à propos du suicide de Robert E. Howard, pardon, « Rabbity Coward » !). La pirouette ultime, en pleine conscience, a quelque chose d’un ultime gag rattachant en définitive mais par la bande ce qui précède au fantastique le plus grotesque, mais l’intérêt est ailleurs, dans ce jeu habile et pertinent sur l’érudition lovecraftienne, riche en savoureux gags. Peut-être y a-t-il cependant quelque chose de plus ? Nash n’est-il pas à certains égards une sorte de reflet de Lovecraft lui-même dans un miroir déformant – un Lovecraft de caricature, qui aurait décidé de faire l’impasse sur la gentillesse et le dévouement dont il était coutumier dans ses lettres à ses amis, et qui s’en serait tenu à l’image « aristocratique » de l’écrivain rêveur ne conspuant jamais assez la lie des pulps ? Les jeux de mots sur les noms ne manquent pas d'y faire penser... Et, par ailleurs, dans les virulentes critiques adressées par Nash à quantité de récits lovecraftiens, n’y a-t-il pas un peu de Ramsey Campbell lui-même, qui fut sauf erreur fan, puis contempteur – son rejet ayant été à la mesure de son adoration –, puis bienveillant à nouveau, d’une manière plus sereine ? Nash, bien sûr, n’a quant à lui jamais atteint cette sage dernière étape… Plus prosaïquement, enfin, Ramsey Campbell semble avoir dit qu’il avait lui-même eu maille à partir avec un sinistre individu de cet acabit… Je m’égare peut-être, mais, quoi qu’il en soit, j’ai beaucoup aimé, vraiment, ce texte à part dans l’anthologie – et il est rare qu’un récit délibérément humoristique, dans le sous-genre tout particulièrement périlleux des lovecrafteries rigolotes, me convainque autant…
[Oui, c'est hilarant ! Un vrai bonheur que ce texte, totalement inattendu, mais vraiment très drôle, et qui sonne tellement juste à l'heure des trolls d'Internet... et des écrivains auto-édités qui savent qu'ils sont les meilleurs de tous, quel scandale que tel blog minable refuse d'en rendre compte, par jalousie et bêtise à l'évidence...]
Changement d’ambiance radical avec Michael Cisco et « Violence, Child Of Trust ». L’histoire est légère, le cadre minimaliste… Mais cette fratrie dégénérée, finalement davantage échappée de La Colline a des yeux ou Massacre à la tronçonneuse plutôt que de Dunwich ou Innsmouth, et qui sacrifie quand le besoin s’en fait sentir des femmes, sans en avoir une à disposition quand c’est de nouveau nécessaire, a quelque chose de profondément dérangeant – effet sans doute renforcé par le choix d’alterner le récit entre les trois frères, le simplet Crover, le violent Julius et le discret visionnaire Todd. Rien de bien stupéfiant d’inventivité sans doute, mais, là encore, ça marche.
[Oui. Mais la dimension lovecraftienne est assurément très limitée.]
Suit une nouvelle de Norman Partridge intitulée « Lesser Demons » (que, là encore, j’avais déjà lue dans New Cthulhu : The Recent Weird ; et, à l’instar de « Pickman’s Other Model (1929) », j’en avais tout oublié, et cette relecture s’est avérée autrement satisfaisante…). À première vue, pas grand-chose de très lovecraftien dans ce survival apocalyptique évocateur avant toutes choses de nombreux films de zombies (ou d’infectés, comme vous voulez), avec juste une touche un poil plus baroque dans les « mutations » des humains et autres animaux anthropophages – lorgnant peut-être davantage vers Clive Barker ? On peut penser à Stephen King, aussi – quelque part entre « Les Enfants du maïs » (peut-être) et « Brume » (plus probablement). J’étais quand même bien sceptique au départ… mais je me suis pris au jeu, et, sur un canevas pareil, qu’on pourrait supposer forcément convenu, « Lesser Demons » m’a en fait très agréablement surpris (c’est dire si je me souvenais de ma première lecture, broumf…), en instillant dans le récit juste ce qu’il faut d’originalité – l’occasion, finalement, de bel et bien rejoindre Lovecraft, même par la bande. Nous y suivons un shérif (le narrateur) dans un bled paumé des États-Unis, secondé par son adjoint, alors que le monde s’effondre – du moins le supposent-ils : un aspect essentiel de la situation, après tout, est la rupture des communications avec « l’extérieur »… Ce qui, à mon sens, fait la valeur de la nouvelle, c’est le rapport qu’entretiennent les deux personnages (et d’autres, en définitive…) avec la compréhension de ce qui est en train de se produire autour d’eux : le shérif est un plouc aux manières brutales, pour qui la compréhension n’a pas lieu d’être – qu’on lui montre où il doit tirer, c’est bien suffisant ; son adjoint, par contre, est d’un naturel curieux, a même quelque chose d’un rat de bibliothèque ou d’un scientifique (citation éloquente d’un personnage secondaire, vers la fin : « I met a scientist once […] I put a bullet in his head. »), et se lance dans une enquête approfondie sur le phénomène, ses causes et ses conséquences – notamment en fouinant dans de vieux bouquins incompréhensibles et vaguement inquiétants, dont les mots illisibles semblent entrer en résonance avec ceux que les « possédés » se gravent eux-mêmes sur le corps… Chose qui dépasse donc totalement le narrateur, pour qui cette attitude de « chercheur » est au mieux inutile, au pire dangereuse. Mais qui, dès lors, deviendra le monstre : celui qui cherche à comprendre ce qu’il affronte, au risque peut-être de se mettre à ressembler à son ennemi, ou celui qui se contente de tirer dans le tas, évacuant tout questionnement pour s’assurer des nuits raisonnables ? Il y a là une vraie question, plutôt subtilement posée dans un texte qui, par ailleurs, adopte la crudité de son narrateur en ne s’embarrassant délibérément pas de joliesses… Et là, pour le coup, ce rapport au savoir, et ce questionnement du lien nécessaire entre connaissance et peur, me paraissent vraiment bienvenus – rejoignant finalement le questionnement cosmique d’un Lovecraft tel qu’il s’exprime notamment dans le célèbre premier paragraphe de « The Call of Cthulhu », mais en l’appliquant à hauteur d’homme, ce qui rajoute de l’éthique dans la problématique – tout en jouant la carte de l’action, avec compétence. Bonne surprise, vraiment.
[Oui, c'est très bien. Mais parce que c'est aussi... révoltant ? Concrètement, depuis cette chronique, il s'est passé pas mal de choses aux USA, et... Bon, disons-le : cette apocalypse zombie me paraît une plongée terrifiante dans l'Amérique de Trump, de la NRA, etc. Au sens où le narrateur est bien plus inquiétant que les démons qu'il massacre. Dans la forme et dans le fond : la manière dont le narrateur s'exprime... C'est affligeant ; vous savez, ce bon sens du cowboy ou du shérif ou du fermier, qui cause simplement, naturel, ne s'embarrassant pas des complications des snowflakes libéraux de la côte Est... Un chat est un chat, he tells it litke it is, etc. Terrifiant et affligeant, oui.]
Tout autre chose avec « An Eldritch Matter », d’Adam Niswander… qui tient largement de la blague : nous y voyons un homme (le narrateur) qui se transforme brusquement en poulpe, dans la douleur d’abord, dans la joie ensuite. En fouinant ici ou là, j’ai vu qu’on avait régulièrement comparé cette brève nouvelle à « La Métamorphose » de Kafka ; peut-être par certains aspects (la tonalité absurde, non dénuée d’humour, encore que d’un autre ordre ; la réaction presque « normale » d’un collègue assistant au phénomène), mais, euh, oserai-je dire que c’est « un peu moins bon » ? Pis bon, hein, on a beau le répéter : le poulpe ne fait pas le lovecraftien…
[Cette comparaison avec Kafka, si elle a été avancée avec un tant soi peu de sérieux, est proprement sidérante. Ce texte est nul, absolument dénué du moindre intérêt, dans le fond comme dans la forme. C'est puéril et creux, probablement ce qu'il y a de pire dans ce recueil ; ou en tout cas de plus inutile.]
Michael Marshall Smith livre ensuite « Substitution », une nouvelle qui m’a laissé pour le moins perplexe… Notre « héros » est un éditeur/correcteur qui travaille chez lui, et réceptionne et trie les commandes passées par son active épouse au supermarché du coin. Passionnant, n’est-ce pas ? Et, un jour – horreur ! Il y a eu une erreur, on a livré les mauvais paquets… Terrible indeed. La vraie destinataire est cependant de suite identifiée, mais notre héros y voit une occasion de sortir de sa routine, en traquant et épiant la dame – construisant autour de ladite d’étonnants fantasmes… Je suppose que ce résumé traduit autant que faire se peut la quasi-totale absence d’événements de la nouvelle, et son caractère longtemps parfaitement prosaïque. La « révélation » finale est supposément « horrible », mais peut-être seulement dans la lignée des fantasmes du narrateur, quand bien même ils en sont chamboulés ? Le plus étonnant est cependant que cette histoire pleine de vide… m’a bien plu. Sans doute parce que Michael Marshall Smith est un artisan doué, qui sait narrer une histoire (voire ici une absence d’histoire), en jouant notamment de la psychologie, parfois bien tordue – sans autre connotation horrible –, de ses personnages…
[Oui, ça se lit très bien. Il ne s'y passe à peu près rien, mais ça fonctionne. C'est léger, drôle même. Mais je m'interroge vraiment sur son caractère lovecraftien ; franchement, ça n'a guère sa place ici... Pas du tout, même.]
L’anthologie se conclut sur la brève nouvelle de Jason Van Hollander intitulée « Susie ». C’est Susan Phillips qui est ainsi désignée, la mère de Lovecraft – reléguée dans un asile, où elle ne tardera pas à périr. Son rapport à son fils fournit les meilleurs moments du texte – car les plus dérangeants, sans nécessité de faire intervenir le fantastique : je pense notamment à sa conviction que son fils était hideux, difforme… Le portrait, dès lors, est intéressant ; mais les « Iä ! Iä ! » me paraissent superflus, à ce stade.
[C'est une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit, mais sur un mode assez rude, qui noue le ventre... Oui, une réussite, sur un thème particulièrement casse-gueule.]
Bilan ? Assurément positif. Encore que peut-être pas autant que pour Black Wings III ? Je ne sais pas… Les textes qui m’ont le moins plu (à savoir ceux de Joseph S. Pulver, Sr., et de Mollie L. Burleson – tiens, y a de la continuité, exactement comme dans Black Wings III… Mais [il faut y ajouter au moins David J. Schow et Adam Niswander, et] il y en a un autre sur lequel je reviens de suite), ces textes donc sont sans doute plus médiocres que mauvais à proprement parler. Le reste est souvent bon à très bon… Mais je relève quand même une chose qui me tracasse un brin : ces « déceptions » par rapport à des textes (plutôt longs, le plus souvent), unanimement loués par ailleurs, mais qui m’ont laissé au mieux froid ou perplexe – je pense tout particulièrement à « The Broadsword », de Laird Barron, ou encore à « Tempting Providence », de Jonathan Thomas (qui est peut-être bien, en définitive, la nouvelle de cette anthologie que j’ai le moins aimée [c'est-à-dire en faisant la part des récits simplement médiocres et inutiles]). En fait, de ces longs récits, seul « Inhabitants of Wraithwood », de W.H. Pugmire, m’a séduit à la mesure de sa flatteuse réputation… [Peut-être même pas, en fait ; j'ai apprécié la nouvelle, mais tout de même pas à ce point non plus...] Je relève aussi que deux de mes textes préférés de cette anthologie, à savoir ceux de Caitlín R. Kiernan et Norman Partridge, m’étaient complètement sortis de la tête après une première lecture qui ne m’avait pas vraiment convaincu ! [Par contre, lors de cette nouvelle relecture, je m'en souvenais bien, et de pas mal d'autres textes de cette anthologie, à vrai dire.] J’imagine que je change, mon point de vue avec, ce qui vient relativiser toute entreprise critique… Je suppose aussi que les circonstances y ont leur part (j’étais dans un très sale état quand j’ai lu New Cthulhu : The Recent Weird, sauf erreur…). Cette chronique, j’imagine, doit donc être envisagée comme étant un point de vue particulier, à un instant « t »...
[Ce qui justifie, je crois, cette édition de ma première chronique suite à ma relecture deux ans plus tard...]
Mais, un de ces jours, je vais poursuivre avec Black Wings II.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)
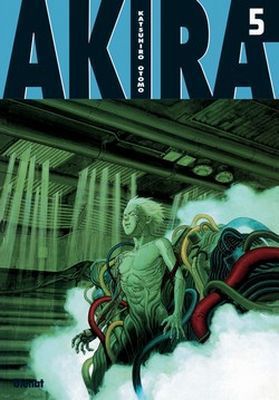


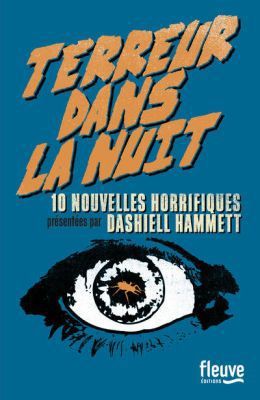


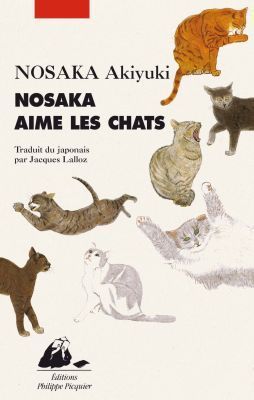



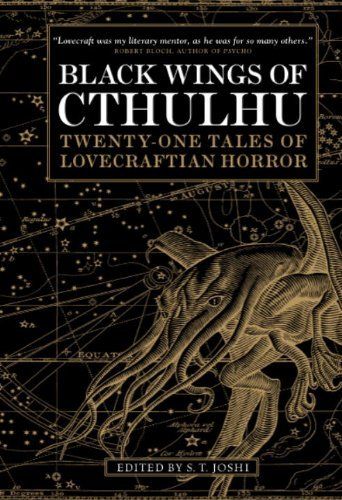

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)