Sandman, vol. 7, de Neil Gaiman
GAIMAN (Neil), Sandman, volume 7, [Sandman #70-75, The Absolute Sandman Volume 4-5, The Last Sandman Story, The Dream Hunters, Endless Nights, The Sandman Companion], illustré par Michael Zulli, John J. Muth, Charles Vess, Bryan Talbot, Dave McKean, Yoshitaka Amano, P. Craig Russell, Milo Manara, Miguelanxo Prado, Barron Storey, Bill Sienkiewicz, Glenn Fabry et Frank Quitely, préface de Shelly Bond, traduction [de l’anglais] de Patrick Marcel, [s.l.], Urban Comics, coll. Vertigo Essentiels, [1995-1996, 1999, 2003, 2011] 2016, 560 p.
Les meilleures choses ayant une fin, et Sandman étant assurément une des meilleures choses que l’on puisse concevoir, la série mythique de Neil Gaiman devait s’achever, à terme. À bien des égards, d’ailleurs, la fin de la série se trouvait dans le volume président, consacré au très ambitieux arc des Bienveillantes, qui rassemblait mille ficelles pour aboutir à la conclusion inévitable, à y regarder après coup, de la série, à savoir la mort de son héros-titre, le Rêve lui-même. Mais ce récit méritait bien un épilogue à la démesure de son génie, et c’est le propos du tout dernier arc de la série, La Veillée, qui ouvre cet ultime volume (encore qu’il adopte une forme assez particulière à ce sujet : la veillée à proprement parler occupe les trois premiers chapitres de l’arc seulement, les trois derniers constituant à leur tour des codas plus resserrées).
Mais, si la série s’achève bien là, Neil Gaiman y ayant posé le point final (et DC/Vertigo n’ayant pas poursuivi cette série emblématique et lucrative en la confiant à quelqu’un d’autre, ce qui n’était peut-être pas gagné à la base), demeurait la possibilité de raconter, toujours, des histoires liées, encore que d’un autre ordre. Ce qui explique que ce dernier tome soit aussi volumineux : outre La Veillée, on y trouve notamment le récit Les Chasseurs de Rêves, superbement illustré par Yoshitaka Amano (on en avait trouvé l’adaptation en bande dessinée par P. Craig Russell, postérieure, dans le volume 5 de cette intégrale), ainsi que le spin-off Nuits d’Infinis, revenant sur la famille du Rêve avec une maestria graphique tout à fait remarquable – disons-le d’emblée, même si j’aurai l’occasion d’y revenir : ce tome 7, à tous les niveaux, est clairement à mes yeux celui qui brille le plus sur le plan du dessin ou de l’illustration, et de loin…
On y trouvera enfin les habituels et toujours aussi passionnants commentaires tirés pour l’essentiel du Sandman Companion, mais plus amples que jamais, puisqu’il ne s’agit pas d’y envisager uniquement La Veillée, mais bien l’ensemble de la série (notamment au travers de ses personnages emblématiques et de leurs sources – remarquons cependant que Nuits d’Infinis, étant postérieur au Sandman Companion, ne bénéficie pas de ces précieuses analyses : en ce qui le concerne, il faut s’en tenir aux postfaces de Gaiman lui-même).
Commençons donc par La Veillée. Ainsi que mentionné plus haut, cet ultime arc a une forme un peu particulière, puisqu’il mêle plus que jamais trame suivie et histoires courtes. Encore que « mêler » ne soit pas le bon terme : il ne s’agit pas ici d’alterner, ou – ce que faisait systématiquement Gaiman au début de la série – de couper la trame suivie avec une ou plusieurs histoires courtes ; ici, les trois premiers épisodes se suivent, concluant la trame générale, tandis que les trois derniers, pour être globalement indépendants les uns des autres, confèrent pourtant un sens supplémentaire à tout ce qui précède, le dernier jouant à cet effet pleinement son rôle de dernier, en autorisant Neil Gaiman à poser le point final, via un saisissant flashback en forme de présage autant que de récapitulation (et peut-être pas dénué d’une certaine mégalomanie…).
Les trois premiers chapitres rapportent donc la veillée funèbre du Rêve à proprement parler. En tant que tels, il est sans doute absurde de ne serait-ce que tenter de les résumer – l’histoire étant par essence relâchée ; Neil Gaiman, à plusieurs reprises, a pu dire combien, et tout particulièrement dans Sandman, il accordait plus d’importance aux personnages qu’aux histoires ; cela peut sembler quelque peu paradoxal au regard de sa maestria de conteur (et voyez par exemple ce que Stephen King en disait dans sa préface au volume 5), et, à vrai dire, on peut en douter de manière plus générale, mais c’est assurément le cas ici.
L’histoire est donc minimaliste : on y voit les frères et sœurs du Rêve, les Infinis, organiser la cérémonie funéraire du disparu – approchant la nécropole de Litharge (voir le volume 5), concevant un golem qui se rend là où eux-mêmes ne se rendent pas (et qui y entend une voix mystérieuse, ajoutant à certains égards un degré supplémentaire dans la profondeur cosmique de la série, déjà oppressante pourtant…), construisant un mausolée démesuré pour y accueillir les veilleurs, etc.
Mais, au fond, il s’agit avant tout de parler. De se souvenir du défunt, et pas uniquement pour le louer, loin de là – demeure après tout l’image de cet « homme » sévère et obtus, rétif au changement et morbide de tempérament, à tel point qu’il était hors de question pour lui de finir autrement. C’est bien, globalement, le propos de la série – à la relecture, j’ai plus que jamais perçu (il était temps…) combien le « héros » n’en était pas un, combien il n’était somme toute guère sympathique, et parfois même horripilant dans son caractère têtu (et conservateur) autant que dans sa tendance à l’autoflagellation… Il a de toute évidence changé – suite à son emprisonnement durant la majeure partie du XXe siècle ; mais, la BD commençant peu ou prou avec sa libération, c’est là une chose que le lecteur ne perçoit qu’occasionnellement, au fil d’allusions portant sur le comportement antérieur du Rêve.
Mais tout ceci doit sans doute être envisagé au regard de la famille dysfonctionnelle (et donc normale ?) des Infinis. Quand la Mort secoue les puces du Rêve abattu à la fin du tout premier arc de la série, le thème de la dépression est on ne peut plus joliment introduit, qui constituera un sous-texte essentiel de tout ce qui suivra, mais, au fond, la question du changement est tout aussi fondamentale, si ce n’est plus. Et elle apparaît notamment dans les complexes pour ne pas dire pathétiques rapports du Rêve avec ses amantes (les autres Infinis ne s’embarrassent semble-t-il pas de ce genre de liaisons…), ce qui, bien sûr, est l’occasion idéale d’opposer le Rêve au Désir, en faisant de ce dernier le « Méchant » de la série, même si les choses sont sans doute plus compliquées que cela, et si le Rêve souffre au fond autant si ce n’est plus de son romantisme pathologique que des manipulations ludiques et sadiques de son cruel frère/sœur…
Les autres Infinis ont eux aussi leur rôle à jouer dans tout ça, même si deux d’entre eux sont relativement effacés. Le moins présent est sans doute le Désespoir, mais cela s’explique sans doute, et de deux manières éventuellement : d’une part, le Désespoir est porté sur la passivité, et est donc peut-être moins démonstratif que ses frères et sœurs ; d’autre part, le Rêve est désespéré – sans qu’il soit nécessaire pour sa sœur d’agir visiblement : il est d’emblée sous son emprise… Le Destin est lui aussi assez discret – mais son rôle est tout à fait notable… Le premier des Infinis, l’aveugle qui poursuit sa marche obstinée dans ses labyrinthiques jardins perpétuellement remodelés, le froid personnage qui est enchaîné à son grimoire comprenant tout ce qui a été, est et sera (à moins que ce soit le grimoire qui est enchaîné à lui ?), celui qui n’est par essence jamais surpris de quoi que ce soit, qui sait déjà tout… s’avère finalement moins rigide que le Rêve lui-même ! Car le Rêve, aussi paradoxal que cela puisse paraître du fait même de son domaine, est pourtant obnubilé par les règles – la logique des rêves, aussi improbable soit-elle, est bel et bien une logique, et il s’y raccroche en permanence… On pourrait croire que le Destin serait encore plus rigide à cet égard… mais justement, ce n’est pas le cas ! Le Destin, parfois, se dédouble – laissant entendre que l’avenir est fait de possibles divergents et même incompatibles, malgré tout… Son austérité, sa froideur, ne sont plus parfois qu’un masque, et on devine même, derrière ses yeux aveugles et masqués par sa capuche de moine, des émotions ! Son masque, dès lors, est-ce une manière de s’exonérer de ce que subit son petit-frère ? Peu probable : les Infinis ne jouent pas ce jeu-là. J’en retiens bien davantage l’idée que le Rêve lui-même est responsable de sa perte, du fait de son intransigeance et de ses lubies dont il ne parvient pas à se débarrasser (car persuadé d’emblée que c’est impossible) ; au fond, quoi qu’en dise le grimoire du Destin, le Rêve a fait des choix, et ce sont ces choix, et non quelque gribouillage cosmique qui avait toujours été là, qui l’ont anéanti à terme…
Deux autres des Infinis ont un rôle autrement essentiel, cependant – et ce sont les plus sympathiques, à n’en pas douter (avec bien sûr la Mort, qui est nécessairement sympathique et réconfortante). Le Délire, tout d’abord – la petite-sœur fantasque, qui était le Plaisir, mais qui a changé… Le thème est donc d’entrée essentiel. Le Délire, à bien des égards, est infréquentable – ses pulsions, forcément irrépressibles, peuvent même l’amener à commettre des horreurs… Mais c’est en toute innocence, globalement. Son intérêt est ailleurs : elle est concrètement, des Infinis, la seule finalement à tenter de venir en aide à son grand-frère (la Mort s’y essaye aussi, au début, mais peut-être est-elle amenée à baisser les bras, devinant le terme et connaissant bien trop son petit-frère pour supposer qu’il puisse y échapper), même s’il n’est pas dit qu’elle en ait seulement conscience – leur odyssée dans Vies brèves (tome 4), après tout, est le moment où la trame globale bascule ; on pourrait en retenir, sans doute, que ce sont les choix commis par le Rêve dans cet arc qui l’ont en définitive mené à sa perte, et c’est parfaitement exact ; mais l’important n’est-il pas, justement, qu’ici le Rêve a choisi ? Et, en choisissant, il a changé – peu importe dès lors que ces choix débouchent sur une pente fatale pour le personnage, ils n’en restent pas moins connotés de rédemption…Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, la sagesse du Délire n’y est sans doute pas pour rien – car elle incarne avec superbe l’étonnante sagesse qui se niche au cœur même de la folie… On a dit plusieurs fois que le Délire s’arrogeait les meilleures répliques de la série, et c’est sans doute très vrai – mais pas seulement parce qu’elles sont drôles : tout autant, en fait, parce qu’elles font sens. Bizarrement, oui, mais sens, quand même. Finalement, quel autre Infini pourrait prétendre avoir un lien aussi fort, quand bien même de circonstance, avec le Rêve ? Le Délire est sans doute le plus à même de prendre sa défense – tout en pestant régulièrement contre lui, contre sa pénible rigidité… Elle aussi, à l’instar de la Mort, remonte les bretelles au Rêve, à l’occasion – mais elle va bien plus loin, allant jusqu’à sermonner de manière impressionnante le Destin lui-même ! Et, même si ce n’est pas avec la même fougue (et, pour le coup, la même lucidité), sans doute a-t-elle aussi bien des choses à dire à la Mort… Par ailleurs, la quête du Rêve et du Délire dans Vies brèves porte sur les retrouvailles avec la Destruction – des Infinis, le Délire est la seule à penser que la Destruction manque à la famille, et à refuser le « fait accompli » de sa désertion : tous les autres font avec, ayant décrété une bonne fois pour toutes que leur frère avait disparu et qu’il ne servait à rien de le retrouver ; et si le Rêve s’engage dans la quête du Délire, c’est, dit-il, pour se changer les idées, il ne croit pas un seul instant qu’ils seront en mesure de retrouver la Destruction, et il sait, bien sûr, que ce n’est de toute façon pas souhaitable… Pourtant, c’est bien ce qui se produira – et, la Destruction incarnant le changement avant tout autre chose, le thème de la série sera alors plus éloquent que jamais. Bien sûr, l’artiste médiocre et colosse jovial fait à certains égards figure de dernier argument en faveur de la possibilité pour un roi d’abandonner son royaume (thème déjà important auparavant dans la série, qui y était revenu à plusieurs reprises – même si l’exemple le plus flagrant autant que complexe est, à n’en pas douter, dans La Saison des Brumes, celui de Lucifer quittant l’Enfer en en laissant la clef… au Rêve), mais Morphée n’en tient bien sûr pas compte… Il admet pourtant, contraint et forcé, qu’il lui faut changer, au moins un peu – et l’arc Vies brèves s’achève sur la bascule au cœur de la série, quand le Rêve s’humanise enfin (un degré supplémentaire après sa relation à Nada, qui avait introduit le thème du « pardon » dans la série, mais en illustrant peut-être plus encore la cruauté froide du Rêve « d’avant »…), et libère enfin son fils Orphée de la malédiction idiote qu’il lui avait infligée au nom des sacro-saintes Règles… en le tuant.
Tous les Infinis, bien sûr, participent à la veillée – à l’exception nécessaire de la Destruction, fort peu désireux de porter le deuil du Rêve avec ses frères et sœurs, mais qui n’en passe pas moins rendre une petite visite au Songe, sous la forme d’un éternel vagabond de bon conseil. Les autres assistent à la cérémonie, dont ils sont les maîtres d’œuvre, et tous ont leur mot à dire. Les Infinis étant ce qu’ils sont, sans doute ne sont-ils guère portés à l’extroversion, et les circonstances s’y prêtent moins que jamais… Notons quand même deux choses : la robe rouge de la Mort, qui ne saurait porter son noir habituel en cette occasion, et la simple vérité qui sort de la bouche du Délire – lapidaire, contrastée, juste.
Mais la veillée dépasse largement les seuls Infinis : des milliers de gens s’y rendent, qui, d’une manière ou d’une autre, ont été en relation avec le Rêve. Au premier chef, bien sûr, les habitants du Songe – qui ont aussi à gérer la transition avec le nouveau maître des lieux, Daniel, qui est plus humain que son prédécesseur, plus empathique (des traits qui apparaissent dans son comportement avec les gardiens de son palais, ou à l’occasion de quelques « recréations » de rêves abattus par les Bienveillantes – le cas le plus touchant étant celui de Gilbert, qui veut rester mort). Certains s’en accommodent sans trop de difficultés, comme Lucien, mais c’est plus difficile pour d’autre – l’exemple le plus éloquent étant Matthew, le corbeau du Rêve ; il avait entretenu une relation très forte avec Morphée, quand bien même largement fondée sur des incompréhensions et des allusions sibyllines ; il est bouleversé par la mort de son maître… et n’accepte pas son remplacement par Daniel. Pourtant, à terme, il devra bien prendre en compte la succession – et admettre, ainsi que les autres habitants du Songe, que si ce Rêve n’est pas son Rêve, il n’en est pas moins le Rêve. Et que le monde continue. La vie aussi, par-delà la mort…
Daniel, comme il se doit, ne participe pas à la veillée de son prédécesseur ; mais, le lendemain, il est là – nouveau frère des Infinis, poursuivant une tâche toujours à reprendre… et tout laisse à croire qu’il fera un très bon Rêve, plus sympathique et moins obtus que son prédécesseur.
Ces figures proprement mythologiques sont cependant rejointes par une foule considérable d’individus souvent plus ordinaires – encore que dieux et fées et anges et démons soient de la partie. C’est, pour les auteurs, l’occasion de faire réapparaître une multitude de personnages, parfois à peine entrevus dans les épisodes précédents (et parmi lesquels les super-héros de DC, ce qui renvoie à l’inscription de Sandman dans cet univers partagé, sensible dans le premier arc, nettement moins par la suite…). Les témoignages ne manquent pas, souvent émouvants, et peu importe que nombre de ces individus n’aient au fond pas la moindre idée de ce qu’ils font là, et de ce qui se déroule au juste… Relevons, tout particulièrement, les discours des amantes du Rêve – toutes ne parlent pas (ainsi Nada ressuscitée), mais Calliope et Thessaly s’avèrent tout particulièrement touchantes ; la relation du Rêve avec cette dernière n’avait jusqu’alors été mentionnée qu’au travers d’allusions hermétiques, elle devient explicite ici seulement – et si la sorcière grecque tente toujours d’arborer un masque sévère et dur, à son habitude, ses larmes, enfin, trahissent la réalité du personnage, autant que la douleur de l’amour…
Mais comment mettre en scène tout ceci ? Ce qui est narré dans ces trois épisodes n’a pas grand-chose à voir avec tout ce qui précède – ni, probablement, avec quoi que ce soit qui ait alors figuré dans des comics… Mais les auteurs ont eu une excellente idée, qui a marqué une certaine émancipation par rapport aux traditions les plus tenace de l’édition de BD américaine. Tout d’abord, Michael Zulli a employé un style graphique radicalement opposé à celui qu’avait employé Marc Hempel dans l’arc précédent, Les Bienveillantes : là où ce dernier usait d’un style « simple », expressionniste, d’une abstraction louchant parfois sur la caricature, à travers une mise en page sobre et enchaînant les petites cases, Michael Zulli a pour sa part fait usage d’un graphisme plus réaliste, mais aussi plus majestueux, avec une mise en page plus complexe et privilégiant les grandes cases. Mais cela ne s’arrête pas là : la meilleure des idées, en l’espèce, a été de recourir à des crayonnées, et non à l’encrage habituel des comics, à base de lignes noires bien marquées instituant des frontières infranchissables… Cet encrage traditionnel des comics s’expliquait par des raisons largement techniques, issues des premiers temps de l’édition de BD américaine ; mais Gaiman et Zulli ont avancé que, les moyens techniques ayant changé, on pouvait tenter de passer outre cet encrage. DC s’est d’abord montrée sceptique, mais a tenté le coup… et constaté que l’intuition des auteurs était parfaitement fondée. Il en résulte un dessin tout à fait splendide, à l’opposé de tout ce que l’on avait pu voir jusqu’alors dans Sandman. La série a souvent été critiquée pour son graphisme inégal, voire « moche », et, je ne prétendrai pas le contraire, j’ai moi aussi hurlé avec les loups, notamment lors de ma découverte de la BD ; cette relecture m’a fait considérablement réviser mes préjugés en la matière, peut-être en partie parce que l’encrage et les couleurs ressortent mieux maintenant que dans mes vieux exemplaires plutôt pâlichons… Mais j’ai régulièrement eu l’impression que c’était bien l’encrage et les couleurs qui posaient problème, le plus souvent, d’une manière que je ne m’expliquais pas forcément très bien. La perfection graphique de ce dernier arc tend à me conforter dans cette opinion… mais j’imagine qu’une relecture ultérieure pourrait encore changer la donne.
Si la veillée au sens strict s’arrête là, l’arc se poursuit cependant sur trois ultimes épisodes, des codas supplémentaires, épilogues à l’épilogue. Il ne s’agit pourtant pas de rajouts destinés à prolonger un peu artificiellement la sauce : ils font sens, et s’avèrent d’une grande (très grande) qualité. Dans « Dimanche de deuil », toujours dessiné et avec autant de réussite par Michael Zulli, nous suivons pour une dernière fois Hob Galding, l’immortel (revenu plusieurs fois dans la série) qui pouvait peut-être se targuer d’être ce qui se rapprochait le plus d’un ami pour le Rêve (avec Matthew dans le Songe même, mais c’est une relation d’un autre ordre – d’autant que lien avec Hob se passe de l’ambiguïté perturbant toujours le rapport entre un maître et son serviteur). Hob se trouve dans une situation absurde : sa compagne (une Noire – qui pour une fois ne brûle pas…) l’emmène participer à un « village Renaissance », où des cosplayeurs avant l’heure reconstituent à grands renforts de clichés ineptes une Renaissance idéalisée, bien loin de la réalité de l’époque (que Hob avait bien connue, et pour cause…) ; la situation a quelque chose de comique, mais Hob – sans doute affecté par la mort du Rêve, encore qu’il n’en ait pas bien conscience – a quelque chose d’un peu aigri, d’autant qu’il lève volontiers le coude… Mais la journée fantasmée, avec ses rencontres improbables et pourtant plus authentiques que toute la reconstitution naïvement hollywoodienne qui leur offre un cadre grotesque, amènera pourtant Hob à dépasser ses nombreux remords autant que ses tout aussi nombreux doutes ; à l’horizon : un futur riche de possibles, de tendresse et d’amour – et la Mort qui se tient à l’écart, parce que, décidément, Hob n’a aucune intention de mourir. Un épisode touchant et juste.
On atteint cependant un niveau de qualité encore supérieur avec l’épisode suivant, et c’est peu dire : cet « Exilés » illustré par John J. Muth est de toute beauté. Graphiquement, le dessinateur a là encore complètement retourné la tendance par rapport à ce qui précédait immédiatement : là où Michael Zulli ravissait en passant outre l’encrage, John J. Muth, lui, décide de se baser tout spécialement sur l’encre… de Chine. Car il s’agit d’un conte chinois, reprenant le thème des « zones floues » déjà envisagé auparavant, avec Marco Polo (volume 3) ; aussi l’illustrateur a-t-il joué sur l’utilisation de l’encre pour livrer une œuvre de toute beauté, fort éloignée des canons des comics, mais usant au mieux de l’imagerie chinoise classique ainsi que du noir et blanc, et c’est de toute beauté – peut-être le plus beau de tous les épisodes de Sandman ? Le scénario n’est cependant pas en reste, qui brille dans sa dimension de conte chinois – jouant d’une plume délicate et poétique, agréablement connotée –, mais aussi en tant qu’épilogue à la série : en effet, les « zones floues » étant ce qu’elles sont, il n’est pas impossible d’y croiser tant Morphée que son successeur Daniel… Et il y a nombre d’autres choses appréciables dans ce très bel épisode – ainsi, par exemple, le sort ultime des cavaliers perdus dans le désert : quel meilleur moyen de célébrer le changement et la fin ? Superbe, parfaitement superbe.
Et on en arrive (à regret ?) au dernier épisode de Sandman, le soixante-quinzième, après huit années de parution mensuelle… Un épisode en forme d’ultime flashback, où Morphée est une dernière fois le Rêve, et qui permet de jeter un regard global en arrière, sur ce que la série a accompli, sur ce qu’autorise le rêve, sur l’art enfin de raconter des histoires, ce qui lui confère quelque chose de « post-moderne », et appuie peut-être encore davantage sur sa relative « mégalomanie »… On aurait pu dire « prétention », j’imagine, mais non – parce que Neil Gaiman sait très bien ce qu’il fait, et a le talent pour le faire. Voici donc « La Tempête ». Où nous retrouvons bien sûr un autre personnage récurrent de la série, un certain William Shakespeare… Nous l’avions croisé dans le premier tome, avide de talent littéraire et de la gloire qui va avec, et désespérant de sa médiocrité – mais le Rêve était là, qui a proposé au Barde en devenir un pacte faustien (la présence de Marlowe dans la scène accentuant cette dimension) : il aura le talent qu’il désire tant, il racontera les plus fortes des histoires, avec les mots les plus justes, et on se souviendra éternellement de lui, comme étant le meilleur d’entre tous… En échange, l’écrivain lui offrira deux pièces. Nous avons vu ce qu’il en était de la première, vers le début de sa carrière, dans l’épisode « Le Songe d’une nuit d’été » (volume 2), où la troupe de Shakespeare se produisait en plein air devant un public de choix, tandis que l’art du dramaturge l’éloignait cruellement de son fils Hamnet (ce qui, au vu des événements ultérieurs, entre bien sûr en résonance, mais à la relecture seulement, avec le rapport entre Morphée et Orphée…) ; un épisode célébrissime, lauréat du World Fantasy Award de la meilleure nouvelle (une première pour un épisode de BD, et même, sauf erreur, un cas unique), mais dont j’avouais dans ma recension que je n’étais cependant pas en mesure de l’apprécier au mieux, pour cause d’inculture crasse concernant tout ce qui touche à Shakespeare ou presque… Un aspect qui, bien sûr, m’affecte aussi pour cet ultime épisode, où le Barde de Stratford accomplit sa promesse, en livrant la seconde pièce au Rêve – cette Tempête qui sera aussi la dernière de ses œuvres (écrites seul, du moins). Le dessin est ici plus varié que ce qui précède (et probablement moins convaincant à mes yeux, bon…) : Charles Vess est le principal illustrateur, mais il est assisté de Bryan Talbot et Michael Zulli. Le style est globalement réaliste, non sans réussite, mais brille surtout à l’occasion de peintures illustrant la pièce de Shakespeare en cours de rédaction. Le contenu de la pièce a bien sûr quelque chose de la métaphore filée, disons, éclairant la biographie de Shakespeare autant que la trame de Sandman ; peut-être a-t-elle aussi quelque chose à voir avec la biographie de Gaiman, j’imagine… Quoi qu’il en soit, cette évocation d’un Maître Will approchant de sa fin, auteur apprécié et vaguement bedonnant, retiré cependant dans sa province de Stratford, et entretenant une relation étrangement tendre avec son épouse plus âgée et un brin acariâtre (mariage forcé) et sa fille passablement naïve, ne manque pas de toucher. Au-delà de sa vie, cependant, il y a son art – ce talent unique, discuté avec le sage et sot Ben Jonson (type-idéal du critique littéraire inepte – du coup j’imagine que c’est un peu mon modèle), et dont les ramifications insoupçonnées sont plus subtiles qu’on ne le croirait au premier abord. Mais Shakespeare avance, quand bien même lentement, sur cette ultime pièce, la confiant enfin au Rêve – lequel le rassure une dernière fois : non, il n’est pas Méphistophélès, et Shakespeare n’est pas davantage Faust. Mais, de toute façon, Shakespeare en Prospero a gagné sa rédemption, si tant est qu’elle était nécessaire, en brisant son bâton de magicien, en abandonnant sa sorcellerie – en s’arrêtant, en somme, ce qui est changer. Le Rêve, lui, confie à son protégé qu’il ne change pas… Prémonition de son sort ultime, par un Morphée plus strict encore que celui qui s’est échappé de sa cage de verre à la fin du XXe siècle ? Demeure la joie de la création, la communication des sentiments et du sens et de la vérité via un art dépassant l’artiste ; et, sans doute, à la fin, le sentiment réconfortant du devoir accompli : Shakespeare met le point final à son œuvre, et Gaiman à la sienne. Arrogance ? Peut-être… Mais la subtilité et la finesse de l’ensemble laissent entrevoir de tout autres raisons, plus sympathiques, à cette conclusion d’une série de bande dessinée qui a bouleversé le monde, et demeure aujourd’hui encore un modèle peu ou prou indépassable – et sans doute Gaiman en a-t-il conscience. Ce tremplin pour sa carrière, à partir du moment où il a choisi de « finir », lui a bel bien permis de « changer » : à venir, ses romans et recueils de nouvelles, des scénarios de films ou d’autres bandes dessinées, une œuvre multiforme qui, si elle n’a à mon sens jamais tout à fait retrouvé le brio de Sandman, n’en a pas moins confirmé l’auteur comme un géant de l’imaginaire contemporain.
Point final.
Pourtant, il reste des choses, et pas des moindres… Du matériel directement en relation avec la série de base, qui est repris dans ce gros dernier volume de l’intégrale de Sandman, mais aussi d’autres choses, un peu plus éloignées, comme les mini-séries consacrées à la Mort (j’espère qu’Urban Comics en fera quelque chose…), ou encore la série The Dreaming (que je ne connais pas du tout) ; sans même parler de The Sandman : Overture, « préquelle » toute récente qui est semble-t-il au programme de traduction.
Mais restons-en à ce qui figure dans ce volume. Tout d’abord, nous avons « La Dernière Histoire de Sandman », un très bref épisode hors-série qui, en fait d’ « histoire de Sandman », est bien davantage un mélange de souvenirs et de réflexions de Neil Gaiman sur sa célèbre création, passant par l’évocation de coïncidences troublantes, mettant en scène des rencontres entre l’auteur et ses personnages (comme la Mort, bien sûr, mais aussi quelqu’un de bien autrement secondaire, comme le démon Choronzon). L’intérêt, cependant – au-delà de cette ambiance certes pas désagréable – réside surtout dans le graphisme : c’est Dave McKean lui-même qui s’en charge, avec sa maestria coutumière. Collaborateur privilégié de Gaiman tout au long de leurs carrières respectives, il a réalisé maints chefs-d’œuvre avec son style si particulier (ce qui vaut aussi, bien sûr, pour ses travaux avec d’autres, comme par exemple l’indispensable Batman : Arkham Asylum avec Grant Morrison, ou en solo, comme l’étonnant Cages), mais son rôle dans Sandman consistait surtout en l’élaboration des couvertures (pour le moins marquantes et inédites alors…), puis en l’assemblage et l’habillage des TPB de la série ; ici, il narre une histoire, et son style s’avère tout aussi approprié, pour un résultat fantastique.
Comme vous avez déjà pu le noter au fil de ce (long, très long…) compte rendu, ce volume 7 de Sandman brille tout particulièrement sur le plan graphique – et cela ne cessera de se vérifier jusqu’à la fin. D’ores et déjà, cependant, après Michael Zulli, John J. Muth et Dave McKean, il faut accorder une place toute particulière à Yoshitaka Amano, qui illustre le récit de Neil Gaiman Les Chasseurs de Rêves avec un brio incroyable – à vrai dire, en passant de la bande dessinée à l’illustration, on change complètement de domaine, et l’appréciation est à son tour d’un autre ordre… Je ne vais pas revenir ici sur l’histoire narrée par Neil Gaiman, l’ayant déjà présentée à l’occasion du cinquième volume de cette intégrale, où figurait l’adaptation en bande dessinée, par P. Craig Russell, du présent récit. Je l’avais beaucoup appréciée, et aussi en matière de graphisme : P. Craig Russell est à n’en pas douter un des plus talentueux dessinateurs à s’être succédé sur Sandman. Mais là… C’est autre chose. P. Craig Russell a fait quelque chose de beau et bien vu, aucun doute à cet égard – mais Yoshitaka Amano joue dans une tout autre catégorie, et son travail sur le conte nippon fantasmé de Gaiman est pour ainsi dire extraordinaire… Au passage, on n’oubliera pas de s’attarder sur la postface du récit par Neil Gaiman lui-même, un très joli canular. J’y note aussi la déclaration d’intention de Yoshitaka Amano, annonçant de futures collaborations avec Gaiman… mais c’était il y a un bail.
Reste un gros morceau (avant les annexes bien dodues), un recueil d’un genre très particulier, bien postérieur à la fin de la série : il s’agit de Nuit d’Infinis, un ensemble de sept histoires, chacune étant consacrée à un membre différent de la famille des Infinis, et chacune étant en outre illustrée par un auteur différent dans un style bien à lui – d’où une grande variété d’approches, des plus classiques au plus expérimentales, pour un résultat souvent épatant.
Cependant, je suis convaincu que c’est un recueil à lire après la fin de la série – précision qui me paraît utile en raison des bizarreries de la publication avortée de Sandman en français chez Delcourt, qui affirmait sur chaque quatrième de couverture que les recueils de Sandman étaient indépendants et pouvaient être lus dans le désordre (alors que non, non, franchement pas…) ; et, s’appuyant sur cette allégation douteuse, la maison d’édition avait publié les divers TPB dans le désordre : Delcourt avait commencé par La Saison des Brumes (en arguant qu’il fallait débuter par là parce que ce n’est qu’ici qu’apparaît la famille des Infinis, quelle bêtise…), puis était passé à ces Nuits d’Infinis (Nuits éternelles, alors) peu ou prou incompréhensibles dans cet ordre, avant de revenir au tout début de la série, en publiant enfin Préludes & Nocturnes, puis les deux TPB suivants faisant la jonction avec La Saison des Brumes… et s’arrêtant là. Si l’on y ajoute des couleurs passées et une traduction parfois déficiente (avec entre autres le gag sur Mike Hammer qui me hantera toute ma vie), on comprend assurément que cette édition avait tout pour énerver – au point sans doute de se retourner contre elle-même, en fâchant les lecteurs français avec Sandman (en fin de compte, cette édition intégrale par Urban Comics est donc une première… quelque chose comme un quart de siècle après la publication de la série et son succès international !). Mais revenons-en à Nuits d’Infinis : pourquoi cette publication précoce, avant la série à proprement parler, et au mépris du bon sens ? Peut-être en raison du prestige de certains des participants – je dirais en priorité Milo Manara, et peut-être Bill Sienkiewicz… Je ne sais pas. Demeure cette certitude : si les événements narrés dans Nuits d’Infinis se répartissent sur bien des époques et dans le désordre, ils ne font cependant sens que si l’on a découvert les Infinis au fil de la série, avec toutes les nuances s’y rapportant et assurant leur complexité. Et c’est sans doute bien pour cela que je n’avais finalement guère apprécié ce recueil lors de ma première lecture… Mais les choses ont changé, heureusement.
On commence avec la Mort – dessin de P. Craig Russell, réussi donc… et pourtant un brin faiblard tant il y a des merveilles par la suite ; enfin, « faiblard » n’est pas le terme – disons « classique », c’est surtout ça, en fait. Cet épisode suit les pas d’un militaire américain en permission, arpentant Venise où il avait vécu quelque temps étant enfant, et désireux d’y retrouver cette jolie jeune fille d’allure gothique, qui patientait le sourire aux lèvres à côté d’une porte infranchissable… L’histoire est bien conçue, qui met en valeur la Mort en tant que personnage et en tant que fonction, dans un cadre complexe où les époques s’entremêlent – d’autant que se cache derrière la porte un jour éternellement parfait, car libéré de la réalité de la Mort, où la débauche de libertins du XVIIIe siècle célèbre à sa manière une vie perdant pourtant de son sens à être débarrassée de son terme. Mais cela va au-delà : le narrateur est un « prêtre de la mort », en bon soldat… et le scénario a été écrit peu après les attentats du Onze-Septembre. Un récit intéressant, parfois dérangeant, mais on trouvera bien mieux ensuite, globalement (et le graphisme me paraît décidément trop sage au regard de ce qui suit).
L’Infini suivant est le Désir – et qui d’autre que Milo Manara pour illustrer le Désir ? Dessinateur inévitablement associé à l’érotisme en bande dessinée, il est probablement le plus célèbre de tous ceux qui se succèdent sur Nuits d’Infinis. Mais je ne suis pas certain que ce soit à bon droit… En fait, j’ai un vague préjugé à l’encontre de Manara – parce que j’ai tendance à trouver son érotisme vulgaire et trop brutal pour vraiment me parler. Cela se ressent ici : ces femmes qui prennent systématiquement la pose la plus excitante, de manière très matérielle, leurs formes d’une perfection plastique inhumaine, leurs lèvres toujours horriblement pulpeuses… Manara a du talent, je ne le nie pas – et certaines de ses cases, ici, sont vraiment de toute beauté, et vraiment érotiques ; son dessin très reconnaissable, par ailleurs, bénéficie de son don pour la couleur – là encore, on est de suite dans une tout autre catégorie par rapport aux canons des comics en général, mais aussi de Sandman en particulier. Disons que je trouve ça un brin inégal, tout de même… Par ailleurs, le récit, s’il n’est pas dénué d’intérêt – amour et vengeance dans un cadre assez archaïque, j’y ai trouvé quelque chose de gaulois(erie) mais sans certitude, peut-être faut-il plutôt chercher du côté des tribus germaniques voire des vikings (mais là j’en doute un peu) – est globalement un peu convenu ; ça reste au-dessus du lot – c’est du Gaiman, et c’est du Sandman – mais quand même…
Le Rêve est lui-même de la partie – après tout, il fait bien partie des Infinis, on n’allait pas s’en débarrasser comme ça… C’est Miguelanxo Prado qui illustre son histoire, avec un style tout à fait séduisant, et des couleurs qui lui sont propres, pour un résultat d’une grande élégance et qui relève à certains égards plus de la peinture que du dessin. L’histoire n’est pas en reste, qui parvient, chose improbable, autant à fasciner par son ampleur cosmique qu’à émouvoir par son contenu intime… Cela se passe il y a bien, bien longtemps – bien avant tout épisode de Sandman, hormis le passage kawaï inoubliable du « Parlement des freux » (volume 4), où Abel évoquait brièvement l’apparition de la Mort et du Rêve. L’univers est pourtant sans doute déjà vieux… Mais nous y voyons le Rêve se rendre à un « parlement d’étoiles », parmi lesquelles notre Soleil n’est qu’un gamin maladroit, rêvant de porter un jour la vie sur une de ses planètes… Le Rêve ne vient toutefois pas seul à cette assemblée hors-normes (où les autres Infinis aussi sont présents – dont le Plaisir qui n’est pas encore le Délire, ou la Mort qui, à l’époque, ne sourit pas encore) : il a (déjà) une compagne… qui, bien évidemment, le trompera avec son propre soleil. Le Désir n’y est pas pour rien, comme de juste – le Rêve, au début, remercie chaleureusement son frère/sœur pour le merveilleux don de l'amour qu'il lui a accordé, mais le lecteur sait déjà comment tout cela va se finir… cette fin étant tout autant celle de l’épisode que celle de la série. Le Rêve s’en rend bien compte, et c’est le début de sa dangereuse discorde avec le Désir – si cruciale dans Sandman. Pour autant, le plus navrant est sans doute que le Rêve, malgré cet épisode mythologique primordial, n’en tire pas la moindre leçon : il recommencera, encore et encore… Il n’a rien appris, et ne change pas – sans doute s’en est-il déjà convaincu, posture navrante qui simplifie absurdement le monde… Un récit important et merveilleux – à l’évidence un de ceux qui ne peuvent être compris si on lit Nuits d’Infinis prématurément, et peu importe qu’il soit chronologiquement antérieur à tout le reste…
Suivent les deux épisodes les plus étranges de ce recueil, et à tous points de vue… À vrai dire, l’épisode consacré au Désespoir n’a rien d’un épisode – et même rien d’une bande dessinée – et ce n’est pas non plus un récit, mais une succession de quinze « portraits ». Autant d’approches du Désespoir (le plus jeune membre de la famille des Infinis à certains égards, puisque le Désespoir originel avait péri et été remplacé), qui glacent le sang dans leur prose poétique suintant la douleur et la tristesse, et sont sublimées par un graphisme étrange et fou, indiscernable à vrai dire, conçu à la base par Barron Storey et « monté » par Dave McKean (cela évoque d’ailleurs pour une bonne part son propre style). Le résultat est parfaitement déconcertant, difficile, pourtant étrangement séduisant et d’un à-propos constant. Mais ce n’est donc pas de la bande dessinée – ça relève plutôt de l’art contemporain, académique et pourtant iconoclaste.
Après quoi nous passons au Délire, et pouvons reprendre une sentence antérieure : qui d’autre que Bill Sienkiewicz pour illustrer le Délire ? J’admire vraiment le travail de cet illustrateur hors-normes (notamment pour son bluffant Elektra Assassin avec Frank Miller, ou, en solo, son parfaitement dingue Stray Toasters), et c’est à n’en pas douter l’homme de la situation : son graphisme subtil et complexe, mêlant bien des techniques différentes (et usant notamment avec brio des collages) est d’une pertinence indéniable pour mettre en scène le « sauvetage » du Délire enfermé dans sa psychose par des fous égarés dans son domaine, et dont les obsessions et hallucinations contaminent les planches… C’est très bien vu, à tous les niveaux, tout en étant plus accessible que le chapitre précédent : cette fois, il s’agit bien de bande dessinée – une bande dessinée folle et ne ressemblant peu ou prou à rien d’autre, une bande dessinée néanmoins. Le subtil équilibre entretenu par cet épisode déconcertant entre mille et une tendances du récit et mille et une tendances du graphisme en fait probablement celui qui me parle le plus dans l’ensemble du recueil.
Les deux derniers chapitres sont bien plus sages… Glenn Fabry met en scène la Destruction ; il emploie cependant ici un graphisme assez « banal », certes pas mauvais, mais qui fait un peu terne après les délires expérimentaux de Storey et Sienkiewicz… Pas grand-chose à voir non plus, d’ailleurs, avec ses célèbres couvertures pour Preacher. De tous les épisodes de ce recueil, c’est à vrai dire probablement celui qui me séduit le moins. L’histoire de base – très science-fictive – sonne étrangement, et la Destruction retraitée (avec le Délire à ses côtés, en vacances/convalescence) manque finalement un brin de charisme, et, surtout, son essence est un peu trop laissée en retrait (cela peut s’expliquer par son abandon de poste, certes, mais il manque de raison d’être – là où son rôle dans la trame générale de Sandman était justement d’interroger la raison d’être au-delà de la fonction). Ce n’est pas mauvais, mais plutôt médiocre – pour moi, hein.
Reste un très court chapitre consacré au Destin – qui, d’une certaine manière, ne peut pas vraiment avoir d’histoire lui-même… Dès lors, contrairement à ce qui précède immédiatement, la fonction domine ici sur l’être. Sur le plan du scénario, on n’en retirera pas grand-chose, mais j’aime beaucoup le dessin de Frank Quitely – que j’ai apprécié dans des comics tels que The Authority, Ultimates ou All-Star Superman, mais qui livre ici quelque chose d’encore différent, plus personnel sans doute, même si pas « expérimental » pour autant : c’est un bel exercice d’équilibre et d’expression personnelle, plus que satisfaisant.
Bilan sans appel : ce septième et ultime volume est à la hauteur de tout ce qui précède – voire meilleur encore sur le plan graphique, irréprochable et plus que cela. Le travail admirable d’Urban Comics permet enfin de disposer d’une véritable intégrale, soignée, à la mesure de la qualité hors-normes de ce monument de la bande dessinée – il était bien temps… Autant finir, dès lors, par où nous avons commencé : Sandman est un objet à part, d’une perfection rare, et très probablement ce que Neil Gaiman a fait de mieux – lui dont on ne peut pourtant pas dire qu’il aurait ultérieurement enchaîné les drouilles…
Lisez Sandman, relisez Sandman.
Et faites de beaux rêves.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





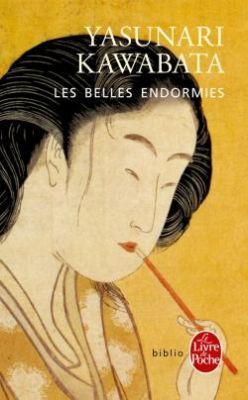



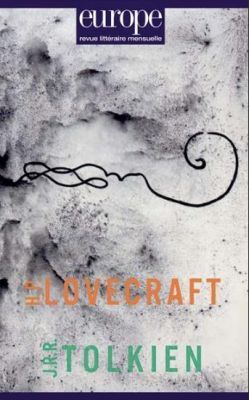
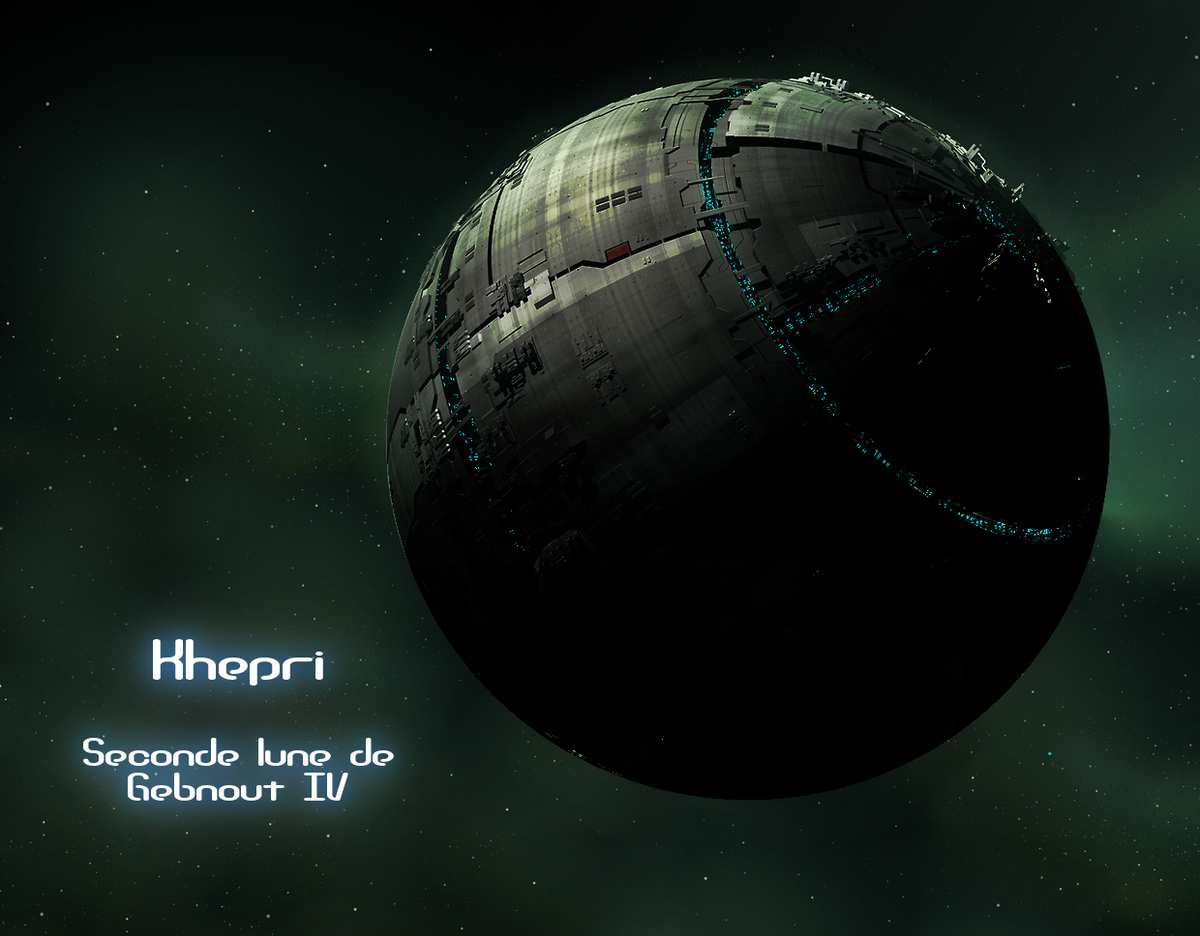

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)